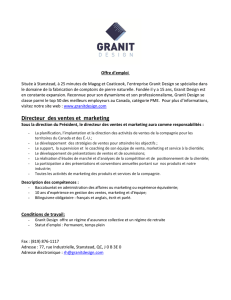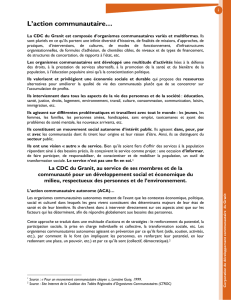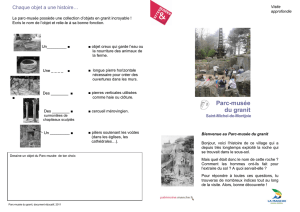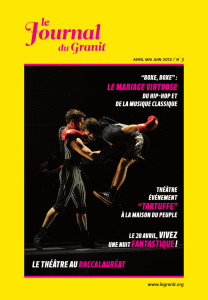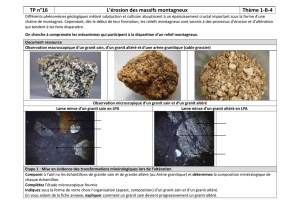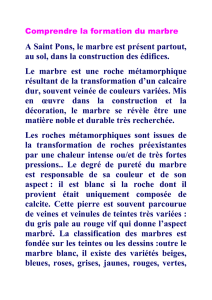à voir en famille la rentrée théâtrale féerique - Le Granit

www.legranit.org
n°2
OPÉRA
À VOIR
EN FAMILLE
Journal JANVIER FÉVRIER MARS 2012
LA RENTRÉE
THÉÂTRALE
DE JANVIER :
NASSER DJEMAÏ &
JOËL POMMERAT
IL ÉTAIT UNE FOIS...
LE THÉÂTRE DE BELFORT
LA CRÉATION
FÉERIQUE
DU “SONGE
D’UNE NUIT D’ÉTÉ”
À LA RENCONTRE DES
BELFORTAINS
AVEC LE BALAGAN SYSTÈME

LA RENTRÉE THÉÂTRALE
DE JANVIER :
NASSER DJEMAÏ & JOËL POMMERAT
PAGE 4 ET 7
À VOIR EN FAMILLE :
LA PETITE RENARDE RUSÉE
PAGE 8
UN “CONCERT DE THÉÂTRE”
8760 HEURES
PAGE 10
CRÉATION
LE SONGE D'UNE NUIT D'ÉTÉ
& SOIRÉE FESTIVE
PAGE 12
Le Granit est subventionné par
la Ville de Belfort, la DRAC
Franche-Comté, le Conseil général
du Territoire de Belfort,
la Communauté de
l’Agglomération Belfortaine
et le Conseil régional de
Franche-Comté.
Directeur de la publication :
ierry Vautherot
Responsable de la publication :
Elise Ruysschaert
Rédaction :
Jérôme Araujo, Elise Ruysschaert
Graphisme : Stéphanie Renaud
Tirage 4000 exemplaires
Imprimé par Est Imprim,
Montbéliard
N° licences 1-1045584,
2-1045585, 3-1045586
n°2
JOURNAL
JANVIER FÉVRIER MARS 2012
Avec ce second trimestriel nous poursuivons notre objectif de
tisser un lien plus étroit entre chacun(e) d’entre vous, les artistes
qui jouent leurs spectacles sur nos plateaux, ceux qui les répètent
dans l’optique d’une création à venir, et nous-mêmes.
La légère et légitime inquiétude de la rentrée est passée.
Nous avions besoin de retrouver une audience plus large que
celle des dernières saisons. Un besoin essentiel pour que le
Granit puisse continuer à assumer en même temps ses missions
de création et de diffusion. Nous franchissons le cap des 2000
abonnés au 30 novembre et la fréquentation de la saison devrait
être multipliée par deux par rapport à la saison passée.
Merci à toutes et à tous pour votre confiance.
Et puisque vous avez eu l’occasion d’assister peut-être à
plusieurs spectacles de cette saison 2011/2012, nous aimerions
vous convier en janvier à une rencontre pour évoquer tout
simplement des spectacles que vous avez vus, comment vous les
avez “reçus”. De notre place, l’équipe du Granit et moi-même,
nous voyons bien que certains spectacles programmés en
octobre/novembre ont reçu un très bel accueil, d’autres ont
provoqué des réactions contrastées : pour ceux-là est-ce
l’esthétique propre au spectacle, la façon dont nous les avons
présentés qui sont en cause, vos attentes de spectateurs ?
Nous aimerions en parler avec vous.
Dans l’attente, nous vous souhaitons les meilleures fêtes
de fin d’année et une année 2012 à la hauteur des espoirs
qui nous animent.
ierry Vautherot, directeur du Granit
© Dorian Rollin
Photo de couverture :
Murmures des murs
© Richard Haughton
Spectacle présenté
les 27 et 28 janvier au Granit
Nous vous convions à une rencontre le lundi 23 janvier
à 18h30 au Granit autour d’une galette des rois, pour
échanger sur les spectacles de la saison. A très bientôt !
LES GRANDS NOMS
DU JAZZ AU GRANIT
PAGE 14
CONCERTS & DANSE
SANDWICHS
PAGE 15
LA GALERIE DU GRANIT
AKI LUMI &
DOMINIQUE DE BEIR
PAGE 16
LE GRANIT ET BALAGAN
SYSTÈME À LA RENCONTRE
DES BELFORTAINS
PAGE 18
IL ÉTAIT UNE FOIS...
L’HISTOIRE DU THÉÂTRE
PAGE 20
LES ÉQUIPES
À LA COOPÉRATIVE
PAGE 22
Retrouvez l’ensemble de la
programmation, des photos,
vidéos, extraits musicaux
et autres compléments
d’information sur notre site
Internet : www.legranit.org
Vous pouvez également
recevoir nos lettres
d’information web en vous
inscrivant sur le site et
réserver ou acheter vos billets
directement en ligne.
Accédez au site internet du Granit
grâce à votre téléphone mobile,
en flashant le code ci-dessus.

LA RENTRÉE THÉÂTRALE DE JANVIER
Invisibles
TEXTE ET MISE EN SCÈNE
NASSER DJEMAÏ
JEUDI 5 JANVIER À 19H30
VENDREDI 6 À 20H30
AU GRANIT
CAT. B / TARIFS DE 7 À 18 €
Rencontres avec l’équipe du spectacle
à l’issue des représentations.
Le comédien et metteur en scène Nasser Djemaï est au Granit
pour présenter deux spectacles appartenant à une trilogie.
Nous accueillons d’abord la nouvelle création, “Invisibles”
qui clôt la série de trois spectacles. “Une Étoile pour Noël”,
le premier volet, sera présenté en avril 2012, en collaboration
avec le CIE Les 3 Chênes.
Récits personnels et contes universels, les spectacles de Nasser
Djemaï, s’ancrent dans le réel pour se l’approprier et le dépasser.
Invisibles, c’est l’histoire bouleversante
d’une rencontre. Martin, la trentaine,
hérite d’un petit coffret avec un nom
et une adresse qui vont être le point
de départ d’une quête d’identité. Les
invisibles : qui sont-ils ? Des travailleurs
immigrés, écartelés entre les deux rives
de la Méditerranée, qui ont vieilli ici, en
France. Ils y ont apporté leurs rêves,
mais ils sont devenus des fantômes.
Nasser Djemaï
“Le texte de Nasser Djemaï, publié chez
Actes Sud-Papiers, est tenu, équilibré,
écrit avec élégance. La mise en scène est
sobre, efficace. Les comédiens Angelo
Aybar, Azzedine Bouayad, Kader Kada,
Mostefa Stiti et Lounès Tazaïrt imposent
leur présence humaine et forte. Sans
en rajouter, ils créent l’émotion. On suit
avec une intensité peu commune et une
conscience douloureuse cette “Tragédie
des Chibanis”. Quand le théâtre dit le
monde mieux qu’un documentaire, c’est
qu’il rime avec art. Bravo, Nasser Djemaï.”
Philippe Chevilley, Les Echos, novembre 2011
“Le spectacle Invisibles allie avec
bonheur la justesse sociologique et
un lyrisme pudique. Récit initiatique
mené sur un mode poétique indéniable,
sous lequel se faufile en sourdine une
réflexion d’ordre politique irréfutable, la
réalisation d’Invisibles témoigne à l’envi
de l’essence du talent de Nasser Djemaï.”
Jean-Pierre Léonardini, L’Humanité
Rencontre avec Nasser Djemaï
“Une Étoile pour Noël”, “Les Vipères se
parfument au jasmin” et maintenant
“Invisibles” forment un triptyque qui
traite de questions sociales. Comment
êtes-vous venu à intégrer ces discours
sur la société à une pratique de théâtre ?
Cela remonte à mon parcours, à travers
des codes sociaux. C’est un peu ce que
j’ai vécu à travers ma famille et l’école.
J’ai senti le fossé entre ces deux mondes.
J’ai aussi eu un parcours dans un milieu
bourgeois et catholique, à l’Aumônerie,
à Grenoble. Des amis m’avaient proposé
de les rejoindre, simplement parce qu’ils
avaient des activités le week-end et que
moi, je ne faisais rien. Cela me permettait
de m’évader un peu. C’est cette sorte de
schizophrénie sociale dans laquelle j’ai
grandi, que l’on retrouve dans mes créa-
tions théâtrales.
Vous avez suivi une formation de comé-
dien. Comment et pourquoi êtes-vous
passé à l’écriture et à la mise en scène ?
J’ai eu la chance de faire deux bonnes
écoles, celle de la comédie de Saint-
Etienne et une école de théâtre à Birmin-
gham en Angleterre. Ces deux formations
m’ont permis à la fois de me former au
jeu de comédien, mais également à la
mise en scène et à la dramaturgie. J’ai
appris à étudier les scènes du répertoire,
à comprendre pourquoi ces scènes fonc-
tionnent, comment elles sont écrites,
quelles sont les forces qui entrent en
interaction, qu’est-ce qui fait que le récit
avance, l’intérêt de la pièce… C’est une
alchimie. Cela forme un tout.
Quand vous terminez l’écriture d’une
pièce, avez-vous besoin de l’expérimen-
ter sur la scène ?
Truffaut disait : “On corrige un scénario
au tournage et on corrige le tournage au
montage”. Il y a des choses que l’on écrit
et l’on se dit, enthousiaste, que cela va
fonctionner sur le plateau. En fait, cela
ne donne absolument rien. Inversement,
sur la scène, un acteur fait une proposi-
tion, un déplacement par exemple, qui va
être signifiant. Il y a une autre écriture qui
est celle de la scène, où l’on va essayer
de trouver la justesse. Ces réajustements
sont indispensables, car rien ne se passe
comme prévu.
Sur “Invisibles”, le processus d’écriture
a été particulier. Pourriez-vous nous
rappeler votre cheminement ?
C’est en effet un processus particulier.
J’ai mené des enquêtes assez longues
et fastidieuses à travers des cafés de
chibanis, dans des mosquées, dans les
quartiers. J’ai recueilli également les
histoires de mon père entendues dans
mon enfance. Je me suis également beau-
coup documenté. Beaucoup d’études, de
thèses universitaires ont été réalisées
sur ces hommes. Grâce à cette matière,
j’ai pu en tirer une histoire. De manière
intuitive, j’ai réalisé que les choses se
recoupaient. C’est dans ce regroupement
d’informations que le mot “Invisibles”
m’est apparu.
En écrivant la pièce, la première question
qui s’est posée pour moi était celle de la
langue. Dans quelle langue ces hommes
vont se parler ? Si j’avais voulu m’appro-
cher de la réalité, ils se seraient parlé en
arabe. Dans ce cas, comment pouvais-
je justifier la langue française ? J’ai donc
eu l’idée d’utiliser un personnage qui
s’appelle Martin, qui n’est pas d’origine
arabe ou musulmane, et qui va entrer
dans ce monde par accident. Le specta-
teur est ainsi amené à découvrir la vie de
ces hommes par ce regard neuf et naïf.
Invisibles est l’histoire d’une rencontre
entre un jeune homme qui n’a jamais
connu son père, en face d’hommes qui
n’ont jamais connu leurs enfants. J’ai
souhaité aussi qu’il y ait de l’humour. Les
chibanis sont des hommes avec qui l’on
rit beaucoup.
Qui sont les chibanis précisément?
En arabe dialectale, Chibanis veut dire
“vieux”, “cheveux blancs”. Pour parler
de ces hommes, pour parler de leur
parcours, il faudrait raconter cinquante
ans d’histoire. Pour l’aborder, j’ai pris une
petite fenêtre, qui est celle des hommes
qui n’ont pas fait venir leur famille en
France et qui sont aujourd’hui prison-
niers entre deux mondes, très isolés
pour la plupart, de santé fragile, avec
des retraites misérables… Ces hommes
ont tellement pris l’habitude d’être seuls
qu’ils se mettent à parler à des fantômes.
Ils ont aussi conservé de leurs pays d’ori-
gine, une vision de carte postale.

La grande
et fabuleuse
histoire
du commerce
TEXTE ET MISE EN SCÈNE
JOËL POMMERAT
JEUDI 12 JANVIER À 19H30
VENDREDI 13 À 20H30
AU GRANIT
CAT. B / TARIFS DE 7 À 18 €
Rencontre avec l’équipe du spectacle,
jeudi 12 janvier à l’issue de la
représentation.
Avec “La grande et fabuleuse histoire du commerce”,
accueilli au Granit en janvier, et “Pinocchio”
programmé en mars, Joël Pommerat est à l’honneur
ce trimestre. Arrêtons-nous sur le parcours de
ce talentueux auteur et metteur en scène.
Un des créateurs les plus pertinents de
la scène actuelle, Joël Pommerat, né
en 1963, est un auteur dramatique et
metteur en scène français qui monte ses
propres textes, aux univers fascinants et
mystérieux.
Après avoir été acteur pendant plusieurs
années, il se consacre exclusivement à
l'écriture théâtrale depuis 1986. Cher-
chant à relier le processus de son écriture
à la scène, il fonde la Compagnie Louis
Brouillard en 1990.
Il décide alors de monter une pièce par
an pendant 40 ans et de s'engager à
embaucher à chaque pièce les sept
acteurs avec lesquels il travaille.
À partir de 1997, un réseau de soutien et
de fidélité se constitue alors autour de la
compagnie. Depuis 2003, ses textes sont
édités chez Actes Sud-Papiers.
En juillet 2006, Joël Pommerat et la
compagnie Louis Brouillard sont invités
au 60ème festival d'Avignon, avec Le Petit
Chaperon rouge (programmé au Granit
en décembre 2006), Au monde et Les
Marchands (programmé au Granit en avril
2006).
En 2007, il est lauréat du 3ème Grand Prix
de littérature dramatique avec son texte
Les Marchands (Actes Sud-Papiers).
Actuellement, Joël Pommerat est artiste
associé à l'Odéon-éâtre de l'Europe
jusqu'en juin 2013 et au éâtre Natio-
nal de Belgique. Sa compagnie a obtenu
le Molière 2011 de la compagnie pour le
spectacle Ma chambre froide.
Dans le paysage théâtral français, Joël
Pommerat, 47 ans, a ceci de précieux
qu’il cultive sa singularité au prix
d’une obstinée fidélité. Celle d’une folle
promesse qu’il a faite, un jour de l’an
2000, à sa troupe, Louis Brouillard
(Molière de la meilleure compagnie) :
monter chaque année une nouvelle
création, jusqu’à ce que mort s’en suive.
Avec la même règle du jeu depuis presque
vingt ans : écrire, à partir du travail
Concernant les comédiens d’“Invisibles”,
vous aviez envisagé de faire interpréter
les personnages par les chibanis, eux-
mêmes. Pourquoi avez-vous finalement
choisi des comédiens professionnels ?
Je me suis en effet posé cette question
dès le départ, mais c’est simple à formu-
ler, le théâtre est un métier. Être acteur
est un métier. Je souhaitais emmener
Invisibles à un endroit que seuls des
professionnels pouvaient atteindre. La
possibilité de travailler avec des chibanis,
comédiens amateurs, aurait été envisa-
geable si j’avais eu en tête de faire passer
des témoignages. Or, dans le spectacle, il
s’agit de personnages, avec des parcours,
une dramaturgie, des contraintes tech-
niques, des répétitions intenses de neuf
heures par jour sur plusieurs mois.
Dans “Une Étoile pour Noël”, qu’est-ce
qui vous a attiré le plus : raconter votre
histoire personnelle ou la fable univer-
selle ?
Être dans une démarche universelle est
mon ambition. À partir d’un parcours
très personnel, j’essaie d’ouvrir pour que
tout le monde puisse s’y reconnaître.
Une Étoile pour Noël raconte surtout la
schizophrénie sociale d’un jeune homme
prénommé “Nabil” à qui l’on va donner
le prénom de “Noël”. Grâce à ce change-
ment de prénom, les portes vont s’ouvrir
plus facilement, mais de manière illusoire.
Cela raconte aussi le complexe d’infério-
rité. Nabil est aussi un personnage sur
lequel les autres projettent des envies,
des projets, sans se soucier de sa propre
quête. Il se rend compte que pour faire
plaisir, pour être accepté du regard des
autres, il va dire “oui” à tout. Il dit “oui”
à son père qui lui demande de ne pas lui
ressembler, il dit “oui” à cette grand-
mère qui va changer son prénom… C’est
l’histoire de l’ascension sociale d’un petit
garçon, parti de rien, qui se retrouve en
Terminale avec mention “Très Bien”, qui
change de langage et de comportement.
Évidemment, plus dure sera la chute.
Vous interprétez tous les personnages
d’“Une Étoile pour Noël” mais vous aviez
besoin d’être mis en scène...
Ce projet ne pouvait être monté seul.
La metteuse en scène Natacha Diet, qui
participe aussi à Invisibles, a été très
présente sur l’écriture et à la direction
d’acteur. Sans elle, cela aurait été trop
dangereux. J’aurai pu tomber dans la
complaisance ou l’écueil d’une caricature
de One Man Show. Ce regard extérieur a
permis que l’histoire ne s’éparpille pas.
Une Étoile pour Noël a une réelle drama-
turgie et laisse la place à la poésie.
Propos recueillis par Jérôme Araujo
–Photographies du spectacle Invisibles
© Philippe Delacroix–
Pinocchio
D’APRÈS CARLO COLLODI
MISE EN SCÈNE JOËL POMMERAT
MERCREDI 28 MARS À 19H30
AU GRANIT
CAT. B / TARIFS DE 7 À 18 €
À partir de 8 ans
© Elisabeth Carecchio
Pinocchio
La grande et fabuleuse histoire du commerce
Une étoile
pour Noël
ÉCRITURE ET INTERPRÉTATION
NASSER DJEMAÏ
MISE EN SCÈNE NATACHA DIET
MERCREDI 11 AVRIL À 20H30
AU GRANIT
TARIF UNIQUE : 5€
RÉSERVATIONS
CIE LES 3 CHENES UNIQUEMENT
2, avenue des Sciences et de l’Industrie,
BAT. 86A / 90000 Belfort
03 84 55 18 12 ou 03 84 55 21 72
www.cie3chenes.org
d’improvisation de ses acteurs, un
théâtre cinématographique, habité de
réalité sociale. Comme une succession
de plans séquences, alternance de
noirs absolus et de lumière irréelle, d’où
surgissent le rêve, la beauté et l’étrange.
Grégoire Biseau, Libération, mars 2011

À VOIR EN FAMILLE
La Petite
Renarde Rusée
OPÉRA LEOŠ JANÁČEK
MISE EN SCÈNE
CHARLOTTE NESSI
MARDI 31 JANVIER À 20H30
À LA MAISON DU PEUPLE
CAT. A / TARIFS DE 8 À 24 €
À partir de 9 ans
Rencontre avec l’équipe du spectacle à
l’issue de la représentation.
© Xavier Pinon
Pourquoi avez-vous décidé de monter “La Petite Renarde Rusée“ de Janàček ?
Depuis vingt ans, beaucoup de personnes me disent que cette œuvre me
correspond bien. Je n’ai jamais su très bien pourquoi, et j’aime bien ce
mystère. Peut-être ce rapport à la nature, à l’enfance ?
Il y a aussi cette manière qu’a le compositeur d’embrasser la vie avec sa
musique. Cette musique s’infiltre dans tous les espaces. Je dois dire enfin que
je suis particulièrement touchée par la musique du XXème siècle.
En raison du grand nombre de musiciens, vous avez choisi une adaptation ?
Quelle en est la nature ?
L’adaptation a été faite par Alexander Krampe à l’Opéra de Zurich. Cette
adaptation laisse toutes ses lettres de noblesse à l’opéra original. Elle privilé-
gie aussi l’histoire et le rapport entre les animaux et les hommes, les scènes
entre les humains n’ayant pas été gardées.
On retrouve dans ce spectacle votre constant travail entre amateurs et
professionnels ? Qu’est-ce que cela vous apporte ?
Dans La Petite Renarde Rusée, la partition du petit groupe de renardeaux est
très riche, très écrite et faite d’onomatopées, Janàček ayant vraiment essayé
de retranscrire le langage des animaux. Seuls des enfants ayant une forma-
tion peuvent assumer cette partition. Ils ont donc été choisis pour leur expé-
rience. Mais ce que j’aime dans ce rapport professionnels/amateurs, c’est
l’énergie qui s’en dégage. Chaque groupe amène quelque chose à l’autre.
Cette interaction fragilise et donne une force à chaque nouveau projet.
Charlotte Nessi, qui dirige l’ensemble Justiniana,
implanté en Franche-Comté, retrouve Belfort pour une
unique représentation de l’opéra de Janàček.
Un opéra à voir en famille, pour 12 musiciens et 25 chanteurs,
véritable conte philosophique sur le rapport entre les
animaux et les hommes, la nature, l’amour, la liberté,
le cycle de la vie et de la mort, le temps qui passe.
Entretien avec Charlotte Nessi
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
1
/
13
100%