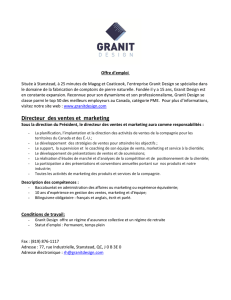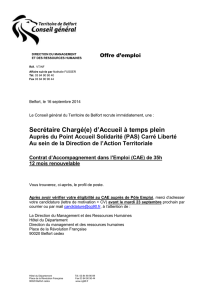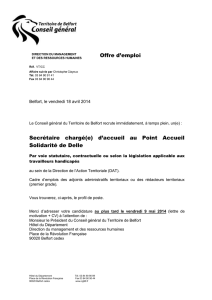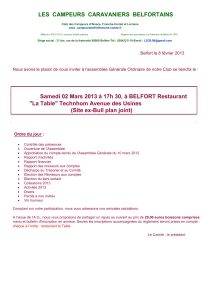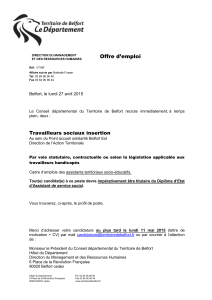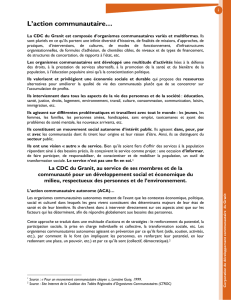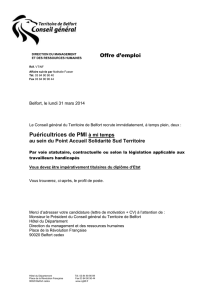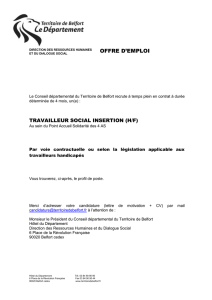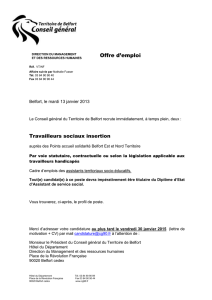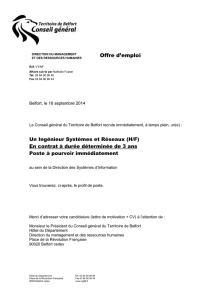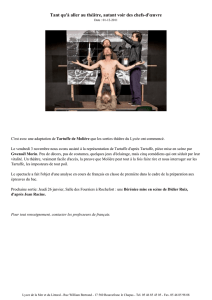Journal - Le Granit

www.legranit.org
THÉÂTRE
ÉVÉNEMENT
“TARTUFFE”
À LA MAISON DU PEUPLE
“BOXE, BOXE” :
LE MARIAGE VIRTUOSE
DU HIPHOP ET
DE LA MUSIQUE CLASSIQUE
LE 20 AVRIL, VIVEZ
UNE NUIT FANTASTIQUE !
Journal
du Granit
le
/ °
LE THÉÂTRE AU BACCALAURÉAT

HIPHOP &
MUSIQUE CLASSIQUE
BOXE, BOXE
PAGE 4
THÉÂTRE
À LA MAISON DU PEUPLE
TARTUFFE
PAGE 6
DANSE / CRÉATION
EXQUISITE CORPSE
PAGE 10
HISTOIRES FANTASTIQUES
LA NUIT FANTASTIQUE &
LES FANTÔMES NE PLEURENT PAS
PAGE 14
Directeur de la publication :
ierry Vautherot
Responsable de la publication :
Elise Ruysschaert
Rédaction :
Jérôme Araujo, Elise Ruysschaert
Graphisme : Stéphanie Renaud
Tirage 4000 exemplaires
Imprimé par Est Imprim,
Montbéliard
N° licences 1-1045584,
2-1045585, 3-1045586
n°3
AVRIL MAI JUIN 2012
MÉTÉO CAPRICIEUSE
À l’heure où ce numéro 3 de notre journal trimestriel part à l’impression, nous
ne savons toujours pas si le montant de 6 % de la subvention du ministère
de la Culture, gelé par décision gouvernementale, sera ou non dégelé. Plus
le temps avance, en dépit de la hausse du thermomètre, plus nous sommes
légitimement inquiets. D’autant que ce gel, convertible en annulation
budgétaire, s’amplifie d’une baisse de 1 % du même ministère de la Culture et
de la perspective, après navette entre le Sénat et l’Assemblée, d’un Collectif
budgétaire.
Après la baisse de 10 % en 2010 de la subvention du Conseil général, après
des années de + 0 %, qui correspondent à une baisse réelle de nos capacités
d’activité compte tenu de l’augmentation du coût de la vie et des charges
fixes, c’est à une modification profonde de l’activité même du Granit que nous
sommes confrontés.
Une activité qui schématiquement repose sur trois piliers :
- la partie visible : la diffusion de spectacles ;
- celle qui alimente cette part d’activité : l’aide à la création par la production
de spectacles, sans quoi, en accord avec Monsieur de La Palisse, les spectacles
n’existeraient pas ;
- tout le travail d’action culturelle que nous menons sur notre territoire en
direction des publics diversifiés, jeunes et adultes.
C’est en résumé le cahier des charges d’une scène nationale, au cœur d’un
réseau de plus de 70 établissements au plan national. Avec cette particularité
du Granit de s’être inscrit très tôt dans l’accompagnement des équipes
artistiques en création, en leur fournissant des moyens logistiques (salle de
répétitions, appartements, prise en charge des hébergements) et financiers.
Qu’en sera-t-il demain ?
Demain commence dès septembre avec cette nouvelle saison que nous
vous présenterons le 12 juin et qui se voit amputée actuellement de près de
50 000 €, soit plus d’un quart des marges que nous pouvons consacrer pour la
diffusion de spectacles entre septembre et décembre 2012.
Comment éviter le cercle infernal, moins de moyens, moins de spectacles
(et de moindre qualité ou ampleur), moins de public, moins de… ?
Un enchaînement “perdant-perdant” comme qui dirait.
Nous y travaillons, forts du succès de cette saison 2011/2012. Quoiqu’il en soit,
pour conserver une attractivité en rapport avec cette saison qui s’achève,
nous serons forcément amenés à augmenter nos tarifs. Avec modération,
discernement et en espérant que ce qui s’impose à nous, et qui finira aussi par
vous toucher, ne sera pas un frein au bon accueil de cette saison 2012/2013
qui s’annonce.
En attendant profitons du printemps.
ierry Vautherot, directeur du Granit
© Dorian Rollin
Photo de couverture :
Boxe, Boxe
© Michel Cavalca
Spectacle présenté
le 6 avril à la Maison du Peuple
LA GALERIE DU GRANIT
JEANFRANÇOIS GUILLON &
DOMINIQUE DE BEIR
PAGE 12
LES ATELIERS
PAGE 16
IL ÉTAIT UNE FOIS...
L’HISTOIRE DU THÉÂTRE
PAGE 20
SUR LES TRACES DE
JEAN NOUVEL
PAGE 22
À LA COOPÉRATIVE
PAGE 23
Retrouvez l’ensemble de la
programmation, des photos,
vidéos, extraits musicaux
et autres compléments
d’information sur notre site
Internet : www.legranit.org
Vous pouvez également
recevoir nos lettres
d’information web en vous
inscrivant sur le site et
réserver ou acheter vos billets
directement en ligne.
Accédez au site internet du Granit
grâce à votre téléphone mobile,
en flashant le code ci-dessus.
Nous vous convions
à la présentation de
la saison 2012/2013
mardi 12 juin à 19h30
en entrée libre.
La nouvelle
plaquette de saison
sera diffusée
à cette occasion.
Dès le 13 juin, la
billetterie sera
ouverte pour la
prochaine saison et
le site Internet sera
mis en ligne :
www.legranit.org
Le Granit est subventionné par
la Ville de Belfort, la DRAC
Franche-Comté, le Conseil général
du Territoire de Belfort,
la Communauté de
l’Agglomération Belfortaine
et le Conseil régional de
Franche-Comté.

HIPHOP
Boxe, Boxe
CHORÉGRAPHIE
MOURAD MERZOUKI
MUSIQUE QUATUOR DEBUSSY
VENDREDI 6 AVRIL À 20H30
À LA MAISON DU PEUPLE
CAT. A / TARIFS DE 8 À 24 €
© Xavier Pinon
Mourad Merzouki débute dès l’âge de sept
ans avec les arts martiaux et les arts du
cirque.
A quinze ans, sa rencontre avec la culture
hip-hop l’emmène vers le monde de la
danse.
Il décide très vite de développer sa
gestuelle hip-hop avec des objectifs plus
professionnels, mais n’hésite pas dans le
même temps à se confronter à d’autres
langages chorégraphiques auprès notam-
ment de Maryse Delente, Jean-François
Duroure et Josef Nadj.
La richesse de son parcours lui donne
cette envie très forte de réaliser des
projets artistiques mêlant le hip-hop
à son apprentissage de la scène et du
spectaculaire, et c’est ce qu’il fait en
créant en 1989, avec d’autres danseurs,
sa première compagnie. Leur premier
spectacle, présenté lors de la Biennale de
la Danse de Lyon, est un véritable succès,
qui réussit à transposer le hip-hop de la
rue à la scène, sans lui faire perdre sa
véritable identité.
Pour développer son propre univers
artistique lié à son histoire et sa sensibilité,
Mourad Merzouki décide de fonder, en
1996, sa propre compagnie Käfig.
Refusant de s’enfermer dans les codes
du hip-hop, il préfère jouer avec tous les
artifices du théâtre pour créer son propre
univers. Son style est un goût assumé
pour le rythme du cartoon, un travail
sur la ligne et le graphisme proche de
la bande dessinée, et une atmosphère
intemporelle qui laisse la place à la
rêverie.
Mourad Merzouki est directeur du Centre
Chorégraphique National de Créteil et du
Val-de-Marne depuis 2009.
Du Ravel, du Schubert ou du Verdi
dans un spectacle de hip-hop ?
C’est “Boxe Boxe” du chorégraphe
Mourad Merzouki, lui-même ancien
pratiquant d’arts martiaux,
qui célébre ici la boxe
en la mélangeant au hip-hop, dans
un spectacle joyeux et poétique.
Ne manquez pas ce duo de choc entre
les danseurs de la compagnie Käfig
et le quatuor à cordes Debussy !
À la rencontre d’un danseur
et chorégraphe qui a fait
exploser les étiquettes
en ouvrant le hip-hop à
d’autres esthétiques :

THÉÂTRE À LA MAISON DU PEUPLE
Tartuffe
TEXTE MOLIÈRE
MISE EN SCÈNE ÉRIC LACASCADE
JEUDI 12 AVRIL À 19H30
VENDREDI 13 À 20H30
À LA MAISON DU PEUPLE
CAT. A / TARIFS DE 8 À 24 €
Rencontre avec l’équipe du spectacle à
l’issue de la représentation du jeudi 12.
Il faut parfois contourner longtemps certains monstres avant
de les affronter ; Molière a été de ceux-là pour Eric Lacascade.
Les géants ne l’ont pourtant jamais inquiété : en trente ans, il a
plongé profondément au cœur de Tchekhov ; Sophocle ne lui a
pas fait peur, Shakespeare, Kleist et Ibsen non plus.
En 2006 avec “Les barbares”, puis l’année passée avec
“Les estivants”, c’est Gorki qu’il a regardé dans le fond des yeux.
Aujourd’hui, Eric Lacascade s’attaque à “Tartuffe”.
Eric Lacascade, en trente ans de mise
en scène, c’est la première fois que vous
abordez Molière, pourquoi ne l’avez-
vous pas monté avant ?
Un spectacle en amène un autre ; et il se
trouve que le dernier spectacle que j’ai
fait, Les estivants de Gorki, m’amène à
Molière.
Dans Les estivants, il y a peu de situa-
tions et beaucoup de dialogues ; les
personnages ne sont pas très définis et
la narrativité est extrêmement difficile à
suivre. J’ai dû adapter et réorganiser le
texte, avec les comédiens nous avons dû
inventer les situations, l’espace, le temps
de la pièce et faire un travail de drama-
turgie très fort pour rendre l’histoire
compréhensible au public. Sorti d’un an
de ce travail-là, j’avais envie de l’inverse :
une pièce avec des situations fortes,
des personnages taillés à la serpe et
une histoire que tout le monde connaît.
Tartuffe s’est naturellement imposé.
Et il y a le défi, le pari que cela repré-
sente ! A mon âge, soit on continue dans
ce qu’on sait faire – et c’est vrai : pour-
quoi faire des barriques carrées si on fait
très bien des rondes et que tout le monde
dit que les rondes sont formidables ? –
soit on essaie d’aller dans des endroits
que l’on connaît moins, quitte à ce que ce
soit difficile ; quitte à surprendre et être
critiqué. C’est un moyen de rester éveillé,
en vie, en découverte.
Il y a les contraintes de la langue de
Molière : comment travaillez-vous cette
langue du XVIIe siècle et les alexandrins
pour donner une liberté de jeu aux comé-
diens ?
La liberté se trouve dans les contraintes :
un fleuve est puissant lorsqu’il court entre
deux berges ; dans la plaine il est épar-
pillé, moins fort, moins puissant et plus
soporifique. La contrainte fait la liberté,
donc nous allons tenter de respecter les
alexandrins, le rythme, les accents, la
façon de les dire. D’autant plus que si on
respecte la structure de cette langue, le
sens apparaît. En faire une langue d’au-
jourd’hui ? La vulgariser ? Non ! C’est
entre autre pour la contrainte que nous
avons choisi ce texte.
Vous travaillez avec des comédiens qui
vous suivent depuis longtemps, comment
ces nouvelles contraintes vous permet-
tent-elles de poursuivre votre recherche
tant sur l’acteur que sur le groupe ?
C’est précisément ces contraintes qui
nous permettent de perpétuer notre
recherche, de réinterroger le travail de
l’acteur. Elles poussent les comédiens
dans des endroits inédits ; ils se dépas-
sent, se mettent en danger, sortent de ce
qu’ils savent faire et inventent à nouveau.
Pour ce qui est du groupe, Tartuffe se
passe dans une famille, donc nous parlons
d’un groupe, d’une communauté ; nous
observons les liens entre les gens, les
règles de vie ensemble, la façon dont ils
communiquent ou dont ils ne commu-
niquent pas, quelles sont les résistances.
La pièce me permet donc de continuer
mon observation microscopique sur le
fonctionnement de l’humain dans une
communauté, et d’une communauté
normalement au service de l’humain.
Du point de vue dramaturgique, comment
traitez-vous ce cadre familial dans lequel
Tartuffe vient semer le trouble ?
La famille est déjà en crise lorsque
Tartuffe arrive, des failles profondes exis-
tent déjà : il y a la crise existentielle du
maître des lieux, visiblement Orgon a du
mal à trouver ou retrouver une relation
de père avec ses enfants ; il y a la relation
d’Elmire, la belle-mère, avec les enfants,
elle a le même âge qu’eux, ce n’est pas
simple ; il y a Cléante, le frère d’Elmire
imposé dans la famille ; il y a la mère
d’Orgon en opposition totale avec sa
belle-fille, elle désire peut-être un retour
à l’ordre ancien du temps de la première
femme d’Orgon ; bref, les problèmes
familiaux sont nombreux et complexes.
Tartuffe arrive dans ce contexte et devient
un instrument par lequel Orgon tente de
retrouver son pouvoir et imposer une loi
morale dans sa maison, une loi divine. De
son côté Tartuffe instrumentalise Orgon
pour capitaliser du vin, des repas, de l’ar-
gent et puis s’il peut se faire sa femme en
passant, il se la fera. Qui utilise qui ? Qui
manipule qui dans cette famille où ça ne
va pas ? C’est ce champ de bataille que
nous étudions et que nous présentons
aux spectateurs de manière un peu cohé-
rente, je l’espère.
Nous mettons ces tensions sur la table,
nous essayons de les comprendre et de
les jouer telles qu’elles existent dans le
texte.

Que faites-vous de la question du
bigotisme et de la vie religieuse dans
“Tartuffe” ?
Je veux dépasser ce thème de la vie
religieuse. C’est l’exercice de la passion
qui m’intéresse, et quelles en sont les
conséquences dans cette micro-société.
Étudier comment toute passion forte
vous coupe des gens, de votre famille et
de l’amour de la réalité : Orgon part dans
un jusqu’au-boutisme qui le sépare des
autres.
Après, il s’agit d’une passion religieuse :
que l’on soit un vrai dévot ou un faux
dévot ce qui est terrible c’est que, au
nom de dieu, toutes les tyrannies sont
possibles. En fait, je ne me pose pas la
question de la vraie ou fausse dévotion
de Tartuffe. La religion pour moi, quelle
qu’elle soit, est tyrannique. Le rituel
proposé à Orgon par Tartuffe ne donne
aucune indication sur leur foi, croient-
ils ou ne croient-ils pas ? Ce n’est pas le
problème : tant qu’ils exécutent le rituel
et que tout le monde le voit, personne
ne peut rien dire, ils sont protégés. Le
Pape est-il croyant, par exemple ? Je ne
sais pas. Peut-être cet homme voulait-
il simplement acquérir du pouvoir, du
respect ou un emploi.
Comment abordez-vous le fait que, au
final, la famille d’Orgon n’explose pas,
qu’elle se réunit dans la détestation de
Tartuffe ?
Oui, bien sûr, ils sont tous contre Tartuffe
à la fin, mais sont-ils réunis pour autant ?
Durant cette unique journée que relate la
pièce, la dernière journée de Tartuffe dans
la maison, il se passe des événements
très violents, bouleversants, énormes :
on va jusqu’à l’expropriation de toute
la famille ; il y a la fameuse scène où
Orgon, caché sous la table, voit et entend
Tartuffe avoir un rapport physique amou-
reux avec sa femme, Elmire ; les amants,
Mariane et Valère, se disputent à mort,
se séparent puis se réunissent ; le fils a
été déshérité. Moi j’ai l’impression qu’à
la fin de cette journée rien ne sera plus
comme avant, que cette folie qui a pris
toute la maison va laisser des traces. Ça a
été une véritable bataille rangée entre les
pro-Tartuffe et les anti, et à la fin de cette
grande guerre, ils sont tous épuisés et pas
si joyeux que ça.
Ça ne se termine malgré tout pas si mal :
les amants se retrouvent et l’imposteur
est chassé ; de plus durant toute la pièce,
on rit ; il y a de la joie et de l’humour en
permanence.
Breton disait : “L’humour, c’est la poésie
du désespoir”, moi je pense qu’il y a de
ça dans cette pièce : de l’obscurité, du
désespoir ; il y a du réel. Pour moi, cette
fin n’est pas si rêvée que ça : après l’im-
mense dispute des amants, c’est le père
qui décide du mariage et pas eux. Ce
pouvoir tout-puissant qui arrive à la fin et
dit “je résous tout”, ce n’est pas si idéal
que ça.
Pour Molière, le théâtre devait, par le rire,
corriger les vices, quelle est votre vision
du théâtre à notre époque ?
Aujourd’hui la fonction du théâtre est
essentielle du côté de la réalité. C’est pour
cela que j’insiste sur la véracité de ce qui
se passe entre les gens sur le plateau,
avant d’y mettre un deuxième ou un
troisième degré. Dans une société de
plus en plus virtuelle, le théâtre propose
un ici-et-maintenant réel et un lien réel
entre le public et l’acteur. C’est pourquoi
je ne pratique pas un théâtre du faire-
semblant ou comme si, mais plus un
théâtre brut de coffre de l’ici-et-mainte-
nant, presque un théâtre matérialiste, un
théâtre de l’immédiat. Montrer du réel,
c’est une fonction très importante du
théâtre aujourd’hui.
Le théâtre aussi a quelque chose qu’il
peut revendiquer, c’est son organicité,
c’est-à-dire son absence de but et ça,
ça ressemble à autre chose qui n’a pas de
finalité : la vie.
Dans une société artefactuelle où
chaque action, peut-être bientôt chaque
personne, a une fonction, un but déter-
miné par la rentabilité, par le profit que ça
peut générer, je trouve que l’absence de
finalité du théâtre est précieuse, impor-
tante à défendre et à mettre en avant.
Propos recueillis par Marc Berman
© photos Mario Del Curto
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
1
/
13
100%