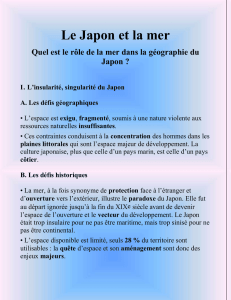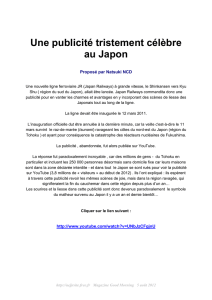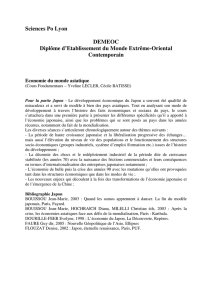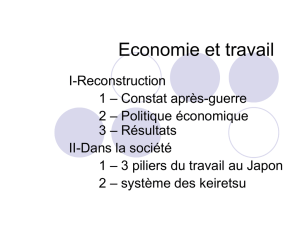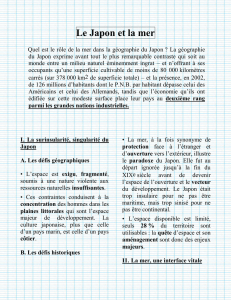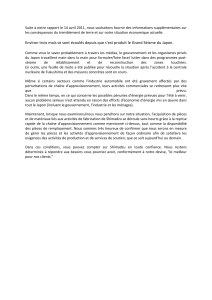Histoire du

Histoire du

Page 2/43
Japon préhistorique et protohistorique Page 3
Le modèle chinois Page 7
La période de Heian Page 11
La période de Kamakura Page 15
La période de Muromachi Page 19
Les trois unificateurs Page 23
Le shogunat des TOKUGAWA : la période d'Edo Page 27
L'Ere Meiji Page 32
L'Ere Taisho et la 1ère partie de l'Ere Showa Page 36
2e partie de l'Ere Showa et début de l'Ere Heise Page 40

Page 3/43
- Histoire du Japon, 1ère partie -
Japon préhistorique et protohistorique
Son insularité confère au Japon une histoire riche et singulière. A
travers cet historique du Japon, décliné en plusieurs tranches
chronologiques, nous vous proposons une plongée dans le coeur
historique et géographique du pays, de sa préhistoire à nos jours.
Aujourd'hui : le Japon de 10 000 av. JC au milieu du VIe siècle ap.
JC.
Le cadre géographique
Le Japon est formé d'un archipel tout en longueur, d'une superficie de 378 000 km2. Quatre îles composent, du
nord au sud, la majeure partie de son territoire : Hokkaido, Honshu, Shikoku et Kyushu. Au large de cette
dernière, les Ryukyu (Okinawa) n'entrent, comme Hokkaido, que tardivement dans le giron japonais, à partir du
XVIIe siècle.
Les quatre îles principales s'étendent d'une latitude correspondant à la région lyonnaise, jusqu’à une autre,
voisine du sud du Maroc. Elles appartiennent à la zone tempérée de l'hémisphère nord, mais connaissent de
grandes variations climatiques, d'Hokkaido, affectée par la froidure sibérienne, aux Ryukyu subtropicales. Les
eaux du Japon sont rendues poissonneuses par la rencontre du courant froid Oyashio et du courant chaud
Kuroshio. Depuis les temps anciens, la mer Intérieure, située entre Honshu, Shikoku et Kyushu, n'a pas
constitué un obstacle pour les communications. En revanche, depuis l'archipel nippon, il faut compter au
minimum180 km pour rejoindre la Corée, et 800 km pour
rallier la Chine. Aussi, suivant les époques, celui-ci s'est ouvert
sur le continent asiatique ou replié sur lui-même.
Géologiquement, le Japon est une terre récente et volcanique.
Située dans la zone de contact de deux plaques tectoniques,
elle est secouée par de fréquents tremblements de terre.
Extrêmement montagneuse, ses plus grandes plaines, rares, se
trouvent dans les régions du Kansai (Osaka, Kobe, Kyoto) et
du Kanto (région de Tokyo). L'archipel nippon se révèle
également pauvre en matières premières.
Les hommes
La population du Japon s'élève à environ 126 millions d'habitants. Elle présente des caractéristiques homogènes
et des traits physiques mongoloïdes proches de ceux des Coréens ou des Chinois. Il est cependant difficile de
dater à quel moment advint ce processus d'homogénéisation.
Car, si la présence humaine est attestée dans l'archipel 30 000 ans av. J.-C., notamment par l'existence d'une
civilisation précéramique, le peuple japonais est issu, à la base, du mélange de plusieurs apports de populations
successifs. Ceux-ci vinrent, depuis la Préhistoire, de différentes parties du continent asiatique ; voire étaient, en
partie, d'origine malayo-polynésienne.
Un tel creuset a abouti à l'émergence des ancêtres des Japonais actuels qui, à défaut d'unité anthropologique, se
sont différenciés de leurs voisins continentaux par leur insularité, leur langue et leur culture. Ils ont colonisé
l'ensemble de l'archipel, aux dépens des Ainu (lien article id=129), peuple peut-être d'origine sibérienne ou de
Protocaucasiens, plus proches des Blancs que des Mongoloïdes et caractérisés par une pilosité abondante. Les
Ainu furent progressivement repoussés vers le nord (Hokkaido), assimilés par la force et le métissage, jusqu'à
pratiquement disparaître aujourd'hui. Le Japon actuel compte également deux minorités importantes : le peuple
des îles Ryukyu, et les Coréens, descendants des travailleurs forcés venus durant la première partie du XXe
siècle. Jomon

Page 4/43
De 10 000 av. J.-C. à 300 av. J.-C., une civilisation de
chasseurs-pêcheurs-cueilleurs, venant peut-être de Sibérie
et centrée sur le Nord-Est du Honshu, s'étend à tout
l'archipel nippon, d'Hokkaido aux îles Ryukyu. Elle va
même se prolonger encore durant de nombreux siècles dans
les villages de montagne ou chez les Ainu du nord du
Japon.
Les hommes d'alors se confectionnent des ustensiles divers
et des pointes de flèches à l'aide de pierres taillées ou polies
et à partir d'os. À l'aide d'arcs, ils chassent le sanglier, les
cervidés et le petit gibier, en compagnie de chiens, les seuls
animaux domestiqués. De nombreux amas de restes de coquillages (kaizuka), souvent devenus des dépotoirs ou
des lieux de sépulture, ont été retrouvés près de campements de pêcheurs, sur les zones littorales. On y
consommait aussi des mammifères marins et divers poissons.
Le nom de civilisation Jomon provient des "motifs cordés" qui caractérisent les céramiques de cette époque,
décorées à cru au moyen de bâtonnets enveloppés de cordelettes roulés sur leurs flancs. Ces poteries permettent
de cuire et de mieux conserver les aliments. Mieux nourrie, la population augmente en nombre et se sédentarise.
Celle-ci se concentre dans des hameaux comprenant une douzaine d'habitations semi-enterrées (tateana),
recouvertes d'un toit de branches et de feuillages, percé d'un trou afin de laisser s'échapper la fumée du foyer.
Ultérieurement, ces villages adoptent une disposition en arrondi, autour de places ou de monuments
mégalithiques (cromlechs) pouvant servir à la célébration de rites, ou utilisés comme tombeaux.
Les morts sont inhumés en position accroupie, et la coutume de l'extraction des dents est très répandue. En fin
de période, les fouilles ont révélé l'enterrement des petits enfants défunts dans des jarres.
La question de savoir si l'agriculture fait son apparition pendant la civilisation Jomon reste très discutée. La
basse époque voit sans doute l'émergence de la culture de céréales sur terrain sec.
Yayoi
Du IIIe siècle av. J.-C. au IIIe siècle ap. J.-C. intervient
une nouvelle civilisation. Venue probablement du sud de la
Chine, elle est centrée sur la partie septentrionale de l'île de
Kyushu, puis s'étend graduellement vers le nord de
l'archipel nippon. Elle est nommée Yayoi, d'après le
quartier de l'actuelle Tokyo où ont été découverts les
premiers exemples de céramiques caractéristiques de cette
période.
Outre les poteries, fabriquées avec un tour, la civilisation
Yayoi se distingue, bien que l'élevage ne se développe
guère, par la généralisation d'une agriculture fondée sur la riziculture sur terrain inondé. Celle-ci va demeurer,
jusqu'à la deuxième partie du XIXe siècle, la base de l'économie japonaise et ses techniques d'exploitation,
nonobstant quelques améliorations, vont se perpétuer jusqu'à nos jours. Les habitations, proches de celles de la
période Jomon, et des greniers sur pilotis, sont regroupées au sein d'agglomérations éventuellement fortifiées de
talus en terre battue et de rondins de bois.
En dehors de la maîtrise de la riziculture, cette époque voit l'apparition des objets en bronze, dont l'usage est
limité d'abord à des rituels religieux (dotaku), puis en fer, en fin de période. Pour ce qui concerne plus
particulièrement le travail des métaux, les modèles pour les armes (hallebardes) et pour les outils provenant de
Chine.
Cette dernière rayonne alors culturellement, suite à son unification par le premier empereur QIN
SHIHUANGDI (221-210 av. J.-C.) ; puis à la poursuite de son oeuvre de centralisme politique par la dynastie
HAN (206 av. J.-C.-220 ap. J.-C.). C'est également sous ces monarques que le bouddhisme est introduit dans
l'Empire du Milieu. Les chroniques chinoises de la dynastie WEI, leWeizhi (IIIe siècle ap. J.-C.), font référence
aux Japonais d'alors, parlant d'un "Pays des Wa" (Pays des "Nains"...).

Page 5/43
À ce moment, l'organisation politique de l'archipel est marquée par une division en de nombreux petits États
tribaux. Une reine-prêtresse, HIMIKO ("Fille du Soleil"), serait à la tête d'une confédération regroupant une
partie d'entre eux. Ce mystérieux "Pays de la Reine" ou royaume du Yamatai, vraisemblablement situé dans le
nord de Kyushu, aurait envoyé un tribut aux Chinois en 238 ap. J.-C. Ces sociétés agraires, plus ou moins
structurées, où les guerriers doivent jouer un rôle important, obéissent à des monarques-chamanes, guides
spirituels plus encore que politiques. Ainsi, HIMIKO, qui n'apparaissait jamais au commun de ses sujets, aurait
gouverné en tandem avec son frère cadet, par l'intermédiaire duquel elle aurait commandé à son peuple.
Kofun et État du Yamato
À partir de la fin du IIIe siècle ap. J.-C., des cavaliers lourdement armés d'arcs et d'épées de fer, protégés de
cuirasses de métal et de cuir, imposent progressivement, partis du nord de Kyushu, un pouvoir centralisé dans la
plaine du Yamato (région de Nara, île principale de Honshu).
La question de leur origine est discutée. Il s'agirait peut-être de "peuples cavaliers" altaïques arrivés, depuis
steppes continentales et via la Corée, par vagues successives dans l'île de Kyushu. Ils auraient formé une
aristocratie qui aurait imposé sa suzeraineté aux populations rurales Yayoi, en se plaçant au sommet de leur
hiérarchie sociale. À moins que l'évolution économique locale n'ait abouti à la création d'une couche sociale
supérieure de guerriers autochtones, nourris par le travail des paysans.
Ces cavaliers sont à l'origine d'une nouvelle civilisation dite des "Anciens Tertres" (ou kofun). En effet, ce ne
sont plus des poteries, mais des monuments funéraires qui servent de critère déterminant pour cette période. Ces
tombeaux monumentaux, des tumuli en forme de "trou de serrure" pour les plus connus, sont bâtis pour les
hauts dignitaires de leur aristocratie, dans le Kyushu et le Honshu, du IIIe jusqu'au VIIe siècle ap. J.-C. Ils sont
entourés de plusieurs rangs de cylindres-figurines en terre cuite. Ces haniwa serviraient, sur le modèle des
coutumes chinoises, de substituts à des victimes sacrificielles accompagnant, à l'origine, le défunt dans sa
dernière demeure. À moins que leur usage ne se résume à retenir la terre du tumulus. Quoi qu'il en soit, de telles
sépultures n'ont commencé à être fouillées que tardivement, après la Deuxième Guerre mondiale. Car certaines
font l'objet d'une vénération particulière, vues comme les tombes des premiers empereurs japonais.
Selon le Kojiki et le Nihon Shoki, les plus anciennes sources historiques traditionnelles japonaises (début du
VIIIe siècle ap. J.-C.), la cour impériale japonaise aurait été établie dans les années 660 av. J.-C. par le premier
empereur JIMMU . Celui-ci aurait quitté Kyushu pour, guidé par un faucon, faire la conquête du Yamato.
Cependant, comme JIMMU, les dix, sinon les trente premiers monarques japonais (660 av. J.-C. à 538 ap. J.-C.)
ont vraisemblablement été inventés pour soutenir la comparaison avec les très anciennes dynasties chinoises.
Cependant, cette légende nationale repose certainement sur le
souvenir de la soumission progressive de peuplades
antagonistes par un groupe unique de cavaliers venus de
Kyushu, jusqu'à la fondation du royaume de Yamato. Mais
cette unification politique daterait en fait du IVe siècle ap. J.-
C. Ainsi, les premiers dirigeants de cet État du Yamato
donnent naissance à la famille impériale. Sa dynastie règne
encore aujourd'hui sur le Japon.
Pétris de croyances chamaniques, ces monarques se
réclament alors de la descendance de la déesse solaire
AMATERASU. Le grand sanctuaire d'Ise, dont les bâtiments
en bois sont aujourd'hui encore reconstruits tous les 20 ans, renferme les trois trésors impériaux : un miroir en
bronze symbole de la divinité, un sabre de fer et un bijou magique en forme de croc (magatama). De tels
mythes se greffent à ceux dus aux périodes antérieures Jomon et Yayoi pour former la religion proprement
indigène du Japon. Celle-ci est appelée ultérieurement shinto (voie des dieux), pour la différencier du
bouddhisme, importé au Japon au VIe siècle ap. J.-C. Outre la vénération de la déesse solaire et de multiples
divinités (kami), notamment protectrices des clans guerriers, ou la célébration du culte des ancêtres, le shinto
fait la part belle au panthéisme et à l'animisme. On établit des fêtes religieuses et des sanctuaires, entre autres
dans des lieux naturels propices à des manifestations surnaturelles. Les pratiques rituelles sont marquées par un
grand souci de pureté : importance des ablutions et des bains chez les Japonais, défiance à l'égard de tâches
incompatibles qui mettent en contact avec la mort, le sang et la souillure en général.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
1
/
43
100%