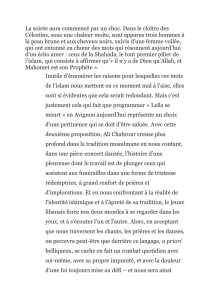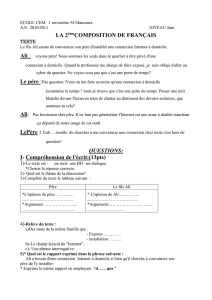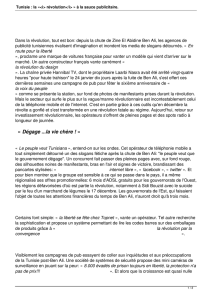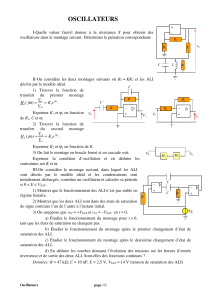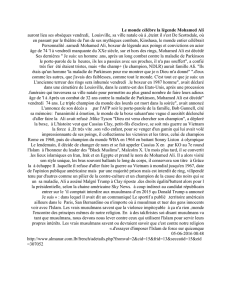« J`aime les auteurs qui osent des sujets plus grands qu`eux »

le festival
d’avignon
Du 6 au 24 juillet
Réservations :
Festival-avignon.com ou fnac.com
Par téléphone : 04-90-14-14-14.
Sur place : Cloître Saint-Louis,
20, rue du Portail-Boquier,
84000 Avignon.
Tarifs : de 14 € à 49 €, selon le spectacle.
théâtre
Les Damnés
Mise en scène : Ivo van Hove.
Cour d’honneur du Palais des papes,
du 6 au 16 juillet (relâche le 10),
à 22 heures (ou 23 heures, le 14).
Le grand metteur en scène flamand,
le retour de la troupe de la Comédie-
Française à Avignon, le scénario
de Visconti, la Cour d’honneur
du Palais des papes… L’incontournable
du Festival.
Ceux qui errent ne se trompent pas
Mise en scène : Maëlle Poésy,
d’après José Saramago. Théâtre Benoît-
XII, du 6 au 10 juillet, à 15 heures.
Un jour d’élection et de pluie diluvienne,
les électeurs votent blanc à 80 %.
Maëlle Poésy met en scène une crise qui
pourrait bien ressembler à la nôtre.
2666
Mise en scène : Julien Gosselin.
La FabricA, les 8, 10, 12, 14 et 16 juillet,
à 14 heures.
Un spectacle-fleuve, inspiré par le
roman magistral de Roberto Bolaño
qui explore le mal au XXIe siècle.
Tristesses
Mise en scène : Anne-Cécile Vandalem.
Gymnase du lycée Aubanel, du 8
au 14 juillet (relâche le 11), à 18 heures.
Une nouvelle venue à Avignon,
avec une pièce policière sur la montée
de l’extrême droite en Europe.
Karamazov
Mise en scène : Jean Bellorini.
Carrière de Boulbon, du 11 au 22 juillet
(relâche les 14 et 20 juillet), à 21 h 30.
Le chef-d’œuvre de Dostoïevski à ciel
ouvert, dans la splendeur de la carrière
de Boulbon.
Tigern (La Tigresse) et 20 November
Mise en scène : Sofia Jupither.
Théâtre Benoît-XII, du 13 au 17 juillet
et du 14 au 17 juillet, à 18 heures
et à 15 heures.
La metteuse en scène suédoise confronte
deux textes contemporains de Gianina
Carbunariu et de Lars Noren, pour parler
d’une Europe au bout du rouleau.
danse
Caen Amour
Chorégraphie : Trajal Harrell.
Cloître des Célestins, du 9 au 12 juillet,
à 22 heures et à minuit.
Dans un décor aux airs de maison
de poupée, le chorégraphe américain
dévoile, avec cinq interprètes, les dessous
de la féminité sur le fil d’une parade de
cow-boys, danseuses orientales et autres
troublantes créatures. Chaud devant.
Fatmeh et Leïla se meurt
Chorégraphie : Ali Chahrour.
Cloître des Célestins, du 16 au 18 juillet
et du 21 au 23 juillet, à 22 heures.
Avec ces deux pièces centrées sur
des femmes et interprétées par des non-
professionnels, le danseur et chorégraphe
libanais Ali Chahrour questionne
les rituels de funérailles de la religion
chiite pour creuser le rapport au corps.
Soft Virtuosity, Still Humid,
on the Edge
Chorégraphie : Marie Chouinard. Cour
du lycée Saint-Joseph, du 17 au 23 juillet
(relâche le 21), à 22 heures.
Une exploration de la marche et du
visage, happée par la force imparable
d’un groupe de dix danseurs experts
dans l’escalade de sensations chère
à la chorégraphe québécoise.
Sisters
Chorégraphie : Elsa Wolliaston.
Jardin de la Vierge du lycée Saint-Joseph,
du 18 au 24 juillet, à 11 heures.
La danseuse et chorégraphe
ambassadrice de la danse africaine
contemporaine et la chorégraphe
espagnole Roser Montllo se prennent
par la main pour s’inventer une famille
planétaire qui leur ressemble.
« J’aime les auteurs qui osent
des sujets plus grands qu’eux »
ENTRETIEN | Après « Les Particules élémentaires », Julien Gosselin revient à Avignon avec le livre-
testament du Chilien Roberto Bolaño. Un spectacle de douze heures qui explore la question du mal
En 2013, Julien Gosselin entrait par
la grande porte à Avignon, avec
une mise en scène des Particules
élémentaires, de Michel Houelle-
becq. Il avait 26 ans, le crâne rasé,
un sweat à capuche, et c’était le
benjamin du festival. Il conserve son titre
cette année, où il vient avec un autre roman,
2666, de Roberto Bolaño. Le spectacle dure
douze heures, le temps qu’il faut pour traver-
ser les 1 352 pages de la fantastique œuvre
testamentaire du poète et écrivain chilien
(1953-2003) qui explore le mal au XXIe siècle.
Y a-t-il un lien entre « Les Particules
élémentaires » et « 2666 » ?
Oui, au sens où le choix de l’un découle de
l’autre. Après Les Particules élémentaires, je
voulais faire un spectacle plus léger, dans sa
forme, et parler de la violence révolution-
naire. J’ai cherché des textes, sans en trouver
un qui me convienne. Ceux que je lisais trai-
taient d’un thème ou deux, mais aucun
n’ouvrait un champ aussi large que le roman
de Houellebecq, qui m’avait permis d’explo-
rer différents types d’écriture, de la narration
à la poésie, et une multitude de thèmes : la
sexualité, le clonage, Mai 68… J’ai donc fait
l’inverse de ce que je voulais faire au début :
me tourner vers des romans encore plus
« totaux » que Les Particules élémentaires.
2666 a été le premier que j’ai lu.
Pourquoi ce roman-là ?
Quand 2666 est sorti en France, en 2008, je
lisais des magazines comme Chronic’art, qui
faisait de vrais longs papiers sur des auteurs
que j’aime, Don DeLillo, William T. Voll-
mann, Thomas Pynchon… Pour 2666, je me
souviens qu’ils avaient titré : « Le premier
grand roman du XXIe siècle ». Un de mes
amis qui l’avait lu m’en a parlé. Je l’ai com-
mencé, et dès le début, j’ai su que je pouvais
avoir les armes pour le porter au théâtre.
Qu’est-ce qui vous a particulièrement
intéressé dans ce roman ?
J’aime être face à des auteurs qui osent des
sujets monumentaux, ou plus grands
qu’eux. Et Roberto Bolaño parle d’une apo-
calypse qui pourrait recouvrir le monde.
A travers quelle histoire ?
Il y a une multitude d’histoires dans 2666.
Pour les raconter, il faut dévoiler la première
partie du roman. Quatre universitaires euro-
péens sont fous d’un auteur allemand dont
on ne connaît rien, sinon qu’il est né
en 1920, qu’il a été jeune pendant la seconde
guerre mondiale, et qu’il a pris pour pseudo-
nyme le nom de Benno von Archimboldi.
Les universitaires, qui sont prêts à tout pour
le retrouver, suivent une piste qui les amène
au Mexique : l’écrivain vivrait dans une ville
frontière avec les Etats-Unis, où depuis une
vingtaine d’années sont commis des centai-
nes de meurtres sur de jeunes femmes.
Cette ville, qui s’appelle Santa Teresa
dans le roman, c’est Ciudad Juarez, où
effectivement des centaines de femmes
ont été tuées ou ont disparu, dans les an-
nées 1990 et 2000, sans que ces meurtres
soient élucidés. Etiez-vous au courant ?
Oui, mais de très loin. J’ai lu des livres sur le
sujet, en particulier Des os dans le désert, de
Sergio Gonzales Rodrigues. Roberto Bolaño
s’est inspiré de ce livre pour « La part des cri-
mes », qui occupe une place centrale dans
2666. Il a d’ailleurs donné le nom de Sergio
Gonzalez dans son livre à un journaliste qui
enquête sur le sujet. Bolaño reprend la thèse
de Sergio Gonzales Rodrigues : ce n’est pas
un, ou des serial killers qui ont tué, c’est la
corruption généralisée au Mexique, où les
narcotrafiquants sont liés à l’Etat, qui fait que
de jeunes ouvrières sont violées, tuées et
abandonnées dans le désert. Mais Bolaño va
encore plus loin : il montre que le mal ne
règne pas que dans l’Etat mexicain, il règne
sur le monde entier.
Avez-vous été tenté d’aller à Ciudad
Juarez, quand vous prépariez le spectacle ?
Oui, à un moment, même si je suis plutôt
un voyageur immobile. Mais j’ai eu peur
d’être dans la reproduction esthétique de
détails. Je n’avais pas envie qu’il y ait des cac-
tus partout sur le plateau, ni des vidéos du
Mexique. Et puis mon travail n’est pas d’être
un sociologue, ni de faire du théâtre politi-
que, au sens où je pourrais porter une accusa-
tion concrète et étayée, avec des preuves ou
des témoignages que j’aurais pu trouver sur
place. Mon but est de transformer le roman
de Bolaño en théâtre, en toute liberté.
Comment votre projet a-t-il été accueilli
par les programmateurs ?
A une ou deux exceptions près, personne
ne savait qui était Bolaño. Des collabora-
teurs de l’Espagnol Alex Rigola, qui a mis en
scène 2666, n’en revenaient pas, tellement
Bolaño est une mégastar, pour le dire vite,
en Espagne et en Amérique latine. C’est sur-
tout la durée de la représentation, douze
heures, qui a fait peur aux programma-
teurs, au départ. Mais je savais que c’était le
moment où je pouvais proposer une forme
aussi longue. Les Particules élémentaires
avaient été un succès, et tout ce qu’on me
Répétition,
fin juin
à Avignon,
de « 2666 »,
mis en scène
par Julien
Gosselin.
SIMON GOSSELIN
« Ce qui m’intéresse,
c’est de dessiner des perspectives
théâtrales, des chocs musicaux,
des chocs de jeu. C’est ce qui
explique la durée de “2666” »
18 |le festival d’avignon JEUDI 30 JUIN 2016
0123

demandait, c’était de faire un nouveau
spectacle. Sur le fond, c’était bizarre, pen-
dant la préparation de 2666 ; je n’avais
même pas de contradicteurs, comme avec
Les Particules élémentaires, où l’on me
disait « Houellebecq, c’est nul », ou « Houel-
lebecq, c’est génial ».
Qu’est-ce qui a guidé votre adaptation ?
Je ne suis pas un metteur en scène qui
prend des phrases dans un livre et en pro-
pose sa vision. Ma vision est dictée par les
contraintes pratiques. Ce qui m’intéresse,
c’est de suivre le fil narratif d’un roman, et,
partant de là, de dessiner des perspectives
théâtrales, des chocs musicaux, des chocs
de jeu. C’est ce qui explique la durée de
2666. Je ne peux pas traiter une partie
comme celle des crimes, qui fait 500 pages,
en une heure. Dans mon travail, j’ai besoin
de créer un suspense, comme Bolaño le fait.
Il met en place une intrigue, qui est presque
de l’ordre du roman de gare, à certains
égards, même si littérairement on en est
très loin. Mais ce suspense, Bolaño le désac-
tive, il dit en substance au lecteur : on se
fiche du suspense, le plus important, c’est le
combat que vous menez avec ma littéra-
ture. Il y a ainsi dans 2666 une percussion
entre un classicisme du grand roman et
une extrême modernité de la violence.
C’est cela qui m’intéresse.
Qu’est-ce qui vous intéresse autant dans
la violence ?
Je le dis honnêtement : il faudrait entamer
une longue psychanalyse pour savoir pour-
quoi la violence me questionne autant. En
tout cas, le fait est que je suis rentré dans l’art
avec des artistes qui travaillaient sur ce sujet.
Quels artistes ?
Les deux premiers chocs esthétiques que
j’ai eus, c’étaient deux films : Caché, de
Michael Haneke, et Hors Satan, de Bruno
Dumont, pour lequel j’ai une tendresse par-
ticulière parce qu’il se passe dans ma région
natale, le Nord. Ces deux cinéastes ont tou-
jours filmé la violence à l’intérieur du
monde, sans jamais verser dans l’esthétisa-
tion molle ou facile. Même si c’est bête de le
dire, cette question de la violence revient
tous les jours sur le devant de la scène. C’est
l’un des thèmes fondamentaux dont il faut
parler aujourd’hui.
Y a-t-il pour vous un lien avec le fait que
vous aviez 14 ans en 2001, et que vous
avez grandi avec cette violence ?
J’ai du mal à le dire, mais c’est très envisa-
geable. En tout cas, Houellebecq et Bolaño
en parlent, chacun à leur façon. Là où je suis
fou de Bolaño, et où je ressens une fraternité
totale envers lui, c’est dans sa vision de la lit-
térature. Il croit en la littérature, mais il ne
dira jamais qu’elle peut être plus forte que la
violence. On pourrait penser que c’est une
vision pessimiste, mais je ne le crois pas :
c’est une vision de combat. Une vision de
samouraï, comme dirait lui-même Bolaño.
« Personne n’accorde d’attention
à ces assassinats, mais en eux se cache
le secret du monde », lit-on page 529
de « 2666 ». Vous le pensez ?
Je ne sais même pas si je le pense, mais ça
me tue.
C’est-à-dire ?
C’est pour des moments de littérature
comme celui-ci que je mets en scène 2666. Il y
a dans cette phrase quelque chose que je peux
saisir. Mais le secret du monde, je ne peux pas
le saisir. Les jeunes femmes tuées sont des
ouvrières, peu éduquées. Bolaño ne met pas
en avant cet aspect, mais en même temps il
est constamment présent. Et tout se passe
comme si la laideur de ce lumpenprolétariat,
la laideur de ce monde industriel cachait la
plus grande pureté. Cette pureté, ce n’est pas
celle de la non-culture. Elle est d’un autre or-
dre : quand le mal s’attaque à qui n’a rien pour
se défendre naît la plus grande tragédie. Et
c’est peut-être là l’un des secrets du monde. p
propos recueillis par brigitte salino
2666, d’après Roberto Bolaño.
Mise en scène : Julien Gosselin. La FabricA,
du 8 au 16 juillet (relâche les 9, 11, 13
et 15 juillet), à 14 heures. Durée : 12 heures
(entractes compris). De 20 € à 49 € .
L’édition de « 2666 » de Roberto Bolaño
citée ici est celle de Folio (traduction
de l’espagnol par Roberto Amutio, 2011).
Au Liban, Ali Chahrour
fait un pas de côté
Le jeune chorégraphe a recruté des amateurs pour interroger
les rituels chiites du deuil et le rapport au corps féminin
Le studio de danse ex-
plose de soleil. Les im-
menses fenêtres ont été
occultées par des para-
vents verts pour tami-
ser l’atmosphère. Plus
de trente degrés sur Beyrouth,
samedi 18 juin. Les ventilos
turbinent. Les packs de bouteilles
d’eau s’effondrent. Le danseur et
chorégraphe Ali Chahrour amé-
nage l’espace – quelques chaises
ici et là – en attendant sa petite
troupe, composée de deux musi-
ciens et de Leïla Chahrour, 52 ans,
la cousine de son père, pleureuse
et vedette de son spectacle Leïla
se meurt.
Voilà donc Leïla, tout de marron
vêtue jusqu’au voile. Alternative-
ment souriante et grave, tran-
quille toujours. Elle parle peu, file
fumer une cigarette dans le cou-
loir, revient et prend position au
centre de la salle. Présence évi-
dente, solide, simplement puis-
sante. « Elle n’était jamais entrée
dans un théâtre, ni montée sur
scène, précise Ali Chahrour. Lors-
que j’étais petit, j’avais peur d’elle.
Elle venait régulièrement pour les
funérailles de telle ou telle per-
sonne dans la famille. C’est elle qui
a pleuré mon père lorsqu’il est
mort il y a quatorze ans. Malheu-
reusement, les femmes comme elle
sont en train de disparaître au
Liban. On ne fait plus appel à leurs
services. Il y a tellement de morts
maintenant qu’ils sont relégués
dans l’anonymat. »
Ali Chahrour ne tourne pas
autour du pot. Vite, il file au but,
décortique le cœur du sujet, avec
un curieux mélange de ferveur et
de détachement. Qu’il s’agisse de
Fatmeh (2014), portraits croisés
de trois femmes – Fatima Zahra, la
fille du prophète Mahomet,
Oum Kalsoum, la diva égyp-
tienne, et sa mère – ou de Leïla se
meurt (2015), ce jeune chorégra-
phe de 27 ans, musulman chiite,
sait exactement ce qu’il cible. « Les
deux pièces de ce qui va être une
trilogie sont basées sur les rituels
chiites autour de la mort et les
façons d’exprimer la catastrophe et
le chagrin, explique-t-il. Nous
n’avons plus le temps de pleurer
nos défunts. Par ailleurs, le pouvoir
considère aujourd’hui que la mort
est un devoir qui doit servir ses
objectifs. Lors des cérémonies de
deuil, les pleureuses célèbrent les
grandes figures religieuses plutôt
que les disparus, gelant toute
relation intime avec eux. Cela
change complètement le rituel.
Leïla, elle, pleure d’abord les gens
qu’elle aime. »
Située en plein centre de la ville,
à quelques mètres du Théâtre
Al-Madina qu’Ali Chahrour loue
pour présenter ses spectacles
comme tous les artistes libanais,
la petite salle de répétitions du
Houna Holistic Center est deve-
nue son QG. Une fois par semaine,
il y donne aussi des cours de
danse – impossible au Liban de
vivre de son travail de chorégra-
phe. Allongé au sol, il s’étire,
s’échauffe à coups de grands
écarts lents et longuement tenus.
Il a décidé de devenir danseur tar-
divement. « Il n’y a pas véritable-
ment d’école, ni de formation pro-
fessionnelle pour la danse ici », pré-
cise-t-il. Admis aux trois filières
universitaires qu’il avait choisies
– ressources humaines, médias et
théâtre –, il opte pour la dernière.
Lors de la deuxième année, il s’im-
merge dans le cours « danse dra-
matique » d’Omar Rajeh, figure de
la scène contemporaine, à la tête
de la compagnie Maqamat et du
festival Bipod. Il intègre sa troupe
et y fait son apprentissage pen-
dant quatre ans. Pas question
pour lui, comme pour certains de
ses collègues, de filer à l’étranger.
« Je ne voulais pas voyager, quitter
mon pays, assène-t-il. Je désirais
rester avec ma famille. Si je devais
faire de la danse, c’était ici, à Bey-
routh. Jamais d’ailleurs, je ne
m’installerai ailleurs. »
Vite, il crée son premier duo, Sur
les lèvres la neige (2011), enchaîne
avec Danas (2012), « sur la violence
quotidienne faite au corps ».
Fatmeh, qu’il considère comme sa
première pièce, marque d’emblée
son territoire. « J’ai décidé d’ouvrir
la recherche en danse contempo-
raine, explique-t-il. Je me suis
demandé quelle sorte de chorégra-
phie il fallait faire, ici, à Beyrouth.
Quel spectacle pour la société dans
laquelle je vis ? Je n’ai pas envie
d’être un artiste qui se contente
de présenter des performances. Je
veux faire face à ce qui se passe
dans mon pays et me confronter
aux questions que je me pose au
quotidien. »
Avec Fatmeh, Ali Chahrour fait
un pas de côté : il ne collabore pas
avec des danseurs professionnels
mais avec des amateurs, comme la
vidéaste Rania Al-Rafei et la
comédienne Umama Hamido.
Une décision qui estampille en
profondeur sa démarche. « Je
désire trouver une sorte de qualité
locale du geste et mettre en scène
des personnes qui racontent leur
propre histoire en proposant une
autre approche du mouvement,
affirme-t-il. Je veux aussi raconter
les grands récits du monde arabe. »
Travailler sur le « local » sans
faire « couleur locale », même si la
menace de l’exotisme pointe par-
fois le bout de son nez, est une
gageure. Surtout lorsqu’il s’agit de
retourner les couches de tradi-
tions, en particulier religieuses,
pour en ausculter les paradoxes.
Sur scène dans Leïla se meurt, Ali
Chahrour joue le mort pendant
que Leïla raconte sa vie. « Je veux
montrer la complexité du rapport
de la religion et de la politique
autour du féminin, poursuit-il. Il
s’agit pour moi de chorégraphier la
façon dont le corps dans la religion
n’est libre que dans des situations
extrêmes, telles les cérémonies fu-
néraires. Ce sont les seuls endroits
où il peut se libérer. Des femmes
peuvent même tout d’un coup arra-
cher leurs voiles lorsqu’elles sont
emportées par la douleur. Ce qui est
généralement interdit est alors par-
donné et autorisé, car il s’agit de la
souffrance et de la mort. »
Dans le contexte libanais, les
thèmes des spectacles d’Ali Cha-
hrour sont délicats. Le poids de la
censure, à laquelle il refuse de sou-
mettre ses textes, ne l’empêche
pas de poursuivre sa recherche.
« Je ne veux pas faire de compro-
mission avec quoi ou qui que ce
soit, assène-t-il. On ne doit pas
représenter la religion mais je la
respecte. Je veux simplement la
questionner au plus profond. »
Difficile d’oublier la mort à Bey-
routh. Les immeubles éventrés,
percés de traces de balles, cohabi-
tent avec des constructions flam-
bant neuf. Au pied de l’apparte-
ment d’Ali Chahrour, quelques
bidonvilles abritent des Palesti-
niens. Chaque semaine, des
explosions surviennent. L’une a
eu lieu récemment devant une
banque à quelques mètres du stu-
dio de danse. « C’est très rare dans
ce quartier, commente le choré-
graphe. Malheureusement, nous y
sommes habitués. Lorsque ça
arrive, nous appelons nos amis
pour savoir si tout va bien, et nous
retournons à nos activités. »
Au travail, donc ! Pour le troisième
volet de cette trilogie autour des
rituels et de la mort, Ali Chahrour
dégagera l’espace à cinq hommes
non-danseurs. Pour explorer « la
fragilité du monde masculin au
regard de l’image que veut en don-
ner notre société ». Encore un pas de
côté. Ainsi va Ali. p
rosita boisseau
(beyrouth, liban)
Fatmeh et Leïla se meurt,
chorégraphie et mise en scène :
Ali Chahrour. Cloître des
Célestins, du 16 au 18 juillet
et du 21 au 23 juillet, à 22 heures.
Durées : 55 minutes et 1 h 20.
« Je me suis
demandé
quelle sorte de
chorégraphie faire,
ici, à Beyrouth.
Je veux faire face
à ce qui se passe
dans mon pays »
ALI CHAHROUR
chorégraphe
0123
JEUDI 30 JUIN 2016 le festival d’avignon |19
*. $&
#!-,*+ '%*
,-")()
LECTURES, CRÉATIONS ET ÉMISSIONS
DU 8AU17JUILLET 2016 /MUSÉE CALVET /ENTRÉE LIBRE*
FRANCE CULTURE
*dans la limite des places disponibles
1
/
2
100%