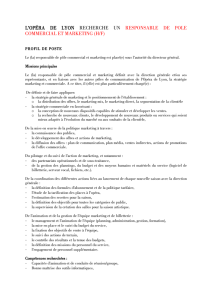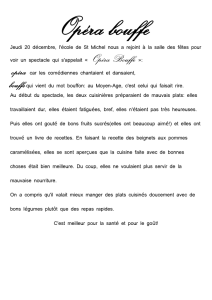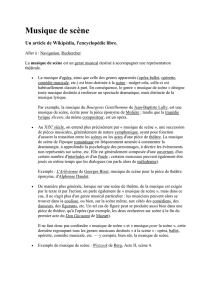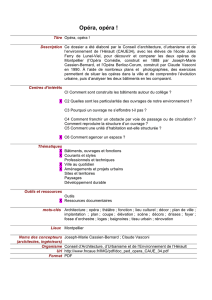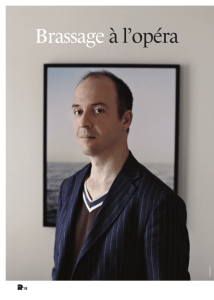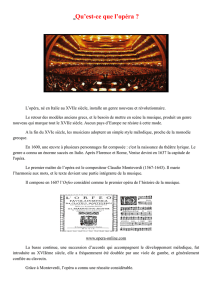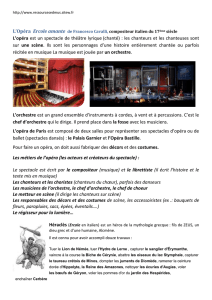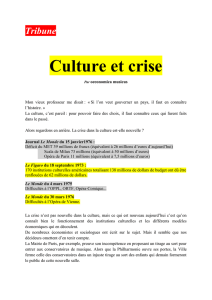introduction L`opéra en RDA - Presses Universitaires de Rennes

Introduction
L’évocation de la musique classique en République démocratique allemande
(RDA) fait surgir dans l’imaginaire collectif deux visions qui, pour être sché-
matiques et radicalement opposées, n’en sont pas moins le re et d’une certaine
réalité: d’un côté, s’impose l’image d’un pays où toutes les compositions auraient
été des commandes d’État pour des manifestations politiques ou des organisations
de masse. D’un autre côté, des noms prestigieux viennent à l’esprit: eo Adam,
Hanns Eisler, Paul Dessau, Franz Konwitschny, Kurt Masur, Peter Schreier ou
Otmar Suitner pour n’en citer que quelques-uns. Si ces musiciens de renom inter-
national œuvrèrent en RDA, c’est qu’ils y trouvèrent un environnement propice
à leur art, malgré les obstacles auxquels ils se heurtèrent tous à un moment ou
à un autre 1 . Derrière des images d’Épinal de chants de masse et de musique de
propagande se cachait probablement une réalité plus complexe.
L’opéra occupe une place toute particulière dans le domaine musical dans la
mesure où, à la di érence de la musique instrumentale, il est assorti d’une trame
dramatique. Comme au théâtre, celle-ci peut contribuer à l’éducation idéologique
du peuple. Cependant, l’héritage de l’histoire de l’opéra, genre noble, n’allait pas
de soi en RDA. L’un des buts proclamés de la politique culturelle était de faire
tomber les barrières entre classes sociales, entre artistes et travailleurs, de faire en
sorte que les ouvriers chantent en travaillant et que les compositeurs écrivent pour
ces derniers 2 . Les chants pour chœurs d’ouvriers des années 1920 constituaient de
• 1– C’est ce que la commission d’enquête «Zur Scha ung eines Geschichtsverbundes» (2006-
2007) nomme, au sujet de la vie quotidienne, «la contradiction constitutivede la RDA». S
Martin et E Rainer (éd.), Wohin treibt die DDR-Erinnerung ? Dokumentation einer Debatte,
Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2007, p.11.
• 2– Hanns Eisler disait ironiquement que l’idéal des autorités était que les travailleurs, en chan-
tant, augmentent la productivité. E Hanns, Gespräche mit Hans Bunge. Fragen Sie mehr über
Brecht, éd. Stéphanie Eisler/Manfred Grabs, Leipzig, Deutscher Verlag für Musik, 1975, p. 237.
« L’opéra en RDA », Lætitia Devos
ISBN 978-2-7535-2068-4 Presses universitaires de Rennes, 2012, www.pur-editions.fr

L’opéra en RDA- 18 -
ce point de vue un véritable réservoir. Si la République de Weimar avait été «l’âge
d’or de la musique prolétarienne 3 », l’opéra de cette même période était un héri-
tage plus contesté en RDA, car il avait été marqué par une irruption de la moder-
nité musicale. Le principal jalon en était l’opéra Wozzeck
4 d’Alban Berg d’après la
pièce de Georg Büchner, créé en 1925 au Deutsche Staatsoper de Berlin et donc
partie intégrante de l’histoire de cette prestigieuse maison située à Berlin-Est 5 .
L’opéra d’Alban Berg se penche sur l’oppression, par le Docteur, le Capitaine
et la société en général, du soldat Wozzeck, lui-même porte-parole des «pauvres
gens 6 ». C’est pour ainsi dire la «lutte des classes» qui est au centre de l’opéra.
Aussi n’aurait-il guère été surprenant que Wozzeck soit mis à l’honneur en RDA,
pays dont «l’ambition culturelle reposait, en dé nitive, sur le postulat de l’e ca-
cité des œuvres d’art 7 ». Mais les «dissonances» de l’opéra de Berg n’étaient pas du
goût des autorités. Pourtant, ces mêmes «dissonances» avaient précédemment été
quali ées de «bolchevisme culturel» par les nationaux-socialistes. Le compositeur
Paul Dessau, qui se battit pour la représentation de Wozzeck en 1955 au Staatsoper
de Berlin-Est, ne manqua pas de relever ce paradoxe 8 . Néanmoins, la vie musi-
cale en RDA ne peut se résumer à un a rontement entre artistes convaincus que
l’avant-garde politique et l’avant-garde musicale doivent marcher «main dans la
main» d’un côté, et autorités aux goûts conservateurs de l’autre. Les quarante
années du régime est-allemand ne constituent ni un bloc monolithique, ni une
ligne droite, et connurent évolutions et revirements. De nombreux débats y eurent
lieu, au nom de la «véritable» esthétique marxiste.
Les opéras d’après Georg Büchner sont emblématiques du sort de la modernité
en RDA. En e et, Georg Büchner (1813-1837) était placé sous le signe d’une
double modernité musicale et théâtrale: musicale grâce à l’opéra Wozzeck d’Alban
• 3– H Pascal, La Musique sous la République de Weimar, Paris, Fayard, 1998, p.367.
• 4– Berg intitula son opéra Wozzeck et non Woyzeck , car il n’avait connaissance, à l’époque de
la composition de l’œuvre, que de la version de Karl Emil Franzos qui reposait sur une erreur de
déchi rement du titre du manuscrit. C’est Fritz Bergemann qui établit en 1922 que le personnage
éponyme s’appelait Woyzeck et non Wozzeck.
• 5– «C’est ici qu’eut lieu un événement de premier ordre: la création de Wozzeck d’Alban
Berg le 14.12.1925. […] Wozzeck devint la référence secrète de l’histoire de l’opéra au Deutsche
Staatsoper de Berlin, et l’apparition de l’écrivain sous la forme d’un personnage sur la scène de
cet opéra, vingt-cinq ans plus tard, en 1987, dans le Büchner de Friedrich Schenker, avait presque
valeur de programme.» N Sigrid und Hermann, Deutsche Oper. DDR 1949-89, Berlin, Peter
Lang, 1992, p.25.
• 6– « Wir arme Leut’ ». Opéra Wozzeck d’Alban Berg, I,1.
• 7– P Jacques, « Culture et politique », Allemagne d’aujourd’hui , n°118, oct.-déc. 1991,
p. 143.
• 8– S B (éd.), Programmheft «Wozzeck» (Berg ), Berlin, Druckhaus, 1955 (pas
de pagination).
« L’opéra en RDA », Lætitia Devos
ISBN 978-2-7535-2068-4 Presses universitaires de Rennes, 2012, www.pur-editions.fr

Introduction - 19 -
Berg ; théâtrale car les expressionnistes avaient trouvé, lors de la redécouverte de ses
pièces au début du
e siècle 9 , un écho à leurs préoccupations et à leur esthétique.
Or, l’expressionnisme avait fait l’objet d’une intense discussion dans les milieux
intellectuels communistes pendant les années 1930, puis d’une condamnation en
RDA. Par ailleurs, dans l’histoire littéraire, Büchner était celui qui occupait une
place orpheline, entre le classicisme et le romantisme, et qui ne s’intégrait donc
pas à la vision dualiste de l’histoire littéraire qui était véhiculée en RDA. Parmi les
marxistes, seuls les prestigieux critiques littéraires Georg Lukács et Hans Mayer
avaient réussi à surmonter les contradictions inhérentes à son œuvre (cf. p.59) et
l’avaient présenté, à quelques nuances près, comme le précurseur de Marx. Mais
dès lors que Lukács et Mayer furent mis au ban de la vie intellectuelle est-alle-
mande, on se mé a également de leur analyse. On ne pouvait toutefois se résoudre
à éradiquer complètement Büchner de «l’héritage», lui qui avait écrit et di usé en
1834 le pamphlet révolutionnaire Le Messager hessois , au risque d’être poursuivi.
Il était di cile de surmonter la dichotomie entre la vie et l’œuvre de l’écrivain.
La caractéristique principale des pièces de Büchner, s’il fallait n’en retenir qu’une,
est en e et leur signi cation ouverte, la multiplicité des interprétations qu’elles
permettent. Ainsi, si dans l’atmosphère de la révolution de novembre1918 ou
de la crise de 1929, le drame La Mort de Danton fut vu comme une pièce à thèse
révolutionnaire 10, au plus fort de la guerre froide, ce drame servit, en Allemagne
de l’Ouest, à dénoncer la dictature communiste 11. En RDA, le drame fut tout
simplement ignoré des théâtres pendant deux décennies, à l’exception d’une mise
en scène, dans une version largement revue et pro-révolutionnaire, à Rostock en
1962. Comme le constate Jan-Christoph Hauschild, dans le drame d’origine,
«les personnages principaux sont pleins de contradictions, ils doutent d’eux-
mêmes, et cela empêche de faire d’eux de véritables héros 12». De même, il faut
bien reconnaître que la tragédie Woyzeck «ne contient pas d’appel explicite à la
• 9– Édition de ses œuvres en 1879 par Karl Emil Franzos. La première représentation de Woyzeck
(orthographié Wozzeck à l’époque) au théâtre eut lieu en 1913 au Residenztheater de Munich grâce
à Hugo von Hofmannsthal. Voir B Bernard, L’Opéra selon Richard Strauss. Un théâtre et son
temps, Paris, Fayard, 2000, p.247. Léonce et Léna fut créé le 31mai 1895 à Munich au cours d’une
représentation privée en plein air. La pièce ne fut jouée à nouveau qu’à partir de 1912 (Düsseldorf).
La Mort de Danton fut donnée une première fois par des étudiants amateurs à Zürich-Fluntern
au début des années 1890, puis créée en janvier 1902 au Belle-Alliance- eater de Berlin. Max
Reinhardt en t une mise en scène restée dans les mémoires au Deutsches eater de Berlin en
décembre 1916.
• 10– V Wolfram, Georg Büchners « Dantons Tod » auf dem deutschen eater , Munich,
Laokoon, 1964, p. 120-140.
• 11– Ibid. , p.296 sq .
• 12– H Jan-Christoph, Georg Büchner. Reinbek, Rowohlt Taschenbuch Verlag, 2004,
p.87. Traduction de Christian Bounay, Nime, Jacqueline Chambon, 1995, p.113.
« L’opéra en RDA », Lætitia Devos
ISBN 978-2-7535-2068-4 Presses universitaires de Rennes, 2012, www.pur-editions.fr

L’opéra en RDA- 20 -
révolution 13». Si la comédie Léonce et Léna repose sur une parodie du genre et
une mise à distance permanente, sa complexité va au-delà de celle des comédies
romantiques allemandes. Il est di cile de reconstituer les intentions de Büchner,
qui semble partagé entre une admiration sincère pour certains romantiques et le
besoin de s’en détacher.
Les pièces de Büchner non seulement soulevaient des questions déplaisantes,
mais elles prenaient le contre-pied ou se moquaient des normes esthétiques théâ-
trales. Sa dramaturgie était ouverte, inachevée, fragmentée, en un mot, anti-cano-
nique. Aussi peut-on se demander si la création de plusieurs œuvres lyriques d’après
la vie ou l’œuvre de Georg Büchner au tournant des années 1970-1980 était révé-
latrice d’un changement de paradigme dans l’esthétique de l’opéra en RDA.
Après trente années de quasi-absence de Büchner sur la scène lyrique, où seul
l’opéra Léonce et Léna de Kurt Schwaen (créé en 1961 au Staatsoper de Berlin)
témoignait que Büchner n’était pas inconnu des compositeurs est-allemands, en
une décennie, la dernière, quatre opéras d’après la vie et l’œuvre de Büchner
furent créés dans le petit pays qu’était la RDA: Léonce et Léna de Paul Dessau en
novembre1979 au Staatsoper de Berlin ; l’opéra du même nom de omas Hertel,
après deux ans d’attente, vit le jour à Greifswald en 1981 ; Friedrich Schenker
acheva quant à lui en 1981 son opéra Büchner , qui ne fut créé que six ans plus
tard au Staatsoper de Berlin. Le même compositeur fut chargé de composer un
opéra radiophonique pour le bicentenaire de la Révolution française, opéra qu’il
intitula Die Gebeine Dantons («Les ossements de Danton») d’après La Mort de
Danton et qui fut di usé à la radio DDR II en 1989 dans une version de concert
et en 1991 dans la version radiophonique.
Nous avons à faire à des opéras composés en apparence indépendamment les
uns des autres, émanant de compositeurs de générations et d’horizons di érents:
Kurt Schwaen (1909-2007), compositeur en phase avec la politique culturelle est-
allemande, eut le mérite de faire revenir Büchner dans les maisons d’opéra, même
si la comédie de Büchner était, dans cette œuvre, considérablement assagie et mise
en conformité avec les attentes musicales et idéologiques des autorités . Le deuxième
opéra Léonce et Léna de RDA était radicalement di érent: de la plume de l’un
des compositeurs est-allemands les plus connus et in uents, Paul Dessau (1894-
1979), alors âgé de 85 ans, cet ultime opéra tranchait sur toutes les autres œuvres
du compositeur par une sorte de pointillisme musical. Le livret de omas Körner
était énigmatique, composé de bribes de la pièce de Büchner dont les scènes étaient
reprises dans un ordre rétrograde. Léonce et Léna fut aussi le sujet choisi par le
• 13– S Robert, «Présentation de Woyzeck », B , Œuvres complètes , édition publiée
sous la direction de Bernard Lortholary, Paris, Le Seuil, 1988, p. 236.
« L’opéra en RDA », Lætitia Devos
ISBN 978-2-7535-2068-4 Presses universitaires de Rennes, 2012, www.pur-editions.fr

Introduction - 21 -
jeune omas Hertel (né en 1951), habituellement chargé de la musique scénique
au théâtre de Dresde, pour son premier opéra. Sa composition ressemblait à un
patchwork de citations musicales et le livret était très proche de la comédie origi-
nale. Quant à Friedrich Schenker (né en 1942), il était l’un des ardents défenseurs
de la modernité musicale en RDA, membre-fondateur de l’ensemble de musique
contemporaine «musique nouvelle Hanns Eisler» à la pointe de l’avant-garde.
Son opéra Büchner , sur un livretque le dramaturg
14 Klaus Harnisch avait écrit à
partir des œuvres et de la vie de Büchner, présentait dans une musique déchirée et
chaotique les délires de Büchner sur son lit de mort. Les Ossements de Danton , sur
un texte de Karl Mickel, allait encore plus loin dans le déchirement et la fragmen-
tation, ne gardant du drame de Büchner que des «ossements».
Comment expliquer le recours quasi-simultané de plusieurs compositeurs et
librettistes à Büchner ? Quelles intentions y avait-il derrière ces réécritures ? Un
compositeur comme Paul Dessau par exemple, écrivit l’opéra Léonce et Léna à la
toute n de sa vie, dans un style qui tranchait radicalement sur le reste de son
œuvre. Sans doute faut-il y voir comme une sorte de synthèse opérée par celui
qui avait connu, de l’exil à la RDA, toutes les polémiques liées aux questions
esthétiques au sein du mouvement communiste. Il en va de même pour Friedrich
Schenker, qui, certes, était plus jeune que Dessau et n’avait ni connu l’exil ni
participé de manière consciente à la construction de la RDA, mais qui était un
disciple de Paul Dessau, et avait eu l’écho des expériences de son maître. La taille
relativement petite du pays et de ses cercles musicaux et intellectuels, dont on sait
que, malgré la surveillance dont ils étaient l’objet, on y discutait et échangeait
beaucoup, permit d’établir une continuité entre les générations. Certaines voix,
même si elles furent condamnées un temps au silence, bâillonnées par la répression
de la politique culturelle (par exemple celles de Lukács, Bloch et Mayer), in uen-
cèrent l’arrière-plan esthétique de nombreux artistes.
Il était audacieux de recourir à un écrivain qui, loin de donner du monde une
image achevée, parfaite, recourait à la fragmentation, tant du discours que de
l’univers représenté. En entreprenant une réécriture de Büchner, compositeurs
et librettistes prenaient eux-mêmes position à l’égard de la question aussi bien
• 14– Nous gardons le terme allemand de dramaturg , car le terme «dramaturge» peut prêter à
confusion en français, cette fonction étant encore peu répandue chez nous: il s’agit d’un conseiller
littéraire et dramatique chargé d’assister le metteur en scène dans son interprétation. Christian
Merlin en donne la dé nition suivante : «Un intellectuel salarié par le théâtre, qui élabore la
conception du spectacle avant d’en laisser le soin de la réalisation au metteur en scène.» M
Christian, «Avant-propos», Le pouvoir de la musique dans l’espace de langue allemande : fascination
et suspicion, Avant-scène opéra, n°36, juin 2005, p.11. Voir aussi la table ronde «dramaturges et
dramaturgies au théâtre» organisée par le laboratoire junior Agôn, [http://agon.ens-lyon.fr/index.
php?id=1049] (11-10-2011).
« L’opéra en RDA », Lætitia Devos
ISBN 978-2-7535-2068-4 Presses universitaires de Rennes, 2012, www.pur-editions.fr
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
1
/
10
100%