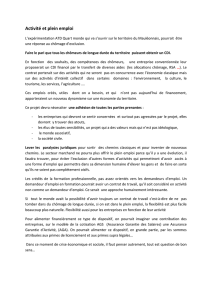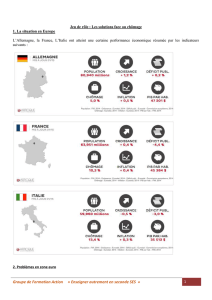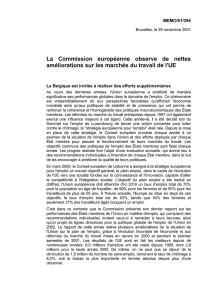Le chômage

http://www.lyc-arsonval-brive.ac-limoges.fr/jp-
simonnet/spip.php?article734
Une typologie du chômage.
Dans leur manuel de macroéconomie Olivier Blanchard et Daniel
Cohen [1] utilisent une métaphore pour montrer qu’un même taux
de chômage peut traduire des situations différentes. Un très grand
nombre de personne peuvent être au même moment dans un
aéroport (ou une gare) pour au moins deux raisons : un trafic
particulièrement dense avec beaucoup de départs et d’arrivées
d’avions (ou de trains) ce qui provoque un va et vient important de
voyageurs et leur présence en grand nombre, ou bien une
circonstance particulière interdisant les départs, le mauvais temps
ou une grève, ce qui provoque l’engorgement des lieux
d’embarquement. Par analogie, un nombre élevé de chômeurs peut
résulter de l’existence d’un très grand nombre de sorties de l’emploi
confrontées à beaucoup d’embauches, ou à un marché du travail
sur lequel ceux qui sont au chômage le reste longtemps. Les
comparaisons entre les taux de chômage et les caractéristiques
des chômeurs en France et aux États-Unis par exemple illustrent
cette distinction. Le marché du travail en France est moins réactif
qu’il ne l’est aux États-Unis.
Le chômage : stocks et flux
Pour comprendre la nature du chômage à un moment donné il faut
prendre en compte les flux qui s’établissent entre 3 groupes de
personnes : ceux qui peuvent être actifs et qui ne le sont pas
encore, ou ne le sont plus ou ne le seront jamais (les inactifs en
âge d’être actifs), ceux qui ont un emploi (les actifs occupés), ceux
qui sont sans emploi mais qui en cherchent un (les chômeurs).
Ensemble ces trois catégories constituent la population en âge de
travailler ou population active potentielle. Les économistes
mesurent le taux de chômage en faisant le rapport du nombre de
chômeurs à la population active (actifs occupés + chômeurs). Ils
calculent aussi le taux d’emploi en faisant le rapport du nombre
d’emplois à la population en âge de travailler (actifs occupés +

chômeurs + inactifs). Comme la mesure du chômage est discutée
en raison des problèmes de définition (voir cet article), il est évident
que s’en tenir au taux de chômage pour apprécier la situation de
l’emploi n’est pas une bonne solution. L’analyse est utilement
complétée par le calcul du taux de non-emploi en faisant le
rapport du nombre de personnes sans emploi en âge de travailler
(chômeurs + inactifs) à la population en âge de travailler (actifs
occupés + chômeurs + inactifs). Cet indicateur traduirait peut être
mieux que le taux de chômage la situation de la population en
matière d’emploi. [2]
Flux trimestriels moyens entre emploi, inactivité et
chômage.
(France métropolitaine, population de 15 à 64 ans).
Source : calculs à partir des données INSEE et INED pour 2005.
Cette figure montre qu’en 2005, chaque trimestre en moyenne il y a
eu 165 000 emplois occupés supplémentaires alors que dans le
même temps, 135 000 personnes de plus passaient par le
chômage.
Ainsi le chômage ne correspond pas à un réservoir de personnes
dont le statut est figé. La durée de présence dans ce réservoir est
une caractéristique essentielle qui conduit à opposer des formes de
chômage.

Certains sont durablement exclus de l’emploi en raison de leur
qualification inadaptée ou de leur âge, d’autres sont très
rapidement embauchés mais sur des emplois précaires et de ce fait
se retrouvent régulièrement au chômage. Dans le premier cas on
parle de chômage d’exclusion (l’indicateur est le taux de chômage
de longue durée) dans l’autre cas on parle de chômage de
précarité (les indicateurs sont nombreux et renvoient aux différents
types d’emplois). L’origine du chômage, repérée par le statut
antérieur du chômeur (CDI temps plein, temps partiel, CDD, en
formation, retiré de l’activité pour d’autres raisons...) est un autre
élément d’appréciation.
Tous les chômeurs partagent les caractéristiques qui permettent de
les ranger dans la population active sans emploi. Cependant, il peut
être commode de désigner par des expressions appropriées des
formes de chômage renvoyant à des causes facilement repérables.
Cette typologie n’épuise pas la question de l’analyse du chômage
mais elle permet d’éviter de traiter le chômage comme un
phénomène indifférencié.
Une première distinction importante peut être établi entre une
composante structurelle et une composante conjoncturelle du
chômage. Pour observer les cycles économiques, les économistes
comparent la croissance tendancielle (ou potentielle) et la
croissance effectivement réalisée. Ils procèdent de la même
manière pour le chômage. Le chômage structurel est celui qui
correspond au « fonctionnement normal » de l’économie, le
chômage conjoncturel correspond au supplément de chômage
provoqué par un ralentissement de l’activité économique.
L’évolution de long terme du taux de chômage en France suggère
une périodisation assez simple.

Jusqu’au milieu des années 1980 le taux de chômage augmente
régulièrement ; il varie ensuite autour de 9 à 9,5 %.
Source : INSEE et Minefi (les taux de chômage du premier
graphique ne sont rigoureusement équivalents à ceux du second -
moyenne annuelle contre valeur de fin d’année et variation de la
définition BIT).
On voit bien que lorsque la croissance économique devient plus
faible, le taux de chômage augmente et inversement même si on

observe clairement un décalage, un temps de réaction (de même
en cas de reprise de l’activité).
Composante conjoncturelle du chômage
Dire que le nombre des chômeurs augmente quand l’activité
économie est moins importante semble assez évident. Pourtant ce
n’est peut être pas aussi simple.
(….)
Un ralentissement de la croissance économique ou une véritable
récession ont un effet négatif sur l’emploi. Mais les entreprises
peuvent adopter des attitudes différentes. Le plus souvent elles
commencent par modifier l’organisation du travail (réduction du
temps) et inciter les salariés âgés à quitter l’entreprise en même
temps qu’elles cessent d’embaucher. Si cela ne suffit pas à adapter
le volume de travail disponible aux besoins réduits par le
ralentissement d’activité, elles peuvent licencier des salariés.
Une illustration : ces vidéos montrant comment la diminution de la
demande peut entraîner un « chômage partiel » [3] (non
comptabilisé comme chômage dans les données publiées puisque
les salariés ne deviennent pas demandeurs d’emploi), un arrêt des
embauches (réduction des contrats d’intérim) avant d’envisager des
licenciements.
(…….)
En situation de croissance économique lente, c’est-à-dire lorsque le
taux de croissance est inférieur au taux de croissance potentiel, le
chômage augmente. Un taux de chômage élevé confronté à une
stratégie de réduction des embauches rend la possibilité de sortir
du chômage plus improbable (il y a moins d’emplois vacants pour
plus de chômeurs). Un taux de chômage élevé ajouté à une
stratégie de licenciements élève mécaniquement le risque pour
ceux qui ont un emploi de le perdre. Ainsi plus le chômage est
élevé, plus le risque d’être chômeur augmente et plus la possibilité
de sortir du chômage se réduit.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
1
/
9
100%