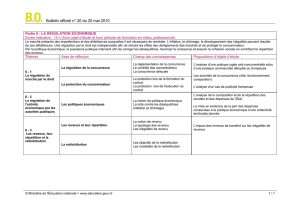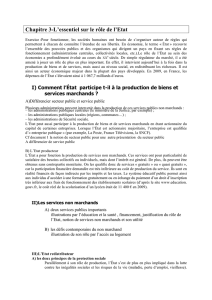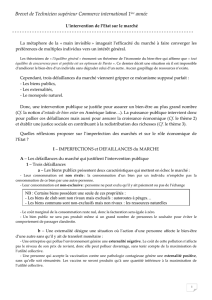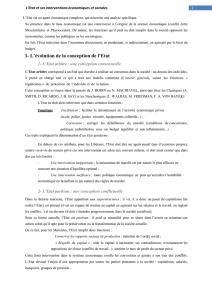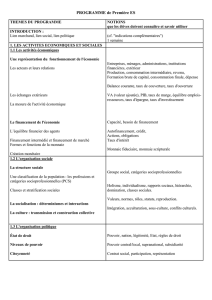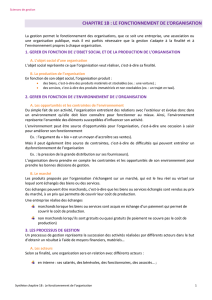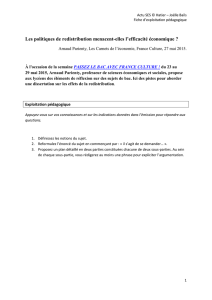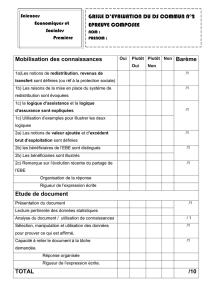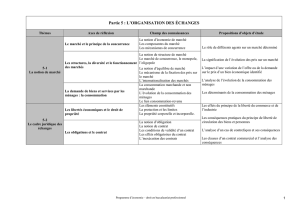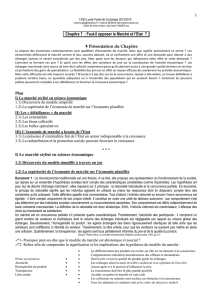Corrigé devoir du vendredi 25 mai PARTIE 1

Corrigé devoir du vendredi 25 mai
PARTIE 1 - MOBILISATION DES CONNAISSANCES (6 POINTS)
Q1 – En quoi un groupe social se distingue-t-il d’une catégorie statistique ? (3pts)
Les catégories statistiques, comme les PCS définies par l'INSEE, sont des subdivisions créées par le statisticien, à partir d'un
certain nombre de critères. Si elles partagent davantage de points communs avec un groupe social que le simple agrégat
physique (rassemblements d'individus en un espace donné, bouchon, file d'attente par ex.. qui ne partagent a priori rien d'autre
que la raison qui les pousse à se trouver à cet endroit), elles ne constituent pas pour autant des groupes sociaux, ceux-ci sont
davantage que de simples collections d'individus.
En effet, un groupe social est caractérisé par deux critères :
- Les individus doivent être en interaction ou avoir des rapports sociaux qui obéissent à des règles préétablies (critère objectif) ;
- Ils doivent se définir eux-mêmes comme membres du groupe et être définis par les autres comme étant membres du groupe
(critères subjectifs).
Q2 - Caractérisez la fonction d’allocation des ressources de l’Etat. (3pts)
L’allocation des ressources est le processus par lequel les facteurs de production disponibles dans une économie sont affectés
aux différents usages économiques possibles. Les marchés contribuent fortement à cette allocation des ressources, mais leur
fonctionnement peut aboutir à des situations non optimales. Afin d’y remédier, l’Etat intervient dans l’économie et modifie ainsi
l’allocation des ressources. Il peut le faire de diverses manières : activités de production (notamment en cas de biens collectifs
où l’Etat doit se faire producteur afin que divers services indispensables puissent être mis à la disposition de la collectivité ou
en cas de monopoles naturels où les coûts fixes sont si importants que seul un unique offreur peut réaliser les économies
d’échelles lui permettant de les amortir ), incitations en direction des autres acteurs économiques (notamment en cas
d’externalités c'est-à-dire quand on a des situations dans lesquelles l'action de consommation ou de production d'un acteur a
des conséquences sur le bien-être d'au moins un autre acteur sans que cela ne donne lieu à une transaction sur un marché et à
une compensation monétaire, qu’elles soient positives ou négatives) ou dans le cadre de politiques de la concurrence.
PARTIE 2 - ÉTUDE D’UN DOCUMENT (4 POINTS)
Doc : Revenus moyens par équivalent adulte pour 2010 pour chaque quintile(1) de population
En €
Q1 : 20% des
moins aisés
Q2 : 20%
suivants
Q3 : 20%
suivants
Q4 : 20%
suivants
Q5 : 20% des
plus aisés
Q5/Q1
Revenu avant
redistribution
7400
15 489
21 191
28 243
53 582
7.2
Revenu après
prélèvements seuls
6 960
14 231
18 725
24 114
42 961
6.2
Revenu disponible
11 293
15 649
19 792
24 933
43 561
3.9
Source : D’après Marie-Cécile Cazenave, Jonathan Duval, Alexis Eidelman, Fabrice Langumier et Augustin Vicard, « La redistribution : état
des lieux en 2010 et évolution depuis 20 ans », INSEE, 2011
(1) : Quintiles correspondent aux valeurs du caractère observé qui partagent l’effectif en cinq parties égales (de Q1 à Q5).
Question : Quels sont les effets de la redistribution sur les inégalités ?
Le document proposé est un document statistique publié par l’INSEE en 2011, extrait lui-même d’un article collectif faisant un
état des lieux de la redistribution depuis 20 ans. Il présente les revenus des ménages en 2010 classés par quintiles (Q1 à Q5),
leurs montants en € avant redistribution, après prélèvements ainsi que leurs revenus disponibles respectifs. Dans une dernière
colonne est aussi donné le rapport interquintile.
Nous pouvons ainsi faire plusieurs constats quant aux effets de la redistribution sur les inégalités. La redistribution est l’action
de L’Etat consistant à prélever des impôts et des cotisations sociales afin de verser ensuite des prestations sociales.
Premièrement, on observe que plus les ménages sont aisés, plus ils sont ponctionnés (à peu près 400€ pour Q1 et un peu plus de
10 000€ pour Q5). En conséquence, le revenu disponible moyen (revenus primaires + revenus de transfert – impôts et
cotisations) des 20% les moins aisés est supérieur de 3893€ à leur revenu avant redistribution ; à l’inverse, les 20% les plus
aisés perdent en moyenne 10 021€ à la redistribution.
D’une façon générale, on peut constater que l’écart entre les revenus des 20% les plus aisés (Q5) et ceux des 20% les moins
aisés (Q1) diminue sous l’action de la redistribution : les premiers qui étaient 7.2 fois plus élevés avant redistribution le sont 6.2
fois plus après prélèvements et disposent d’un revenu disponible « seulement » 3.9 fois plus important que les seconds, attestant
les effets positifs de la redistribution sur les inégalités de répartition des revenus primaires.

PARTIE 3 – RAISONNEMENT S’APPUYANT SUR UN DOSSIER DOCUMENTAIRE (10 POINTS)
Sujet : « Vous montrerez que le marché n'est pas le seul moyen efficace
d’organiser les échanges. »
I – Au brouillon : Analyse des mots clés et définitions
- Marché : lieu de rencontre réel ou fictif entre une offre et une demande (ex : marché des biens et services, marché financier,
marché du travail,…)
- efficace : allocation optimale des ressources
- seul moyen : il y a d’autres mécanismes, non marchands (État, association, échanges informels)
- échanges : action par laquelle on donne et reçoit en contrepartie.
II - Mobilisation des connaissances et analyse des documents :
Contenu
Lien avec le sujet
Connaissances
vues en cours
CHAPITRE 4 :
- définition du marché
-thèse d’A. Smith + efficacité de la division du travail
+ extension des rapports marchands
- l’importance du non marchand (notion de don +
doc3 du sujet vu en cours !) + tableau de synthèse
CHAPITRE 5 :
- La main invisible + notion d’optimum
- la CPP + notion d’efficacité du marché
CHAPITRE 6 :
- les défaillances de marché
- notions d’externalités, de biens collectifs et
d’asymétrie d’information
CHAPITRE 12 :
- fonction d’allocation des ressources
Doc.1
Doc factuel sur le développement industriel de la
Chine et son succès dans le commerce mondial.
Les premiers succès s’expliquent par le passage du
communisme à l’économie de marché
Liens économie de marché et efficacité : possibilité
d’investissements importants, et de croissance avec
l’exemple de la Chine.
Texte positif vis-à-vis de l’économie de marché :
possibilité de libre entrée des facteurs de production
et illustration par la réussite d’une entreprise
française délocalisée en chine
Exemple de Tockheim : implantation (délocalisation)
a permis le rattrapage technologique ; succès sur le
marché chinois puis mondial. A permis aussi de créer
des emplois en France (nouveaux clients)
- il vaut mieux parler d’émulation que de concurrence
- et de complémentarité avec Hong Kong
Avantages directs : compétitivité plus élevée,
augmentation des parts de marché ;
Avantages indirects : retombées économiques, ex de
Canton devenue un centre névralgique pour
différentes entreprises françaises => emplois gagnés
(contrepartie de ceux perdus ?)
Montre l’efficacité du marché : l’ouverture permet la
diffusion du PT, incite à être plus compétitif et donc
génère de la croissance et de l’emploi
Smith (main invisible), analyse néoclassique.
=> Mise en avant des avantages du marché et de son
efficacité : rappel 5 hypothèses de la CPP
=> Liens taille du marché et croissance économique
=> Intervention de l’Etat toutefois pour les
infrastructures : Etat régulateur (fonction économique
de l’Etat) : à relier à Musgrave
Doc.2
Doc factuel : explosion d’une plateforme pétrolière
de BP : coût de 8Mds, chute du titre en bourse
Obama considère BP comme responsable « BP
paiera » les coûts de la catastrophe écologique
Mais les courtiers restent rassurants
Exemple d’une intervention de l’Etat : gouvernement
américain vient au secours d’une entreprise connue
mondialement BP, pour l’extraction de pétrole et afin
de stopper une fuite de pétrole.
Le marché peut générer des externalités
négatives (ici, pollution due à une explosion
nécessite l’intervention de l’Etat (normes,…) et seul
l’Etat a le pouvoir de contraindre l’entreprise à régler
le problème.
Ms aussi efficacité du marché car BP en paye les
frais, et le marché sanctionne !
=> Fonction d’allocation des ressources en cas de
défaillance du marché.

Doc.3
Doc stat sur les services informels entre ménages.
Selon la revue « Economie et statistiques », datée de
2003, 48.1% des individus interrogés déclarent avoir
rendu des services informels (à leur famille ou amis)
au cours des 4 semaines précédant l’enquête.
Ils s’agit alors d’un acte de bénévolat, les services
rendus n’étant pas rémunérés.
Leur fréquence moyenne était de 10.2 fois sur cette
période de 4 semaines, en distinguant les services
informels rendus à la famille, plus nombreux (10.6
fois en moyenne) de ceux rendus aux amis.
Les services informels les plus souvent rendus sont
les services à la personne (s’occuper d’adultes, 8.8
fois en moyenne) ou simple garde d’animaux (8.7
fois en moyenne). Ils relèvent également de travaux
ménagers (préparation des repas, 6.7 fois en
moyenne).
Taux de participation toutefois reste le plus élevé
pour des tâches pratiques (faire les courses : taux de
participation de 19.5% ; bricolage : 11% ou la simple
garde d’enfants : 16.1%)
=> Services informels relèvent des échanges non
marchands rendus à des personnes par d’autres
personnes sans contrepartie monétaire ;
=> Marché ici qui ne joue pas de rôle : échanges
peuvent se faire sans le marché, et sont facteurs de
lien social.
Type d’échange qui ne passe pas par le marché
Peut réduire les inégalités, palier à certaines
défaillances du marché et de l’Etat.
Notion de don – contre-don
Doc.4
Montre que l’Etat produit des services non
marchands (éducation, défense, recherche, sécurité
Document statistique du ministère des Finances sur le
projet de loi de finances, rappelant les missions
essentielles de l’Etat et les possibilités de faire des
choix dans les dépenses budgétaires
Sur un total de 250 milliards d’€ de dépenses
(arrondis), 60 sont consacrés à l’enseignement
scolaire (25%), 47 à la défense (presque 20%), même
montant pour la charge de la dette (46milliards)
Rend compte des priorités étatiques à un instant « t »,
ici l’année 2009.
Notion de services collectifs. A relier aussi aux
défaillances du marché
=> Fonction de régulation et de stabilisation de l’Etat
via le budget : fonction qui consiste à lutter contre les
déséquilibres et à lisser les fluctuations de l’activité
économique, à travers des politiques conjoncturelles
budgétaire et monétaire.
=> référence aux missions régaliennes de l’Etat :
même si marché autorégulateur, Etat se doit
d’intervenir pour pallier à certaines défaillances du
marché.
=> Défaillances du marché : laissé à son libre
fonctionnement, le marché peut aboutir à des
conséquences non voulues des acteurs économiques
concernant leurs activités de production et c’est alors
que l’Etat doit intervenir.
=> Plusieurs types de défaillances : externalités,
biens collectifs, monopole naturel, encadrement du
marché par des règles de droit
Fonction d’allocation des ressources
III) Structuration du raisonnement (les différents éléments attendus)
a) Introduction
- Accroche : référence à l'actualité, à l'histoire ou à un document permettant de montrer l'intérêt du sujet. Ex : loi de
finances2011 votée par l’ancien gouvernement, actualité concurrence chinoise, etc.
- Définition des termes : marché ; échanges marchands et non marchands
- Reformulation de la question posée : l’existence d’autres moyens plus efficaces que le marché pour organiser les échanges et
pourquoi.
- Annonce du déroulement du raisonnement = annonce du plan suivi = annonce des différents paragraphes.
b) Organisation logique des arguments
1) Rappel efficacité du marché selon la théorie libérale et fonction d’allocation des ressources.
2) Néanmoins, le marché n’est pas toujours efficace pour organiser ces échanges et nécessaire intervention de l’Etat pour
pallier aux défaillances.
3) De plus, marché n’est pas le seul à organiser efficacement des échanges : certains sont informels et non marchands

c) Conclusion
- Synthèse de la réponse apportée à la question posée
- Ouverture sur une problématique connexe, par ex, les S.E.L aujourd’hui ou l’échange de savoir-faire. Ou encore, la nécessité
d’encadrer les marchés boursiers, etc.
IV - Proposition de plan :
I- Le marché comme moyen efficace d’allocation des ressources (théorie + doc1 et 2)
- La thèse d’Adam Smith puis des néoclassiques, notion d’optimum. + idée que le marché est « juste » (ex : BP est sanctionnée
sur les marchés financiers (doc.2)
- Exemple du document 1 : l’ouverture à l’économie de marché améliore l’efficacité des facteurs de production, au niveau local
et international (échange gagnant – gagnant)
II- Le rôle de l’État pour palier aux défaillances du marché (fonction d’allocation – doc2 et 4)
- Le marché ne peut produire certains biens (biens collectifs), l’Etat doit donc prendre en charge leur production
- L’Etat a aussi des missions de service public, et produit des services non marchands (ex : éducation –doc4)
- Le marché a aussi besoin de règles pour être efficace (ex du doc2)
III- L’importance des échanges informels non marchands comme moyen de satisfaire les besoins (doc3)
- Constat du doc.3 avec illustration
- Analyse : ces échanges sont réalisés en dehors de la sphère marchande et de la sphère de l’Etat et permettent de satisfaire des
besoins.
- Le rôle des associations (le « tiers secteur » économie sociale et solidaire)
1
/
4
100%