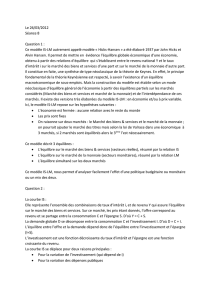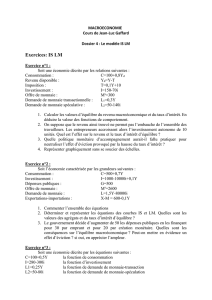TD2 : monnaie 2/02/2011 Dossier n°2 : Pourquoi définit

TD2 : monnaie 2/02/2011
Dossier n°2 :
Pourquoi définit-on des agrégats monétaires ?
Le calcul d’agrégats d’actifs monétaires vise a informer la conduite de la politique monétaire par
l’estimation de la quantité de monnaie en circulation, il s’agit de connaitre la capacité de dépense
des agents. C’est que le volume et le caractère plus ou moins facilement mobilisable de cette
capacité de dépense, ne sont pas sans influence sur le niveau général des prix ( ce problème se pose
dans une perspective monétariste) ou sur l’activité économique elle-même.
Depuis janvier 1999 a partir du bilan consolidé des IFM ( institution financière et monétaire= banques
centrales, OPCVM, ACDC) l’euro système définit trois agrégats emboités selon leur degrés de
liquidité :
- M1 : c’est la monnaie au sens étroit.
- M2 : c’est ce que l’on appel la quasi monnaie.
- M3 : c’est la monnaie au sens large.
LES ACTIFS MONETAIRES :
Liquidité : capacité d’un actif quelconque a être plus ou moins immédiatement (rapidement et
commodément) convertibles en monnaie et donc utilisable en moyen de paiement de biens et
services quelconques.
Remarque : la liquidité est une propriété émergente de la monnaie.

Dans quel mesures les actifs liquides sont-ils de la monnaie ?
Les actifs liquides (M3-M1) sont de la monnaie à la mesure de la rapidité et du cout de leur
conversion en monnaie au sens stricte.
Sur quels critères est fondée la décomposition de la masse monétaire en différents
agrégats ?
La décomposition de la masse monétaire en différents agrégats est fondée sur deux principes :
- Une définition harmonisée des acteurs résidents détenteurs de monnaie (ANFRAIF agents
non financiers résidents et autres intermédiaires financiers) les ANFRAIF :
o Les ménages.
o Les sociétés non financières.
o Les administrations publiques hors états, c'est-à-dire hors administrations centrales :
Les gouvernements d’états fédérés et les administrations de sécurité sociale.
o ISBLSM
o Les autres intermédiaires financiers : assurance etc.
- Une définition harmonisée des acteurs émetteurs de monnaie dans la zone euro, c’est ce que
l’on appel les IFM les institutions financières et monétaires. (doc 2)
Remarques les 6 institutions de la comptabilité nationale :
- Ménage
- Entreprises
- Banques
- Administrations publiques
- ISBLSM
- RDM reste du monde.
A partir du bilan agrégé des IFM des catégories d’exigibilité des engagements sont établies en
fonction de leur degrés de liquidité, c’est sur cette base qu’ont été défini les agrégats monétaires.
Deux choses importantes :
1) Les agrégats ne comprennent que les actifs émis par les IFM.
2) Les agrégats ne comprennent que les actifs détenus par les ANFR.

IFM
Actif (avoir)
Passif (devoir)
Créances/résidents :
- Privés
- publics
Créances/ reste du monde.
Autres actifs.
M3.
Engagements non monétaires.
Création monétaire (grosso modo) :
Banque
actif
passif
Promesse de payer dette
100 u signature ANF 2
Promesse de payer 100
u dette signature
Banque 3
1
Quel est l’objectif premier de la BCE ?
L’objectif « principal » ( principal c'est-à-dire non exclusif mais lexicographique) de la banque
centrale européenne (crée en juillet 1998) est défini par l’article 105.1 du traité de Maastricht de
1992 au chapitre protocole SEVC : « la stabilité des prix » ( a vrai dire l’expression stabilité des prix
n’a toujours pas été défini précisément, reste que jusqu’en 2003 la BCE a pris le parti d’interpréter ce
mandat constitutionnel par inflation inférieur ou égale à 2%). A partir de 2003 dans un texte qui est
le communiqué du conseil de la BCE du 8 mai 2003, va s’opérer une symétrisation de l’objectif de la
politique monétaire, a partir de la stabilité des prix est interprété par un taux d’inflation proche de
2%.
Pour se faire il s’agit d’ajuster le volume de monnaie en circulation au volume des échanges réalisés,
selon la logique que l’on appelle la théorie quantitative de la monnaie de Fisher MV=PQ la banque
centrale va agir sur la quantité de monnaie pour atteindre les prix.
ménages
actif
passif
Promesse de payer
dette : 100 u signature
ANF.

Comment la BCE justifie-t-elle le choix de M3 comme agrégat de référence pour la conduite
de sa politique monétaire ?
La BCE a choisi M3 comme agrégat de référence pour la conduite de sa politique monétaire car :
- M1 a une évolution plus instable que M3 du fait de sa plus grande sensibilité aux variations
du taux d’intérêt.
- M3 est une variable fiable de l’analyse économétrique ainsi son évolution par rapport au PIB
dans les années 1990 a permis de montrer une tendance au ralentissement de la circulation
monétaire jusqu’en 1993 puis une accélération dans les 18 mois suivants ce qui fut somme
toute concordant avec la crise monétaire observée a l’époque.
- M3 s’est révélé être un excellent indicateur des anticipations à 18 mois de l’évolution de
l’indice des prix a la consommation harmonisée (IPCH) c'est-à-dire de l’inflation.
Pour atteindre son objectif et compte tenu d’une hypothèse donnée de croissance et de baisse de la
vitesse de circulation, la BCE s’est donné fin 1998 une cible de 4,5 % de croissance annuelle de M3.
Exercice :
1) Calcul des agrégats :
On traitera les données de juin 2005 juin 2006 et juin 2007. Cette question se réfère au 1er tableau.
M1
M2
M3
Juin 2005
3304397
5851942
6830660
Juin 2006
3598132
6372506
7395888
Juin 2007
3844108
7004831
8228169
2)
Part des pièces et billets dans M1 :
- Juin 2005 : (496551/3304397)x100=15%
- Juin 2006 : (553695/3598132)x100=15,3%
- Juin 2007 : (604885/3844108)x100=15,7%
en %
Pièces billets/M3
DAV/M3
M1/M3
M2/M3
Juin 2005
7,3%
41,1%
48,4%
85,7%
Juin 2006
7,5%
41,1%
48,6%
86,2%
Juin2007
7,4%
39,4%
46,7%
85,1%
3) Vérification de M3 :
M3= créances/extérieur + crédit + titres – divers – ressources non monétaires

M306-05= 443395 + 8754463 + 2765507 – 116816 - 5015636 = 6830660
( a ) ( b )
4)
La part des différentes contreparties de M3 : a contrepartie externe 3,7%, b contrepartie interne
96,3%.
a+b= 11846292 .
de la même manière :
M306-06= 460657 + 9612316 + 2962100 – 201732 – 5437453= 7395888 avec a=3,6% et b=96,4%.
M306-07= 725069 + 10528129 + 3138394 – 221861 – 5941562= 8228169 avec a=5% et b=95%
L’essentiel de la contrepartie est interne.
5) Taux de croissance :
Mois-année/mois-année
dM1
dM2
dM3
06-06/06-05
𝑉𝐴−𝑉𝐷
𝑉𝐷 x100= 8,89%
8,89%
8,27%
06-06/06-07
6,84%
9,92%
11,25%
06-07/06-05
16,33%
19,70%
20,45%
M3 croit plus vite que M2 et M1. On est a des taux de croissance (8,27% et 11,25%) bien supérieur a
4,5% qui était l’objectif de la BCE. Au fil du temps le poids de la monnaie au sens stricte (M1) dans la
masse monétaire tend a diminuer puisque M3 croit plus vite que M1. c’est un indicateur d’une baisse
de la vitesse de circulation.
Il faut distinguer 3 périodes : doc 2 graphique.
- Premier temps baisse de la vitesse de circulation
- M1 et M3 voient leur taux de croissance diminuer, contraction monétaire.
- 3ème temps 2008 : M1 complètement figé et M3 voit son taux de croissance continuer a
diminuer.
- 2008-2009 : M3 diminue encore mais M1 voit son volume s’accroit soudainement. C’est la
crise les acteurs se figent, forte incertitude les acteurs veulent beaucoup de liquidité. pour
 6
6
1
/
6
100%