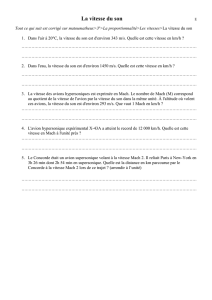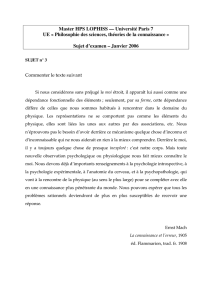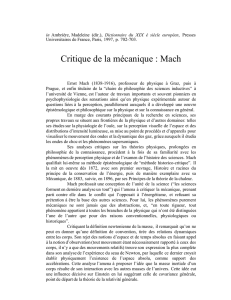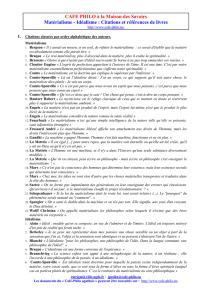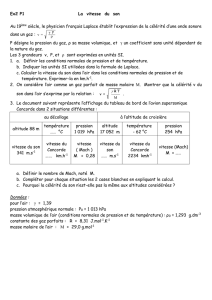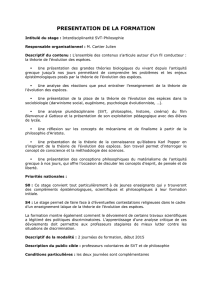Lénine - Matérialisme et empiriocriticisme - communisme

V. LENINE
MATERIALISME ET EMPIRIOCRITICISME
Edition électronique réalisée par Vincent Gouysse à partir de l’ouvrage
publié en 1975 aux Editions en langues étrangères, Pékin.
WWW.MARXISME.FR

2
Sommaire :
Dix questions au conférencier (p. 3)
MATERIALISME ET EMPIRIOCRITICISME – Notes critiques sur une philosophie réactionnaire (p. 4)
Préface à la première édition (p. 4)
Préface à la deuxième édition (p. 5)
En guise d'introduction – Comment certains «marxistes» en 1908 et certains idéalistes en 1710 réfutaient le matérialisme (p. 5)
Chapitre I. LA THEORIE DE LA CONNAISSANCE DE L'EMPIRIOCRITICISME ET DU MATERIALISME DIALECTIQUE. I
(p. 14)
1. Les sensations et les complexes de sensations (p. 14)
2. La «découverte des éléments du monde» (p. 20)
3. La coordination de principe et le «réalisme naïf» (p. 28)
4. La nature existait-elle avant l'homme ? (p. 32)
5. L'homme pense-t-il avec le cerveau ? (p. 38)
6. Du solipsisme de Mach et d'Avenarius (p. 42)
Chapitre II. LA THEORIE DE LA CONNAISSANCE DE L'EMPIRIOCRITICISME ET DU MATERIALISME DIALECTIQUE.
II (p. 44)
1. La «chose en soi», ou V. Tchernov réfute F. Engels (p. 44)
2. Du «transcensus», ou V. Bazarov «révise» Engels (p. 48)
3. L. Feuerbach et J. Dietzgen sur la chose en soi (p. 54)
4. Y a-t-il une vérité objective ? (p. 57)
5. De la vérité absolue et relative, ou de l'éclectisme d'Engels découvert par A. Bogdanov (p. 62)
6. Le critère de la pratique dans la théorie de la connaissance (p. 65)
Chapitre III. LA THEORIE DE LA CONNAISSANCE DU MATERIALISME DIALECTIQUE ET DE L'EMPIRIOCRITICISME.
III (p. 68)
1. Qu'est-ce que la matière ? Qu'est-ce que l'expérience ? (p. 68)
2. L'erreur de Plékhanov concernant le concept de «l’expérience» (p. 72)
3. De la causalité et de la nécessité dans la nature (p. 73)
4. Le «principe de l'économie de la pensée» et le problème de l'«unité du monde» (p. 81)
5. L'espace et le temps (p. 84)
6. Liberté et nécessité (p. 91)
Chapitre IV. LES PHILOSOPHES IDEALISTES, FRERES D'ARMES ET SUCCESSEURS DE L'EMPIRIOCRITICISME (p. 94)
1. Le kantisme critiqué de gauche et de droite (p. 94)
2. Comment l'«empiriosymboliste» Iouchkévitch s'est moqué de l'«empiriocriticiste» Tchernov (p. 100)
3. Les immanentistes, frères d'armes de Mach et d'Avenarius (p. 102)
4. Dans quel sens évolue l'empiriocriticisme ? (p. 106)
5. L'«empiriomonisme» de A. Bogdanov (p. 110)
6. La «théorie des symboles» (ou des hiéroglyphes) et la critique de Helmholtz (p. 114)
7. De la double critique de Dühring (p. 117)
8. Comment J. Dietzgen put-il plaire aux philosophes réactionnaires ? (p. 119)
Chapitre V. LA REVOLUTION MODERNE DANS LES SCIENCES DE LA NATURE ET L'IDEALISME PHILOSOPHIQUE (p.
123)
1. La crise de la physique contemporaine (p. 124)
2. «La matière disparaît» (p. 127)
3. Le mouvement est-il concevable sans matière ? (p. 131)
4. Les deux tendances de la physique contemporaine et le spiritualisme anglais (p. 135)
5. Les deux tendances de la physique contemporaine et l'idéalisme allemand (p. 139)
6. Les deux tendances de la physique contemporaine et le fidéisme français (p. 144)
7. Un «physicien idéaliste» russe (p. 148)
8. Essence et valeur de l'idéalisme «physique» (p. 149)
Chapitre VI. L'EMPIRIOCRITICISME ET LE MATERIALISME HISTORIQUE (p. 155)
1. L'excursion des empiriocriticistes allemands dans le domaine des sciences sociales (p. 155)
2. Comment Bogdanov corrige et «développe» Marx (p. 159)
3. Les «Principes de la philosophie sociale» de Souvorov (p. 164)
4. Les partis en philosophie et les philosophes acéphales (p. 166)
5. Ernst Haeckel et Ernst Mach (p. 172)
Conclusion (p. 177)
Supplément à la section 1 du chapitre IV -De quel côté N. Tchernychevski abordait-il la critique du kantisme ? (p. 178)
Notes (p. 179)

3
NOTE DE L'EDITEUR
La présente édition du Matérialisme et empiriocriticisme a été établie d'après les traductions existant
en langue française, en s'appuyant sur une confrontation avec le texte chinois publié par les Editions
du Peuple, Pékin, avril 1971. Les notes mises à la fin du livre sont rédigées d'après celles de l'édition
chinoise des Editions du Peuple, Pékin, et celles des traductions françaises existantes.
DIX QUESTIONS AU CONFERENCIER1
1. Le conférencier admet-il que le matérialisme dialectique est la philosophie du marxisme ?
Dans la négative, pourquoi n'a-t-il jamais examiné les innombrables déclarations d'Engels à ce sujet ?
Dans l'affirmative, pourquoi les disciples de Mach appellent-ils «philosophie du marxisme» leur
«révision» du matérialisme dialectique ?
2. Le conférencier admet-il la division essentielle des systèmes philosophiques, telle que l'énonce
Engels, en matérialisme et idéalisme, étant donné que la tendance de Hume dans la philosophie
moderne, tendance appelée «agnostique» par Engels, qui déclare que le kantisme est une variété de
l'agnosticisme, est une tendance médiane, hésitant entre les deux précédentes ?
3. Le conférencier admet-il que la théorie de la connaissance du matérialisme dialectique se fonde sur
l'admission de l'univers extérieur et de son reflet dans le cerveau humain ?
4. Le conférencier reconnaît-il la justesse de la thèse d'Engels sur la transformation de la «chose en
soi» en «chose pour nous» ?
5. Le conférencier reconnaît-il la justesse de l'affirmation d'Engels selon laquelle «l'unité réelle du
monde consiste en sa matérialité» ? (Anti-Dühring, 2eédit. allemande, 1886, p. 28, première partie, §
IV, «Le schème de l'univers».)
6. Le conférencier reconnaît-il la justesse de l'affirmation d'Engels selon laquelle «la matière sans
mouvement est tout aussi inconcevable que le mouvement sans matière» ? (Anti-Dühring, 2eédit.
allemande, 1886, p. 45, § VI, «Philosophie de la nature, cosmogonie, physique, chimie».)
7. Le conférencier admet-il que les idées de causalité, de nécessité et de loi, etc. reflètent dans le
cerveau humain les lois de la nature, les lois du monde réel ? Ou Engels aurait-il eu tort de l'affirmer ?
(Anti-Dühring, pp. 20 et 21, § III, «L'apriorisme», et pp. 103 et 104, § XI, «Liberté et nécessité».)
8. Le conférencier sait-il que Mach a exprimé son accord avec le chef de l'école immanente, Schuppe,
et lui a même dédié son dernier et principal ouvrage philosophique ? Comment le conférencier
explique-t-il cette adhésion de Mach à la philosophie manifestement idéaliste de Schuppe, défenseur
du cléricalisme et, de façon générale, manifestement réactionnaire en philosophie ?
9. Pourquoi le conférencier a-t-il passé sous silence la «mésaventure» de son camarade d'hier (d'après
les Essais [C'est-à-dire les Essais sur la philosophie marxiste — Note du traducteur.]), le menchévik
Iouchkévitch, qui (après Rakhmétov2) déclare aujourd'hui Bogdanov3idéaliste ? Le conférencier sait-
il que Petzoldt classe, dans son dernier livre, divers élèves de Mach parmi les idéalistes ?
10. Le conférencier confirme-t-il le fait que la doctrine de Mach n'a rien de commun avec le
bolchévisme ? que Lénine a maintes fois protesté contre cette doctrine ?4que les menchéviks
Iouchkévitch et Valentinov5sont de «purs» empiriocriticistes ?
Rédigé en mai-juin 1908
Publié pour la première fois en 1925 dans le Recueil Lénine, III
Conforme au manuscrit

4
MATERIALISME ET EMPIRIOCRITICISME
NOTES CRITIQUES SUR UNE PHILOSOPHIE REACTIONNAIRE6
PREFACE A LA PREMIERE EDITION
Nombre d'écrivains qui se réclament du marxisme ont entrepris parmi nous, cette année, une véritable
campagne contre la philosophie marxiste. En moins de six mois, quatre livres ont paru, consacrés
surtout, presque entièrement, à des attaques contre le matérialisme dialectique. Ce sont tout d'abord les
Essais sur [? il aurait fallu dire : contre] (Dans le présent ouvrage, tout texte mis entre les crochets est
dû à Lénine, sauf indication du contraire — Note du traducteur.) la philosophie marxiste, Saint-
Pétersbourg, 1908, recueil d'articles de Bazarov, Bogdanov, Lounatcharski, Bermann, Hellfond,
Iouchkévitch, Souvorov ; puis Matérialisme et réalisme critique, de Iouchkévitch ; La Dialectique à la
lumière de la théorie contemporaine de la connaissance, de Bermann ; Les Constructions
philosophiques du marxisme, de Valentinov. Toutes ces personnes ne peuvent ignorer que Marx et
Engels qualifièrent maintes fois leurs conceptions philosophiques de matérialisme dialectique. Toutes
ces personnes, qui se sont unies — malgré les divergences accusées de leurs opinions politiques —
dans leur hostilité envers le matérialisme dialectique, se prétendent cependant des marxistes en
philosophie ! La dialectique d'Engels est une «mystique», dit Bermann. Les conceptions d'Engels ont
«vieilli», laisse tomber incidemment Bazarov, comme une chose qui va de soi. Le matérialisme serait,
paraît-il, réfuté par ces hardis guerriers, qui invoquent fièrement la «théorie contemporaine de la
connaissance», la «philosophie moderne» (ou «positivisme moderne»), la «philosophie des sciences de
la nature contemporaines», voire même la «philosophie des sciences de la nature du XXesiècle». Forts
de toutes ces doctrines prétendument modernes, nos pourfendeurs du matérialisme dialectique en
arrivent sans crainte à reconnaître purement et simplement le fidéisme (Doctrine substituant la foi à la
science ou, par extension, attribuant à la foi une certaine importance.)7(on le voit bien mieux chez
Lounatcharski, mais il n'est pas le seul !8) ; ils perdent, par contre, toute hardiesse, tout respect de leurs
propres convictions quand il s'agit de définir nettement leur attitude envers Marx et Engels. En fait,
abandon complet du matérialisme dialectique, c'est-à-dire du marxisme. En paroles, des subterfuges
sans fin, des tentatives de tourner le fond du problème, de masquer leur dérobade, de substituer un
matérialiste quelconque au matérialisme en général, le refus net d'analyser de près les innombrables
déclarations matérialistes de Marx et d'Engels. Véritable «révolte à genoux», selon la juste expression
d'un marxiste. Révisionnisme philosophique typique, car seuls les révisionnistes se sont acquis une
triste renommée en s'écartant des conceptions fondamentales du marxisme, trop conscients de leur
crainte et impuissants à «régler leur compte» ouvertement, avec netteté, énergie et clarté, aux idées
qu'ils ont abandonnées. Quand les marxistes orthodoxes avaient à combattre certaines conceptions
vieillies de Marx (ainsi que l'a fait Mehring à l'égard de certaines affirmations historiques), ils l'ont
toujours fait avec tant de précision, de façon tellement circonstanciée que jamais personne n'a pu
relever dans leurs travaux la moindre équivoque.
On trouve d'ailleurs dans les Essais «sur» la philosophie marxiste une phrase qui ressemble à la vérité.
C'est cette phrase de Lounatcharski : «Nous [il s'agit évidemment de tous les auteurs des Essais] nous
fourvoyons peut-être, mais nous cherchons» (p. 161). Que la première moitié de cette phrase soit une
vérité absolue, et la seconde une vérité relative, c'est ce que je m'efforcerai de démontrer
complètement dans le présent ouvrage. Je me bornerai pour l'instant à faire observer que si nos
philosophes, au lieu de parler au nom du marxisme, parlaient au nom de quelques «chercheurs»
marxistes, ils témoigneraient d'un plus grand respect d'eux-mêmes et du marxisme. En ce qui me
concerne, je suis aussi un «chercheur» en philosophie. Plus précisément : je me suis donné pour tâche,
dans ces notes, de rechercher où se sont égarés les gens qui nous offrent, sous couleur de marxisme,
quelque chose d'incroyablement incohérent, confus et réactionnaire.
L'auteur
Septembre 1908

5
PREFACE A LA DEUXIEME EDITION
Cette édition, à quelques corrections près, ne diffère en rien de la précédente. J'espère qu'elle ne sera
pas inutile, indépendamment de la polémique avec les disciples russes de Mach, en tant
qu'introduction à la philosophie du marxisme — au matérialisme dialectique, et aux conclusions
philosophiques tirées des découvertes récentes des sciences de la nature. L'article du camarade V.
Nevski, qui fait suite à ce livre, donne sur les dernières œuvres de A. Bogdanov, dont je n'ai pas eu la
possibilité de prendre connaissance, les éclaircissements nécessaires.9Le camarade V. Nevski, qui a
travaillé non seulement comme propagandiste en général, mais aussi et surtout comme militant de
l'école du Parti, a pu parfaitement se convaincre que A. Bogdanov propage des idées bourgeoises et
réactionnaires sous les apparences de «culture prolétarienne».
N. Lénine
2 septembre 1920
EN GUISE D'INTRODUCTION - COMMENT CERTAINS
«MARXISTES» EN 1908 ET CERTAINS IDEALISTES EN 1710
REFUTAIENT LE MATERIALISME
Quiconque connaît un peu la littérature philosophique doit savoir qu'on aurait peine à trouver
aujourd'hui un professeur de philosophie (ou de théologie) qui ne s'occupât, ouvertement ou par des
procédés obliques, à réfuter le matérialisme. Des centaines et des milliers de fois, on a proclamé que le
matérialisme était réfuté, et l'on continue à le réfuter pour la cent et unième, voire pour la mille et
unième fois. Les révisionnistes de chez nous ne font que réfuter le matérialisme, tout en feignant de ne
réfuter en somme que le matérialiste Plékhanov, et non le matérialiste Engels, ni le matérialiste
Feuerbach, ni les conceptions matérialistes de J. Dietzgen, — et de réfuter le matérialisme en se
plaçant au point de vue du positivisme «moderne» et «contemporain», des sciences de la nature, etc.
Sans recourir aux références que chacun trouvera à volonté, par centaines, dans les ouvrages cités plus
haut, je rappellerai les arguments à l'aide desquels Bazarov, Bogdanov, Iouchkévitch, Valentinov,
Tchernov (V. Tchernov : Etudes de philosophie et de sociologie, Moscou, 1907. Disciple zélé
d'Avenarius, l'auteur est un adversaire du matérialisme dialectique, tout comme Bazarov et consorts.)
et quelques autres disciples de Mach combattent le matérialisme. Le terme «machiste» (Dans la suite,
nous avons préféré au terme de «machiste», en raison de sa déplorable consonance française,
l'expression «disciple de Mach» — Note du traducteur.), plus bref et plus simple, a conquis le droit de
cité dans la littérature russe, et j'en userai dans le texte à l'égal du mot «empirio-criticiste». Ernst Mach
est généralement reconnu dans la littérature philosophique (Voir, par exemple, Dr Richard
Hönigswald : Über die Lehre Humes von der Realität der Aussendinge, Berlin, 1904, p. 26.) comme le
plus populaire des représentants actuels de l'empiriocriticisme, et les écarts de Bogdanov et de
Iouchkévitch de la «pure» doctrine de Mach sont, comme nous le montrerons plus loin, d'importance
absolument secondaire.
Les matérialistes, nous dit-on, reconnaissent l'impensable et l'inconnaissable, la «chose en soi», la
matière placée «au-delà de l'expérience», au-delà de notre connaissance. Ils tombent dans un véritable
mysticisme en admettant quelque chose au-delà, qui est situé hors des limites de l'«expérience» et de
la connaissance. Quand ils déclarent que la matière agissant sur les organes de nos sens suscite des
sensations, les matérialistes se basent sur l'«inconnu», sur le néant, puisque eux-mêmes, disent-ils,
reconnaissent nos sens comme la seule source de la connaissance. Les matérialistes tombent dans le
«kantisme» (c'est le cas de Plékhanov qui admet l'existence de la «chose en soi», c'est-à-dire des
choses existant en dehors de notre conscience), ils «doublent» le monde et prêchent le «dualisme»,
puisque derrière les phénomènes, d'après eux, il y a encore la chose en soi, puisque derrière les
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
 129
129
 130
130
 131
131
 132
132
 133
133
 134
134
 135
135
 136
136
 137
137
 138
138
 139
139
 140
140
 141
141
 142
142
 143
143
 144
144
 145
145
 146
146
 147
147
 148
148
 149
149
 150
150
 151
151
 152
152
 153
153
 154
154
 155
155
 156
156
 157
157
 158
158
 159
159
 160
160
 161
161
 162
162
 163
163
 164
164
 165
165
 166
166
 167
167
 168
168
 169
169
 170
170
 171
171
 172
172
 173
173
 174
174
 175
175
 176
176
 177
177
 178
178
 179
179
 180
180
 181
181
 182
182
 183
183
1
/
183
100%