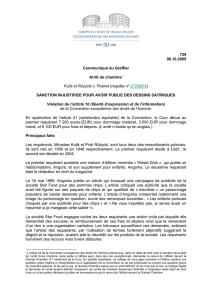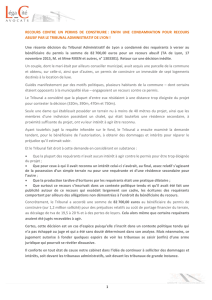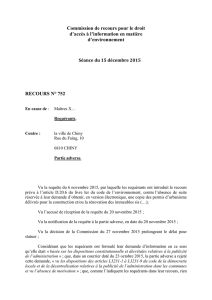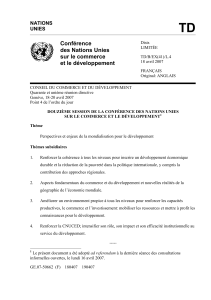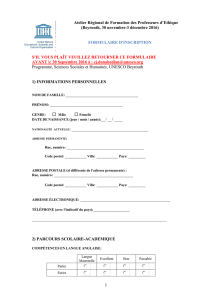cinquième section décision sur la recevabilité en fait

CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 51987/07
présentée par Arlette ATALLAH et autres
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant
le 30 août 2011 en une chambre composée de :
Dean Spielmann, président,
Jean-Paul Costa,
Boštjan M. Zupančič,
Mark Villiger,
Isabelle Berro-Lefèvre,
Ann Power,
Angelika Nußberger, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 9 novembre 2007,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur, celles
présentées en réponse par les requérants et celles présentées par la tierce
partie, l’Organisation des Nations Unies,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, Mmes Arlette et Lynn Atallah ainsi que M. Géo Atallah,
sont des ressortissants français, nés respectivement en 1938, 1970 et 1967 et
résidant à Paris et à Lugano pour ce qui est de la deuxième requérante. Ils
sont représentés devant la Cour par Me B. Favreau, avocat à Bordeaux. Le

2 DÉCISION ATALLAH c. FRANCE
gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent,
Mme E. Belliard, directrice des Affaires juridiques au ministère des Affaires
étrangères
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se
résumer comme suit.
1. Le contexte de l’affaire
Au début des années 1970, la tension le long de la frontière israélo-
libanaise s’est accentuée, en particulier après le repositionnement
d’éléments armés palestiniens de Jordanie au Liban. Les opérations-
commando palestiniennes contre Israël et les représailles israéliennes contre
des bases palestiniennes au Liban se sont intensifiées.
Le 11 mars 1978, une attaque-commando en Israël fit de nombreux morts
et blessés parmi la population israélienne. L’Organisation de Libération de
la Palestine (OLP) revendiqua cet attentat. En riposte, les forces israéliennes
envahirent le Liban dans la nuit du 14 au 15 mars et, en l’espace de
quelques jours, occupèrent entièrement la partie sud du pays à l’exception
de la ville de Tyr et de ses environs.
Le 15 mars 1978, le Gouvernement libanais adressa une protestation au
Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies (ONU) contre
l’invasion israélienne affirmant qu’il n’avait aucun lien avec l’opération
commando palestinienne. Le 19 mars, le Conseil de sécurité adopta les
résolutions, 425 (1978) et 426 (1978), dans lesquelles il demandait à Israël
de cesser immédiatement son action militaire et de retirer ses forces de tout
le territoire libanais. Le Conseil a également décidé la constitution
immédiate de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (FINUL). Les
premières troupes de la FINUL sont arrivées dans la région le 23 mars 1978.
Continuant à siéger pendant les mois de juin, juillet et août 1982, le
Conseil exigea qu’Israël lève son blocus de Beyrouth de façon à pouvoir
ravitailler les civils en ville. Il autorisa le déploiement d’observateurs
militaires de l’ONU, connus sous le nom de « Groupe d’observateurs de
Beyrouth » pour contrôler la situation à Beyrouth et aux alentours.
En août, pendant le siège de l’ouest de Beyrouth par les forces
israéliennes, les États-Unis, la France et l’Italie, sur la demande du
Gouvernement libanais, envoyèrent dans cette ville une force multinationale
de sécurité (FMS) pour faciliter le départ du personnel armé palestinien en
bon ordre et dans des conditions de sécurité. L’évacuation des forces
palestiniennes de la région de Beyrouth s’acheva le 1er septembre 1982, et la
force multinationale fut retirée au cours des deux semaines suivantes.
Toutefois, suite aux massacres de Sabra et Chatila le 17 septembre 1982,
une nouvelle force multinationale de sécurité fut mise en place à Beyrouth

DÉCISION ATALLAH c. FRANCE 3
de septembre 1982 à fin mars 1984. Elle comprenait notamment des
détachements de l’armée française.
Le mandat de la FINUL a été prolongé depuis lors sans interruption.
2. Les données de l’affaire
M. Pierre Atallah, le mari et père des requérants, de nationalité libanaise,
était avocat à Beyrouth.
Le 24 avril 1983, des soldats français détachés au profit de la FMS
reçurent l’ordre de mettre en place un poste de contrôle dans une rue de
Beyrouth, en face du poste de commandement de la compagnie d’éclairage
et d’appui. Un barrage routier fut installé. Vers 18 h 15, un lieutenant reçut
par radio l’ordre d’arrêter un véhicule de marque mini Austin bleue. Il était
précisé : « arrêter avec précaution, personnel armé.»
Le même jour, M. Atallah se rendait au volant de son véhicule Austin
mini de couleur orange de son bureau vers son domicile. Les requérants
précisent qu’il n’était porteur d’aucune arme ou objet dangereux et qu’il
n’était impliqué d’aucune manière dans le conflit. Vers 19 h 45, à la nuit
tombante, il arriva aux abords du barrage, rue de Damas, à proximité du
carrefour du musée national et, selon l’enquête de la brigade prévôtale de
Beyrouth, ne ralentit pas et n’obtempéra pas aux gestes d’arrêt du militaire
placé au milieu de la chaussée. Lorsque la voiture arriva à environ 4 à 5
mètres de lui, le soldat S. ouvrit le feu. M. Atallah décéda des suites de ses
blessures.
L’enquête fut menée par la brigade prévôtale de Beyrouth de la
gendarmerie française. Le commandant de la brigade se transporta sur les
lieux peu après les faits. Des plans et des photographies furent faits, ainsi
qu’une description précise des différents éléments sur place. Le soir même,
cinq militaires, dont le soldat qui avait tiré, et qui étaient tous présents sur
les lieux furent entendus. Dans son procès-verbal de synthèse rédigé le 25
avril 1983, le commandant de la brigade prévôtale de Beyrouth conclut que
le véhicule intercepté était dépourvu de plaque minéralogique avant, que
son conducteur n’avait ni ralenti ni obtempéré aux gestes d’arrêt du militaire
français placé au milieu de la chaussée et que ce militaire avait accompli sa
mission en appliquant strictement les consignes reçues de ses supérieurs.
La police militaire libanaise fit également des investigations techniques
et matérielles. L’autopsie fut effectuée par un médecin libanais qui conclut
son rapport comme suit :
(traduction)
« Ces blessures résultent d’une rafale de plusieurs cartouches de deux armes à feu
différentes, ce qui souligne que :
1. Les grands trous résultent des fracas de l’explosion des balles ou des projectiles
de grand calibre qui ont été tirés de droite vers la gauche et inversement.

4 DÉCISION ATALLAH c. FRANCE
2. Il y a des blessures susmentionnées ayant entre 5 et 8 mm de long dont le nombre
n’est pas moindre que cinq et qui sont causées par les coups d’une arme à feu, tirés de
l’avant vers l’arrière probablement.
3. Les projectiles ont été tirés d’une distance excédant 50 cm, vu qu’il n’existe pas
de trace évidente autour des blessures.
4. Les petites blessures sont dues à de petits éclats.
5. Le décès a été causé par une forte hémorragie fatale. »
Le soir même, entendue par la police militaire libanaise, la première
requérante déclara se constituer partie civile à l’encontre de l’auteur des
coups de feu.
A une date non précisée en 1983, compte tenu de la situation des
requérants, le ministère de la Défense décida de leur attribuer
exceptionnellement une allocation de 120 000 FF et de participer au coût
des études des trois enfants au moyen d’allocations annuelles de
40 0000 FF, ce qui fut fait de 1984 à 1990. Une nouvelle allocation de
22 000 FF leur fut versée à titre exceptionnel en 1991. Les requérants
obtinrent également la nationalité française.
Le 21 juin 1995, le bureau des dommages de l’armée de terre française
répondit à une demande d’indemnisation de la première requérante. Il
indiqua que, d’après les renseignements obtenus auprès du ministère des
Affaires étrangères et « s’agissant d’un contingent français de la FINUL »,
la responsabilité juridique de l’État français n’était pas engagée, « seule la
responsabilité de l’État libanais aurait pu être mise en cause à cette
époque. ».
Par courrier du 16 avril 1998, l’avocat des requérants adressa une
demande d’indemnisation au Secrétaire général de l’ONU. Il indiquait que
le mari et père des requérants était décédé suite à des blessures mortelles qui
lui avaient infligées par un soldat de nationalité française, détaché par l’État
français auprès de la FINUL. Il ajoutait que « cet acte illégal d’un soldat
dépendant des Nations Unies [était] la cause de la disparition de Monsieur
Pierre Georges Atallah et, par voie de conséquence, du préjudice énorme
subi par sa veuve, sa fille et son fils. » Il demandait en conséquence
réparation de ce préjudice aux Nations-Unies. Plus loin, il mentionnait que
la compagnie à laquelle appartenait ce soldat était détachée au profit de la
FMS de Beyrouth depuis le 2 décembre 1982.
Aucun document figurant au dossier ne permet de déterminer si cette
demande a reçu une réponse et l’Organisation des Nations Unies indique
qu’elle n’a pas trace d’une réponse apportée à ce courrier.
Les 15 et 16 mars 2001, les requérants firent citer devant le tribunal de
grande instance de Paris le ministre de la Défense, le soldat S. et un autre
soldat présent sur les lieux à l’époque des faits. Ils mentionnaient que le
soldat S., qui avait tiré, était « détaché au profit de la FMS de Beyrouth
depuis le mois de janvier 1983 ». Ils ajoutaient plus loin que la FMS était

DÉCISION ATALLAH c. FRANCE 5
« en détachement auprès de la FINUL. » Ils demandaient qu’il soit jugé que
la mort de leur mari et père était un meurtre qui n’était justifié ni par le
commandement de l’autorité légitime, ni par la légitime défense et que ce
meurtre constituait une voie de fait. Ils contestaient les résultats de l’enquête
menée par la gendarmerie française, notamment au vu du rapport médico-
légal établi par un médecin libanais après l’autopsie. Ils concluaient que les
constatations du médecin-légiste montraient que plusieurs armes avaient été
utilisées et estimaient notamment que le rapport de l’armée française
n’expliquait en aucune manière l’existence d’impacts de tailles différentes
correspondant à des tirs de différents diamètres et de provenances distinctes.
Ils demandaient également que le ministre de la Défense ès-qualité et les
deux soldats soient condamnés solidairement à les indemniser.
Le tribunal se prononça par jugement du 31 juillet 2003. Il considéra que,
compte tenu, d’une part, du contexte particulièrement dangereux au moment
des faits et, d’autre part, du comportement du conducteur de l’Austin, le
militaire français avait légitimement fait usage de son arme pour préserver
sa vie. En tout état de cause, il avait agi dans le cadre de l’exécution d’un
service commandé, ce qui ne saurait être constitutif d’une voie de fait. Le
tribunal conclut qu’il n’appartenait pas aux juridictions de l’ordre judiciaire
de connaître de l’action des requérants et se déclara incompétent, renvoyant
les requérants à mieux se pourvoir.
Les requérants firent appel de cette décision en reprenant les arguments
développés devant le tribunal de première instance.
La cour d’appel de Paris statua par arrêt du 16 décembre 2005. Elle
estima que, à supposer même une mauvaise exécution de l’ordre reçu, en
raison d’une appréciation inexacte du comportement du conducteur du
véhicule, et de l’assimilation erronée de ce véhicule à celui recherché, ces
circonstances auraient été à l’évidence encore susceptibles d’être rattachées
aux pouvoirs appartenant à l’administration et donc exclusives de la voie de
fait. En effet, l’ordre d’interception donné incluait, au vu des conditions
générales d’intervention de la FINUL, la possibilité de tirer en cas de mise
en danger de la vie des soldats chargés de son exécution. La cour d’appel
considéra que cette condition était réalisée dès lors que, selon l’enquête, le
soldat S. risquait d’être renversé par le véhicule en cause, qui était démuni
de sa plaque d’immatriculation avant, qui n’avait pas obéi aux signes clairs
d’avoir à ralentir et s’arrêter et qui continuait à venir vers lui à la même
vitesse. La cour d’appel confirma donc le jugement de première instance.
Les requérants se pourvurent en cassation contre cette décision. Ils
soutenaient que les pouvoirs se rattachant à l’administration dans le cadre
d’une opération spéciale visant à intercepter un véhicule avec un
signalement précis ne lui permettaient pas d’interpeller et d’ouvrir le feu sur
un véhicule ne correspondant visiblement pas à ce signalement ; que les
militaires français avaient reçu l’ordre d’intercepter avec précaution un
véhicule de couleur bleue transportant des personnes armées ; que cet ordre
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
1
/
10
100%