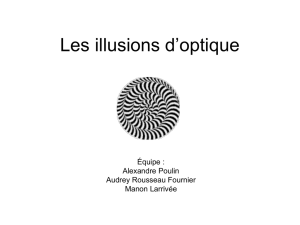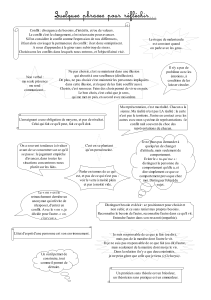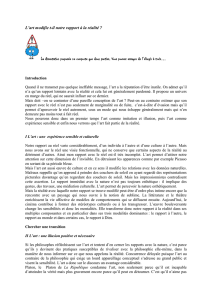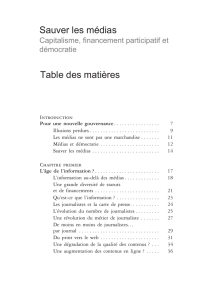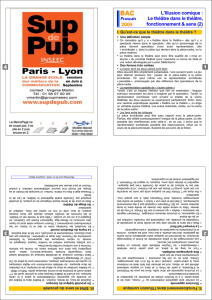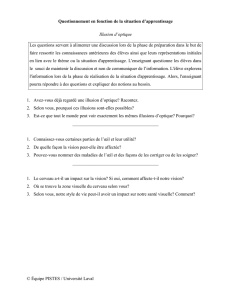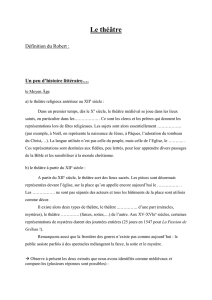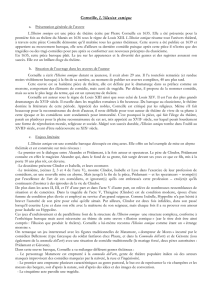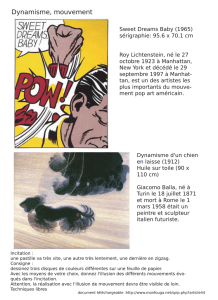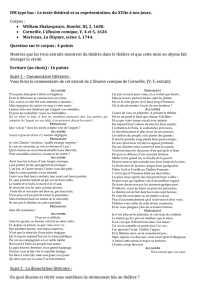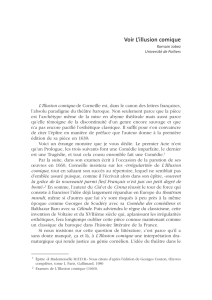2009-rapport jury-CAPESA Lettres Modernes-INTERNE

CAPESA INTERNE (session 2009)
Etude littéraire, grammaticale et stylistique de deux textes littéraires d’auteurs
du XVIème à nos jours
RAPPORT DE JURY
L’épreuve écrite d’admissibilité au concours interne du CAPES A porte sur deux
textes littéraires et est organisée en trois parties : la présentation d’une question littéraire mise
en jeu dans les deux textes, une question grammaticale (lexique, morphosyntaxe, grammaire
de texte…) et une étude stylistique de tout ou partie d’un des deux textes. L’épreuve dure 5
heures. Les textes proposés à la session 2009 du concours présentaient deux extraits de
théâtre : la scène première de la première journée du Soulier de satin (1928-1929) de Paul
Claudel et les vers 1589-1641 du dénouement (Acte V, scène 5) de L’Illusion comique (1635-
1636) de Pierre Corneille.
L’étude littéraire portait sur les enjeux de l’illusion théâtrale dans les deux textes.
Les réponses attendues par le jury, pour être claires, demandaient une mise en forme
synthétique et non un examen linéaire et souvent décousu des textes. Ces enjeux étaient
multiples. A titre d’exemples, nous en retiendrons trois.
Un enjeu esthétique. On ne pouvait rester insensible à l’hybridité générique des deux
textes. L’ « étrange monstre » que constitue L’Illusion comique multiplie les registres et mêle
dans l’extrait proposé le tragique, le comique et le tragi-comique. Le Soulier de satin, désigné
comme un « drame » et « une action espagnole », offre le spectacle d’un martyr présenté dans
le registre burlesque, d’un bonimenteur de foire dont la péroraison tisse trois paradoxes
poétiques et mystiques. A la manière élisabéthaine ou espagnole, le prologue s’inscrit dans la
tradition impertinente du drame shakespearien ou dans celle, théocentrique, de l’auto
sacramental caldéronien. Corneille et Claudel lancent des défis esthétiques, le premier en
faisant culminer la logique de l’hétérogénéité propre à la tragi-comédie, le second en opposant
son extravagance aux canons du théâtre naturaliste et aux principes de la tragédie classique.
L’analyse des extraits pouvait, de ce point de vue, mettre en évidence l’esthétique baroque
dont relèvent les deux pièces.
Un enjeu métathéâtral. Les deux extraits illustrent en pratique, comme le titre de la
pièce de Corneille l’indique, le principe de l’illusion théâtrale. La théâtralité y est exhibée,
aussi bien dans la matérialisation de la représentation scénique de l’illusion que dans la
réflexion dramaturgique et rhétorique à laquelle les personnages se livrent devant les
spectateurs. L’étude de la mise en abyme scénique pouvait être menée à partir des didascalies
externes et internes et des effets d’enchâssement (de la pièce-cadre et de la pièce enchâssée
dans L’Illusion comique, de la citation du Père Jésuite dans le prologue de l’annoncier du
Soulier de Satin). Elle se devait de privilégier l’apologie du théâtre par Corneille, tant dans un
souci de réhabilitation sociale que dans l’exaltation de son activité lucrative. Chez Claudel,
l’étude pouvait se centrer sur l’ivresse d’une distanciation joyeuse exhibant les ficelles du
théâtre et transgressant toutes les formes de mimesis et d’illusion référentielle. Les didascalies
oralisées par l’Annoncier disent un réel infigurable : « Fixons, je vous prie, mes frères, les
yeux sur ce point de l’Océan Atlantique qui est à quelques degrés au-dessus de la Ligne à
égale distance de l’Ancien et du Nouveau Continent ». C’est que chez les deux dramaturges
l’exhibition des procédés théâtraux est secondaire, la magie du théâtre relevant moins de la
scène que du verbe. Il fallait absolument analyser dans les textes cette valeur performative de

la parole. Pour Alcandre, le théâtre est essentiellement un acte de langage (« Leurs vers font
leurs combats, leur mort suit leurs paroles », v. 1621) et l’Annoncier de Claudel décrit moins
les constellations qu’il ne les fait surgir à l’imagination. La mise en abyme du théâtre porte
aussi sur son pouvoir cathartique. Pridamant est une des figures récurrentes du spectateur naïf
dans les pièces du XVIIème siècle. Relais du spectateur de L’Illusion comique, il est
l’incarnation sur scène de l’illusion théâtrale, qui consiste pour le personnage à « prendre pour
vrai ce qui n’est que feinte » (v. 1623). Il éprouve terreur et pitié devant « la triste fin d’une
pièce tragique » (v. 1633). Ainsi tous les éléments de la catharsis sont réunis dans cet extrait.
On pouvait cependant montrer les limites de cette incarnation puisque Pridamant est aussi un
père qui, dans sa décision de rejoindre son fils dans la mort, résiste à la purgation des
passions, interrompant ainsi le processus cathartique. Pridamant doit donc découvrir son statut
de spectateur – deuxième temps de l’extrait proposé – pour parvenir au terme de la maïeutique
conduite par Alcandre. Dans l’extrait du Soulier de satin, le spectateur est moins conduit que
chahuté, rabroué par l’Annoncier. Les images des « religieuses écroulées » et du Père Jésuite
« attaché », si elles entrent dans un dispositif cathartique, c’est en cohabitant paradoxalement
avec le grandiloquent et l’humour – l’héroï-comique ? -, comme si l’exubérance et le
stéréotype avaient une vertu provocatrice. Avec cet anti-prologue, le spectateur est embarqué
dans un chaos énonciatif, fait de ruptures de registres et de tons, sans aucune assurance
concernant le lieu, le temps et l’intrigue, mais comme préparé de la sorte au caractère déceptif
et sublime de la pièce. Avec les dernières phrases du texte, la déconstruction de l’illusion,
cette désillusion nécessaire, devient, comme chez Corneille, une caution de l’illusion même.
Un enjeu éthique. Corneille et Claudel proposent tous deux une méditation sur la
leçon de vérité que procure l’illusion théâtrale. En réactivant des topoï tout d’abord, qui
servent une interprétation allégorique du propos, Ainsi la roue de la Fortune est-elle
convoquée par Alcandre pour mettre les revirements de l’existence au service d’une
rhétorique de la consolation et pour préparer le retournement ironique de la situation dans la
suite du texte. Plus profondément, c’est le topos du theatrum mundi qui, dans les deux
extraits, assimile la vie à un théâtre, que ce soit dans la perspective profane de Corneille pour
qui le comédien figure la condition humaine ou dans celle, théologique, de Claudel qui
installe son « drame » sur « la scène » du « monde », s’inspirant ainsi ouvertement du Grand
Théâtre du Monde de Caldern. Les deux extraits constituent aussi des moments de révélation
où l’illusion prend une valeur heuristique. L’Illusion comique présente une révélation
progressive du mystère : de l’erreur à la vérité, en passant par l’incrédulité et l’étonnement. Le
dispositif de l’illusion et sa mise en abyme servent la maïeutique opérée par Alcandre qui
débouche non seulement sur l’éloge du théâtre, mais aussi sur une allégorie de la vie humaine
pacifiée : « Le traître et le trahi, le mort et le vivant / Se trouvent à la fin amis comme
devant » (v. 1223-12224). Marc Fumaroli résume la leçon de L’Illusion comique en ces
termes : « Le théâtre est une école d’humanisme et d’humour »1. Vérité humaniste chez
Corneille, vérité mystique chez Claudel. Les paroles rapportées du Père Jésuite, données
comme texte à dire, participent de la métathéâtralité tout en requalifiant soudain l’illusion à
laquelle les dernières paroles de l’Annoncier nous somment d’adhérer. Ces trois dernières
propositions introduisent à la vérité poétique et religieuse de l’œuvre, cosmique et comique
tout à la fois. Corneille, Claudel : du mystère révélé au mystère annoncé.
1 Marc Fumaroli, Héros et orateurs. Rhétorique et dramaturgie cornéliennes, Droz, Coll. « Titre courant »,1996,
p. 286.

L’étude grammaticale ne présentait guère de difficultés. La question de vocabulaire
(les mots « scène » dans les deux textes et « équipage » dans L’Illusion comique) ne
nécessitait pas une étude exhaustive, mais une analyse précise et nuancée en contexte, qui
excluait par exemple que l’on transforme la scène de L’Illusion comique en passerelle de
navire ! La question de syntaxe (l’étude de la phrase complexe dans les vers 1629-1640 de
L’Illusion comique) supposait, pour être traitée avec rigueur, que les candidats définissent
clairement les notions de phrase, de propositions, subordonnées et indépendantes, et
proposent un classement et une analyse des diverses propositions. Seule la dernière
subordonnée de l’extrait à étudier (v. 1639-1640 : « …mais non pour s’en parer/Qu’alors que
sur la scène il se fait admirer ») présentait une difficulté. On peut considérer qu’il s’agit d’une
proposition subordonnée complément circonstanciel de temps précédée d’un « qu’ », adverbe
uniceptif qui se greffe sur le mouvement négatif « non pour… », afin d’en excepter le terme
qu’il introduit. On pouvait gloser ainsi le mouvement : « non pour qu’il s’en pare excepté/si ce
n’est lorsque sur la scène il se fait admirer ».
Le commentaire stylistique portait sur la scène d’ouverture du Soulier de satin de
Claudel. Le jury attendait que les candidats organisent leur commentaire selon des axes
propres à éclairer la nature du texte et ses tonalités.
On pouvait ainsi, dans un premier temps, se demander si cette scène répondait aux
exigences d’une scène d’exposition. Aux règles d’unité et aux patrons du théâtre classique,
Claudel oppose une scène de prologue métamorphique et jubilatoire.
A ce titre, le personnage de l’Annoncier devait retenir l’attention. Héritier du
prologue antique, il véhicule comme lui les intentions auctoriales, mais ne dialogue pas,
comme le faisait le coryphée, avec les personnages présents à l’action, ici le Père Jésuite, qui
n’appartient pas au même plan énonciatif que lui. Le terme, peu courant, d’ « annoncier » est
emprunté au vocabulaire de la presse et désigne l’ouvrier typographe qui met en page les
petites annonces d’un journal. Volonté de rabaisser le coryphée à un rang trivial ou désir de
mettre en scène un personnage polymorphe d’annonciateur qui rassemble en lui le
personnage parabatique, le chœur épique du drame shakespearien (voir par exemple HenriV)
et pourquoi pas une figure de l’Ange de l’Annonciation ? Sans exiger toutes ces références, le
jury attendait qu’on s’interroge sur l’emploi incongru de ce terme. Faute de l’avoir fait, la
dimension parodique du discours a échappé à la plupart des candidats : discordance héroï-
comique entre le rang dramaturgique du personnage et l’emphase rhétorique de la tirade, dont
on soulignera les éléments de dispositio (exorde, narration, péroraison) ; apostrophe burlesque
« mes frères » qui assimile le boniment à une homélie et transformation parodique par les
impératifs et le ton didactique de la prédication en leçon de géographie puis d’anatomie ;
introduction dans le discours d’adverbes à valeur axiologique (« parfaitement »,
« extrêmement ») ou d’adverbe d’énonciation (« des anglais probablement ») qui exhibent une
subjectivité partiale et envahissante ; redondance généralisée du propos enfin, qui confère à
l’Annoncier une posture pontifiante et grotesque.
De cette redondance participe aussi l’ancrage spatio-temporel attendu dans une
exposition. A l’unicité et aux précisions préconisées par l’esthétique classique, Claudel
substitue un espace et un temps anamorphosés : dans la didascalie externe, la scène est dilatée
aux dimensions du monde, avant de faire l’objet d’une compression par deux retouches
correctives ou épanorthoses qui rendent le lieu et l’époque aussi imprécis qu’un arrière-pays
traité en sfumato par Léonard de Vinci : « de même qu’à la distance voulue plusieurs lignes de
montagnes séparées ne sont qu’un seul horizon ». Brouillage des contours et perspective
atmosphérique paradoxalement démentis par la perspective linéaire que l’annoncier propose

au regard du spectateur : « Fixons (…) les yeux sur ce point de l’Océan Atlantique qui est à
quelques degrés au-dessous de la Ligne à égale distance de l’Ancien et du Nouveau
Continent ». L’unicité du déterminant démonstratif et l’imprécision de la relative
déterminative semblent conjuguer la netteté d’un travelling optique et une mise au point qui
abolit à nouveau les contours. L’illusion référentielle, un instant convoquée, se transforme en
illusion d’optique.
De fait, c’est à une exhibition systématique de l’illusion théâtrale que s’adonne
Claudel. Outrance des procédés de coulisses (trompette, sifflet) qui rappellent l’univers du
cirque ; inutilité fonctionnelle de la didascalie externe qui ne se matérialise pas après le lever
de rideau ; inutilité fonctionnelle du prologue lui-même qui invite à regarder le décor ;
dénonciation du caractère artificiel de ce décor en carton-pâte (« on a …représenté ici ») et
des accessoires emphatiquement désignés par des adjectifs quantifiants qui en soulignent
l’excès (« énormes girandoles », « gigantesques panoplies ») ; allusion aux métiers du
spectacle et au travail de mise en scène (le « on » anonyme pouvant désigner les décorateurs
et les costumiers) ; insistance burlesque sur les conditions de la représentation (« ne toussez
pas ») ; mise en abyme du caractère conventionnel de la double énonciation théâtrale (
l’Annoncier cite et caractérise comme citationnel l’énoncé du Père Jésuite) ; dénonciation de
l’artifice du personnage et de son rôle, au moyen de la figure verbale du polyptote (« le voici
qui parle …. C’est lui qui va parler ») : voilà pour la vraisemblance.
Le désastre d’un naufrage – un avatar du Radeau de la Méduse ?- qui inscrit
hyperboliquement dans le texte (énumération de participes passés, démultiplication des
déictiques) les vestiges d’un acte de piraterie et une propension à s’affranchir du théâtre pour
verser dans le récit d’aventures et l’imagerie romanesque ; une hécatombe de missionnaires
avec « ces grandes taches de sang », « ces cadavres partout » et l’image macabre d’un
entassement de religieuses « écroulées l’une sur l’autre » ; le martyre du Père Jésuite enfin,
avec ces figures d’insistance et ce nouveau polyptote (« comme vous voyez » « laisse voir »)
pour installer le spectateur au comble du voyeurisme : voilà pour la bienséance.
Faisant fi de toutes les règles, articulant le burlesque et le macabre, la dénonciation
de l’illusion et l’appel à l’imagination, ce prologue fait flamboyer les paradoxes. C’est en
raison de cette dimension paradoxale et de cette ambivalence, le plus souvent occultées dans
les copies, que l’on pouvait, dans un second temps, considérer le texte de Claudel comme une
invitation d’ordre spirituel.
Le comique chez Claudel est indissociable de l’émotion et de la foi, et l’expérience
théâtrale constitue une expérience, voire une épreuve spirituelle. C’est vrai des personnages,
cela l’est aussi des spectateurs. D’où ce prologue qui rompt la convention de la double
énonciation et construit un rapport énonciatif direct entre le personnage de l’Annoncier et le
public dans la salle. Le coup de sifflet initial invite à un embarquement, à une communion
fraternelle (« mes frères »). C’est dans cette perspective que l’on peut interpréter les
nombreuses occurrences de première et deuxième personnes (pronoms personnels « je »,
« me », « vous », adjectif possessif « ma »), les impératifs de la fin du texte, les tournures
performatives (« je vous prie » à rapprocher de « je vous remercie » adressé à Dieu par le Père
Jésuite) ou encore la récurrence des adverbes de lieu (« ici », « ici-bas ») et la préposition
temporelle « voici », dont les valeurs indexicales dessinent un cadre énonciatif de proximité
où peut se vivre une communauté de destin. Proximité des hommes entre eux et de cette
dérisoire humanité avec le ciel. On comprend alors le refus d’installer la scène dans un lieu et
un temps circonscrits et la volonté d’établir un lien entre le public et le cosmos, entre la partie
et le tout. C’est l’un des sens possibles du geste burlesque de l’Annoncier lorsqu’il approche
sa canne des constellations : « Je pourrais les toucher avec ma canne », comme pour faire se
conjoindre macrocosme et microcosme. Avec la didascalie préliminaire, Claudel élevait le

spectateur à un point de vue divin : « La scène de ce drame est le monde ». L’Annoncier, lui,
rapproche la terre du ciel dans une juxtaposition quasi oxymorique des contraires : « Autour
du ciel. Et ici-bas… », les deux dimensions s’inscrivant dans un paradigme lexical religieux
qui parcourt l’ensemble du texte (« mes frères », « l’Ancien et le Nouveau », « la Croix »,
« ce groupe de religieuses », « un Père Jésuite » aux allures christiques et en posture de
martyr, « Seigneur, je vous remercie »).
Ce désir d’embrasser la totalité relève d’une sorte de catholicité dramaturgique dont
la vocation est de porter le regard à contempler tout le visible pour accéder à l’invisible. Si
Claudel libère le théâtre des « patrons de l’art classique français », il ne refuse pas pour autant
de puiser dans la tradition rhétorique, qui irrigue cet art, en inscrivant son prologue dans le
grand genre de l’épidictique. Aussi convenait-il d’étudier avec précision l’éloge du décor qui
se plie en tous points aux lois de l’ecphrasis : la caractérisation laudative s’appuyant sur les
marques du haut degré (« parfaitement bien »), les formes de radicalisation (les indéfinis
« Toutes », « l’un », « l’autre »), les hyperboles (« énormes », « gigantesques »), la
prolifération des déictiques (« ces », « ce ») en accord avec la nature périodique de la phrase.
Il s’agit bien de donner à contempler deux tableaux (« bien représenté », « en bon ordre »,
« un peintre qui voudrait représenter ») organisés en pendants : d’un côté une voûte céleste et
de l’autre une marine avec naufrage, d’un côté donc les Mirabilia Dei, de l’autre une scène de
martyre, très proche dans sa composition du Martyre de saint Philippe (1639) peint par José
de Ribera. De la peinture de méditation en quelque sorte, comme si le visible ne devait retenir
qu’un temps notre attention. On pouvait aussi penser aux Exercices spirituels de saint Ignace
et à ses fameuses compositions de lieu auxquelles le Père jésuite s’est sans doute bien souvent
adonné. Une façon de reconsidérer la procédure rhétorique : ecphrasis ou hypotypose ? les
mêmes déictiques qui montrent les éléments du décor désignent tout autant le geste de
monstration destiné à faire surgir aux yeux de l’imagination des figures absentes. Ainsi de
l’inventaire des constellations ressortissant davantage de l’hymnologie ou de la désignation
litanique que de la cartographie céleste. Nouvelle fonction de l’Annoncier qui décrit peut-être
moins qu’il ne crée par le verbe, en faisant apparaître le monde à la pointe de sa canne : Fiat
lux ! Comme indices de cette performativité créatrice, on pouvait relever la majuscule sur le
mot « Ligne », l’inversion probable des termes de la comparaison (« girandoles » et
« panoplies » pouvant être lus comme des comparés et « Grande Ourse, Petite Ourse… »
comme des comparants), ainsi que le mot « idée », placé au cœur du texte, qui métamorphose
la réalité peinte en disegno, à la fois dessein et dessin, et convertit le regard du visible à
l’invisible. Ce n’est pas le moindre paradoxe – à vrai dire récurrent dans le théâtre
contemporain - que cette transformation d’un texte de nature didascalique en poème, et ici en
exercice spirituel. Car le firmament importe moins que l’action de grâce (« Seigneur, je vous
remercie… »), le martyre que l’oblation sacrificielle (« …de m’avoir ainsi attaché »). Ira-t-on
jusqu’à lire dans la transmission du verbe (« Mais c’est lui qui va parler ») l’effacement du
poète devant celui qui l’inspire et la conversion du poème en prière ? Un mystère que la fin de
la tirade promeut en principe esthétique.
Les candidats ne se sont pas assez intéressés aux trois paradoxes de la péroraison,
dernière mise en abyme du texte en ce qu’elle présente l’art poétique de Claudel et une
apologie du mystère. Cette dernière phrase, de rythme ternaire, constitue une ultime
provocation : esthétique (le beau relève du mystère), dramaturgique (soutenir le défi de douze
heures de représentation), générique (Le Soulier de satin est une pièce comique). Mais surtout
elle inscrit mystiquement le drame de Claudel dans le registre de l’ironie divine et dans
 6
6
1
/
6
100%