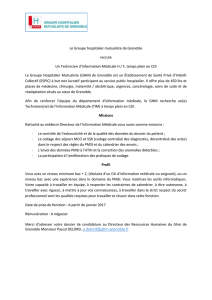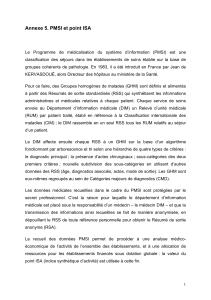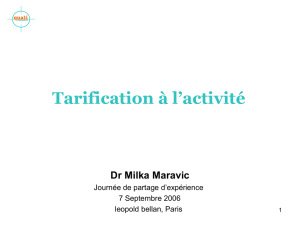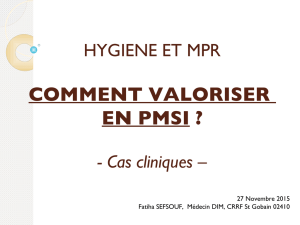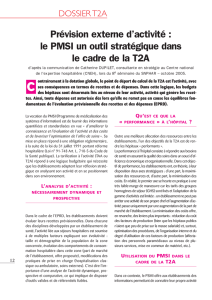Règles de codage - Faculté de Médecine Paris-Ile-de-France

1
RECOMMANDATIONS ACTUELLES DE CODAGE
D’UN SEJOUR DE REANIMATION
Pr Bertrand Guidet
Service de réanimation médicale
Chef de projet PMSI, Hôpital Saint-Antoine, AP-HP
184 rue du Fg St Antoine 75012 Paris
Dr Benoît Misset
Service de réanimation polyvalente
Hôpital Saint Joseph

2
Le PMSI est un outil d’allocation budgétaire d’établissement et non de service et il a
été élaboré pour des séjours simples, essentiellement chirurgicaux. Le codage de séjours
complexes de Réanimation nécessite de respecter les règles générales de codage PMSI tout en
permettant de décrire l’ensemble des diagnostics, symptômes et défaillances ainsi que les
actes spécifiques de réanimation. Les implications budgétaires, mais également stratégiques
justifient une réflexion et une attention sur le codage servant à classer les séjours dans les
“ bons GHM ”. Les valeurs en points d’indice synthétique d’activité (ISA) des GHM indiqués
dans le chapitre se référent à l’échelle 1999.
I Rappel sur le PMSI
Parmi les indices d'activité hospitalière, la durée de séjour est la mieux corrélée au
coût du séjour. La durée de séjour devient donc la variable à expliquer pour des malades d'age
comparable, partageant un diagnostic principal et des diagnostics associes similaires et ayant
bénéficiés des mêmes actes. Enfin, le mode de sortie (domicile, transfert, décès) s'avère être
une cinquième variable influençant la durée de séjour.
Cette classification G.H.M. répond donc à une logique médicale de diagnostics et
d'actes ainsi qu'à une loi statistique du plus fréquent. De cette façon, la puissance du
classement trouve ses limites dans la définition de pathologies rares ou de situations cliniques
atypiques par exemple lorsqu’il existe une association actes pratiqués et diagnostics sans
rapport. De la même manière, les séjours avec décès ou transfert immédiats sont classés dans
des GHM à part afin de ne pas perturber l'homogénéité des autres G.H.M..
Le séjour est codé à l'échelon de l'hôpital entier. Il est orienté dans une Catégorie
Majeure de Diagnostics (CMD) à partir du Diagnostic Principal (DP), puis dans un Groupe

3
Homogène de Malades (GHM), soit en fonction de l'association "Acte Classant - DP", soit en
fonction du DP lui-même s'il n'y a pas d'acte classant, alourdi éventuellement d'une
CoMorbidité Associée (CMA). Quatre listes de diagnostics permettent d'orienter dans un
GHM plus lourd: les CMA, les CMA Sévères (CMAS), les CMAS Traumatiques (CMAST),
et les diagnostics reliés au VIH. Lorsqu'un diagnostic est une CMA ou une CMAS, celle-ci ne
peut pas jouer son rôle de comorbidité si elle est utilisée en DP. Pour orienter le séjour dans
les traumatismes multiples sévères (CMD 26), il faut que le DP soit un traumatisme et qu'au
moins deux diagnostics du Résumé de Sortie Standardisé (RSS) soient des CMAST de
topographies anatomiques différentes (le DP peut être l'un les deux). Dans tous les autres cas,
le choix du DP est fondamental, car en cas de séjour chirurgical, il doit être cohérent avec
l'acte chirurgical, et en cas de séjour médical, c'est lui qui pèse le plus lourd dans la
détermination du GHM. Le guide méthodologique paru au Bulletin Officiel (1) recommande
que le DP soit le diagnostic d'une manifestation clinique plutôt que celui d'une étiologie. C'est
la raison pour laquelle le guide des outils d'évaluation de la SRLF en 1995 proposait de mettre
systématiquement en DP un symptôme du thesaurus, c'est-à-dire une défaillance viscérale (2).
L'expérience acquise ces dernières années a montré que les séjours de réanimation sont
évalués à un tiers de leur valeur financière réelle par le PMSI. D'après plusieurs simulations en
réanimation, coder une manifestation en DP était presque toujours moins bien valorisé que
coder une étiologie dans les versions en vigueur jusqu'en 1997.
De ce fait, les règles de choix du DP que nous croyions justes en 1995 nous ont probablement
souvent défavorisés. Cependant, des simulations récentes montrent que le nouvel algorithme
(1998) attribue un meilleur poids à certaines défaillances courantes et nous encourage à
proposer des règles de codage proches à celles de 1995, dans de nombreux cas.
II Aspects techniques du thesaurus commun SRLF-SFAR :
La dernière version du thesaurus de réanimation a été élaborée par la SRLF et la SFAR
et a été validé par le pole d’expertise et de référence des nomenclatures de santé (PERNS).
! 1- Précisions diagnostiques avec des bornes.
Des “ bornes ” ont été ajoutées à certains diagnostics de la CIM-10 pour améliorer
l'homogénéité des bases de données épidémiologiques de notre discipline. Afin de ne pas nous
défavoriser plus dans le PMSI, ces bornes ne concernent que des diagnostics qui actuellement

4
n'ont aucun rôle en tant que DP ou CMA dans le PMSI: il s'agit par exemple de l'hypothermie,
des dyskaliémies, de la leucopénie.
! 2- Associations de diagnostics
Certains diagnostics demandent d'utiliser deux codes pour respecter les règles de
codage de la CIM-10. Dans ces cas, la manifestation doit être codée avant la cause. Lorsque
l'on doit retourner à la CIM-10 pour affiner un diagnostic imprécis ou manquant dans le
thesaurus, il faut savoir que certains diagnostics y sont représentés deux fois, l'une au titre de
la manifestation - il est alors annoté avec un code "astérisque" (*) -, et l'autre au titre de
l'étiologie - il est alors annoté avec un code "dague" (†). Ces règles ne modifient pas les
résultats du codage pour la réanimation, mais servent de référence pour les contrôles externes
de la qualité du codage par les tutelles ou les sociétés de services.
Les diagnostics les plus fréquents nécessitant d'utiliser deux codes sont:
le choc hypovolémique,
l'insuffisance respiratoire aiguë des insuffisances respiratoires chroniques (noter qu'il
existe désormais un code pour les IRC restrictives),
la péritonite,
le diabète,
la pyelonéphrite aiguë,
ainsi qu'une grande quantité de maladies infectieuses pour lequel on doit coder en plus
le germe responsable.
Les diagnostics concernés sont indiqués tout au long du thesaurus avec leurs deux codes, dans
l'ordre dans lequel ils doivent être utilisés.
! 3- Comorbidités
Les CMAS sont le plus souvent possible représentées dans le thesaurus, et indiquées
dans une colonne après le code. Lorsqu'un diagnostic n'est pas suffisamment précis dans le
thesaurus, il est recommandé de le chercher d'abord dans les listes de CMA et CMAS qui sont
des extractions de la CIM-10, publiées au Bulletin Officiel. Ces listes sont renouvelées tous
les ans. Les dernières listes disponibles sont: CMAS (3) , CMA (3), CMAS traumatiques (3),
Diagnostics reliés au VIH (4). Noter que ces listes sont susceptibles d'être modifiées chaque
année à l'occasion de la révision de l'algorithme à partir de l'exploitation statistique des séjours
des hôpitaux de l’échelle Nationale des Coûts, ou bien à l'occasion de transformations

5
profondes de l'algorithme comme cela a été le cas récemment pour les greffes, le SIDA et les
traumatismes multiples.
! 4- Codes étendus
Certains diagnostics n'existent pas dans la CIM-10 et ont été ajoutés par la
Commission d'Evaluation de la SRLF en créant des "extensions" des codes de la CIM-10. Il
s'agit des codes de Coma, de Bactéries multirésistantes, de dyscalcémies et dysphosphorémies,
d'intoxication au méprobamate, et de CIVD. Les extensions réalisées comportent deux lettres
à la fin du code. Celles-ci ont été proposées car le PERNNS ne pouvait pas nous proposer de
codes ou d'associations de code appartenant déjà à la CIM-10. Le PERNNS ne valide pas ces
codes, ne les considérant pas indispensables. Ils ne seront donc pas pris en compte dans
l'algorithme de groupage. Ceci n'a pas d'inconvénient pour les bactéries multirésistantes qui ne
peuvent pas être en DP et ne sont pas des CMA. Par contre, le Coma est une CMA (non
sévère!), et peut être un DP. Nous conseillons de coder le coma deux fois, l'une en R40.2, et
l'autre avec le code indiqué dans le thesaurus. Le code tronqué (R40.2) sera reconnu par
l'algorithme de groupage, le code indiqué dans le thesaurus (R40.2 suivi de deux lettres) sera
utile pour votre indexation personnelle ou pour votre participation à une base de données
interservice, pour distinguer le coma, l'état végétatif persistant et la mort cérébrale.
! 5- Diagnostics "sans autre précision" et "autre précisé":
Ces intitulés (SAI) de la CIM-10 sont assortis de codes se terminant en .9 et .8. Ils sont
réputés être des critères de mauvaise qualité de codage pour les organismes chargés du
contrôle externe de qualité. Le thesaurus SRLF-SFAR en comporte cependant un grand
nombre, du fait de la variété de notre "case-mix", afin de parvenir à un thesaurus de taille
raisonnable pour être utilisable (<800 codes). De plus, il a été validé par le PERNNS, ce qui
permettre à chacun d'entre nous de justifier nos choix de codage.
III Choix du Diagnostic Principal:
! 1- Acte chirurgical codé :
Si un acte chirurgical est effectué au cours du séjour dans le service de réanimation, il
faut le coder et indiquer un DP cohérent avec cet acte chirurgical, car les GHM chirurgicaux
sont presque toujours mieux valorisés que les séjours non chirurgicaux. Noter cependant que
si le diagnostic et l'acte ne sont pas cohérents, le séjour est envoyé dans un groupe "erreur":
anciennement GHM 901 qui a été subdivisé en GHM 908, valorisé 4500 points ISA pour un
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
1
/
21
100%