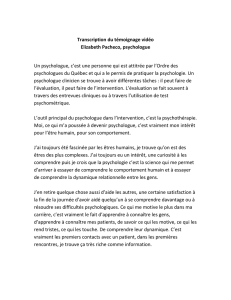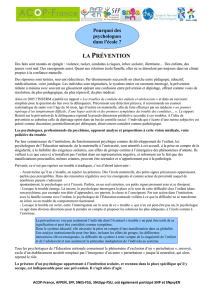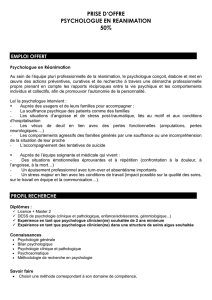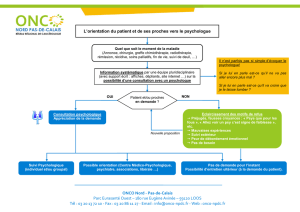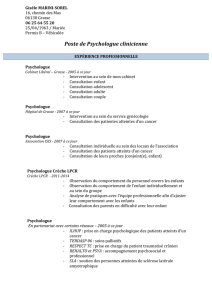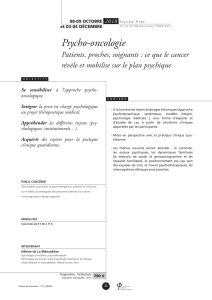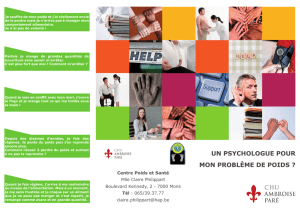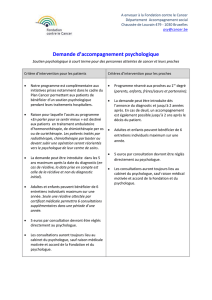CODE DE DEONTOLOGIE DE LA SSPL/SGRP

C O D E D E D E O N T O L O G I E D E L A S S P L / S G R P
INTRODUCTION
La SSPL / SGRP respecte les principes d’éthique professionnelle de la FSP et son code de déon-
tologie constitue la base reconnue par la SSPL / SGRP et sur laquelle elle s’appuie fondamen-
talement et entièrement.
La spécificité de la profession du psychologue spécialiste en psychologie légale, travaillant en
lien étroit avec la justice et la loi (civile ou pénale), requiert toutefois un complément de prin-
cipes éthiques.
Les psychologues légaux se situent dans l’interface entre la psychologie et la justice. Ils sont
dès lors plus souvent exposés à des comportements agressifs, négligents ou non-éthiques tra-
duisant la douleur de leurs clients et présentant un risque accru et un danger majeur pour la
collectivité. Ceci rend leur tâche parfois difficile, les situant entre la souffrance agie et la sécu-
rité d’autrui, et accentue les dilemmes en matière d’éthique. Dans ce domaine, l’intérêt de la
profession est de peser constamment à la fois les intérêts de l’individu et ceux de la collectivité.
La protection de l’individu peut parfois se trouver en conflit avec la sécurité publique, les Droits
de l’Homme avec le bien-être de la société. En ce sens, le domaine de l’expertise et de l’éva-
luation tend bien souvent à limiter l’autonomie personnelle pour le bien de la collectivité, en-
trant ainsi en contradiction avec les principes des Droits de l’homme.
La spécificité de ce domaine d’activité du psychologue nécessite une adaptation des règles
éthiques en fonction de la particularité du setting, différant de la plupart des autres settings en
psychologie et psychothérapie. Le psychologue spécialiste en psychologie légale est con-
fronté à la plus grande complexité des situations sociales et culturelles.
L’utilisation de la force, de la contention, de l’emprisonnement et du contrôle (par exemple
dans la garde parentale d’enfant, le placement en institution, l’emprisonnement…) est bien
souvent déjà une violation basique des Droits de l’homme. Dans ce contexte, les droits à l’inti-
mité, la confidentialité, la capacité de discernement et de responsabilité ainsi que l’autono-
mie, sont bien souvent limités des suites des décisions des psychologues. Cet état de fait rend
le métier de psychologue légal plus vulnérable et plus exposé aux critiques, jugements et
plaintes. Il est important que le psychologue légal en soit conscient et veille à toujours travailler
au plus près de ces principes éthiques.
Ces recommandations sont en outre en accord avec l’association européenne des psycho-
logues dans le domaine forensique et d’expertise (EFPA : European federation of psychologists’
associations)
REGLES SPECIALES REGISSANT LE METIER DE PSYCHOLOGUE LEGAL
1) Le praticien doit être en mesure de préciser ses propres limites et compétences, les poser
clairement aux instances supérieures et être prêt à renoncer à un mandat lorsqu’il dépasse
ses exigences personnelles et qu’il estime ne pas être de son ressort.
2) Une conscience éthique est particulièrement de rigueur dans les compétences du psycho-
logue légal, plus que chez un psychologue ordinaire. En tout temps, ce dernier doit être prêt
à examiner et reconsidérer les conséquences éthiques d’une situation. Il a également le
devoir d’en parler et d’en échanger avec toutes les parties concernées afin de pouvoir
peser tous les intérêts. Pour ce faire, il doit avoir d’excellentes connaissances des limites lé-
gales ainsi que de l’ensemble du champ juridique et pénal.

3) Dans le cadre de l’évaluation, conduisant généralement à un jugement et une prise de
décision, le psychologue légal doit se baser sur des informations et des observations évi-
dentes, sur des faits objectifs. Il s’appuie sur des méthodes scientifiques valides et des pra-
tiques documentées, en restant au plus près d’une description de la réalité afin de rendre
compte de l’objectivité d’une situation et d’éviter toute prise de position subjective ou ne
lui incombant pas.
4) Les évènements ou enjeux rencontrés dans le domaine de la justice peuvent être provo-
cants et confrontants, entrant souvent en contradiction avec les valeurs majoritaires propres
à tout un chacun. Le psychologue doit ainsi être conscient des biais liés à sa propre per-
sonne et de ses valeurs intrinsèques, de même qu’être capable de juger en quoi elles peu-
vent biaiser une situation ou prise de décision. En cas de doute, l’échange avec des col-
lègues de la profession permet parfois la prise de recul nécessaire et la confrontation avec
ses valeurs et ses biais.
5) Les psychologues légaux travaillent souvent avec des personnes disposant de faibles res-
sources sociales ou personnelles pour affirmer leur autonomie ou s’autodéterminer par rap-
port à leur situation. Le rôle du psychologue-légal ou de l’expert est justement d’identifier et
d’être attentif à la partie la plus faible. Il est de son devoir de pouvoir, si nécessaire, en ex-
primer les intérêts et les besoins ainsi que de leur laisser un minimum d’autonomie. Lorsqu’il
travaille avec un enfant, il s’agit de rendre une évaluation dans le meilleur intérêt de l’en-
fant. Dans le cadre d’une prise en charge thérapeutique d’un enfant, un bilan doit être
effectué avec les parents, dans l’intérêt de l’enfant.
6) Lorsque l’intervention du psychologue est ordonnée par des instances judiciaires, que ce
soit dans le cadre d’une expertise ou d’un suivi sous contrainte, il relève de sa responsabilité
d’informer clairement son patient sur les limites du secret professionnel, sur la relation théra-
peutique particulière, sur les méthodes utilisées mais également sur la communication de
renseignements aux instances judiciaires ou autre autorité compétente.
a. Le psychologue doit être en premier lieu particulièrement vigilant à ne pas confondre les
rôles d’expert et de thérapeute. S’il est au préalable déjà engagé dans une relation thé-
rapeutique avec un client, il ne peut accepter une mission d’expertise au sujet de ce
dernier. Inversement, s’il a joué le rôle d’expert, il ne pourra poursuivre une mission de
prise en charge thérapeutique.
b. Lorsqu’il s’agit d’un suivi imposé, les patients seront bien souvent peu motivés voire pas
du tout consentants à s’investir dans une relation thérapeutique. Le psychologue se doit
d’informer soigneusement les personnes des conséquences de leur non-consentement
ou non-coopération dans de tels processus. Afin de préserver à la fois les intérêts de la
justice et ceux du patient, il peut être amené à convenir d’un contrat thérapeutique
définissant clairement les aspects soumis au secret professionnel de ceux soumis auto-
matiquement à un compte rendu auprès des instances judiciaires.
c. Dans le cadre de l’expertise, il se doit d’informer minutieusement son patient sur l’objectif
de la demande, et du fait qu’il n’y aura pas de secret professionnel concernant les ques-
tions posées dans la mission d’expertise. L’expert doit ensuite remettre au Juge un rapport
répondant essentiellement à ses questions (par exemple, crédibilité de la victime, sé-
quelles psychologiques observables, dangerosité d’un coupable, risque de récidive, des-
cription et évaluation des relations entre un enfant et chacun de ses parents…). Son
compte rendu exige qu’il utilise un langage compréhensible à la fois pour les parties ju-
diciaires et civiles, mais également qui soit respectueux et instructif pour les personnes
évaluées. Il sera particulièrement vigilant à éviter les étiquettes offensives et privilégiera
plutôt une description des modes de comportement plutôt que des caractéristiques per-
sonnelles. A partir du moment où les informations sont transmises à des tiers, le psycho-
logue n’a plus la maîtrise de ce qu’il sera fait de ses déclarations et à quelles fins elles
seront utilisées. Il incombe de ce fait au psychologue d’être extrêmement prudent sur la
façon dont il transmet l’information et de ne pas exposer plus d’informations que ce qui
est nécessaire à son mandat.

7) Travailler dans un contexte de conflit d’intérêt et d’utilisation du pouvoir accroît les possibili-
tés de distorsion ou d’interprétation abusive des dires du psychologue par d’autres agents
du système pénal. Il est donc nécessaire que le psychologue ait conscience de la possibilité
que son travail puisse être utilisé de façon illégitime pour opprimer, nuire ou induire
quelqu’un en erreur. Il doit donc prendre les mesures nécessaires en amont et en aval afin
d’éviter au maximum toute mauvaise interprétation. Il se doit de préserver une forte neutra-
lité et la plus grande intégrité dans les différences d’intérêt. Ceci implique de ne pas se
laisser influencer ou manipuler par les diverses parties, mais chercher la solution la plus équi-
table et la décision la plus juste.
8) Dans le cadre de la défense de droits juridiques et de sécurité individuelle, le travail du
psychologue peut être facilement soumis aux critiques et plaintes, plus que dans de nom-
breux autres domaines. Le psychologue doit être prêt à réagir à ces critiques avec intégrité.
Il doit être conscient d’une haute éthique professionnelle dans ce domaine.
[11.06.2016 autorisé du comité de la SSPL]
1
/
3
100%