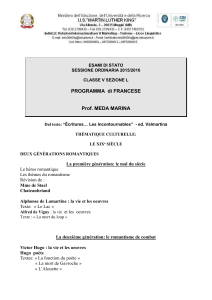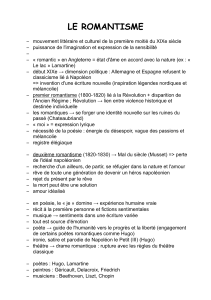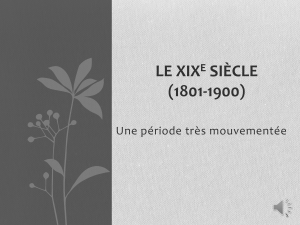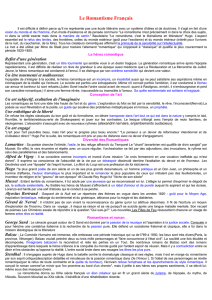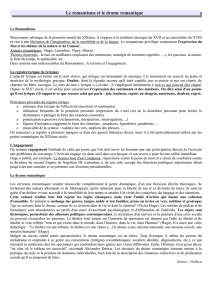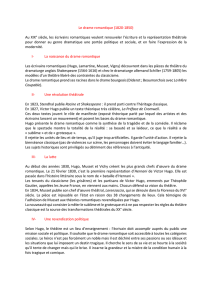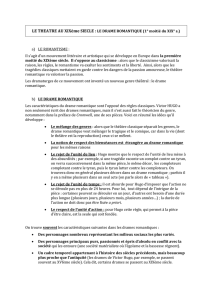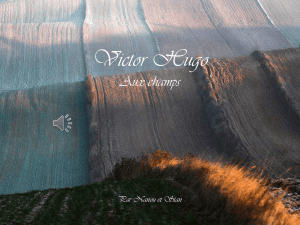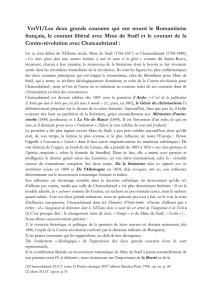Le Romantisme

1
Le Romantisme
Comment s’explique l’état d’âme romantique? :
- on s’aperçoit que la raison ne peut tout expliquer.
- on pense qu’on ne pourra pas réaliser le progrès et l’âge d’or,
c’est-à-dire le bonheur proclamé par les philosophes des Lumières.
- la délusion face à la Révolution et à la période napoléonienne: les
idéaux de liberté, d’égalité et de fraternité ne sont pas respectés.
L’état d’âme romantique naît de la conscience de la perte de toutes les illusions, tout en
conservant l’aspiration à l’infini et à l’éternité, à un bonheur sans limites.
Le Romantisme, en tant que mouvement culturel organisé, naît en Allemagne, et c’est tout
d’abord un mouvement philosophique qui s’oppose à la philosophie des Lumières (Kant, Fichte,
Schelling, Hegel et Schiller).
Ses caractéristiques essentielles sont :
- recherche de l’harmonie primitive avec la nature, d’une vie riche,
totale et heureuse.
- contradictions (antinomies) : 1) mélancolie pour le bonheur perdu; 2)
enthousiasme pour le bonheur futur.
Comment surmonter ces antinomies? Diverses tentatives :
- le sentiment, quelque chose d’illimité, indépendant de la réalité, vie
pure de notre esprit. Ce sentiment, chez les Latins, est très souvent accompagné de la
méditation. On doit noter que leur réaction à la philosophie des Lumières se fait justement
au nom du sentiment.
- l’évasion sentimentale : à travers trois procédés :
- la fuite dans le temps (le Moyen Age en particulier, qui
sera réévalué, après une longue période d’oubli).
- la fuite dans l’espace (appelée également exotisme) :
recherche de nouvelles sensations dans un cadre géographique en dehors de la norme : on
peut l’observer dans l’œuvre de Chateaubriand ou dans celle de Victor Hugo.
- la fuite vers des mondes imaginaires: c’est l’expérience
du rêve, de la rêverie, de l’imagination libérée.
- l’extase amoureuse (influence du mysticisme amoureux de La
Nouvelle Héloïse de Rousseau tout d’abord sur l’œuvre de B. Constant et sur celle de G. Sand).
Le nouveau mysticisme, contrairement à celui de Dante, élève vers le ciel la femme telle
qu’elle est, avec tout le poids de sa nature sensible, et l’adore comme une idole.
- la nature : on peut fuir les bornes de la vie dans le contact immédiat
et total avec la nature, dans laquelle palpite la vie divine (présence de Dieu). Influence de J.-
J. Rousseau : image d’une nature amie, confidente, consolatrice. On peut vivre en sympathie
avec la nature, comme avec les hommes. On arrive à la transfiguration
anthropomorphique de la nature : les phénomènes physiques sont interprétés avec des termes
tirés de l’expérience psychologique et vice versa. Le thème central de cette conception de la
nature c’est celui de la fusion de l’individu avec le tout, avec l’infini. A la base de toute cette

2
interprétation de la réalité, il y a le panthéisme, doctrine selon laquelle Dieu s’identifie avec
le monde, la Création. On doit noter que le Romantisme se balance entre deux pôles :
l’individualisme et le mysticisme.
- l’art : dans le monde de l’art, l’homme est parfaitement libre, exempt
de toute contrainte et de toute limitation. Les antinomies (individu et cosmos; raison et
sentiment; réflexion et fantaisie; conscience et inconscience; esprit et sens) se réconcilient
en une totale heureuse harmonie, justement dans le monde de l’art. Mais l’art, en tant
qu’expérience humaine, ne peut donner lui aussi qu’une illusion d’infini. L’erreur des
romantiques est celle d’avoir pris l’artiste pour un mystique qui reçoit une révélation
surnaturelle. Ainsi toute tentative de sortir du fini à travers l’art se termine par un échec.
Cela engendre la mélancolie qui naît de la conscience de ne pouvoir atteindre l’idéal
(Weltschmerz=douleur mondiale, douleur métaphysique).
Quelques aspects de la culture romantique :
- l’historisme : les philosophes du XVIIIe siècle avaient donné de
l’importance de l’histoire (en particulier Voltaire), mais ils avaient jugé chaque époque
historique en fonction de leur idéal philosophique; ainsi la plupart des époques passées sont
considérées négativement : en particulier le Moyen Age est considéré comme une période de
préjugés, d’erreurs, de violence, de superstitions, de ténèbres mentales et morales. Au
contraire, pour les romantiques, l’histoire est un organisme qui se développe selon un système
qui relie une période à la période précédente et présente les germes du futur. En particulier,
on réévalue les époques primitives comme étapes nécessaires pour le développement
successif, et surtout le Moyen Age et la Grèce classique, dont la culture est considérée plus
originale par rapport à la culture latine (influence de Mme de Staël). On réévalue le Moyen
Age, car c’est à cette époque-là que remonte, selon les romantiques, la naissance des nations
européennes. En outre, c’est la période où se consolide le christianisme, religion qui
est à la base de la culture moderne. La critique des Romantiques contre les Classiques aura
comme noyau central le thème de la religion. Les ouvrages inspirés de l’Antiquité présentent
une religion, le paganisme, qui n’est pas la religion des modernes. Aussi bien Chateaubriand
que Mme de Staël insistent sur la nécessité d’exalter le christianisme : Chateaubriand
compose alors Le Génie du Christianisme (1802) et Mme de Staël, dans son ouvrage théorique
De l’Allemagne (1810, mais publié en 1813) déclare que «La littérature des anciens est chez
les modernes une littérature transplantée : la littérature romantique ou chevaleresque est
chez nous indigène, et c’est notre religion et nos institutions qui l’ont fait éclore.» C’est
donc l’anachronisme qui selon elle est la caractéristique première des ouvrages imités de
l’Antiquité.
- le nationalisme : chaque individu naît, pas comme citoyen du monde (cf. Le
cosmopolitisme du siècle des Lumières), mais comme citoyen d’une patrie, dont il reçoit une
marque à travers la langue, les institutions, la tradition, la religion, etc. Dans presque tous les
pays, on assiste à une évolution : une première phase caractérisée par la lutte de l’individu
contre la société, qui se traduit souvent par un repli de l’individu sur lui-même; une deuxième
phase, qui débute vers 1830, où l’écrivain s’ouvre aux exigences sociales. La vie de
Lamartine offre un excellent exemple de cette évolution : avec son entrée dans la politique
correspond le début d’une phase de sa carrière d’homme de lettres où le poète s’occupe des
problèmes de la société, et en particulier du prolétariat. Il faut tout de même

3
noter que son chef-d’œuvre lyrique, Les Méditations poétiques, appartient à la première
phase.
- la personnalité : le romantique recherche, comme le philosophe du XVIIIe siècle,
le bonheur, mais il veut un bonheur absolu, sublime, qui naisse non pas de la modération des
impulsions ou de l’élimination des contrastes, mais de l’ivresse de leur dépassement, même à
travers l’expérience de la douleur (pour le romantique, le malheur n’est pas représenté par la
douleur, mais par l’ennui). Le romantique aime les gestes sublimes et les expériences
exceptionnelles. Il se sent comme un solitaire et un exilé au milieu des autres hommes, qui
sont selon lui médiocres, mesquins. Il rêve de choses impossibles : il ne peut donc pas les
réaliser; alors il accuse de son échec le Destin, mais il n’accepte pas la défaite, l’insuccès :
ainsi se manifeste sa supériorité morale. Même le suicide est vu, non pas comme un geste
de faiblesse, mais comme un défi au Destin, la manifestation suprême de la grandeur d’une
âme qui refuse d’accepter la vie.
La poétique classique :
1) imitation des modèles anciens.
2) respect des règles de chaque genre littéraire.
3) en France, en particulier, étroit rapport avec le goût de la Cour, des
classes élevées (XVIIe siècle).
La poétique romantique :
1) la littérature vue comme l’expression de la société : «La littérature
est l’expression de la société.» (Mme de Staël, De l’Allemagne) : selon elle, il faut tenir
compte, pour comprendre une oeuvre littéraire, de l’importance du climat, des coutumes, des
institutions politiques, des idées religieuses, morales.
2) la distinction entre la littérature classique et la littérature
romantique : Mme de Staël, dans son ouvrage De l’Allemagne, déclare que la littérature
classique chez les peuples modernes est un phénomène d’imitation, un véritable anachronisme
(cf. Citation dans la section ayant pour titre historisme).
3) La valeur de l’œuvre dépend de l’originalité de son inspiration, et non
pas de l’imitation des Anciens. La véritable oeuvre d’art est le produit du génie individuel, qui
ne connaît pas de règles et de modèles en dehors de lui-même, mais au contraire crée avec
une totale spontanéité et sincérité.
4) Au théâtre : contre la règle des trois unités (thèse exprimée par
les frères Schlegel, puis par Manzoni et par Hugo). Les motifs qui expliquent le rejet de cette
règle sont les suivantes : elle ne respecte pas le principe de la vraisemblance et surtout elle
ne tient pas compte du fait que toute oeuvre forme un organisme individuel avec des lois qui
lui sont propres. Les romantiques voient dans l’œuvre d’art la traduction sensible d’une idée.
Dans la célèbre Préface de Cromwell, Victor Hugo donne une clé de lecture
religieuse à la naissance du drame romantique où se mêlent comique et tragique, sublime et
grotesque : «Du jour où le christianisme a dit à l’homme : «Tu es double, tu es composé de
deux êtres, l’un périssable, l’autre immortel [...] De ce jour le drame a été créé.» En
outre il ridiculise lui aussi la règle des “deux unités” (c’est-à-dire celle de lieu et celle de
temps), en retournant contre les classiques l’argument de la vraisemblance, qui selon Hugo, n’a
pas été respectée. Hugo propose une autre forme d’art dramatique qui doit justement
respecter le principe de la vraisemblance, un art plus libre, capable de prendre pour sujets

4
des événements historiques, mais aussi de les transposer au théâtre à travers la force de
l’inspiration poétique : «La vie transfigurée dans l’art.» (Préface de Cromwell).
L’esthétique romantique :
Elle est caractérisée par la présence d’un poète enthousiaste et passionné (Romantisme latin
surtout), par le refus de la mythologie, considérée comme un ensemble de fables, de
mensonges, par la musique qui favorise chez l’auditeur l’impression d’infini, par la parole qui
doit suggérer (pouvoir évocatoire, magique de la parole), par la nouvelle exigence de
représenter le vrai. Pour ce qui concerne ce dernier aspect, on peut préciser qu’au vrai
“typique” (qui représente une nature et un homme en général) des classiques, les romantiques
substituent le vrai “caractéristique” qui représente une nature et un homme individuels,
concrets, d’un certain temps et d’un certain lieu. Cela explique la préférence des sujets tirés
de l’histoire, surtout au théâtre et le fait qu’on ne se limite pas à dépeindre le beau, mais
aussi le laid, le difforme, car lui aussi fait partie de la réalité. (cf. La Préface de Cromwell de
V. Hugo et le personnage de Quasimodo de Notre-Dame de Paris).
Dernier élément de l’esthétique romantique, c’est la nouvelle fonction du poète, vu comme un
mage, un magicien, qui, grâce à la parole, ne décrit pas le monde visible, mais un monde
inconnu. Selon V. Hugo, le poète est un sacerdote et prophète, élu de Dieu pour révéler au
peuple ses décrets et pour guider l’humanité vers un avenir meilleur. (cf. le recueil Les Rayons
et les Ombres et la pièce “Stella”). Dans ce cadre, le poète a très souvent une triple mission :
religieuse, sociale et nationale. Hugo, en outre, critique les poètes qui se désintéressent des
problèmes de la société et déclare qu’il n’y a pas de sujet tabou. A l’occasion de la parution du
poème “Clair de lune”, sujet de scandale (pour la première dans le cadre de la poésie on traite
un sujet très violent: des Grecs meurent noyés, enfermés encore vivants dans des sacs, par
leurs ennemis les Turcs), il répond aux accusations en affirmant: “Il n’y a en poésie ni bon ni
mauvais sujet, mais de bons ou de mauvais poètes; tout relève de l’art; tout a droit de cité en
poésie”.
Histoire de l’adjectif “romantique” :
Il est d’abord employé au XVIIe siècle, en Angleterre, pour indiquer certaines
caractéristiques des romans pastoraux (“romantic” = semblable aux vieux romans) et possède
une connotation négative. Au XVIIIe siècle, le courant rationaliste l’emploie encore dans le
sens péjoratif pour indiquer les aberrations de la raison et les excès du sentiment, alors que
le courant sentimental l’utilise dans une acception positive pour indiquer un état d’âme rêveur,
mélancolique. C’est Rousseau qui le premier l’emploie dans ce sens dans les Rêveries d’un
promeneur solitaire pour représenter “un je sais quoi” (expression déjà employée dans La
Nouvelle Héloïse, une émotion vague suscitée par la vision d’un certain paysage. Mais ce sont
les Allemands qui les premiers attribuent à ce terme une connotation spirituelle et
esthétique. En particulier, les frères Schlegel dans l’expression antithétique “classique-
romantique” se réfèrent au nouvel idéal littéraire; c’est dans cette acception que le mot se
répandra en Europe.
Date de naissance du Romantisme :
En Allemagne, tout d’abord : un groupe de poètes se réunit autour de la revue “Athenaeum”
qui commence à paraître en 1797 : c’est le groupe d’Iéna qui comprend les frères Schlegel,
Novalis et Tieck. Il se formera une deuxième école romantique : le groupe d’Heidelberg.

5
En Angleterre : en 1798, publication des Lyricals Ballads de Coleridge et Wordsworth.
En Italie : en 1816, publication de la Lettera semiseria di Crisostomo de Berchet.
En Espagne : les premiers manifestes datent de 1823.
En France enfin, il est difficile d’indiquer une date précise. On peut indiquer l’ouvrage
théorique De l’Allemagne de Mme de Staël composée en 1810, mais publié seulement à partir
de 1813 en Angleterre, puis en 1814 en France à cause de la censure napoléonienne. D’autre
part la Préface de Cromwell (1827) de V. Hugo contient des idées qui circulent déjà depuis dix
ans. Mais on doit tout de même rappeler la grande influence qu’a sur tout le mouvement
l’œuvre de Rousseau, véritable précurseur du romantisme littéraire.
La diffusion des idées romantiques et la lutte contre le Classicisme se fait aussi à travers les
journaux et les revues : en Allemagne, l’ “Athenaeum”; en Italie, “Il Conciliatore”; en Espagne,
“El Artista” e “El siglo”; en France, “La Muse” et “Le Globe”.
Les ouvrages théoriques les plus importants sont : De l’Allemagne de Mme de Staël et Cours
de littérature dramatique (1814) des frères Schlegel.
Quelques notions complémentaires de la culture romantique :
- le sublime : le romantique préfère le sublime au beau. L’impression du sublime qui naît d’un
violent et grandiose contraste entre des forces cosmiques : spirituelles et naturelles. Le
sublime naît de la vision de spectacles grandioses, sauvages, terribles qui font comprendre à
l’homme sa petitesse et son impuissance physique et qui en même temps lui donnent la
conscience de sa grandeur et de sa supériorité morale (influence de lord Byron).
Les romantiques aiment la nuit, la lumière pâle de la lune, la pénombre qui donnent une
impression de vague au paysage et qui favorise l’évasion de l’esprit vers la réalité
suprasensible. Ce goût se retrouve également dans la description de l’architecture gothique
(cf. réévaluation du Moyen Age) : la cathédrale gothique, avec ses lignes saillantes et la
suggestion indéfinie de ses ombres, semble répondre à l’élévation mystique de l’esprit et à la
soif de mystère : c’est l’impression qu’on peut relever dans certaines pages de Notre-Dame de
Paris de V. Hugo. Une autre source du sublime est représentée par l’idée de la mort, qui prend
des connotations différentes selon les auteurs. (Voir aussi le passage ci-dessus concernant le
thème du suicide).
- la vie intérieure : l’art devient le miroir de la personnalité individuelle, et surtout de la vie
du cœur. L’influence de Rousseau, encore une fois, sera évidente sur un grand nombre
d’ouvrages autobiographiques sur le modèle des Confessions et de l’ouvrage Les Rêveries d’un
promeneur solitaire. On peut ainsi citer pour la France : Oberman de Sénancour ; Confession
d’un enfant du siècle de Musset et Adolphe de B. Constant et pour l’Italie : Foi et beauté et
Journal intime de Tommaseo et Mes Prisons de Silvio Pellico. Tous ces ouvrages sont
caractérisés par une profonde analyse psychologique. L’objet de l’analyse n’est plus, comme
par le passé, l’homme en général mais un individu bien particulier dans des circonstances
particulières, avec des passions particulières et dépeint dans toutes les nuances de sa
psychologie. La passion dominante est l’amour. On retrouve cet intérêt pour l’analyse
psychologique et pour la description de la vie intérieure même dans les ouvrages qui ne sont
pas autobiographiques. Mais dans ce cas, les héros sont des personnages ou bons ou mauvais.
Cela est dû à une sommaire analyse psychologique, à l’influence de Byron. Dans le cas de Hugo,
son goût antithétique le pousse à présenter deux camps : un positif et un négatif.
- le réalisme : le Romantisme a exalté en même temps la fantaisie et le vrai. Le principe de la
liberté et de la sincérité dans l’art élargit le domaine d’observation de l’écrivain et le pousse à
 6
6
 7
7
1
/
7
100%