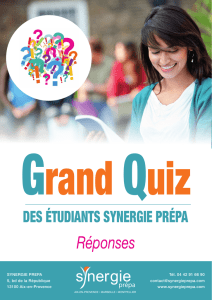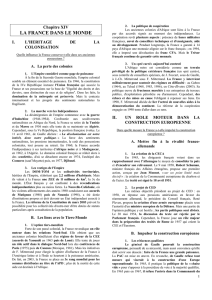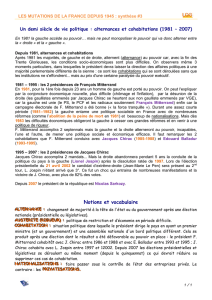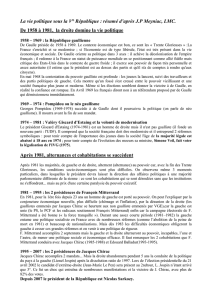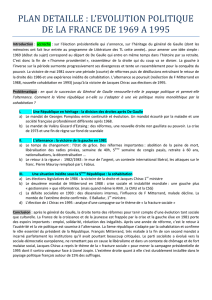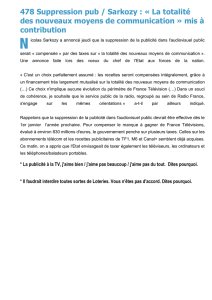ArnoldLabbe?2014 - TARA

The International Linguistic Association 59th Annual Conference
Paris, France, May 22-24, 2014
Proposition de communication
Votez pour moi… ne votez pas pour l’autre
Edward ARNOLD
(Trinity College – Dublin)
Dominique LABBE
(PACTE – CNRS – Grenoble)
dominique.labbe@umrpacte.fr
Résumé
L’élection présidentielle française se déroule en deux scrutins. Le second tour oppose les deux
candidats arrivés en tête au premier. Entre les deux tours, depuis 1974, un débat télévisé oppose les
deux finalistes sur le modèle des débats présidentiels aux Etats-Unis. Notre communication utilisera
les textes de ces 6 débats (136 000 mots). Une bibliothèque de plus de 6 000 textes politiques offre des
points de comparaison.
Cette communication présente des indices statistiques construits pour l’analyse de cette
communication en situation d’interaction. Ces indices sont issus des théories concernant la
présentation des actants du discours, l’énonciation de la subjectivité du locuteur et de la modalisation
du discours. L’application de ces indices permet d’apporter un éclairage neuf sur ces débats mais
surtout de définir, pour chacun de ces indices, sa portée, ses limites et les améliorations possibles.
La première partie analyse la tendance à la personnalisation propre à chaque orateur et la
décompose dans les dimensions suivantes : l’importance relative donnée à l’orateur, à l’autre et aux
véritables destinataires du message (les auditeurs). La seconde partie mesure le choix fondamental en
faveur du verbe et, au sein de celui-ci, entre l’accompli (densité des verbes, de être et avoir) et les
modalités (possible, souhaitable, volonté, obligation, connaissance). Enfin, la densité plus ou moins
importante de la négation mesure la portée polémique du discours.
On en tire quelques conclusions sur la spécificité des discours électoraux et l’évolution du
discours politique français depuis 40 ans. La conclusion souligne enfin l’utilité des vastes corpus de
textes et de la lexicométrie pour l’étude de la langue et son enseignement.

L’élection présidentielle française se déroule en deux scrutins. Le second tour oppose
les deux candidats arrivés en tête au premier. Entre les deux tours, depuis 1974, un débat
télévisé oppose les deux finalistes sur le modèle des débats traditionnels aux Etats-Unis
(Coullomb-Gully 2009)
1
. Notre communication utilisera les textes de ces 6 débats, soit
136 000 mots (annexe 1). Ce sera l’occasion d’analyser la "parole politique en confrontation"
(Burger, Jacquin & Micheli 2011).
Pour être évaluée toute communication doit être replacée dans son "contexte". Dans le
cas précis, la situation au sens strict est semblable depuis 1974 : deux personnes face-à-face
dans un studio avec deux journalistes chargés de veiller à l’égalité de traitement des candidats
spécialement de leur temps de parole. Le cadre institutionnel est aussi fondamentalement
identique, depuis 1974, même si les institutions ont un peu évolué : à partir de 2002, la durée
du mandat a été réduite de 7 à 5 ans et l’élection de la chambre des députés suit l’élection
présidentielle).
Troisièmement, la conjoncture politique est toujours différente. Le président sortant est-
il candidat (comme en 1981, 1988 ou 2012) ? Qui est arrivé en tête ? Quels seront les reports
de voix (les candidats s’adressant prioritairement à ces électeurs qu’ils doivent conquérir pour
arriver en tête) ?
Autrement dit, les différences constatées entre les différents locuteurs peuvent provenir
de leurs personnalités, de leur conception particulière de l’action politique, de leur
programme, etc. mais aussi de la conjoncture politique de l’entre-deux-tours.
Pour répondre objectivement à ces questions, nous étudierons un certain nombre
d’indices statistiques. Ces indices sont déduits de la théorie standard concernant la
présentation des actants (Amossy 2010, Charaudeau 1994), l’énonciation de la subjectivité du
locuteur dans son discours (Benveniste 1956 & 1958, Dubois 1969, Kerbrat-Orecchioni 1981)
et la modalisation du discours (Benveniste 1965, Gross 1999, Labbé & Labbé 2010). Il s’agit
de tester ces propositions théoriques sur des corpus de grandes dimensions afin de définir leur
portée, leurs limites et les améliorations possibles. Des étalons de comparaison seront fournis
par les autres sections de la bibliothèque (annexe 2), notamment plus de 6 000 textes
politiques, soit au total 12,5 millions de mots (en français). Nous utiliserons aussi quelques
données issues de la politique anglaise (Arnold 2005 & 2008).
La première partie étudie l’importance relative donnée à l’orateur, à l’autre et aux
véritables destinataires du message (les auditeurs, les électeurs à conquérir).
La seconde partie mesure l’orientation du discours vers l’accompli (densité des verbes,
de être et avoir), ou l’inaccompli (autres verbes, notamment faire) ou les modalités (possible,
souhaitable, volonté, obligation, connaissance). Enfin, la densité plus ou moins importante de
la négation donne un indice de la portée polémique du discours.
Cela permettra de présenter quelques conclusions sur la spécificité des discours
électoraux et l’évolution du discours politique français depuis 40 ans. On évoquera enfin
1
Les références bibliographiques sont placées à la fin de cette communication

l’utilité des vastes corpus de textes et de la lexicométrie pour l’étude de la langue et son
enseignement.
I. Pronoms et personnalisation
L’orateur a-t-il choisi de personnaliser son propos ou au contraire de lui donner une
teinte impersonnelle ? Pour répondre à cette question, Dubois (1969) propose de s’intéresser à
la densité relative des pronoms personnels qui permettrait de calculer un indice global de
personnalisation.
Mesure globale
En s’en tenant aux pronoms personnels, comme le suggère Dubois, l’indice de
personnalisation se formule ainsi :
mots de totalNombre personnels pronoms de Nombre
De la même manière, il peut être calculé des indices pour les références au locuteur, à
son adversaire et aux auditeurs (tableau 1).
Tableau 1. Densité relative de l’ensemble des pronoms personnels, des premières et seconde
personnes (en pour mille mots : ‰).
Date
Candidats
Indice
personnalisation
(‰)
je (‰)
vous (‰)
nous (‰)
1974
V. Giscard d'Estaing
84,9
32,3
21,4
6,5
F. Mitterrand
90,2
29,6
24,0
5,9
1981
V. Giscard d'Estaing
82,3
25,2
20,0
9,6
F. Mitterrand
80,4
34,3
12,3
3,4
1988
F. Mitterrand
85,3
30,8
16,3
6,0
J. Chirac
85,7
33,4
18,5
9,2
1995
J. Chirac
77,6
27,8
11,7
11,6
L. Jospin
74,0
30,9
8,7
5,6
2007
S. Royal
71,1
28,9
11,8
4,4
N. Sarkozy
77,8
26,5
13,4
4,4
2012
N. Sarkozy
85,8
20,8
20,9
8,7
F. Hollande
78,6
29,5
25,3
8,5
Moyenne
80,8
28,7
17,2
6,7
Les densités sont exprimées en pour mille mots (‰). Ainsi, en 1974, V. Giscard
d’Estaing a employé en moyenne environ 85 pronoms personnels (exactement 84,9) pour
1 000 mots. Soit 5% de plus que la moyenne de tous les débats (moyenne donnée en dernière
ligne du tableau).
Est-ce beaucoup ? Dans l’ensemble de la bibliothèque du discours politique, cet indice
est de 57,3‰. Par rapport à cet étalon, les débats présidentiels comportent donc 48% de

pronoms supplémentaires, ce qui est considérable et très significatif du point de vue
statistique (il n’y a aucune chance pour que cet écart puisse être imputé au hasard (pour une
discussion sur ces tests statistiques : Labbé & Labbé 2013b).
Cette personnalisation exceptionnelle peut-elle s’expliquer par la situation
d’interlocution propre au face-à-face ou bien est-ce une caractéristique du discours électoral ?
Pour la France, les deux élections présidentielles donnent une base de comparaison (Labbé &
Monière 2008 et 2013). L’indice de personnalisation moyen dans les discours des principaux
candidats était de 64.8‰ en 2007 et de 69,6‰ en 2012.
On peut donc en conclure sans risque d’erreur que la situation de débat en face-à-face
pousse à une personnalisation élevée, nettement plus forte qu’en campagne électorale où cette
personnalisation excède déjà la situation "normale".
Dans cette moyenne les candidats ont-ils fait des choix divergents ? Pour le savoir, la
moyenne sert de référence et la densité propre à chaque locuteur est convertie en indice. Par
exemple, pour Giscard d’Estaing (en 1974) :
84,9/80.8*100 = 105,1.
Autrement dit, en 1974 par rapport à la moyenne de tous les débats, V. Giscard
d’Estaing a utilisé 5% de pronoms personnels en plus. Pour son adversaire dans ce même
débat, l’écart est de + 11,6%. En suivant l’intuition de Dubois, le premier face-à-face aurait
donc été nettement plus "tendu" que la moyenne des suivants.
Les résultats de ce calcul sont récapitulés dans le graphique ci-dessous. L’axe horizontal
représente la moyenne. Toute barre supérieure à la moyenne indique un suremploi et vice-
versa.
Graphique 1. Propension à personnaliser les propos de chaque candidat (moyenne = 100)
Deux constatations s’imposent :
Sauf pour la dernière élection, les deux adversaires semblent faire des choix
convergents. Il y a eu des débats particulièrement personnalisés : 1974 et 1988, dans une
moindre mesure 2012. A l’inverse, deux débats ont été plus impersonnels (1995 et 2007).
Autrement dit, ces choix pourraient dépendre plus de la conjoncture que de la personnalité des

locuteurs. Par exemple, F. Mitterrand et V. Giscard d’Estaing tiennent des propos plus
personnalisés en 1974 qu’en 1981. De même pour J. Chirac entre 1988 et 1995. Il n’y a qu’en
2012 que les choix divergent : N. Sarkozy opte pour une moindre personnalisation – assez
comparable à son choix de 2007 - contrairement à F. Hollande qui retrouve les niveaux des
débats de 1974 ou de 1988…
Deuxièmement, bien que n’étant pas de très grande ampleur, les écarts entre les
locuteurs sont statistiquement significatifs. Pour les valeurs extrêmes, Mitterrand (1974)
dépasse S. Royal (2007) de 28%.
L’indice de personnalisation apporte donc une information intéressante qui mérite d’être
approfondie en le décomposant suivant les différents actants du discours : le locuteur, le ou
les allocutaires (détail dans le tableau 1). En fait, il peut sembler plus pertinent de à ceux des
première et deuxième personnes (je, nous vous).
La première personne
Naturellement, il ne s’agit pas seulement d’un mot mais d’une famille de mots. Ainsi la
première personne du singulier comprend non seulement "je" mais aussi ("j’" "me" (et "m’"),
"moi", "mien" (ne,s). Il faudrait d’ailleurs y ajouter les adjectifs possessifs (mon, ma, mes).
En s’en tenant aux pronoms, la moyenne de tous les débatteurs est de 28,7‰, ce qui
signifie que près de 3 mots sur 100 sont des pronoms de la première personne (principalement
"je"). Est-ce habituel ou non en politique française ?
Présidents de la république (1958-2012) : 19,5‰,
Candidats présidentielles 2007 : 19,6‰
Candidats présidentielles 2012 : 20,9‰
Ajoutons que les politiciens français disent beaucoup plus "je" que ceux d’Amérique du
Nord (Canada et Québec).
Donc, lors des débats télévisés, les orateurs utilisent nettement plus la première
personne que dans les autres situations, même électorales. Mais ici, les choix sont plus
nettement divergents (le graphique 2 est construit selon les mêmes principes que le graphique
1)
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
1
/
20
100%