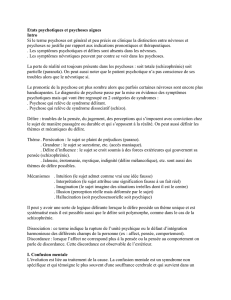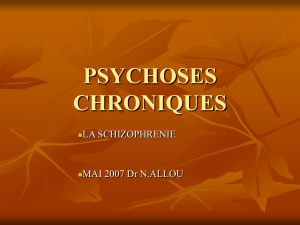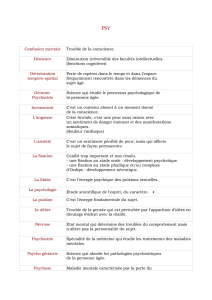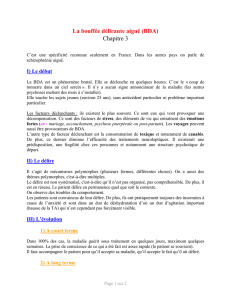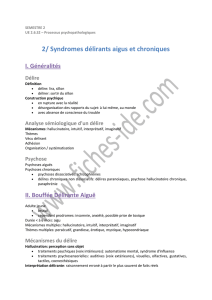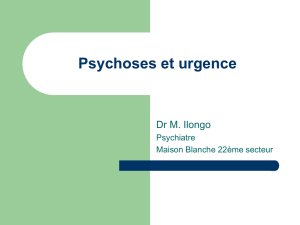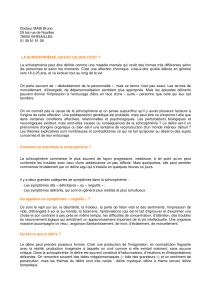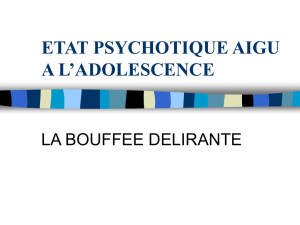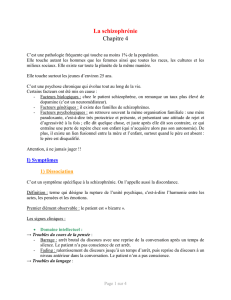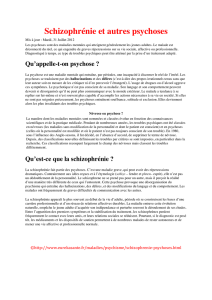les psychoses de l`adulte

1
LES PSYCHOSES DE L’ADULTE
INTRODUCTION :
Mais d’abord, qu’est ce qu’une psychose ?
Le terme est apparu sous la plume de VON FEUCHTERLEBEN en 1847, sous une forme bien
différente de l’acceptation actuelle. Il s’opposera deux décennies plus tard aux névroses, nommées
ainsi en 1877 par William CULLEN.
Même si leur contenu a beaucoup évolué depuis leur définition initiale, nous opposons
traditionnellement celles-là à celles-ci. La névrose serait l’apanage du « nerveux », la psychose
recouvrirait une maladie plus grave, celle du « fou ». En fait cette « vérité » reste relative : certaines
névroses graves sont plus invalidantes socialement que certaines psychoses. A l’inverse, la perte
même de contact avec la réalité, souvent mise en avant dans la psychose n’est pas toujours au
devant de la scène, comme chez certains schizophrènes. Ces derniers vivent très douloureusement
leur « stabilisation », avec une conscience douloureuse (et parfois mortelle) de leur handicap. Alors
que nombre de névrotiques nient toute pathologie psychiatrique.
D’autres définitions n’ont de sens que dans un vertex (point de vue) donné : par exemple, en
phénoménologie (cf. Karl JASPERS), nous pourrions définir la psychose en ce qu’elle a
d’incompréhensible pour l’être humain qualifié de normal (sous-entendu à peine névrosé) : le
patient se situe radicalement dans un ailleurs par rapport à l’examinateur, il s’agit bien d’une
pathologie de l’être, au sens ontologique et non de l’avoir…Autre exemple, nous pourrions définir
en psychanalyse des types de fonctionnement psychiques caractéristiques de la psychose, comme le
déni de la réalité, le clivage ou l’identification projective mais ceux-ci n’ont de sens qu’au sein
d’un discours analytique spécifique et non consensuel. Ces mécanismes sont présents chez le sujet
normal, en particulier durant certains moments évolutifs ou bien du fait de traumatismes sévères :
dans la psychose à proprement parler le sujet fonctionne de manière quasi exclusive selon ces
modes.
Toutes les observations précédentes ont ceci de commun qu’il n’y a pas à priori de
possibilités de passer de la névrose à la psychose et inversement. Certaines théories toutefois
admettent la possibilité toutefois non pas de formes de passage, mais d’une coexistence d’une
partie psychotique de la personnalité et d’une partie non psychotique chez tous les individus
(Wilfred Bion). Bien sûr le résultat final dépend des « dosages » respectifs de l’une et de l’autre.
Ces déterminations psychopathologiques supposent au préalable une bonne connaissance
des théories sous-jacentes. La tendance actuelle se veut plus descriptive, plus pragmatique, au prix
parfois d’une simplification excessive. Ainsi, dans le DSM IV-TR et la CIM X, le concept de
névrose a disparu au profit de multiples entités entre lesquels le lien reste à définir et celui de
psychose se retrouve essentiellement dans le chapitre schizophrénie, trouble schizotypique et autres
troubles délirants soient les items F20 à F29 (schizophrénie et autres troubles psychotiques pour le
DSM IV). Ceux-ci se caractérisent essentiellement par :
1. Une perte au moins partielle de contact avec la réalité, matérialisée par un délire,
qui parfois n’est pas exprimé.
2. Des anomalies du comportement, éventuellement de la structure même du
discours, mais qui peuvent se limiter à certains secteurs de la vie psychique. Celles-
ci sont associées à l’item précédent.
3. Des modifications plus ou moins durables de la personnalité du sujet.
4. De manière fréquente s’y ajoutent des troubles affectifs

2
(triste, anormalement indifférent)
On y distingue donc la schizophrénie (F20), le trouble schizotypique (F21), les troubles
délirants persistants (F22), les troubles psychotiques aigus et transitoires (F23), le trouble délirant
induit (F24), les troubles schizo-affectifs (F25) et des catégories par défaut, tel que autres troubles
psychotiques sans précision (F28 et F29).
Nous commencerons ce cours par la plus fréquente des psychoses, la schizophrénie.

3
LA SCHIZOPHRENIE
1 DEFINITION :
Terme crée en 1911 par Eugène BLEULER pour regrouper différents états pathologiques
antérieurs ayant en commun :
1. Existence d’un syndrome délirant non systématisé. Autrement dit, il s’agit d’un
délire peu organisé.
2. Un syndrome dissociatif, retrouvé dans le discours (incohérence), le
comportement (désorganisé..) et le domaine affectif (désorganisation et
émoussement des affects).
Les troubles sont durables, plus de six mois pour le DSM IV, et ne sont pas liés directement
à un trouble de l’humeur associé, une affection médicale associée, en particulier neurologique
(F06.2) ou une prise de toxique (F10-19.5). Ils sont nettement distincts des psychoses infantiles
dont l’épidémiologie, les origines supposées et l’évolution sont particulières.
On tend à reconsidérer actuellement ce terme, dans la mesure où il s’agirait peut-être
d’affections s’exprimant sous une forme symptomatique commune, mais d’origine et d’évolutions
distinctes. On parlera alors du spectre de la schizophrénie.
2 CLINIQUE :
2.1 PHASE D’ETAT :
2.1.1 Syndrome dissociatif :
La dissociation ou « discordance » est toujours présente, elle a longtemps été considérée comme le
noyau de la schizophrénie, qui permettait d’en faire le diagnostic en l’absence même de délire
exprimé. Elle se retrouve dans les domaines des pensées, du langage, des affects et du
comportement et se caractérise par :
1. L’ambivalence : existence simultanée d’affects, de propos ou d’attitudes contradictoires.
2. Bizarrerie : aspect insolite, inhabituel des sentiments ou des actes qui donnent
l’impression de l’étrange, du fantasque.
3. L’impénétrabilité : aspect énigmatique et incompréhensible, le discours, les actes et les
pensées ont une forme hermétique, sibylline (dont le sens n'apparaît
pas clairement).
Ainsi, la pensée est embrouillée, chaotique (fading), tantôt elle se ralentit (stagnation,
persévération), tantôt elle s’accélère, elle est discontinue. Le barrage est la traduction langagière du
trouble du cours de la pensée : c’est une suspension brutale du discours qui reprend plus tard sur le
même thème ou un autre. La pensée est relâchée, illogique. Il ne s’agit pas d’un réel affaiblissement
intellectuel (au moins chez le sujet jeune) mais de difficultés à utiliser les fonctions cognitives.
Le langage perd sa fonction de communication : le patient peut-être mutique, on peut
retrouver une verbigération (dévidage automatique de mots sans relation entre eux), des réponses à
côtés et bien sûr des barrages. Certains signes sont caractéristiques : les néologismes, la logolâtrie
(culte des mots, les mots sont pris pour la chose-en-soi), glossolalie (langage privé).
Les affects sont parfois très crus, mais plus souvent émoussés (froideur et indifférence), il
existe une dissociation idéo-affective, les manifestations émotionnelles sont paradoxales,
inappropriées.
Le comportement est discordant, cf. paramimie pour la mimique (mimique inappropriées)
avec des sourires immotivés. On retrouve un maniérisme, une passivité, qui contrastent avec des

4
impulsions agressives ou suicidaires en règle sous-tendues par le délire. Dans les formes extrêmes,
c’est à dire en l’absence de traitement, des conduites régressives majeures se rencontrent. A minima
on retrouve une incurie, une tendance à la négligence corporelle et vestimentaire.
2.1.2 Syndrome délirant :
Un délire se définit classiquement par :
1. Son organisation.
2. Ses mécanismes.
3. Ses thèmes
Organisation : il s’agit du délire « paranoïde », c’est à dire un délire non systématisé,
flou et illogique, sans axe thématique particulier, subissant des contaminations multiples,
envahissant tout le champ psychique du sujet sans en épargner aucun secteur.
Il s’accompagne d’une angoisse intense, parfois masquée par la discordance, lorsque par
exemple un patient évoque avec froideur un vécu terrifiant.
Mécanismes : tout peut se voir, les illusions (perception déformée de la réalité), les
interprétations (la réalité est transformée par le mode de pensée du sujet, elle est lue à travers un
code qui lui est propre et, dans la schizophrénie, celui-ci est volontiers impénétrable), les intuitions
(type révélations…), les imaginations (thèmes extraordinaires, type extraterrestres..). Mais ce qui
est quasi constant est l’existence d’hallucinations
1
(50 à 70%), perceptions sans objet à percevoir,
auditives, visuelles, cénesthésiques (impression corporelles anormales) On parle d’hallucinations
psychosensorielles lorsqu’elles empruntent les canaux sensoriels classiques (c’est le cas des
« voix » dans la tête), ou d’hallucinations psychiques lorsqu’elles s’imposent directement au patient
(sur un mode télépathique par exemple). Elles peuvent constituer ce qu’on appelle un
« automatisme mental » ;
1. Automatisme idéo-verbal, associant des hallucinations auditives
psychosensorielles et psychiques avec commentaire de la pensée, écho de
la pensée ou de la lecture, la pensée est devinée par des intrus ou volée.
2. Automatisme idéo-moteur, des gestes, des attitudes, voire des actes
complexes sont imposés. Lorsque les feux automatismes sont associés, on
parle de « grand automatisme mental ».
Thèmes : ils sont multiples, parfois se juxtaposent de manière absurde, les plus fréquents
sont d’ordre persécutif, avec idées d’influence, de dépersonnalisation, hypochondriaque
(transformation d’organe). En fait, on peut tout retrouver, filiation, grandeur, mysticisme, etc. Ce
qui est caractéristique est le caractère décousu de ces thèmes qui fluctuent au cours du temps chez
un même malade, parfois s’associent de manière paradoxale.
2.1.3 L’autisme schizophrénique :
Le terme d’autisme est un mauvais terme, dans la mesure où il a pris une extension
particulière en psychiatrie de l’enfant alors même qu’il paraît important de bien dissocier les
psychoses de l’enfance et de l’adulte. Ce terme s’applique à des sujets repliés dans leur monde
intérieur, fermés à toute communication, désinvestissant la réalité. Le patient est distant,
inaccessible. Son détachement est massif.
De ce fait, les aptitudes scolaires pour les plus jeunes, socioprofessionnelles pour les autres
s’en trouvent amoindries.
1
Hallucinare : rêver, se méprendre, divaguer, tromper se tromper.

5
2.1.4 Symptômes affectifs :
Les troubles de l’humeur sont fréquents, sur un versant dépressif ou maniaque, avec des
fluctuations parfois rapides et surtout une discordance idéo-affective importante.
L’existence potentielle de ceux-ci appelle deux remarques :
1. La première concerne l’existence de troubles dépressifs éventuels chez les
schizophrènes. Ceux-ci sont mieux connus actuellement et il faut noter leur caractère
particulier (délire parfois présent, non congruent à l’humeur, discordance, résistance aux
traitements, facteurs déclenchant absents ou paradoxaux, etc.).
Ils apparaissent en particulier à un moment bien particulier de l’évolution d’un
schizophrène, lorsque, grâce au traitement, le délire disparaît, alors que la
symptomatologie affective et autistique sont moins sensibles aux neuroleptiques.
D’authentiques thèmes dépressifs peuvent s’y ajouter, soit du fait de l’hypothétique effet
dépressogène des neuroleptiques, soit du fait de la disparition du délire qui laisse le sujet
littéralement vide. 25 % des schizophrènes présenteraient des symptômes dépressifs.
2. Mais il faut bien différencier ce syndrome dépressif éventuel de ce que l’on appelle « la
symptomatologie négative de la schizophrénie ». Certains auteurs différencient en effet
- les symptômes positifs (agitation, délire, excitation)
- des symptômes négatifs (ralentissement psychique et moteur, athymhormie – perte
de l’élan vital -, anhédonie – perte de toute sensation de plaisir -dissociation), ces
derniers pouvant passer à tort pour de la dépression. Or la prise en charge en est
différente sur tous les points.
2.1.5 Troubles des conduites sociales :
Fréquentes, jusqu’à d’authentiques conduites psychopathiques. L’association franche d’une
psychopathie et d’une schizophrénie fait poser le diagnostic de héboïdophrénie. Typiquement
française et absente de la classification américaine, cette forme clinique est difficile à traiter du fait
des implications comportementales des deux pathologies.
A noter la fréquence croissante des conduites toxicomaniaques et alcooliques utilisées
littéralement pour ne plus penser.
Il y a trois fois plus de fumeurs chez les hommes schizophrènes (cinq fois chez les
femmes !) que dans la population normale.
Dans les psychoses on retrouverait selon les études jusqu’à 60% de consommation
excessive d’alcool. Ceci serait surtout vrai dans les six premières années de l’évolution de la
pathologie et avant 45 ans. En fait on ne dispose que de peu de données fiables sur le lien
étiopathogénique éventuels qui relierait alcool et psychose, à priori il n’y a pas de modification de
la prévalence de la psychose schizophrénique chez les buveurs excessifs et les dépendants de
l’alcool. Le risque est augmenté s’il existe des antécédents familiaux addictifs.
Pour le cannabis les données sont controversées : pour Zammick (2002) au-delà de 5 à 10
usages le risque de faire une psychose serait augmenté de 30%. Pour Degenhart (2003) il
n’existerait pas de relation directe mais les patients vulnérables débuteraient plus précocement leur
pathologie. Rappelons d’ailleurs l’action anticholinergique et dopaminergique du THC, qui
interfère donc avec les anti-psychotiques.
Il n’existe pas encore de données sur les amphétamines.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
1
/
28
100%