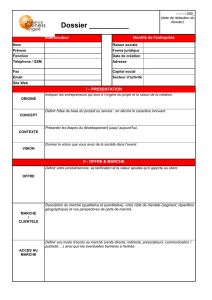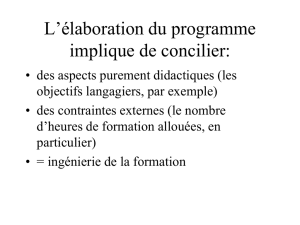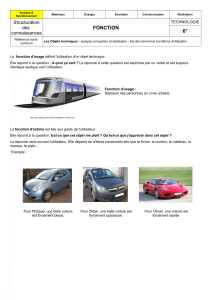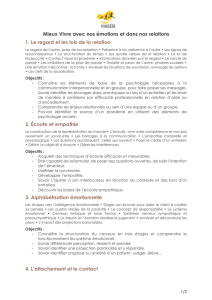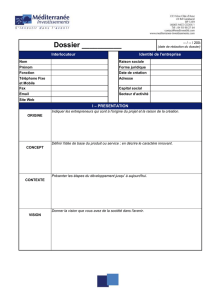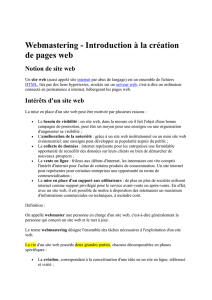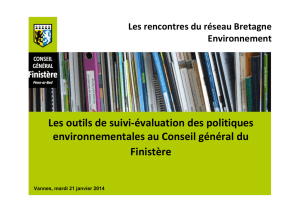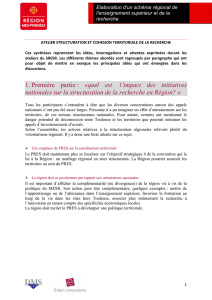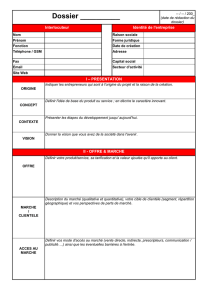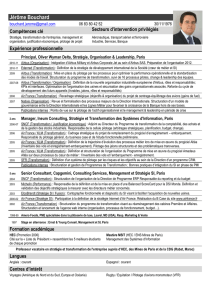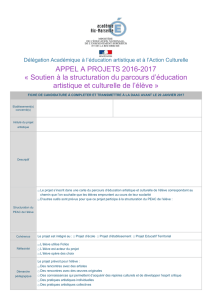INSTITUTIONS ET STRUCTURATION SPATIALE

1
FORCE DYNAMIQUE DE STRUCTURATION SPATIALE
ET
CONFIGURATIONS DIFFERENCIEES DU TERRITOIRE
DYNAMIC FORCE OF SPACE STRUCTURING
AND
DIFFERENT KINDS OF TERRITORIAL CONFIGURATIONS
B. KHERDJEMIL
Maître de Conférences
Chercheur à l’Institut des Mers du Nord
Dunkerque
Université du Littoral Côte d’Opale
Département Economie-Gestion
49/79 Place du Général de Gaulle
F- 59383 DUNKERQUE CEDEX
RESUME
L’objectif de ce papier est un essai de mise en relief du processus de structuration différenciée de
l’espace. Deux temps analytiques sont mis en relief. D’abord, nous avons élaboré notre instrument
d’analyse : la force dynamique de structuration spatiale. Ensuite, nous avons mis en œuvre cet outil
conceptuel dans le champ de la dynamique spatiale afin de mettre en saillie le caractère différencié de la
configuration des territoires
SUMMARY
The aim of this paper is to characterize the different kinds of space structuring. First, we make a
theoretical effort to formalize our analytical instrument: the dynamic force of space structuring. After,
we try to implement this conceptual tool in space dynamics for giving prominence to the process of
differential territorial configurations.
MOTS-CLES : espace économique, espace institutionnel, force dynamique de structuration,
rationalité, cité.
KEY-WORDS : economic space, institutional space, dynamic force of structuring, rationality, city.
CLASSIFICATION JEL : K11, K12, L22, R10, R15.

2
-INTRODUCTION -
L’objectif de ce papier est de tenter d’apporter un éclairage conceptuel institutionnel sur la dynamique
de structuration de l’espace. Celle-ci doit être saisie dans le sens où il est question « d’expliquer les
grands principes qui président à la répartition et à l’interaction des activités économiques dans l’espace
géographique » (TELLIER,1985, p. XIX). Cette thématique n’étant pas nouvelle, nous souhaiterions la
revisiter avec un instrument d’analyse dont les sources tissent un lien très étroit avec les apports de la
théorie des conventions.
Cet objectif ne peut être atteint que si l’on opère une révision profonde à l’endroit du traitement de la
notion de l’espace.
Selon les canons traditionnels de l’économie standard où règne la rationalité substantielle et
l’information parfaite, l’espace « intervient à travers les anisotropies de coûts et les coûts de
franchissement de la distance physique » (VELTZ, 1993,p.671). Dans ce type de configuration théorique,
l’entreprise ne semble pas jouer un rôle déterminant dans la dynamique de régulation du système
économique. On ne la perçoit qu’au travers de la seule fonction de transformation des « inputs » en
« outputs ». Elle est réduite à la fonction de production Cobb-Douglas. Dans cette perspective, il est
difficile de mesurer son caractère actif dans le processus de structuration spatiale. De la même manière,
les autres acteurs productifs, comme les salariés, sont considérés comme de banals facteurs de production.
Bien entendu, il n’est pas question de parler de syndicats. Ils sont exclus purement et simplement de
l’analyse économique.
A cette sensibilité méthodologique, nous souhaiterions opposer celle qui intègre les institutions dans le
moteur de la dynamique économique (DUFOURT, 1993, KIRAT, 1993). On ne peut vraiment
comprendre les ressorts structurants de l’espace que si l’on prend « en compte [les] dimensions nouvelles
des phénomènes économiques comme les croyances, les institutions ou encore le temps… » (THISSE,
WALLISER, 1988, p. 24). Avec ce type d’approche, on réintègre l’homme dans l’analyse économique,
non pas en tant que variable réifiée et quantitative, mais en tant que produit de l’histoire et producteur de
celle-ci. C’est sous l’angle de la rationalité limitée, bornée, procédurale (SIMON, 1957) que s’exerce sa
dynamique d’action dans le processus de la construction de l’espace. Il participe ainsi fortement au
processus d’institutionnalisation de ce dernier.
A partir de ces postulats, nous allons essayer, tout d’abord, dans une première période, de forger les
éléments identitaires de notre instrument d’analyse : la force dynamique de structuration spatiale.
Ensuite, dans une seconde phase, nous la mettrons à l’épreuve dans des espaces différenciés afin de
souligner la forme bureaucratique de structuration. Enfin, dans un troisième temps, nous
l’expérimenterons dans des contextes qui lui permettront d’affirmer sa capacité à rendre compte des
formes variées de structuration conventionnelle de l’espace.

3
-I-
IDENTIFICATION DES COMPOSANTES DE LA FORCE DYNAMIQUE DE L’ESPACE
INSTITUTIONNEL
Avant de rendre compte, sous un aspect formalisé, de la force dynamique de structuration spatiale, il
importe, d’abord, d’examiner les relations que les acteurs entretiennent dans le système organisationnel
de la production, et, ensuite, de pointer du doigt les logiques différentielles de leurs actions
(BOLTANSKI, THEVENOT, 2000)
1.1. La nature des relations productives entre les acteurs et les différentes formes sociétales
Les acteurs-productifs (A), insérés dans le champ économique structurant, vont être identifiés au travers
des rapports qu’ils entretiennent dans le procès de production. On peut les caractériser par trois
types de relation :
- la relation de propriété renvoie à l’aspect juridique à l’endroit de l’outil de travail (T);
- la relation de détention exprime la possibilité, pour les acteurs, d’avoir la garde minimale de
l’outil de travail. On peut ne pas en être propriétaire, juridiquement parlant, mais on peut s'en occuper
comme s’il nous appartient;
- la relation d’appropriation porte sur le degré de maîtrise de l’outil de travail par les acteurs.
Ces différentes relations sont à rapprocher, dans le principe, des transactions de Commons(1935).
Néanmoins s’en distinguent-elles par le fait qu’elles se nouent beaucoup plus au niveau de la production
que de l’échange. De ce fait, par le type de règles et de normes véhiculées, elles vont personnaliser et
structurer d’une manière singulière le champ dans lequel elles s’inscrivent. Sur le plan méthodologique,
elles constituent une partie des composantes d’une grille de lecture capable de rendre compte des
structurations différentielles de l’espace. Les rationalités spécifiques des sociétés traditionnelle et
moderne peuvent notamment être repérées au travers des spécificités relationnelles de leurs acteurs
impliqués dans un processus de production.
Cependant ces relations, en soi, ne suffisent-elles pas pour cerner en profondeur la force dynamique de
structuration spatiale. Il faut également tenir compte des logiques différentielles des actions des acteurs.
1.2. Identification des logiques différentielles des actions des acteurs
Les actions des acteurs n’obéissent pas toutes à une même logique. Elles sont mues par des rationalités
spécifiques. Nous pouvons reprendre à notre compte la typologie de l’action humaine établie par
Boltanski et Thévenot (2000). D’autres que nous ont pu s’alimenter auprès de ces auteurs pour analyser le
développement dans les sociétés subsahariennes (FAVERAU, 1995) ou pour établir « grille de
correspondance mettant face à face les six mondes [cités] (…) avec les territorialités qui leur
correspondent » (CREVOISIER et GIGON 2000) .
Dans la grille de pensée de Boltanski et Thévenot, les actions humaines peuvent être mises en
mouvement par six types de logique :
-le premier relève de l’esprit de la «cité domestique». Là, les individus agissent en conformité
scrupuleuse avec les règles, normes et valeurs du groupe auquel ils appartiennent. Ces valeurs
référentielles sont portées par la tradition, l’habitude. Les gens « agissent avec naturel parce qu’ils sont
mus par des habitudes ». Celles-ci « prises de bonne heure [ne sont] jamais une contrainte et
[deviennent] rapidement un comportement naturel » (BOLTANSKI, THEVENOT, 2000, P.210).

4
-le second traite de la «cité industrielle.» Là, l’action « repose sur l’efficacité des êtres, leur performance,
leur productivité, leur capacité à assurer une fonction normale, à répondre utilement aux besoins »
(BOLTANSKI, THEVENOT,2000, P.254) ;
-le troisième porte sur la « cité marchande» où « les actions sont mues par les désirs des individus, qui
les poussent à posséder les mêmes objets, des biens rares dont la propriété est aliénable »
(BOLTANSKI, THEVENOT, 2000, P. 244) ;
-le quatrième s’inscrit dans la «cité du renom.» Là, c’est le côté narcissique de l’homme qui est mis en
avant. Le prestige et la domination symbolique sont les références majeures de cette « cité ». « Les
personnes sont toutes susceptibles d’accéder à [l’état de grandeur] parce qu’elles ont en commun d’être
mues par l’amour-propre. C’est l’amour-propre qui fait leur dignité d’êtres humains. Elles ont un même
désir d’être reconnues, la passion d’être considérées » (BOLTANSKI, THEVENOT, 2000, P. 224).
-le cinquième traite de la «cité civique.» Là, c’est le principe de l’intérêt général qui prédomine. « Les
actions des gens sont pertinentes lorsque, participant d’un mouvement social, elles participent d’une
action collective qui donne sens aux conduites des individus et les justifie… » (BOLTANSKI,
THEVENOT, 2000, P. 231, 232) ;
-enfin, le sixième type de logique s’enracine dans la «cité inspirée.» Là, l’action humaine n’est pas régie
par « les mesures, les règles, l’argent, la hiérarchie, les lois » (BOLTANSKI, THEVENOT, 2000, P.
200). Sa légitimité se forge dans les profondeurs de l’intériorité des êtres où « la passion qui les anime
leur procure , indissociablement, le désir de créer, que l’inspiration a réveillé en eux, l’inquiétude ou le
doute, l’amour pour l’objet poursuivi et la souffrance » (BOLTANSKI, THEVENOT, 2000, P. 201).
Ces différentes rationalités spécifiques de l’action humaine, conjuguées à la structure relationnelle
des acteurs insérés dans le procès de production, constituent l’essence de la force dynamique de
structuration spatiale que nous allons tenter de formaliser
*
(1)
1.3. Présentation formelle de la force dynamique de structuration spatiale
Les forces structurantes du champ économique empruntent à la fois aux théories traditionnelles de la
localisation et aux logiques différentielles des acteurs en présence.
1.3..1. L’approche traditionnelle de la localisation et l’aspect objectif de la force dynamique de
structuration
Si l’on s’arrête aux présentations traditionnelles de la structuration de l’espace, on peut, avec
Luc-Normand TELLIER (1985, p.6), mettre, en avant, la fonction suivante de la dynamique de
localisation des entreprises:
L(x) = L[(F1(x)…Fj(x)….Fm(x), G(x, y1)…G(x,yk)…G(x,yn)]
où :
F(x) renvoie « aux propriétés absolues du point x » (TELLIER, 1985, P. 6) lorsque l’on considère
les facteurs de localisation 1,j,m, ces derniers pouvant être « le loyer, le coût de terrain, les taxes
foncières, le zonage, [les ressources], etc) » (TELLIER, 1985, p.6) ;
G(x,y) est une fonction qui traduit la distance, la « position relative du point x par rapport à
certains autres points de l’espace » (TELLIER, 1985, p.6). Cette fonction permet d’examiner
*
Les chiffres entre parenthèses renvoient aux notes en fin d’article.

5
« les phénomènes d’attraction et de répulsion par rapport à certaines activités » (TELLIER,
1985, p.7).
Ce type de fonction garde son actualité et son éclairage peut nous aider à comprendre la complexité de
la structuration spatiale. Cependant, il nous semble qu’elle ne nous rend pas compte du caractère vivant et
différencié des mécanismes structurant l’espace. C’est pourquoi nous nous proposons de prolonger cette
approche traditionnelle de la fonction de localisation en lui greffant cette notion de force dynamique de
structuration spatiale que nous allons caractériser.
1.3..2. L’approche dynamique de l’espace et l’aspect subjectif de la force de structuration spatiale
Pour notre part, la force dynamique de structuration spatiale mobilise deux blocs de fonctions :
- Le premier a trait aux éléments de la fonction traditionnelle de localisation (L(x)). Il
s’agit, là, de l’aspect objectif de la force de l’espace institutionnel dont l’expression
s’affirme par des données quantitatives liées aux différents facteurs de localisation ;
- Le second porte sur les différentes rationalités (R), évoquées plus haut, des acteurs en
présence (A) insérés dans des systèmes productifs et d’échange aux technologies (T) en
perpétuelle mutation. Il est question, ici, du caractère subjectif de la force spatiale de
structuration dont l’essence renvoie aux différentes stratégies historiques des acteurs. On
peut l’exprimer ainsi : H(x) = H(A, R, T)
Ces deux aspects objectif et subjectif de la force dynamique structurante de l’espace institutionnel
peuvent être ramassés par la fonction suivante :
F(x) = F[ L(x), H(x)]
F(x) = F{ [(F1(x)…Fj(x)….Fm(x), G(x, y1)…G(x,yk)…G(x,yn], H (A,R,T) }
Au total, si l’on veut rendre compte de la complexité de la structuration spatiale dont la
problématique n’est pas nouvelle (LAJUGIE, DELFAUD, LACOUR, 1979) il faudra étudier les
composantes de la fonction de l’espace institutionnel dans leur singularité et dans le réseau de leurs
interrelations. C’est, là, une tâche bien ardue, mais possible. L’aspect objectif de la fonction de
localisation ayant, déjà, fait la cible d’analyses fort pénétrantes, nous allons, quant à nous, nous
intéresser uniquement à celui subjectif de la fonction qui met en jeu les logiques d’actions des acteurs
dans un environnement technologique en évolution incessante.
Nous allons, donc, grâce à la fonction - H(x) = H(A,R,T) – tenter, non pas de faire l’histoire de la
structuration spatiale, mais de pointer du doigt, au travers de quelques cas, la manière dont le
mécanisme de la force dynamique de l’espace institutionnel se met en œuvre au cours du processus de la
localisation des entreprises.
A cet effet, nous pouvons mettre en relief deux types de structuration de l’espace : bureaucratique et
conventionnel.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
1
/
17
100%