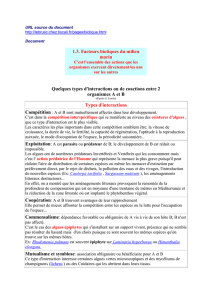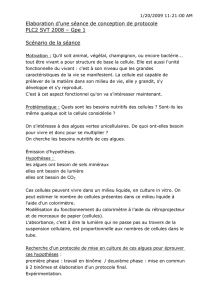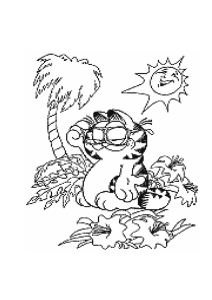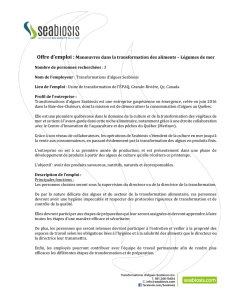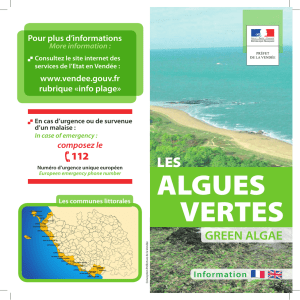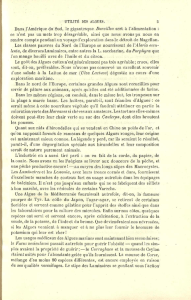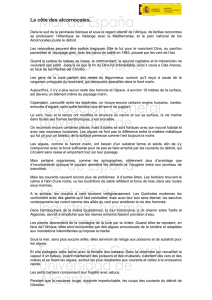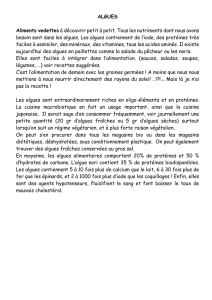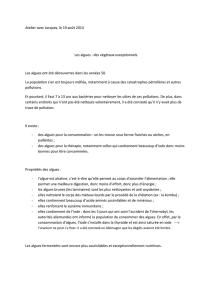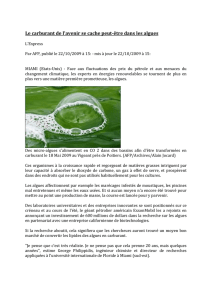La pollution des algues vertes en Bretagne

H. DAUBERT, T. JEAN, C. PADIOLLEAU
Lycée Julie Victoire Daubié
95100 ARGENTEUIL
La pollution
des algues
vertes en
Bretagne
Dossier de presse
2011

1
Dossier de presse « Algues vertes »
Titre de l’article
Date
Source
Pourquoi les algues grignotent-elles la Bretagne ?
Éventuellement : Sangliers morts en Bretagne : le
sulfure d’hydrogène en cause
Les algues vertes recouvrent la mer Baltique
15/10/2011
8/09/2011
6/10/2010
Le républicain lorrain
Science et avenir
Terra Eco
Algues vertes : les agriculteurs en colère
19/09/2011
Zegreenweb
Plan contre les algues vertes : peut mieux faire
Algues vertes : l’Europe somme Paris de s’expliquer
Algues vertes : un décret suscite la colère des
écologistes
27/10/2011
19/10/2011
11/10/2011
Ouest-France
Le Monde
Le nouvel observateur
La méthanisation : une solution pour endiguer les
algues vertes ?
Algues vertes ou rouges, Olmix sait les valoriser
Des algues vertes pour fabriquer du papier
Les algues vertes, symptôme de l’urgence d’une
transition économique des territoires
7/09/2011
6/10/2011
14/10/2011
7/09/2011
Terra Eco
Le Télégramme
MaxiSciences
Le Monde
Terra Eco est un bimédia composé d'un magazine mensuel français et d'un quotidien électronique Terraeco.net. Il est publié chaque mois, en
version papier, et chaque jour sur le Net. Fondé le 5 janvier 2004 par une trentaine de journalistes professionnels, il se fixe pour objectif de
mettre l'économie et les enjeux du développement durable à la portée de tous et de replacer l'humain et l'environnement au cœur de
l'économie. Économie, social et environnement : Terra Eco traite donc des 3 piliers du développement durable.
Zegreenweb est un portail grand public d’information, de consommation et de loisirs, interactif et communautaire, dédié à l’écologie, au
développement durable et au bio.
Le Télégramme est un quotidien régional de Bretagne
Maxisciences est un site d'actualité scientifique et environnementale mis à jour quotidiennement par une équipe de journalistes scientifiques
spécialisés.

2
Le républicain lorrain
15/10/2011
Pourquoi les algues grignotent-elles la Bretagne ?
Depuis environ quarante ans, déjà, la Bretagne, victime des rejets de nitrates dus en grande partie aux engrais utilisés dans
l'agriculture et à l'élevage intensif des porcs, n'en peut plus des algues vertes qui s'accumulent sur ses plages. La mort de trente-
six sangliers cet été relance le débat, car ces algues vertes sont aussi dangereuses pour les animaux que pour les hommes.
La Bretagne comporte beaucoup de baies et de petites criques fermées et confinées qui favorisent le développement des
végétaux marins. Dans cette région pilote en matière d'agriculture et d'élevage avicole et porcin, les activités ont
considérablement augmenté la teneur en nitrates des sols et des cours d'eau. Ce sont ces mêmes nitrates qui favorisent
aujourd'hui la multiplication des algues vertes, en particulier de l'ulve ou « laitue de mer ». Les pluies abondantes de la région
n'arrangent rien, entraînant avec elles les surplus de matières azotées qui proviennent des engrais et du lisier vers les cours
d'eaux et les réseaux d'eaux pluviales qui s'écoulent ensuite dans la mer. Les plages contaminées, bien que nettoyées en
permanence, sont parfois frappées d'interdiction de baignade et fermées à la population.
Pourquoi est-elle dangereuse ?
Cette algue verte se dépose en quantité sur les plages bretonnes, en particulier sur les plages du Finistère et des côtes d'Armor
où elle s'accumule et blanchit en pourrissant. En se décomposant, elle dégage une trentaine de gaz dont le sulfure d'hydrogène
(H2S), qui, inhalés par les vertébrés, provoquent des malaises ainsi que d'autres complications (asthme, conjonctivite, œdème
pulmonaire) pouvant entraîner rapidement la mort. Si vous vous trouvez seul dans un secteur fortement contaminé, et que vous
continuez à inhaler ce gaz, la mort peut survenir en quelques minutes. Cette décomposition des algues constitue donc un réel
danger et un risque très sérieux pour l'homme (mort d'un transporteur d'algues en 2009, grave coma d'un ramasseur de «
laitues de mer » en 2008, mort d'un cheval dont le cavalier a été lui-même victime d'une intoxication aiguë…). Cette particulière
dangerosité est surtout valable pour l'ulve qui contient beaucoup de soufre, molécule qui entre dans la composition du sulfure
d'hydrogène. Cette algue a une manière toute particulière de se décomposer, qui la rend encore plus dangereuse : elle échoue
sur le sable sous forme de tas qui sèchent au soleil. La couche superficielle des amas forme une croûte qui durcit sous l'effet de
la chaleur et du soleil et devient ainsi imperméable. Les algues qui se trouvent emprisonnées à l'intérieur de ces amas entrent en
putréfaction sans aucune pénétration d'oxygène, ce qui est très favorable à la production du sulfate d'hydrogène.
Un plan de lutte
Élaboré en février 2010, ce plan prévoit d'améliorer d'ici à 2015 la gestion des algues et de prévenir la prolifération en réduisant
les flux de nitrates déversés dans les bassins par les eaux pluviales. Ce plan concerne en premier lieu les huit baies bretonnes les
plus exposées. Il comprend trois volets : un volet sécuritaire qui porte sur l'amélioration des connaissances et la gestion des
risques, un volet relatif aux actions curatives – amélioration du ramassage et du traitement des algues échouées – et un dernier
volet préventif qui concerne les actions à mettre en œuvre pour limiter les flux d'azote déversés sur les côtes.
S. Seuron

3
Sciences et Avenir.fr
08/09/2011
Sangliers morts en Bretagne : le sulfure d’hydrogène en cause
Deux rapports lient la mort de plusieurs sangliers, cet été, dans l'estuaire du Gouessan à la présence d’algues
vertes qui ont rejeté du sulfure d’hydrogène.
La piste des algues vertes
En juillet et août 2011, des cadavres d'animaux sauvages dont majoritairement des sangliers mais aussi quelques
ragondins ont été découverts sur la plage de Morieux et sur les berges de l'estuaire de la rivière du Gouessant. Dès
leur découverte, l’hypothèse des algues vertes tueuses a été envisagée par les associations de protection de la
nature d’abord puis par les autorités. Ces algues vertes qui chaque année envahissent principalement les côtes du
littoral breton dégagent en effet du sulfure d’hydrogène (H2S), un gaz toxique, lors de leur décomposition.
Deux rapports de l’ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail)
et de L’INERIS (Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques) viennent conforter cette hypothèse
sans pour autant affirmer qu'il s'agit du seul facteur contributif de la mortalité massive.
Les éléments relevés lors de l’autopsie des cadavres indiquent que les sangliers s'étaient approchés de l'estuaire du
Gouessant pour s'abreuver, après une prise alimentaire. Par ailleurs, du sulfure d’hydrogène a été retrouvé dans les
poumons de plusieurs animaux et d’autres lésions caractéristiques plaident également en faveur d'une intoxication
aigüe causé par du H2S.
Les effets du sulfure d’hydrogène
Des campagnes de mesure menées sur place ont relevé des dégagements importants de composés soufrés,
principalement du H2S, lors du perçage de la croûte des dépôts d’algues : des libérations de gaz se produisent alors,
de type « bouffées instantanées ». Par endroit, des valeurs de plus de 3 000 mg/m3 ont été relevées. A cette dose,
c’est la mort assurée pour un homme en quelques secondes. Le gaz inhalé passe dans le sang au niveau des
poumons et bloque le système nerveux notamment le contrôle de la respiration, les sujets intoxiqués meurent
d’asphyxie.
Mais ces fortes concentrations décroissent rapidement à mesure que l’on s’élève du niveau du sol, les détecteurs,
placés à la hauteur de la taille des opérateurs, ont ainsi fourni des valeurs de 15 à 140 mg/m3. Elles se situent à des
niveaux pour lesquels des effets ont été observés sur l’Homme, notamment l’anesthésie de l’odorat, au-delà d’une
heure d’exposition en continu sur des zones de dépôts d’algues.
Les deux organismes considèrent que l’intoxication au sulfure d’hydrogène est la cause la plus probable de la mort
des animaux trouvés sur les plages. L’ANSES demande néanmoins que des travaux complémentaires soient réalisés,
sur les tissus prélevés durant les autopsies, afin d’écarter définitivement d’autres causes comme par exemple une
intoxication par des cyanobactéries.
J.I.

4
Terra Eco
6/10/2011
Les algues vertes recouvrent la mer Baltique
Par Thibaut Schepman -
En France, on connait bien les algues vertes. Mais nous ne sommes pas les seuls à souffrir du phénomène. La RTBF
révélait hier que la mer Baltique est recouverte d’un énorme tapis d’algues vertes de plus de 380 000 km², soit plus
que le territoire de l’Allemagne tout entier.
Comme en Bretagne, ce sont les engrais agricoles et les déjections animales qui sont responsables de cette
prolifération. Lorsqu’ils finissent en mer, ceux-ci entraînent une augmentation de l’azote dans l’eau. Ajoutez-y un été
très chaud, un manque de vent et beaucoup de rejets d’eaux usées par les bateaux et voilà un cocktail idéale pour
faire de la Baltique une vraie soupe aux algues vertes.
Problème, la petite mer nordique n’est reliée à la mer du Nord que par un minuscule détroit. Autant dire que les
polluants qui s’y échouent y restent. L’éco-système déjà très limité de cette mer est donc tout particulièrement
menacé.
À l’appel de la Finlande, les dirigeants des pays du bassin de la Baltique s’étaient réunis en février dernier pour
établir un programme d’actions pour défendre cette mer. Sans beaucoup d’impact pour le moment. Ainsi, une
enquête menée le mois dernier par le WWF montrait que la moitié des bateaux qui font la navette entre les villes de
la Baltique continuent à jeter leurs eaux usées dans la mer.
Terra Eco : Fondé le 5 janvier 2004 par une trentaine de journalistes professionnels, il se fixe pour objectif de mettre
l'économie et les enjeux du développement durable à la portée de tous et de replacer l'humain et l'environnement au
cœur de l'économie. Économie, social et environnement : Terra Eco traite donc des 3 piliers du développement
durable.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
1
/
14
100%