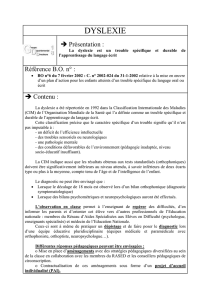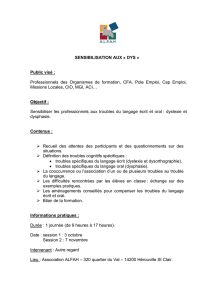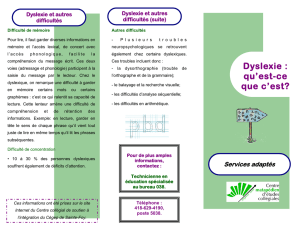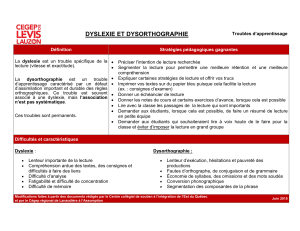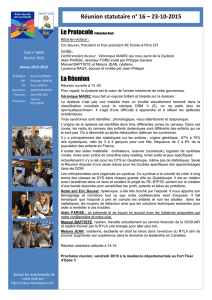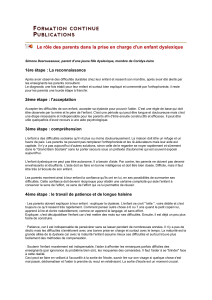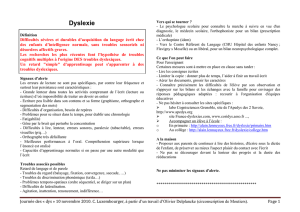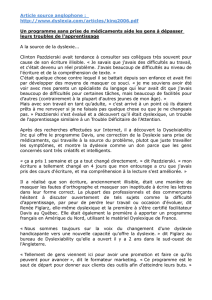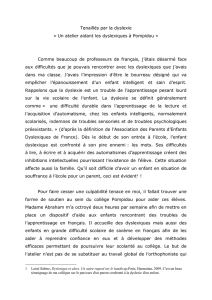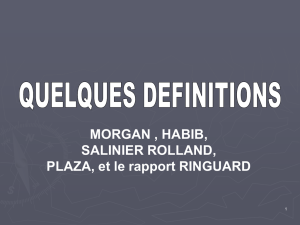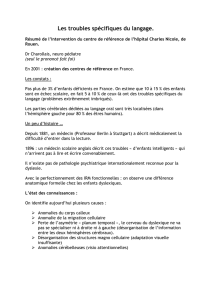comment dépister une dyslexie chez un petit écolier

PORTIER Mélanie PE2 groupe 6 Année 2006-2007
VALIDATION DE FRANÇAIS
COMPTE RENDU DE LECTURE
COMMENT DÉPISTER UNE DYSLEXIE CHEZ UN PETIT ÉCOLIER ?
Pierre Debray-Ritzen & Flora J. Debray
Institut universitaire de formation des maîtres de l’académie de Versailles
Centre de Cergy-Pontoise
Professeur référent : Mr RAFONI

2
SOMMAIRE
Introduction
A/ Généralités sur la dyslexie
I - Définition
II - Historique
III - Les aspects neuro-psychologiques
IV - Répartition de la dyslexie
V - Les causes de la dyslexie
VI - Les conséquences de la dyslexie
VII - Dyslexie et méthodes d’apprentissage
B/ Le dépistage
I - Quand dépister une dyslexie ?
II - Comment dépister une dyslexie ?
III - La leximétrie
IV - La conversion de la leximétrie en points
V - L’examen général de l’enfant
C/ Les remèdes
I - La rééducation
II - Nécessité pour le dyslexique d’une meilleure insertion scolaire et sociale
D/ Conclusion personnelle
Annexes
Zones fonctionnelles du cerveau
Texte libre écrit par un enfant dyslexique
Extrait du tableau de conversion de la leximétrie en points
Exemples de rééducation

3
Introduction
Ce compte-rendu va porter sur P.Debray-Ritzen et F.J.Debray, Comment dépister une dyslexie chez un
petit écolier ?, Editions Fernand Nathan, 1979.
Ce livre traite de la dyslexie d’un point de vue de la neuro-psychologie. Il est destiné aux enseignants et
éducateurs afin de les aider à mieux appréhender ce problème grâce à une nouvelle méthode (pour cette
époque). De plus, la dyslexie étant encore mal connue à cette période, l’objectif est également d’informer
le plus grand nombre sur la manière de la dépister.
Les auteurs partent de constatations et d’observations sur ce fait à partir de leur recherche. En effet, Pierre
Debray est professeur de psycho-pédiatrie et directeur du comité de la dyslexie depuis 1977 et Flora
Debray médecin-phoniatre et chef du département de la dyslexie dans le service de psycho-pédiatrie.
A/ Généralités sur la dyslexie
I/ Définition
« La dyslexie est une difficulté durable d’apprentissage de la lecture et d’acquisition de son
automatisme chez les enfants intelligents, normalement scolarisés, indemnes de troubles sensoriels ».
Le terme « durable » s’explique par le fait que l’enfant n’accède pas au stade de l’automatisme dans la
lecture qui constitue la troisième étape de l’apprentissage de la lecture après le stade logogrammique et
orthographique.
Le terme « intelligent » s’entend dans le sens où les enfants dyslexiques obtiennent plus de 90 points au
test d’intelligence de Wechsler.
« Normalement scolarisé » implique le fait que le contexte socio-culturel n’est pas pris en compte.
Enfin, l’expression « indemne de troubles sensoriels » précise que les organes sensoriels sont intègres.
Pour pouvoir parler de dyslexie, toutes ces conditions doivent être réunies.
II/ Historique
La lecture a 6000 ans, elle est la conséquence de l’agriculture, du commerce (besoin de contrats)
Pendant longtemps, elle fut avec l’écriture réservée aux clercs et scribes. Ce n’est qu’à la fin du 15e siècle
que Gutenberg invente la typographie qui en 500 ans allait gagner toute la civilisation.
En 1850, on comptait 30 à 40% d’analphabètes en France.
En 1882, Jules Ferry rend l’enseignement obligatoire et ce pourcentage descend à 3,4% en 1946 et c’est
au fur et à mesure d’une instruction scolaire généralisée que se sont révélés des cas de dyslexie. Attention,
la dyslexie est différente de l’analphabétisme mais le fait qu’il y ait de moins en moins d’analphabètes
permet de détecter de plus en plus de dyslexiques.
Les recherches sur ce sujet débutent en 1895 en Angleterre puis au début des années 1900 dans le reste de
l’Europe et aux Etats-unis
Le terme « dyslexie » est proposé par Hinshelwood en 1917. Ce trouble a donc un peu plus de 125 ans
(aujourd’hui, 2006) alors que la lecture en a 6000.
III/ Les aspects neuro-psychologique (Annexe 1)
Le cerveau est une masse de substance nerveuse qui occupe la cavité du crâne. Il peut être divisé en 4
lobes, chacun ayant une fonction déterminée :
Le lobe frontal : il concerne tout ce qui touche à la motricité
Le lobe temporal : il concerne tout ce qui a attrait à l’audition
Le lobe occipital : il concerne tout ce qui touche à la vision
Le lobe pariétal : il permet la reconnaissance tactile des objets et les activités gestuelles

4
Cependant les fonctions du langage (oral, lecture et écriture) ne sont pas localisées dans un lobe en
particulier. On distingue une aire à la jonction des lobes pariétal, occipital et temporal et une aire dans le
lobe frontal au-dessus de la scissure de Sylvius.
Comment se fixent en nous les informations que l’on reçoit ? Pourquoi le langage appartient à tous les
lobes ? Prenons l’exemple d’ « un crayon » pour un enfant :
1. l’enfant se saisi d’un crayon pour la première fois
2. le crayon va implanter sa signification dans le cerveau grâce à tous les stimuli (visuel, olfactif,
tactile…)
3. ces stimuli vont au cortex par des voies sensorielles nombreuses et ramifiées
4. ils passent par tous les lobes et laissent une trace (vision du crayon dans la zone occipitale,
impression tactile dans la zone pariétale…)
Cette trace qui existe sans être localisée peut être appelé un circuit. L’ensemble de ces circuits va
constituer la représentation de tous les phénomènes qui vont parvenir à l’enfant puis à l’adulte durant
toute sa vie.
5. la mère va prononcer le mot « crayon » et l’enfant va fixer une engrammation auditive verbale
à la signification de l’objet (trace précédente) grâce à un nouveau circuit
6. pour arriver au langage écrit, un nouveau circuit passant par tous les lobes va se mettre en
place (dans les lobes temporal et occipital pour créer le circuit auditivo-verbal et la
reconnaissance de l’alphabet phonographique puis le circuit se poursuit dans le lobe pariétal
pour le mouvement de la main et il se termine dans la lobe frontal pour l’exécution motrice.
Tous ces circuits sont donc très complexes et si l’un d’eux ne se met pas correctement en place lors des
apprentissages de l’enfance, cela peut entraîner des troubles plus ou moins graves.
IV/ Répartition de la dyslexie
Un peu moins d’un écolier intelligent sur dix présente une dyslexie plus ou moins
importante.
Concernant le sexe, il y a 3 garçons dyslexiques pour une fille.
Aucun rapport avec le milieu social.
Reconnu dans tous les pays.
V/ Les causes de la dyslexie
Le facteur génétique est prouvé en 1907.
Des souffrances cérébrales majeures ou mineures sont relevées de manière significative à
l’origine d’un bon nombre de dyslexies. (enfant prématuré, ayant eu une jaunisse très tôt,
subit un accouchement difficile…)
La méthode d’apprentissage de la lecture n’est pas en cause cependant, l’utilisation de la méthode globale
est désastreuse pour un enfant dyslexique et rend son repérage difficile. Il y a une tentative de la faire
disparaître.
VI/ Les conséquences de la dyslexie
1. problèmes en lecture puis orthographe
Tout le langage écrit est pauvre, bref, maladroit, mal construit. L’enfant est incapable de transformer avec
aisance sa pensée. (Annexe 2)
2. problèmes en calcul vers 9-10 ans
Ces problèmes sont dus à des difficultés de lecture et de compréhension des énoncés.

5
3. rejet de l’école car difficultés scolaires.
4. problèmes de comportements
Ces enfants ont tendance à se décourager et à s’enfermer dans des conflits pouvant entraîner une certaine
agressivité ou des comportements de fugue qui deviennent alarmant vers 12-13 ans car cela peut amener à
la délinquance.
D’autres présentent plutôt un repli sur eux-mêmes, une passivité ou encore des troubles du sommeil.
Quelles que soient les conséquences de ce trouble sur l’enfant, elles sont difficiles à assumer et
dommageables pour l’avenir de celui-ci. C’est pour cela qu’il faut les détecter le plus rapidement possible
afin de les déculpabiliser et les rééduquer.
VII/ Dyslexie et méthodes d’apprentissage
La dyslexie n’est absolument pas du à l’utilisation d’une méthode de lecture plutôt qu’une autre.
Cependant, l’utilisation de la méthode syllabique permet de détecter beaucoup plus facilement ce trouble
alors que la méthode globale est une catastrophe pour les enfants dyslexiques. En effet, ils ne
comprennent pas les mots donc ils essaient de se souvenir des formes pour prononcer ce qu’ils voient en
coïncidence avec ce qu’ils ont déjà entendu. Cette manière de faire provoque très souvent chez ses enfants
en malaise voir un dégoût de la lecture car ils sont conscients qu’ils n’y arrivent pas et essaient de faire
illusion pour cacher cette difficulté.
B/ Le dépistage
I/ Quand dépister une dyslexie ?
On ne peut faire de diagnostic avant l’âge de 7 ans, 7 ans et demi. Il faut attendre que la lecture est
été apprise et que les retardataires reviennent à niveau.
II/ Comment dépister une dyslexie ?
On peut se poser des questions lorsque certains signes nous interpellent comme :
Difficultés de lecture au CP avec de bons résultats ailleurs.
Confusion des sons proches (j-g ; p-b…) et inversion des lettres (crac- carc…)
8-12 ans, lecture lente, avec le doigt, hésitante de manière plutôt syllabique.
Les textes sont mal compris et mal retenus
Cependant, la meilleure et seule façon de dépister un dyslexique est de le comparer aux enfants de son
âge et à leur niveau de lecture. C’est ce que fait le test de leximétrie.
III/ La leximétrie (mesure de l’acuité lexique)
Elle est utilisée pour la première fois en 1940 aux Etats-Unis puis en 1958 en Angleterre.
En France, c’est le test de l’alouette de P. Lefavrais qui permet le mieux la leximétrie. Elle indique la
différence entre l’aptitude de l’enfant et la moyenne des enfants du même âge.
Bases et principe du test
Faire lire à haute voix le texte dénommé l’alouette et de juger de sa lecture selon 2 paramètres : le temps
de lecture et le nombre de fautes commises.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
1
/
9
100%