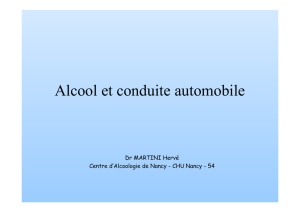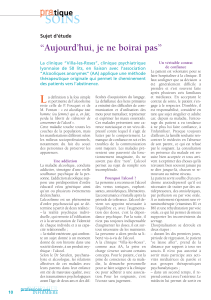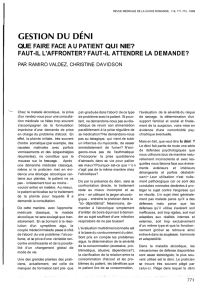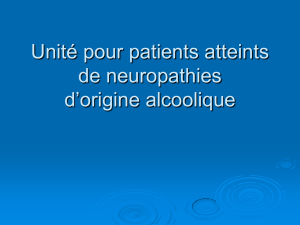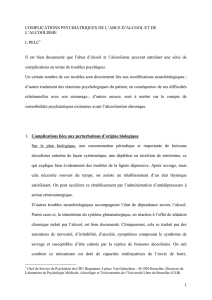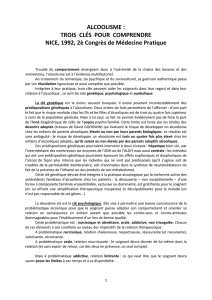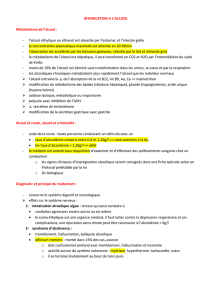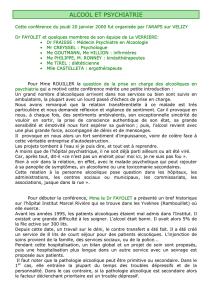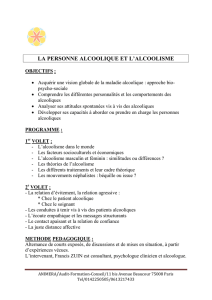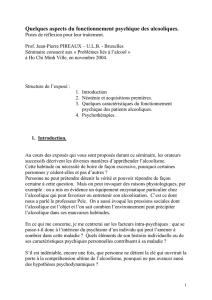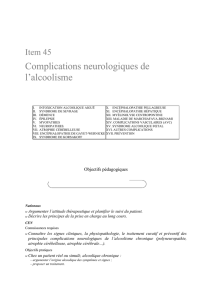L`urgence en alcoologie : Ressource et compétences du système

9èmes Journées Francophones de Thérapie familiale systémique de Lyon – mai 04
RESSOURCES ET COMPETENCES : Intérêts et limites de ces concepts. Qu’en fait le systémicien ?
Dr Vanghélis Anastassiou - 108, avenue des Ternes - 75017 Paris - tel : 0145747980 – fax : 0140687839 – email : anastassiou@online.fr
L’urgence en alcoologie : Ressource et compétences du système alcoolique et
du système des soins alcoologiques.
Téléchargement d'une version Word au format .doc :
http://anastassiou.free.fr/documents/urgence.doc
© Vanghelis Anastassiou - 2005
Aucune reprise de ce document sur un site WEB ou dans une publication imprimée ne peut se faire sans l’accord écrit de l'auteur et d’un éventuel
éditeur. Toute reprise doit mentionner la source originale et conserver l’intégralité du texte, notamment les références bibliographiques.
1) Changements du contexte de l’Alcoologie.
a) Interrogations sur la place et l’importance de la cure de désintoxication.
Le temps intra-hospitalier de la cure de désintoxication ou cure de sevrage, objectif premier et
pivot central de la prise en charge du patient alcoolodépendant pendant des décennies, est
actuellement mis en question. La « cure » ne désigne effectivement pas une méthode
thérapeutique particulière ; elle induit, par ailleurs, une fausse idée de l’existence d’un
traitement (« curatif » voire « purgatif ») particulièrement intense et/ou suffisamment long
pour être définitivement efficace. Elle induit surtout l’illusion de l’application d’un traitement
incontournable, miraculeux et puissant sur un patient passif et éventuellement, mais pas
nécessairement, consentant. Elle occulte le fait que ce temps intra-hospitalier n’est qu’une
première étape d’un long processus de changements psychologiques, relationnels,
épistémologiques, culturels, spirituels avant le rétablissement ; elle occulte, également, ce
temps de réflexion, d’écoute et de parole, de prise de distance et de décisions parfois
déchirantes. C’est un temps très actif pendant lequel la motivation du patient est sans cesse
sollicitée. Situation paradoxale car le déni de la maladie alcoolique est le symptôme central de
l’alcoolique.
b) Pénurie de lits hospitaliers de cure de désintoxication et promotion des soins
ambulatoires.
Aux interrogations théoriques sur la pertinence de la « cure », s’ajoute la pénurie des lits
hospitaliers disponibles pour une prise en charge intra-hospitalière de ce premier temps du
processus thérapeutique. Il est nécessaire qu’une prise en charge ambulatoire, relationnelle et
psychothérapique, précède le temps de l’hospitalisation et prenne immédiatement le relais.
Dès lors, le processus thérapeutique est fondé bien plus sur la motivation de patient
alcoolodépendant, l’implication de son thérapeute et la mobilisation de son entourage que sur
la structure hospitalière du service d’alcoologie, la thérapeutique institutionnelle et
l’hypothétique plateau technique.
c) Changements de la population qui s’adresse aux urgences alcoologiques et
aux soins de l’alcoologie hospitalière.
Les progrès effectués ces dernières années dans la prise en charge ambulatoire des patients
alcooliques, en rapport avec le développement des CCAA, ont eu, pour conséquence, que les
patients et leurs familles s’adressant à l’alcoologie hospitalière soient des personnes
présentant également d’autres difficultés psychologiques et comportementales qui
compliquent leur prise en charge ambulatoire. D’autres membres de leur famille présentent,
aussi, des difficultés psychologiques et un haut risque de psychopathologie.
d) Développement de l’addictologie.
L’addictologie s’est développée grâce au rapprochement théorique entre intervenants en
toxicomanie et alcoologues bien qu’ils ne partagent pas, pour autant, ni la même clinique ni
des démarches thérapeutiques similaires. C’est également la prise en considération de ces
malades, souvent séropositifs au virus de sida ou de l’hépatite C, de plus en plus nombreux,
dont le comportement alcoolique est suivi ou précédé de conduites toxicomaniaques ou
d’autres troubles alimentaires. Les conduites addictives désignent un mode d’existence et se

9èmes Journées Francophones de Thérapie familiale systémique de Lyon – mai 04
RESSOURCES ET COMPETENCES : Intérêts et limites de ces concepts. Qu’en fait le systémicien ?
Dr Vanghélis Anastassiou - 108, avenue des Ternes - 75017 Paris - tel : 0145747980 – fax : 0140687839 – email : anastassiou@online.fr
présentent comme des pathologies chroniques. Dans la perspective addictologique le rapport
de l’alcoolique à la bouteille doit être élargie sur l’ensemble de ses liens relationnels, même
ceux qui lui font défaut, et les contextes au sein desquels la conduite addictive prend son
essor. L’alcoolisme n’est pas qu’une mauvaise habitude, pas plus qu’un comportement
déviant induit par le contexte culturel viticole.
2) Comment penser l’urgence en Alcoologie
a) La métaphore dramaturgique.
La métaphore dramaturgique (proposée par l’alcoologue lyonnais Fr. Gonnet) comme
méthode d’approche de l’urgence en Alcoologie est justifiée par son caractère redondant,
prévisible et même « planifiable ». Rappelons que l’alcoolisme est une maladie chronique ou
des périodes d’alcoolisations fortes alternent avec des phases de sobriété. La scène (le
contexte) du drame alcoolique est, le plus souvent, la vie familiale et parfois le cadre
professionnel.
Nous pouvons déchiffrer le sens de l’urgence alcoologique en nous penchant sur le contexte.
Les quatre personnages habituels y sont d’emblée posés : l’alcoolique, sa famille (conjoint,
enfants, parents), le médecin généraliste de famille, et l’alcoologue. Chacun « jouera » ou
plutôt « portera » son rôle, bien connu d’avance : l’alcoolique exhibera sa déchéance
physique, son déni de la maladie, le creux de son discours ; la famille exprimera son désarroi
et fera part de son ambivalence entre colère et rejet, inquiétude et souffrance ; le médecin
généraliste montrera, gêné, son impuissance mais aussi son rejet pour ce type de malade peu
gratifiants ; l’alcoologue enfin dépositaire du savoir thérapeutique face à cette maladie aura le
rôle du hôte dans cette scène de l’urgence alcoologique. Il n’est pas inutile de se rappeler que
les rôles sont connus aux uns et aux autres d’avance ; chacun est prisonnier de son rôle ;
l’issue de la scène est, également, connue, d’avance, aux uns et aux autres !
Avant une nouvelle période de sobriété et de rapprochement affectif intra-familial et jusqu’à
la prochaine urgence !
Toutefois, bien que redondante, l’urgence alcoologique n’est pas exempte d’accidents de
parcours : risque vital bien plus grave que l’habituel coma éthylique, agressivité qui se
concrétise en véritable violence et parfois meurtre, menaces variables mises en exécution en
raison d’une erreur de « timing » telles une véritable tentative de suicide, parfois même
réussie, ou une fugue etc. Mais ces ratés de « timing » ou de mise en scène ne modifient en
rien le caractère fondamentalement répétitif de l’urgence alcoologique.
L’urgence alcoologique est la fonction cathartique dans le scénario du système alcoolique.
Son caractère redondant signifie que le comportement alcoolique demeure le principe
organisateur de la vie familiale et prescripteur des rôles dans la vie de chaque membre de la
famille.
b) Le cinquième personnage de l’urgence en alcoologie : ses ressources face en
un scénario de désespoir répétitif.
Il n’y a pas que l’alcoolique seul qui vit dans une alternance redondante sobriété-
alcoolisations ; le système familial s’organise à partir des conduites de l’alcoolique dans une
existence bi-modale « il est bien »-« il est mal » ; le système alcoolique a le pouvoir d’arrimer
à son rythme tout autre système qui entre en contact avec lui ; c’est ainsi, que le système de
soins va bientôt, interpellé par le système alcoolique, fonctionner au même rythme bi-modal :
le médecin de famille débordé, c’est l’alcoologue qui se trouvera interpellé et puis le
psychiatre et plus tard le psychothérapeute et entre temps le juge après l’éducateur. La crise
relationnelle engendrée par le comportement alcoolique trouve sa résolution en triangulant un
autre et en l’incluant dans le système.

9èmes Journées Francophones de Thérapie familiale systémique de Lyon – mai 04
RESSOURCES ET COMPETENCES : Intérêts et limites de ces concepts. Qu’en fait le systémicien ?
Dr Vanghélis Anastassiou - 108, avenue des Ternes - 75017 Paris - tel : 0145747980 – fax : 0140687839 – email : anastassiou@online.fr
Elle est, de sorte, renouvelée la croyance à une solution magique s’imposant de l’extérieur au
système, et faisant disparaître l’alcoolisme sans autre mise en question concernant la
formation de ce système relationnel.
Le cinquième personnage au drame alcoolique est celui dont le discours et le rôle n’est pas
connu d’avance : médecin urgentiste, interne de médecine, psychiatre de garde ou
psychologue aux urgence, l’alcoologue qui ignore le dossier ou le généraliste remplaçant. En
fait, c’est lorsqu’un événement prévisible, l’urgence, va muer en un événement
imprévisible qu’une lecture irrévérencieuse du scénario alcoolique peut être faite par un
personnage irrévérencieux du contexte de l’urgence. Ce cinquième personnage, en train d’être
interpellé par l’urgence va (il doit) donner une définition du problème auquel il est confronté.
Ce sera (ou pas) une nouvelle interprétation de la situation d’urgence et un nouveau sens au
contexte ; une possibilité, donc, pour qu’un scénario imprévisible ait lieu.
3) Le marché des dupes
a) Les ressources du système alcoolique face aux compétences du système des
soins alcoologiques.
Il pourrait, toutefois, adopter l’interprétation que l’alcoolique ou sa famille ou le généraliste
ou l’alcoologue précédent ont eu de l’urgence ; que c’est, effectivement, une véritable urgence
qui mérite de lui être adressée et pour laquelle il mérite de faire ses preuves ! Dès lors, il
relèvera le défi, il rejoindra la cohorte des orgueilleux et il participera à l’hybris : le soin
d’autorité, la cure de désintoxication volontariste, l’abstinence décrétée de l’alcoolique ;
ajoutons-y des conseils pour son environnement ! C’est un scénario antidote aux scénarios
présentés par l’alcoolique et le cortège des personnages arrimés à son parcours désespéré ; et
c’est un scénario prévisible dans sa finalité de corriger le désordre que l’alcoolique représente.
Le savoir alcoologique sera disqualifié et jugé incompétent une fois que les soins s’avéreront
inefficaces.
Une des « compétences » de l’alcoolique est la « triangulation » des personnes et des
institutions qu’il croise dans sa vie : tôt ou tard, ils feront partie de son univers, se trouveront
arrimés à son organisation systémique, et ils subiront sa loi de fausses urgences, de fausses
crises, de fausses promesses, de véritables coups de théâtre avec une issue parfois tragique.
Car à défaut d’une issue authentique, et donc imprévisible, ce sera un événement tragique qui
tiendra lieu de vérité.
b) Les ressources du système de soins alcoologiques face aux compétences de
l’alcoolique.
Le système des soins alcoologiques connaît aussi bien la propension du malade alcoolique
pour le déni de ses symptômes et de sa maladie, que la nécessité de mentir pour ne pas
déplaire tant la honte a eu raison de son amour propre et de sa capacité de s’affirmer ;
l’alcoolique ne peut pas ne pas faire de fausses promesses ! Le système de soins alcoologiques
sait également qu’aucune entreprise de soins n’est valable sans l’adhésion du patient, sa
motivation et son implication. Pourtant, c’est justement ce qui lui fait défaut en tant
qu’alcoolique !
Dans le contexte de l’urgence, le système de soins accueillera avec bienveillance et même
candeur les déclarations, les promesses, la motivation instamment retrouvée de l’alcoolique
qui veut bien convaincre de l’importance de cette urgence justement (rien à voir avec les
précédentes ; celle-ci est toute différente car cette fois-ci « il a tous compris ») ; le système de
soins se concentrera entièrement sur le discours de l’alcoolique, en urgence, avec l’espoir,
qu’en le laissant trop dire qu’il est motivé, il en sera convaincu lui-même ; on soutiendra son
discours, on se voudra compréhensif à son apologie de l’alcoolisation incontournable et aux

9èmes Journées Francophones de Thérapie familiale systémique de Lyon – mai 04
RESSOURCES ET COMPETENCES : Intérêts et limites de ces concepts. Qu’en fait le systémicien ?
Dr Vanghélis Anastassiou - 108, avenue des Ternes - 75017 Paris - tel : 0145747980 – fax : 0140687839 – email : anastassiou@online.fr
arguments avancés pour justifier la situation d’urgence actuelle. Aux urgences comme dans le
service de l’alcoologie, bien que convaincu que l’alcoolique mente on s’intéressera à son
discours d’alcoolique. Après tout c’est bien connu que l’alcoolisme est une maladie
chronique, à rechutes, pour laquelle on ne peut pas grande chose.
« Soignez-moi, bien que je ne crois pas à votre compétence », « Je vous soignerai, bien que je
ne crois pas à votre motivation » !
Dans ce marché des dupes, chaque acteur tiendra, sans faille, son rôle : qui de l’alcoologue,
qui de l’alcoolique, qui de l’entourage ! Peu à peu les rôles tiendront lieu d’identité :
l’alcoolisme est un trouble d’identité (et pas uniquement celle de l’alcoolique !). Peu à peu les
scénarios répétitifs remplaceront les liens relationnels : l’alcoolisme est une pathologie de
lien.
Personne n’avancera à visage découvert, malheureusement !
4) Compétences imprévisibles du système de soins et ressources inattendues de la
famille
Toutefois, le cinquième personnage, interpellé lors de l’urgence, peut chercher une nouvelle
interprétation de la situation, faire part à l’alcoolique et à son environnement de ses doutes
quant à la version officielle de la situation, et leur demander de collaborer pour comprendre
autrement la répétition des alcoolisations, des violences, des comas, des annonces de rupture
sans lendemain. C’est une invitation à former un système thérapeutique qui évoluera sur une
période longue, car l’alcoolisme est une maladie chronique. Le système thérapeutique
s’intéressera à ce qui fait souffrir les uns et les autres, bien au-delà et bien avant la
consommation abusive de l’alcool. Est-ce que la vie familiale peut être organisée autrement
qu’en fonction des alcoolisations ou de l’abstinence de l’alcoolique ?
Pour former le système thérapeutique, il faut être, d’abord, convaincu que l’urgence
alcoologique n’est pas le lieu idoine pour valider ses compétences en alcoologie ; puis, il faut
convaincre l’alcoolique que ce n’est pas, vraiment, le moment pour nous prouver qu’il est bel
et bien un vrai alcoolique ; il ne faut pas oublier les proches, qui habituellement
l’accompagnent aux urgences : ils n’ont pas à nous convaincre, pour cette fois, au moins,
qu’ils n’en peuvent plus : nous en sommes persuadés d’avance.
L’urgence est, par contre, une bonne occasion pour demander à l’alcoolique si, à part nous
parler de l’alcool, il voudrait bien s’exprimer sur tout autre aspect de sa vie. Comment fait-il
pour avoir une vie familiale et conjugale sans se sentir coupable d’avoir négliger ses parents ?
Comment fait-il pour entretenir une relation psychothérapique, si c’est le cas, sans se sentir
déloyal face à son conjoint ou ses parents ? L’alcoolisme est une pathologie de
l’autonomisation. Pendant qu’il boit, qu’est-ce qu’il est en train de transmettre à ses enfants?
Qu’est-ce qu’il a reçu de ses parents, comme legs ? Parfois, lorsqu’il est violent avec son
conjoint et ses enfants, nous pouvons lui demander s’il ne se sent pas très seul, s’il ne s’est
pas isolé volontiers, pour ne pas trop encombrer son conjoint ou ses parents dans la prise en
charge de ses enfants. Il est fort probable que l’alcoolique ne trouve pas sa place, ou qu’il se
croit déjà fini. L’alcoolisme est une pathologie de différenciation de soi et de l’individuation.
Nous pouvons, de même, interpeller les proches qui l’accompagne pour témoigner sur les
« traces » que la fréquentation de l’alcoolique, durant tant d’années, a laissé sur leur
personnalité ; D’où, pensent-ils puiser la force et la patience pour continuer à vivre avec et à
vouloir guérir un alcoolique ? Qu’est-ce qu’il changera pour eux si l’alcoolique cesse un jour
de boire définitivement ? Se trouver aux urgences c’est croire déceler chez leur malade
alcoolique un risque vital : comment pensent-ils la mort et la séparation ?
Finalement, il faut que tous soient convaincus que c’est une belle occasion pour « causer à
propos de plein de choses ».

9èmes Journées Francophones de Thérapie familiale systémique de Lyon – mai 04
RESSOURCES ET COMPETENCES : Intérêts et limites de ces concepts. Qu’en fait le systémicien ?
Dr Vanghélis Anastassiou - 108, avenue des Ternes - 75017 Paris - tel : 0145747980 – fax : 0140687839 – email : anastassiou@online.fr
Bien entendu, il y a des jours où les uns et les autres n’ont pas cette disponibilité et donc on
fera comme d’habitude ; mais avec l’alcoolisme cela ne porte pas en conséquence : dans
quelques semaines le même scénario se représentera aux urgences.
5) La contextualisation de l’imprévisibilité
a. La déclaration de l’impuissance face à la pulsion alcoolique
Le processus que nous avons décrit comme un marché de dupes se met naturellement en place
aux urgences en alcoologie, en tant que modalité relationnelle, entre le système familial
alcoolique (il est extrêmement rare qu’un alcoolique se trouve seul aux urgences
alcoologiques) en proie au désarroi qui interpelle le système de soins en raison de ses
compétences affichées. Il est, donc, urgent, afin d’y échapper, à faire une déclaration
d’impuissance face à la pulsion alcoolique et une démonstration d’attitude humble quant aux
possibilités d’intervention thérapeutique. Affirmer explicitement que c’est le malade
alcoolique, et lui seul, qui a le pouvoir de décider quant il arrêtera à boire c’est une façon pour
communiquer aussi bien à l’alcoolique qu’à ces proches que la décision d’être soigné est un
acte de responsabilité et d’éthique personnelle et qu’on ne doit pas se substituer les uns aux
autres ; c’est une façon de remettre en question des relations intrafamiliales fusionnelles aux
rôles indifférenciés et interchangeables et aux frontières perméables.
b. La reconnaissance de la souffrance de chacun des différents acteurs.
Bien qu’impuissant face à la pulsion alcoolique, nous devons, néanmoins, entendre et
reconnaître la souffrance des familiers de l’alcoolique et l’interpeller sur sa propre souffrance.
Nous allons explorer les origines de la souffrance de chacun, les conséquences, et les
modalités de l’organisation, au quotidien, de ces souffrances. Nous pourrons, par la suite,
mieux explorer comment chaque membre de la famille pourrait, s’il le souhaite, échapper à sa
souffrance et s’approprier sa vie.
c. La proposition d’un engagement relationnel réciproque
Bien que le système de soins ne puisse priver l’alcoolique de l’alcool sans que lui-même le
décide, nous pouvons lui proposer un engagement relationnel et réciproque, sur une période
plus ou moins longue, pour lui montrer, que sa personne et son histoire nous intéresse : parler,
réfléchir, s’interroger sur sa vie, sur le sens qu’il donne à son existence, sur ses craintes et
espoirs, sur les personnes qui l’entourent mais aussi sur l’actualité. La finalité de cette
proposition est d’offrir une alternative relationnelle à l’isolement redondant dans l’alcool.
C’est un processus relationnel qui s’inscrit dans le temps : on compte le temps qui passe,
séance après séance ; on s’interroge sur les redondances, événement après événement ; on
construit une narration, souvenir après souvenir. Ce processus relationnel va avoir lieu sur la
scène familiale.
d. Re-narcissisation et avance de parole
Bien au delà de la dépendance physique à l’alcool, c’est la honte, la culpabilité et la sinistre
image de soi qui privent l’alcoolique de la motivation nécessaire pour se décider à s’abstenir.
Il est, donc, important, outre la reconnaissance explicite que la décision de l’abstention lui
appartient, de lui manifester toute confiance et respect et de croire à son sens de
responsabilités et à son éthique. Dans ce contexte relationnel, tout jugement moral et autres
considérations sur les mensonges de l’alcoolique ou son goût pour les « cachotteries »
semblent superflues et contre-productives. Il est, toutefois, difficile et contrariant à
communiquer ces convictions aux familiers du malade alcoolique ; d’autant plus, que pour les
 6
6
 7
7
1
/
7
100%