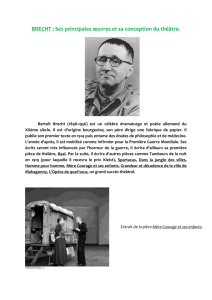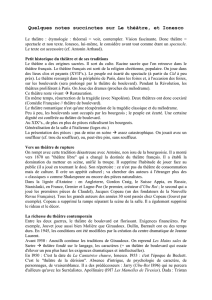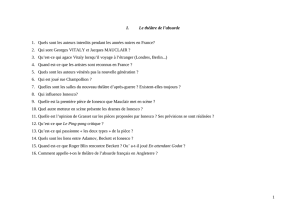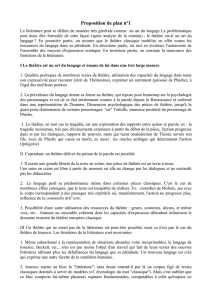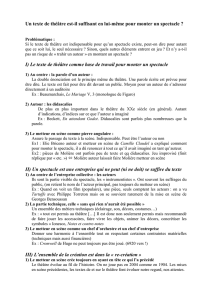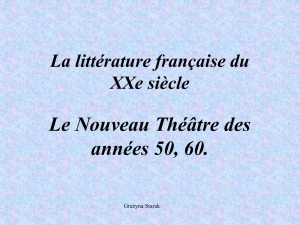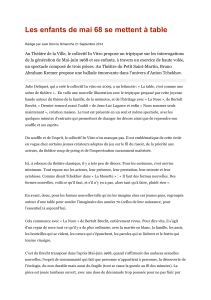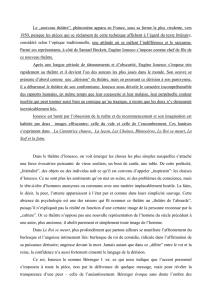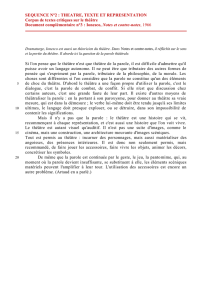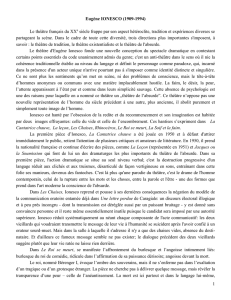Le nouveau théâtre

Envoyé par Françoise
THÉÂTRE OCCIDENTAL - Le nouveau théâtre
C’est au début des années 1950 que remonte la naissance de ce qu’on est convenu, plus
tard, d’appeler le “ nouveau théâtre ”, à l’instar du “ nouveau roman ” qui avait trouvé sa
dénomination, non sans quelque intention publicitaire, un peu auparavant. L’un et l’autre
avaient en commun une volonté de rupture avec l’héritage (notamment avec le
psychologisme et l’humanisme traditionnels), quelques grands ancêtres (dont Joyce et
Kafka) et un écrivain capital : Samuel Beckett ; la création et le succès, certes relatif mais
décisif, de sa pièce En attendant Godot , en 1953, au théâtre de Babylone à Paris,
établirent la réalité de ce “ nouveau théâtre ” qui n’avait pas encore été baptisé ainsi.
Ce nouveau théâtre n’est pas resté circonscrit à la dramaturgie française des années
1950. Il a fait école. Il s’est transformé. Du texte, il a gagné la scène. Il s’est diversifié.
Jusqu’à perdre son identité dans la seconde moitié des années 1970.
1. Une dramaturgie du refus
C’est en 1950 que se produisirent les premières manifestations du “ nouveau théâtre ” ;
cette année-là, La Cantatrice chauve d’Eugène Ionesco apparut, à l’affiche du théâtre
des Noctambules ; les deux premières pièces d’Arthur Adamov, La Parodie et
L’Invasion , écrites depuis quelque temps déjà, furent publiées en un volume où
figuraient des témoignages élogieux de Gide, de Prévert, de René Char, et sa troisième
pièce, La Grande et la Petite Manœuvre , créée, elle aussi, aux Noctambules.
Les titres de ces œuvres l’indiquent assez : un tel théâtre procédait d’abord d’un refus
du théâtre tel qu’il se pratiquait alors. Dans La Cantatrice chauve , il n’y avait ni cantatrice
ni chauve : rien que des Smith et des Bobby Watson, rabâchant, à longueur de soirée,
des lieux communs empruntés (Ionesco l’a avoué plus tard) à L’Anglais sans peine , un
manuel de la méthode Assimil. Et, sur la page de garde du premier tome de son Théâtre ,
Adamov annonçait son “ refus délibéré de s’abandonner à ce que Jean Vilar appelle les
dentelles du dialogue et de l’intrigue ”.
Ce contre quoi ces nouveaux dramaturges s’inscrivaient en faux, c’était le théâtre
psychologique, voire philosophique, qui avait fait les beaux soirs de la scène française
entre les deux guerres. Ils dénonçaient les subtilités langagières d’un Giraudoux ou les
travestissements à l’antique d’un Cocteau comme autant de trahisons de ce que devait
être un véritable théâtre. Ils s’en prenaient aussi aux pièces à message d’un Camus,
voire d’un Sartre (celui des Mains sales et de Morts sans sépulture plus que celui de
Huis clos ). Contre une métaphysique du langage et contre des discours idéologiques, ils
revendiquaient une “ physique de la scène ”. Dès cette époque, la formule d’Artaud
(celui-ci restait encore peu connu, mais Adamov, qui avait été son ami, s’en réclamait) :
“ La scène est un lieu physique et concret qui demande qu’on le remplisse et qu’on lui
fasse parler son langage concret ”, aurait pu leur servir de slogan. Adamov ne se
promettait-il pas de “ faire de la scène le lieu même de l’action ”. Dans mon théâtre,
poursuivait-il, “ tout est visible, jusqu’aux motifs cachés qui fondent le drame. Visible au
point de nous proposer un véritable sens littéral. Ainsi, dans L’Invasion , le désordre des
pensées, qui empêche de vivre tous les personnages, se manifeste par le désordre de la
chambre qu’ils habitent. Dans La Grande et la Petite Manœuvre , la mutilation physique
du héros traduit sa dépossession intérieure. Les tares morales reprochées aux réfugiés

de Tous contre tous sont résumées dans une tare physique : ils boitent, dit-on. Enfin, Le
Professeur Taranne , poussé par sa terreur d’être percé à jour, en vient à se dépouiller
de ses vêtements. ” Dans La Leçon de Ionesco, loin de servir à la communication et à
l’enseignement, le langage n’est plus qu’un instrument de puissance : il assure la
domination du professeur sur son élève, une domination qui ira jusqu’au viol et au
meurtre (le quarantième meurtre de la journée du Professeur). Et dans Les Chaises ,
comme nous l’assure l’auteur, “ le thème de la pièce n’est pas le message, ni les échecs
dans la vie, ni le désastre moral des vieux, mais bien les chaises , c’est-à-dire l’absence
de personnes, l’absence de l’Empereur, l’absence de Dieu, l’absence de matière,
l’irréalité du monde, le vide métaphysique ; le thème de la pièce, c’est le rien [... un] rien
[qui] se fait entendre, se concrétise, comble de l’invraisemblance ! ”.
Partout, ici et là, la scène se remplit ou se vide d’objets ou de matière. On essaie de lui
faire parler son langage propre, au-delà des mots que prononcent les personnages et
parfois contre eux. Le cadavre qui ne cesse de croître dans Amédée, ou Comment s’en
débarrasser en dit bien plus sur l’échec de l’amour et de la vie d’Amédée et de
Madeleine que les discours sans queue ni tête de ceux-ci.
Sans doute est-ce En attendant Godot qui approche au plus près ce théâtre “ visible ”
et “ littéral ” dont rêvaient Adamov et Ionesco. Alain Robbe-Grillet, qui, à la même
époque, tentait aussi d’instaurer, selon la formule de Roland Barthes, une “ littérature
littérale ”, célébra dans la pièce de Beckett l’avènement d’un théâtre également
débarrassé des “ vieux mythes de la profondeur ”, d’un théâtre qui soit pleinement et
exclusivement “ présence sur la scène ” : “ Nous saisissons tout à coup, en les regardant
[les deux clochards de Godot ], cette fonction majeure de la représentation théâtrale :
montrer en quoi consiste le fait d’être là. Car c’est cela, précisément, que nous n’avions
pas encore vu sur la scène [...] Le personnage de théâtre, le plus souvent, ne fait que
jouer un rôle , comme le font autour de nous ceux qui se dérobent à leur propre
existence. Dans la pièce de Beckett, au contraire, tout se passe comme si les deux
vagabonds se trouvaient en scène sans avoir de rôle. Ils sont là ; il faut qu’ils
s’expliquent. Mais ils ne semblent pas avoir de texte tout préparé et soigneusement
appris par cœur, pour les soutenir. Ils doivent inventer. Ils sont libres. Bien entendu, cette
liberté est sans emploi [...] La seule chose qu’ils ne sont pas libres de faire, c’est de s’en
aller, de cesser d’être là : il faut bien qu’ils demeurent puisqu’ils attendent Godot [...] Ils
seront encore là le lendemain, le lendemain du lendemain, et ainsi de suite [...], seuls en
scène, debout, inutiles, sans avenir ni passé, irrémédiablement présents. ”
Ainsi le “ nouveau théâtre ” entend-il parachever le démantèlement des principes
dramaturgiques qui, depuis Aristote (sans compter, il est vrai, le long entracte du Moyen
Âge), régissent le théâtre occidental. À une action bien définie, progressivement menée,
il substitue une série de rencontres, de hasards ou de répétitions ; à des héros
psychologiquement cohérents, des personnages sans épaisseur et souvent sans
identité, capables des plus surprenantes métamorphoses (l’Amédée de Ionesco s’envole
à la fin de la pièce, faute de pouvoir trouver d’autre solution à sa situation). Et, au lieu de
constituer un facteur de connaissance, le langage se révèle être la raison même de
l’incommunicabilité entre les êtres, des êtres qui, loin d’accéder, par son entremise, à
une vérité longuement et chèrement gagnée, ne parviennent plus qu’à répéter des
phrases toutes faites.
Mais ce rêve d’un “ degré zéro ” qui serait aussi le point oméga du théâtre ne pouvait
rester qu’un rêve. Bien vite, spectateurs et commentateurs rechargèrent de sens ces

paraboles qui prétendaient n’en privilégier aucun ou admettre tous les sens possibles. Le
“ nouveau théâtre ” fut baptisé “ théâtre de l’absurde ” et réintégré ainsi dans une
tradition qui, pour n’être pas celle de Racine ou de Molière (du Molière petit-bourgeois de
la Comédie-Française au moins), n’en avait pas moins ses lettres de noblesse, de Jarry
à Kafka, de Büchner à Strindberg, voire à Pirandello. Un véritable investissement
idéologique se produisit : “ être là ” se mit à signifier n’être pas ailleurs, être privé de ce
qui est ailleurs... La présence ou l’absence scéniquement concrètes voulurent aussi dire
le trop-plein ou le vide d’une existence absurde, privée de but (“ Est absurde ce qui n’a
pas de but [...]. Coupé de ses racines religieuses ou métaphysiques, l’homme est perdu,
toute sa démarche devient insensée, inutile, étouffante ”, Ionesco). Ainsi, le “ nouveau
théâtre ” renoua, subrepticement, avec le théâtre philosophique, avec la littérature à
message. Et il en retrouva du même coup les catégories formelles. Le Bérenger de
Ionesco (apparu dans Tueur sans gages et se taillant la part du lion dans Rhinocéros )
bénéficiait à nouveau du statut de héros : un héros dérisoire, sans doute, mais qui en
apparaissait d’autant plus exemplaire. Et le théâtre tout entier de Ionesco versa dans la
prédication. Certes, Beckett entendait, en revanche, s’en tenir au rien. Mais ce fut au prix
d’un processus de raréfaction : les dialogues de En attendant Godot firent place au
quasi-monologue de Winnie dans Oh ! les beaux jours , et ses œuvres théâtrales se
réduisirent bientôt à des mini-pièces qui sont comme autant d’objets minutieusement
agencés et proches de l’invisibilité ou de l’inexistence. À l’inverse, Adamov entreprit
d’ouvrir son univers obsessionnel au monde de l’extérieur et, rompant avec le huis clos
de l’avant-garde, d’installer sur la scène non plus seulement la grande et la petite
manœuvre de toute société, mais encore les mille et une grandes et petites manœuvres
de notre société régie par le profit. S’il y réussit avec Le Ping-Pong ou Paolo Paoli , il
échoua lorsque, dans Le Printemps 71 , il voulut évoquer par le détail les jours, les nuits
et les travaux de la Commune de Paris.
2. Une autre contestation
Vers 1960, alors que Beckett et Ionesco commençaient à être joués sur toutes les
scènes du monde et faisaient l’objet d’innombrables commentaires, peu ou prou
universitaires (américains, notamment), le “ nouveau théâtre ” des années 1950 était bel
et bien mort. Il avait sans doute rempli sa tâche : celle d’un “ déconditionnement ” de la
dramaturgie bourgeoise héritée du XIXe siècle et un peu frottée de belles-lettres pendant
la première moitié du XXe siècle. Mais il avait trébuché dans son ambition majeure : celle
de fonder un théâtre en quelque sorte “ pur ” qui ne doive rien à la littérature ni aux
idéologies. Il reste qu’il avait mis en branle un processus de transformation aussi bien de
la dramaturgie que de la pratique théâtrale, et que ce processus était irréversible.
Sans doute, un peu partout, les imitateurs et les épigones du “ nouveau théâtre ”
proliféraient (de Wolfgang Hildesheimer à Norman Frederick Simpson, en passant par
Robert Pinget et par les premières pièces de Harold Pinter, sans oublier des auteurs
dramatiques surgis un peu plus tard, à l’Est, qui réussissaient à concilier la dramaturgie
selon Beckett ou Ionesco avec leur tradition nationale : ainsi, par exemple, Slawomir
Mrozek en Pologne et Václav Havel en Tchécoslovaquie). Mais de nouvelles exigences
se faisaient sentir. Les noms, devenus des slogans, de Brecht et d’Artaud en témoignent.
Non qu’il y ait eu à proprement parler influence de ces auteurs – surtout pour ce qui est
d’Artaud dont l’œuvre était encore difficile d’accès : souvent ceux qui se réclamèrent

expressément de l’un ou de l’autre (quand ce ne fut pas des deux à la fois) ne prirent
guère la peine de les lire et moins encore celle de les comprendre. Toutefois, le nouveau
théâtre des années 1960 fut hanté par le désir de réaliser ou ce théâtre épique et
politique dont Brecht, mort en 1956, avait échafaudé la théorie, construit la méthode et
laissé des modèles (au sens propre du mot : que l’on se reporte aux “ livres modèles ”
d’Antigone ou de Mère Courage ) ou le “ théâtre de la cruauté ” qu’Artaud, mort en 1948,
avait célébré, voire les deux simultanément.
C’est au courant brechtien que l’on peut rattacher, alors, bon nombre des dramaturges
de langue allemande (à l’exception de Peter Handke) et, parmi eux, Max Frisch, pour qui
la rencontre avec Brecht, en 1947, en Suisse, fut décisive, Martin Walser et Peter Weiss.
Ils eurent en commun la volonté de traiter à la scène des problèmes essentiels de la
société allemande (dont celui, bien sûr, de sa responsabilité dans le nazisme, la guerre
et les camps de concentration) et de le faire dans une forme à laquelle Brecht a redonné
ses lettres de noblesse : la “ pièce didactique ” (ou Lehrstück : Max Frisch sous-titre
Biedermann et les incendiaires “ pièce didactique sans doctrine ”). En apparence, la
modification de la dramaturgie traditionnelle à laquelle procédèrent un Frisch ou un
Walser est moins radicale que celle des auteurs des années 1950 : le personnage est
réinstauré dans son identité, la description du milieu social va jusqu’à frôler le
naturalisme... C’est aussi le cas avec ce qu’on a appelé le “ nouveau théâtre anglais ” qui
est plus ou moins issu de l’“ école de la cuisine ” (d’après le titre de la première pièce de
Wesker : La Cuisine ). Sans doute des dramaturges comme John Osborne et Arnold
Wesker utilisèrent-ils certains procédés du “ théâtre épique ” selon Brecht : construction
par tableaux nettement séparés les uns des autres, inclusion de songs coupant l’action,
présence d’un narrateur... Mais c’est plutôt au théâtre réaliste de la fin du XIXe siècle
qu’il faudrait rattacher ces dramaturges, à celui d’Ibsen notamment (auquel Osborne
s’est intéressé). Le seul auteur britannique qui ait tenté de construire une dramaturgie
proprement épique est John Arden, dont La Danse du sergent Musgrave reste,
probablement, la parabole politique la plus aiguë du théâtre anglais des années 1960.
En Allemagne, inspiré par la leçon de Brecht et l’exemple du théâtre révolutionnaire
des années 1920, d’Erwin Piscator notamment (ce Piscator qui, redevenu, après plus de
vingt ans d’exil, l’intendant de la Freie Volksbühne, y créa – ce fut son avant-dernier
spectacle – L’Instruction ), Peter Weiss essaya de mettre au point de nouvelles formes
de théâtre politique pour lesquelles il reprit le terme, déjà utilisé sous l’Allemagne de
Weimar, de “ théâtre-document ” ou “ théâtre documentaire ”. Ce théâtre documentaire,
précisait-il, est un “ théâtre du compte rendu ” : il “ se refuse à toute invention, il fait
usage d’un matériel documentaire authentique qu’il diffuse à partir de la scène, sans en
modifier le contenu, mais en en structurant la forme ” ; il “ ne met pas en scène des
conflits individuels mais des comportements liés à leurs motivations
socio-économiques ”. Refusant la conception aristotélicienne (encore respectée par
Brecht) de la fable ou de l’action comme la fiction des personnages, ce théâtre
documentaire “ ne représente plus la réalité saisie dans l’instant ”, mais cite, sur le
tribunal de la scène, tel ou tel “ morceau de la réalité arraché au flux continu de la vie ”,
après l’avoir soumis à un travail formel rigoureux de type épique (utilisation des
interruptions, éclatement de la structure du récit...). Il devient le moyen d’une prise de
parti politique. Et, de préférence à l’édifice théâtral conventionnel, sa représentation
appelle d’autres lieux : “ Le théâtre documentaire doit parvenir à pénétrer dans les

usines, les écoles, les stades et les salles de meetings. ”
Au-delà des modifications de la structure dramatique, c’est tout un bouleversement de
la pratique théâtrale que supposait un tel théâtre documentaire (celui de Weiss bien plus
que celui de Rolf Hochhuth qu’on a, abusivement, classé dans cette tendance). En
France, le travail d’un Armand Gatti, sans être aussi étroitement rattaché à Brecht et à
l’exemple du “ théâtre épique ”, allait dans le même sens : l’éclatement des concepts
dramaturgiques fondamentaux (notamment l’unité du temps et de l’espace comme celle
du personnage, remplacées par un jeu entre l’espace et le temps, entre la subjectivité et
l’objectivité de personnages divisés en autant de figures qu’ils ont de “ moi possibles ”,
cf. La Vie imaginaire de l’éboueur Auguste G. et Chant public devant deux chaises
électriques ) a conduit Gatti à des expériences de théâtre écrit et monté avec la
collaboration même du public auquel elles étaient destinées (par exemple, Les Treize
Soleils de la rue Saint-Blaise ).
En revanche, d’autres œuvres, d’autres expériences de théâtre (la notion même
d’œuvre s’efface ici) relevaient de ce qu’on peut appeler le “ courant Artaud ”. Il s’agissait
de provoquer une véritable subversion de la pratique théâtrale traditionnelle et de
réaliser ce qu’Antonin Artaud a nommé, dans les années 1930, un “ théâtre de la
cruauté ”. Entendons par là, non, bien sûr, un théâtre fondé sur l’exercice d’une cruauté
toute matérielle (“ Il ne s’agit dans cette Cruauté ni de sadisme ni de sang, du moins pas
de façon exclusive ”), mais un théâtre qui, par des moyens plastiques et physiques, par
“ une poésie dans l’espace indépendante du langage articulé ”, soit comme “ un
formidable appel de forces qui ramènent l’esprit par l’exemple à la source de ses
conflits ” : “ Le théâtre, comme la peste, est à l’image de ce carnage, de cette essentielle
séparation. Il dénonce des conflits, il dégage des forces, il déclenche des possibilités, et
si ces possibilités et ces forces sont noires, c’est la faute non pas de la peste ou du
théâtre, mais de la vie [...] Et de même que la peste, le théâtre est fait pour vider
collectivement des abcès ” (Le Théâtre et son double ).
Sans doute, une telle ambition était, au sens propre, irréalisable. Elle ne supposerait
rien de moins qu’un changement radical de civilisation. Il n’empêche qu’elle est devenue
le mythe de tout un secteur du théâtre contemporain. Un moteur de ses métamorphoses.
On peut en trouver un écho dans une des œuvres les plus vivantes de cette époque,
celle de Jean Genet, et, notamment, les trois pièces que Genet a écrites dans les années
1950 (sans référence à Artaud, car il est probable qu’il n’a connu les textes de celui-ci
que plus tard) : Le Balcon , Les Nègres et Les Paravents. Certes, Genet est loin
d’abdiquer, comme le réclamait Artaud, “ la poésie du langage ” et de lui substituer “ une
poésie dans l’espace ”, et son théâtre ne s’adresse pas “ d’abord aux sens au lieu de
s’adresser d’abord à l’esprit comme le langage de la parole ”. Mais ce que, en fin de
compte, il détruit, c’est la possibilité même de toute représentation, la certitude de tout
ordre (fût-il esthétique) : le théâtre de Genet veut être comme la dernière fête que puisse
se donner le théâtre occidental : “ Je ne sais ce que sera le théâtre dans un monde
socialiste, je comprends mieux ce qu’il serait chez les Mau-Mau, mais dans le monde
occidental, de plus en plus touché par la mort et tourné vers elle, il ne peut que raffiner
dans la réflexion de comédie de comédie, de reflet de reflet qu’un jeu cérémonieux
pourrait rendre exquis et proche de l’invisibilité. Si l’on a choisi de se regarder mourir
délicieusement, il faut poursuivre avec rigueur, et les ordonner, les symboles funèbres ”
(Lettre de l’auteur à Jean-Jacques Pauvert, pour l’édition des deux versions des
Bonnes , Sceaux, 1954).
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%