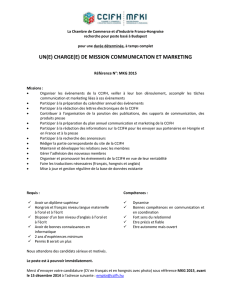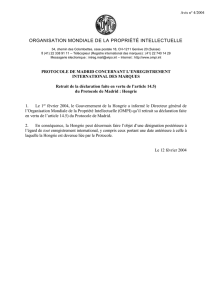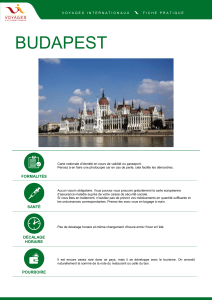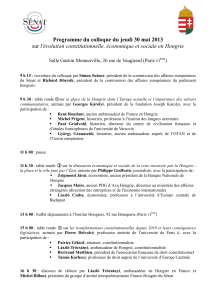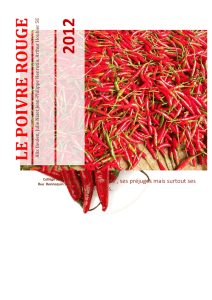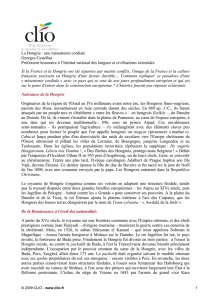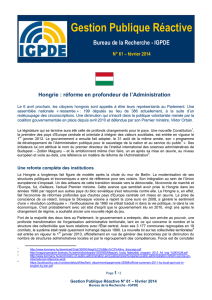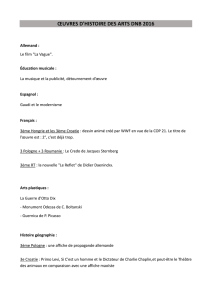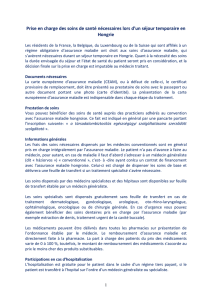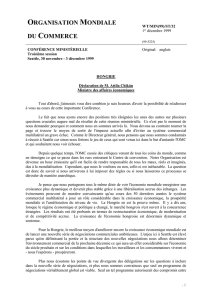histoire de la hongrie

Histoire de la Hongrie Archelle page 1 de 55
HISTOIRE DE LA HONGRIE
La Hongrie est un Pays continental et plat, situé à l’est de l’Autriche, dans un espace entouré par les
Carpates (espace qu’elle partage avec la Slovaquie, la Transylvanie roumaine, le nord de la Serbie, de
la Croatie et de la Slovénie). C’est un des États les plus anciens du Centre-Est européen. Réduite en
1920 au tiers de son territoire, elle s’étend sur 93.000 kilomètres carrés, soit un sixième de la France
actuelle ; en 1993, elle comptait un peu moins de 10,3 millions d’habitants (sa population est en
diminution constante depuis le début des années 1980).
Le peuple hongrois («magyar») appartient, par ses origines et par sa langue, à la famille finno-
ougrienne, dont certains groupes habitent toujours l’Oural. Après de longues migrations, pendant
lesquelles ils se sont mêlés à des peuplades turques vivant alors sur les steppes au nord de la mer Noire,
les ancêtres des Hongrois finirent par se fixer, à la fin du IXe siècle, dans les grandes plaines du bassin
pannonien, entre les Germains et les Slaves de l’Ouest d’une part, les Roumains et les Slaves du Sud
d’autre part. Ils devaient par la suite recevoir l’apport ethnique de tous ces groupes ainsi que de certains
autres peuples ou fragments de peuple propulsés sur leur territoire tantôt par les invasions mongoles
(comme les Coumans), tantôt par leur propre dynamisme (Tsiganes et Juifs de Pologne), tantôt par des
politiques de colonisation impériale (Saxons et autres Allemands). Le vocabulaire de la langue magyare
porte la trace de toutes ces cohabitations et de tous ces métissages. À présent, les magyarophones
forment plus de 95% de la population du pays, mais de 3 à 4 millions de Magyars vivent aussi dans les
pays limitrophes de la Hongrie, principalement en Roumanie (en Transylvanie), en Slovaquie du Sud,
en Ukraine subcarpatique et en ex-Yougoslavie (Voïvodine). On estime le nombre des Hongrois
dispersés dans le monde occidental (Europe de l’Ouest et Amériques) à 1 million et demi, dont une
fraction non négligeable (10% ou plus) est de souche juive.
Les Hongrois s’étaient convertis au christianisme à la fin du Ier millénaire ; cette religion leur était
venue de Rome, ce qui les a placés depuis lors dans l’orbite de la culture occidentale. Au XVIe siècle,
la Hongrie a massivement participé à la Réforme et, en dépit de certains succès de la Contre-Réforme,
une bonne partie de la population est restée calviniste ou luthérienne (30 p. 100, selon les dernières
statistiques exhaustives, qui remontent à l’entre-deux-guerres). Avant la guerre, de 5 à 6% de la
population était de confession israélite ; comme en Pologne, en Tchécoslovaquie et en Roumanie, les
juifs étaient particulièrement nombreux dans les villes. C’est ainsi que près du quart des habitants de la
capitale (Budapest) étaient, encore au début des années quarante, de religion ou d’origine juives. De la
fin du XIXe siècle jusqu’à l’époque des persécutions (qui, en Hongrie, avaient débuté en 1919-1920
pour culminer en 1944 avec l’extermination de plusieurs centaines de milliers de citoyens hongrois
d’origine juive), les juifs ont joué un rôle éminent dans la vie intellectuelle hongroise, en particulier
dans les courants de modernisation.
La Hongrie n’est pas très favorisée par la géographie : elle a un sol fertile mais, pays de plaine (son
plus haut sommet dépasse à peine 1.000 m), elle a peu de ressources minérales ; pays continental, elle
est dépourvue d’accès à la mer (sauf par voie fluviale). Mais surtout, elle appartient à une zone de
l’Europe qui, tant par son exposition géographique que par sa multiplicité ethnique, est rarement
arrivée à se soustraire à l’influence de ses puissants voisins de l’Ouest ou de l’Est : l’Empire
germanique d’un côté, l’Empire ottoman et la puissance russe, de l’autre côté. Écrasée et envahie par
les Turcs au début du XVIe siècle, la Hongrie n’a pu se perpétuer comme État que dans le cadre de
l’Empire des Habsbourg, ce qui l’a réduite, pendant des siècles, à un statut de colonisé. Associée, plus

Histoire de la Hongrie Archelle page 2 de 55
ou moins à égalité, à l’Autriche dans le cadre de la Double Monarchie (1867-1918), elle n’a pu éviter
d’en partager la chute, avec pour conséquence l’amputation des deux tiers de son territoire. Alliée des
puissances de l’Axe, elle devait être traitée par l’Union soviétique, à l’issue de la guerre, à la fois en ex-
ennemi et en futur satellite. Dans la zone d’influence créée par les Soviétiques en cette partie centrale
de l’Europe, les Hongrois seront d’ailleurs les premiers à se révolter les armes à la main en 1956 : mis
en échec dans un premier temps, les Soviétiques devront mobiliser toutes leurs ressources pour venir à
bout de la révolte hongroise. Une fois de plus, les velléités d’indépendance de la Hongrie seront écrasés
par la force mais, trente-deux ans plus tard, en 1989, les Hongrois seront parmi les premiers à rompre
avec le système communiste.
Du point de vue de son développement (social, économique, technique), la Hongrie se classe dans le
groupe des pays « moyennement développés », avec un niveau de vie qui est de 30 à 50% inférieur à
celui de l’Europe occidentale. Le retard de la Hongrie, en termes de modernité technique, est
particulièrement manifeste au niveau des infrastructures (routes, hôpitaux, etc.) et des équipements
productifs, alors qu’il est en train de s’atténuer au niveau des biens offerts à la consommation courante.
Certes, ce retard est en partie le produit de l’histoire dans la mesure où, jusqu’au milieu du XIXe siècle,
l’économie hongroise, paralysée sous le poids des latifundia improductifs, n’est pas parvenue à se
lancer dans une industrialisation de type capitaliste. Comme la plupart des pays du Centre-Est
européen, la Hongrie n’a pas disposé d’une bourgeoisie commerçante et industrielle assez forte pour
moderniser son économie ainsi que ses institutions politiques. Culturellement brillante, la Hongrie était
donc un pays socialement attardé avant de tomber dans la zone d’influence de l’U.R.S.S. L’importation
forcée des méthodes soviétiques n’a pas porté remède à ce retard, loin de là. Une réforme agraire
radicale, réalisée dès 1945, aurait certes pu jeter les bases d’une économie paysanne prospère, mais la
collectivisation – imposée pour des raisons de conformité avec le modèle soviétique – a bientôt recréé
aussi bien les latifundia improductifs que les rapports de subordination de type féodal. L’autre volet du
développement à la soviétique – la concentration des ressources au profit d’une industrie lourde
autochtone, destinée à renforcer l’autarcie technique du bloc soviétique – avait pour résultat d’arracher
la Hongrie à la division internationale du travail. En conséquence : tout « industrialisée » qu’elle soit
désormais, la Hongrie est complètement déphasée par rapport aux structures modernes de la
production ; avec la décommunisation, elle ne sait que faire de ses industries vieillies avant d’avoir
servi.
Au regard de ses institutions politiques et sociales, la Hongrie pendant le communisme n’a pas été très
différente de ses voisins. La société hongroise a vécu sous le signe d’un capitalisme d’État dont
l’inspiration était marxiste-léniniste, ce qui signifie en pratique que toutes les décisions dépendaient,
d’une façon ou d’une autre, du pouvoir politique et que tous les personnels à tous les niveaux étaient
nommés (et révoqués) par l’État-parti. Toutefois, en 1968, la planification hongroise a été dans une
certaine mesure décentralisée, ce qui faisait que, dans leur activité quotidienne, les entreprises
hongroises disposaient d’une plus grande marge d’autonomie que leurs homologues est-européennes
(Yougoslavie exceptée). Une autre originalité de la Hongrie était que, après 1956, l’exploitation
familiale a pu reprendre ses droits dans le cadre des fermes collectives. Elle vivait en symbiose avec la
gestion collective et profitait même de certaines facilités (crédits, équipements) gérées au titre de la
collectivité. Ces assouplissements ont mieux préparé la société hongroise au postcommunisme que ne
l’étaient ses voisins sans toutefois lui épargner les chocs d’un changement total.
1. Un pays continental
Cadre naturel et ressources
Les paysages, si souvent décrits, de la Grande Plaine ou Alföld, donnent l’image de la Hongrie
traditionnelle. À l’est du Danube s’étend un vaste bassin de subsidence tertiaire, comblé par des

Histoire de la Hongrie Archelle page 3 de 55
formations alluviales et éoliennes quaternaires. Le climat, marqué par la relative faiblesse des
précipitations (500 mm par an) et leur irrégularité, annonce celui des steppes de l’Europe orientale.
L’aridité exclut la forêt ; les sols noirs se forment sur les lœss, mais les placages alcalins s’étendent au
fond des dépressions occupées l’hiver par des marais. Dévastée par les Ottomans après la bataille de
Mohács (1526), reconquise après le traité de Karlowitz (1699) par les descendants de Magyars réfugiés
au nord du pays, de Slaves chassés des Balkans et de populations d’Europe centrale, la Grande Plaine
se couvre alors de grands villages au plan en damier, au centre de terroirs à champs assolés où se
pratique la culture extensive des céréales : elle devient au XIXe siècle l’un des greniers à blé de
l’Europe. Ce n’est qu’avec l’afflux ultérieur de la population que des points d’habitat temporaire et
isolé, les tanya deviennent des établissements permanents.
Les grands travaux d’aménagement ont apporté de profondes modifications dans l’économie agricole et
les structures sociales. Aux pâturages médiocres, rappelant la puszta primitive, qui s’étendent encore
sur les dunes de l’interfluve Danube-Tisza et sur les parties sableuses du Nyírség, se sont ajoutées les
plantations d’arbres fruitiers et des vignobles dans le premier ; de tabac, pommes de terre et tournesol
dans le second. Le Hortobágy est passé de l’élevage extensif de buffles, de chevaux, de porcs et d’oies
à la culture intensive. Mise en place petit à petit au cours de ce siècle, l’irrigation concernait en 1970
plus de 300.000 hectares : puisées dans les nappes phréatiques ou canalisées à partir de barrages
construits en amont de la Tisza dont les crues dévastatrices ont été régularisées, les eaux furent
distribuées dans le cadre d’exploitations d’État ou de coopératives qui pratiquaient les cultures
maraîchères et fourragères à haut rendement. L’amélioration des sols alcalins par la culture pionnière
du riz, la plantation de rideaux protecteurs, le reboisement des pentes, le remembrement des terres et la
fondation de villages modèles sont autant d’opérations qui, malgré quelques échecs, ont contribué à
transformer la physionomie des paysages. L’implantation de combinats de transformation de produits
agricoles, l’extraction du pétrole et du gaz naturel ont permis le réveil d’agglomérations comptant de
20.000 à 50.000 habitants. Au nord-est, Debrecen, ville calviniste par excellence, capitale culturelle et
religieuse de la Grande Plaine approchait les 200.000 habitants en 1980.
À l’ouest du Danube, l’ensemble des régions appelées Transdanubie ont été moins modifiées.
L’invasion turque et les guerres les ont relativement épargnées ; l’évolution plus ancienne d’un
peuplement continu a favorisé la dispersion de l’habitat. Le relief introduit de notables différences : au
sud, les affluents de la Drave découpent en collines un glacis de dépôts néogènes, dominé par le massif
du Mecsek, témoin de l’effondrement pannonien. À l’ouest s’élèvent les derniers massifs des Alpes
ite Plaine représente un vaste marécage
drainé. Des vallées alluviales confluent dans le plus étendu des lacs d’Europe centrale, le Balaton
(600 km2), frangé de vignobles et de vergers, centre de tourisme balnéaire. Partout, le climat plus
humide et relativement plus doux l’hiver explique l’extension d’une forêt de hêtres et de chênes que les
défrichements ont épargnée sur les versants, les sols pauvres et le fond des vallées. Les transformations
engagées dans le régime socialiste ont atteint moins profondément le système de culture et d’élevage
traditionnel, les exploitations collectives furent moins étendues que dans la Grande Plaine, la
polyculture restant règle, l’irrigation exceptionnelle. De taille moindre, les bourgades restent des
marchés agricoles. Les mines de charbon et d’uranium du Mecsek animent une petite région
industrielle ; Komló, ville nouvelle, se développe auprès de la ville historique de Pécs.
On convient d’appeler dorsale montagneuse une série de massifs qui, du sud-ouest au nord-est, relient
les Alpes aux Carpates, traversant ainsi en diagonale le nord du bassin pannonien ; la plupart se
composent de horsts de roches primaires, de plateaux calcaires ou dolomitiques qui renferment des
bauxites, de pointements et de coulées d’origine volcanique ; le long des lignes de failles, des éruptions

Histoire de la Hongrie Archelle page 4 de 55
se sont en effet produites à la fin du Tertiaire : les sources thermales attestent encore cette activité.
Dans les bassins qui séparent les massifs les uns des autres, des charbons bruns et lignites sont
exploités. À l’ouest, le Bakony domine de ses hauteurs boisées le lac Balaton. Le Danube, au centre,
incise en un beau défilé le complexe de massifs appelé Dunazug. À l’est, le Mátra atteint les plus
hautes altitudes. Un piémont couvert de vignobles le relie à l’Alföld. Dans les vallées et les bassins, des
foyers d’industrie sidérurgique et chimique retiennent la population. Les agglomérations urbaines de la
dorsale se sont développées en fonction de l’industrie extractive. À l’ouest, les activités dans le comitat
de Nógrád et les villes de Tatabánya, Várpalota et Dorog sont fondées sur le charbon, tandis que Ajka,
industries chimiques nées du gaz naturel ; sa capitale, Miskolc, deuxième ville hongroise, avec plus de
200.000 habitants, est un combinat sidérurgique utilisant les minerais de Rudabánya. Seul minerai rare,
le manganèse est exploité à Úrkút.
Une vocation agro-industrielle
La spécialisation de la Hongrie est déterminée par deux facteurs historiques. Le premier découle de
l’éclatement de l’Empire austro-hongrois et de la signature du traité de Versailles, après la Première
Guerre mondiale ; le second est l’intégration de la Hongrie dans le système socialiste. Après la
Première Guerre mondiale, la Hongrie a perdu les deux tiers de son territoire et donc une grande partie
de ses ressources en matières premières. Avec son entrée dans la zone d’influence de l’U.R.S.S., elle a
développé une stratégie industrielle qui a distendu ses liens économiques traditionnels avec ses voisins,
Autriche, Allemagne, Italie, pour s’intégrer au sein du Comecon. La transition postsocialiste,
commencée en 1990, la pousse à renouer avec ses partenaires d’antan et à chercher l’intégration dans
l’économie européenne. Un traité d’association avec la C.E.E. a été signé en 1991.
Sa vocation agricole a été contrariée par plusieurs tentatives d’industrialisation tout au long des cent
dernières années. Au cours des années soixante, la Hongrie a créé un puissant secteur agro-industriel
qui en fait un concurrent redouté de pays plus développés, comme la France, qui se montre réticente à
voir ce pays bénéficier d’avantages commerciaux avec la C.E.E.
Après la Seconde Guerre mondiale, le pays va connaître une profonde réorientation de son économie.
Le contrôle de l’économie et l’organisation des activités sous l’égide d’une planification impérative
vont contribuer à remodeler ses structures économiques. L’accent sera mis sur le développement rapide
de l’industrie lourde, jugé prioritaire ; l’agriculture sera collectivisée brutalement et les choix
industriels tiendront peu compte des ressources disponibles et des possibilités réelles de l’économie.
C’est après l’explosion de 1956 qu’on en reviendra à une approche plus réaliste, en tenant compte de la
vocation agro-industrielle du pays.
L’agriculture hongroise, organisée en fermes d’État et en coopératives, est spécialisée dans la
production de blé et de maïs. La Hongrie produit annuellement 34 millions de quintaux de blé et
45 millions de quintaux de maïs, se situant aux niveaux ouest-européen et nord-américain en ce qui
concerne les rendements. Parallèlement, les plantes industrielles se sont développées (betterave à sucre,
tournesol, fourragères pour le bétail) ; l’irrigation des terres et l’aménagement des superficies
cultivables ont permis d’étendre les cultures maraîchères : oignons, tomates, concombres, piments. La
culture de la vigne s’est fortement développée. Certains crus, comme le tokaj (tokay), dont une partie
est exportée, sont mondialement reconnus ; on cultive la vigne sur la quasi-totalité du territoire. Les
combinats vinicoles sont en voie de privatisation. Des repreneurs occidentaux, italiens et français
notamment, adaptent ce secteur aux techniques en vigueur à l’Ouest.
L’élevage favorise encore la production de viande de porc (823.000 tonnes en 1992, contre 230.000
pour le bœuf, 28.000 pour le mouton, 416.000 pour la volaille). L’agriculture hongroise, un fleuron de

Histoire de la Hongrie Archelle page 5 de 55
l’ancien système socialiste, est aujourd’hui en plein marasme, en raison du démantèlement et de la
privatisation des coopératives. La mise en place de quotas par la Communauté européenne limite les
possibilités d’exportation.
L’industrie hongroise est fortement dépendante de l’extérieur pour ses approvisionnements en
ressources naturelles. En 1960, le charbon représentait 80% de la production énergétique de la Hongrie.
Aujourd’hui, les sources d’énergie se sont différenciées : en 1992, le charbon (toutes qualités) ne
représente plus que 18,3% contre 34,5% pour le pétrole, 29,9% pour le gaz naturel, 12,8% pour le
nucléaire, 2,2% pour le bois et 0,2% pour l’énergie hydraulique. La production d’énergie d’origine
nucléaire, avec l’ouverture de la centrale atomique de Paks, au début des années quatre-vingt, contribue
à réduire la dépendance énergétique du pays. Par contre, de nombreuses mines de charbon ont été
fermées, et d’autres doivent subir le même sort. La production de charbon n’est plus que de
4,9 millions de tonnes, contre près de 23 millions dans les années quatre-vingt. La production de
pétrole atteint 1,8 million de tonnes. La Hongrie doit importer, pour couvrir ses besoins, de grandes
quantités de matières premières : plus de 30% pour l’énergie électrique, près de 80% pour le pétrole,
40% pour le gaz naturel en 1987. Des investissements de rationalisation sont effectués, dans le but
d’appliquer de nouvelles technologies dans la production et l’utilisation de l’énergie.
L’industrie sidérurgique hongroise dépend également d’approvisionnements extérieurs en matières
premières. La Hongrie importe la quasi-totalité des consommations intermédiaires utiles à la
production d’acier. Cette industrie, comme dans les autres pays socialistes, a connu un développement
soutenu, atteignant une production annuelle de 3,7 millions de tonnes en 1986. Toutefois, ce secteur
connaît des difficultés. La crise frappe les villes sidérurgiques (Ozd, dans le nord du pays) qui ont
beaucoup de mal à se reconvertir et se trouvent confrontées au chômage, toujours aigu dans les
industries monoproductrices. La production d’acier n’atteint plus que 1,6 million de tonnes en 1992. La
production hydraulique est peu développée. Un projet austro-hongrois d’exploitation en commun d’une
centrale hydraulique sur le Danube, en amont de Budapest, a été abandonné, en raison de ses effets
négatifs sur l’environnement. La bauxite est la seule matière première que la Hongrie détient en
abondance ; elle est à l’origine du développement de l’industrie de l’aluminium. Ce secteur est affecté
par les cours mondiaux, ainsi que par l’apparition de nouveaux matériaux. La Hongrie possédait une
industrie agro-alimentaire très performante, qui représentait un quart des exportations du pays et plus
du quart de ses recettes en devises convertibles, avant l’effondrement du système socialiste.
Aujourd’hui, ce secteur sinistré est en pleine reconversion.
Les communications
En raison de sa faible dimension et de sa situation géographique, la Hongrie jouit d’un bon réseau de
communications, aujourd’hui bien entretenu mais qui semble, dans certaines parties du pays,
insuffisant pour faire face à l’accroissement de la motorisation et à l’afflux de touristes. Le réseau
ferroviaire compte 7 767 kilomètres, en diminution de 15% par rapport aux années soixante. Environ
un quart des lignes sont électrifiées, mais ce secteur absorbe 59% du trafic, les locomotives Diesel le
reste. Le réseau routier, long de près de 30.000kilomètres, est asphalté à 90% (contre 11% en 1949). La
construction d’autoroutes est encore modeste, 227 kilomètres en 1986 ; les autoroutes partent de la
capitale dans quatre directions : le Balaton, l’ouest, l’est, et, récemment, le sud. Budapest souffre de
l’absence d’une voie de contournement. Avec l’aide financière internationale et la participation
d’entreprises étrangères, plusieurs projets d’extension sont en cours de réalisation, notamment le
raccordement Györ-Vienne, qui mettra Budapest à seulement deux heures de Vienne. On projette
également la construction d’autoroutes vers l’Ukraine, vers la Serbie. Plaque tournante, la capitale est
souvent congestionnée par le trafic.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
1
/
55
100%