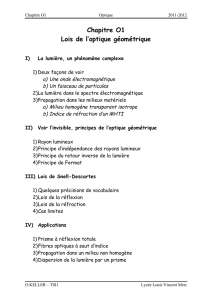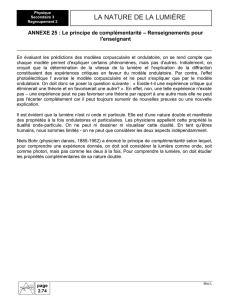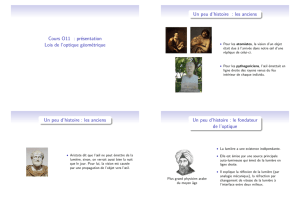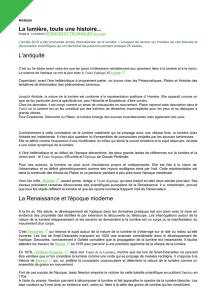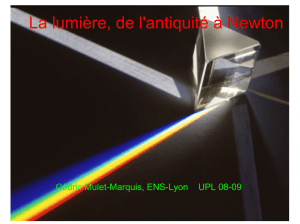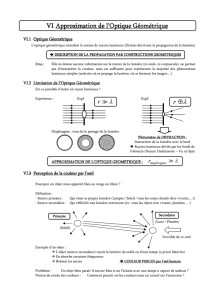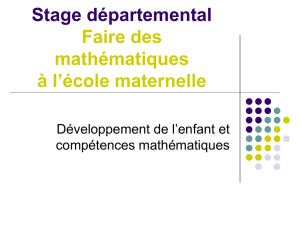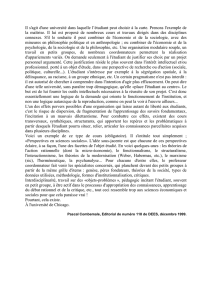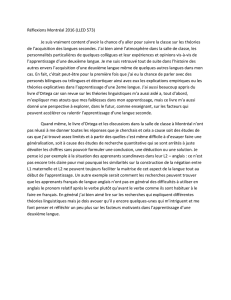Lumière

Histoire de l’étude de la lumière
a Lumière : elle apparaît évidence et simplicité : mais qu’est-elle réellement ?
Corps ou mouvement d’un corps
Substance spécifique ou mouvement spécifique
Jusqu’au XVIIIe siècle, les hypothèses sur la nature ondulatoire ( de onde) ou corpusculaire ( de corps) de la
lumière, sur son mode de propagation par l’émission de corpuscules ou par vibrations n’étaient aucunement
essentielles. La lumière était considérée :
soit comme un milieu continu, « feu artiste » susceptible d’un mouvement d’ensemble
soit comme une structure corpusculaire donc discontinu
Du continu au discontinu, ce n’est qu’une affaire d’échelle, et ce n’est alors pas primordial
Puis certaines contradictions vont apparaître (voir apposition entre les Principe de moindre action (Maupertuis)
et Principe de moindre temps (Fermat)).
Dès lors apparaît la notion de dualisme onde corpuscule
L


Extrait de l’Encyclopædia Universalis :
LUMIÈRE - Histoire des idées
La lumière est facilement associée à une notion
d’évidence et de simplicité dont elle reste le symbole. La Genèse
affirme que la lumière fut créée le premier jour, précédant ainsi
largement une complexité du monde sans cesse accrue.
Pourtant ce phénomène, le plus directement associé
aux manifestations du monde sensible et aux perceptions
visuelles immédiates, se révèle bientôt très mystérieux. «Nous
saurions beaucoup de choses, affirmait Louis de Broglie, si nous
savions ce qu’est un rayon lumineux.»
Si l’on essaie de formuler les questions qui se posent
actuellement sur la nature de la lumière, on constate bien vite que
la forme même des questions ne peut se transposer dans le passé
sans d’essentielles modifications. Dès que les notions de
corpuscule et de milieu prirent un sens précis, au XVIIe siècle,
on a pu, en effet, se demander si la lumière était un corps, ou
bien, au contraire, le mouvement d’un corps; s’il s’agissait d’une
substance spécifique ou bien d’un mouvement spécifique. Dans
l’Antiquité, cette distinction n’avait pas beaucoup de sens car la
notion de milieu, support de vibrations, mais dépourvu lui-même
de mouvement d’ensemble, était à peu près inconnue. C’est dire
que, jusqu’au XVIIIe siècle, les hypothèses sur la nature
ondulatoire ou corpusculaire de la lumière, sur son mode de
propagation par l’émission de corpuscules ou par vibrations
n’étaient aucunement essentielles. On pouvait parfaitement
concevoir la lumière comme un milieu continu, comme un «feu
artiste», susceptible de déplacement d’ensemble. On pouvait
aussi lui attribuer une structure corpusculaire, réduction non
spécifique d’un objet macroscopique avec toute sa diversité. Les
notions de continu et de discontinu se rattachent alors à une
question d’échelle, mais ne sont pas primordiales. De même, le
mode de propagation n’est pas essentiel tant que l’on ignore les
propriétés d’un milieu.
Au fur et à mesure que se précisent les notions de
milieu et de vibrations, la question de la nature de la lumière –
substance spécifique ou mouvement spécifique – se pose avec
plus d’acuité. Il est remarquable que, dans cette évolution, la
lumière ne cesse de se présenter comme un phénomène
d’exception : ses manifestations les plus simples, les phénomènes
de réfraction, montrent qu’elle ne se comporte pas comme une
particule matérielle usuelle: dans un milieu plus dense, les rayons
lumineux se rapprochent de la normale alors qu’une pierre, jetée
dans l’eau, s’en écarte. Une vue plus approfondie de la situation
conduit à de profondes difficultés dès qu’on veut rapprocher le
principe de la moindre action (Maupertuis) appliqué à un
projectile matériel d’un principe du moindre temps (Fermat).
Finalement, au début de ce siècle, la lumière semble
bénéficier d’un célèbre dualisme: elle se manifeste tantôt comme
onde, tantôt comme corpuscule. C’est un tel dualisme que la
mécanique ondulatoire va étendre à la propagation de toute
particule matérielle.
Ainsi, la lumière s’affirme comme un phénomène
d’exception: en relativité, les trajectoires des rayons lumineux
définissent le cône isotrope délimitant le passé et le futur de
chaque observateur. En mécanique ondulatoire, les théories de la
lumière ont servi de modèle pour prévoir l’existence d’une «onde
associée» au mouvement de chaque particule. Néanmoins, la
coexistence de l’onde et du photon a soulevé maints problèmes.
Ainsi, la simplicité primitive de la «lumière du
premier jour» devient la complexité qui accompagne les
fondements mêmes de la physique et rassemble, en grande partie,
ses difficultés.
1. Les théories archaïques
Les théories archaïques concèdent à la lumière une
sorte de prédominance mythique. Il s’agit alors d’un Feu qui
constitue la forme primitive de la lumière. Dans la physique
d’Héraclite d’Éphèse (VIe siècle av. J.-C.), ce feu réalise l’unité
de toute chose; il constitue la règle des transformations de la
matière et préside à ses bouleversements.
Pour les pythagoriciens, la lumière permet une
harmonisation de la connaissance; c’est un feu visuel adapté à la
diversité du monde qu’il permet d’explorer.
Les théories archaïques vont bientôt se fragmenter en
plusieurs courants, sans cesser de constituer des théories de la
vision beaucoup plus que des théories sur la nature de la
lumière. La question qui se pose est en effet «Comment
voyons-nous?» et non pas «Quelle est la nature de l’agent qui
nous permet de voir?». Selon la réponse à cette première
question, on peut distinguer trois types de théories: la lumière
peut, en effet, avoir sa source dans les objets eux-mêmes
(théories du feu externe), dans l’œil qui voit (théories du feu
visuel), ou bien dans les deux à la fois. Notons que dans toutes
ces conceptions, la nature continue ou discontinue de la lumière,
son mode de propagation (mouvement spécifique d’un milieu ou
émission de corpuscules) ne jouent qu’un rôle très accessoire.
Théories du feu externe
Empédocle d’Agrigente propose un cosmos fondé sur
la présence de quatre éléments (feu, air, eau, terre). Le premier
d’entre eux, le plus subtil, s’apparente à la lumière sans toutefois
se confondre avec elle. Plus tard, Aristote essaiera de rattacher

les propriétés de la lumière à la propagation du feu dans le
diaphane, à ses altérations spécifiques au sein des milieux
transparents. Ces modifications vont-elles conduire déjà à
supposer des mouvements de type vibratoire? L’ambiguïté de la
physique d’Aristote permet difficilement de souscrire à une
opinion aussi tranchée que soutiendront plus tard de nombreux
disciples. D’autre part, dès l’époque de Leucippe de Milet
(VIe siècle av. J.-C.), certaines théories du feu visuel avaient
décomposé ce feu en micro-objets, les eidola , images fidèles et
réduites des corps matériels. Cette miniaturisation qui conserve
au corpuscule lumineux les multiples qualités de l’objet s’affirme
chez Épicure, dont la théorie sera vulgarisée plus tard par
Lucrèce. Les «simulacres» qui produisent alors la vision et même
les phantasmes des rêves possèdent toutes les qualités des corps
dont ils proviennent.
Au contraire, ces micro-objets vont se fragmenter,
soit d’après un atomisme des qualités (chaque micro-objet
correspond alors à une propriété, couleur, odeur, etc.,
déterminée: ce sont les «homéories» d’Anaxagore), soit d’après
les seuls critères de l’étendue et du mouvement. Tels sont les
atomes de Démocrite, atomes dépourvus de toute autre qualité
sensible. La vision résultera ainsi de la collision entre ces
atomes, mais ces derniers ne sont pas spécifiques du seul feu
externe.
Théories du feu visuel
Les théories du feu visuel affirment, au contraire, que
l’œil, et non pas les objets vus, est le siège d’une émission
spécifique permettant la vision. Cette opinion est admise par une
part importante de l’école pythagoricienne (Aechytas de
Tarente), mais son représentant le plus brillant reste certainement
Euclide. Il n’est pas étonnant que le fondateur de l’école
d’Alexandrie, auteur de l’optique géométrique et de la
catadioptrique, ait déduit des conséquences aussi remarquables et
aussi rigoureuses d’une théorie du feu visuel: le principe du
retour inverse de la lumière autorise toutes les constructions
d’Euclide, fondées seulement sur la notion de rayon lumineux et
de propagation rectiligne. Bien mieux, ce principe les simplifie et
les facilite. Les disciples d’Euclide, Hipparque (vers 150 av. J.-
C.) puis, au Ier siècle de notre ère, Claude Ptolémée et Héron
d’Alexandrie vont admettre des principes analogues et
développer leurs conséquences avec succès. Dans la seconde
moitié du IIe siècle, Galien de Pergame étudie la structure de
l’œil sans en déduire un mécanisme de la formation des images.
Théories mixtes
Les théories mixtes ont une double origine: la
doctrine des quatre éléments (Empédocle) et l’hypothèse d’un
feu visuel spécifique. La vision résulte ainsi d’une nécessaire
interaction de ces deux courants. Selon Platon, la vision naît
d’une adaptation réciproque de l’agent et du patient.
D’une manière plus précise, les couleurs sont
produites par des modalités particulières de cette réciproque
adaptation: si le feu externe est constitué par des particules plus
étendues que celles du feu visuel, le feu externe rassemble le feu
visuel et produit la sensation de noir. Si le feu externe, au
contraire, comporte des particules plus petites, il en résulte
l’impression de blanc. Les autres couleurs découlent de
proportions diverses et de mélanges variés. D’une manière
ingénieuse, une théorie mixte permet d’interpréter les
caractéristiques des images obtenues par réflexion, en particulier
l’inversion droite et gauche de ces images par rapport à l’objet
après réflexion sur les miroirs plans ou concaves.
2. Le Moyen Âge
Les premiers siècles de notre ère laissent subsister des
courants très divers, issus de conceptions rudimentaires,
superficielles, que ne viennent étayer que de très rares et très
insuffisantes vérifications expérimentales. Il faut attendre ensuite
le XIe siècle pour qu’une optique expérimentale renaisse en
Égypte; elle est l’œuvre de physiciens arabes, et surtout d’Ibn al-
Haytham, plus connu sous le nom d’Alhazen (965-1039).
Alhazen attribue à la lumière une origine extérieure à
l’œil, mais, surtout, il imagine diverses expériences destinées à
mettre en évidence l’influence de la lumière sur l’œil, se servant
par exemple d’un dispositif de chambre obscure. D’autre part, il
reprend le concept de rayon lumineux, qui avait fait le succès de
l’optique d’Euclide, et l’utilise pour préciser une correspondance
biunivoque entre chaque point de l’image et chaque point de
l’objet. Le phénomène de la vision est ainsi décomposé en
processus élémentaires et la formation de l’image est déterminée
par la position du cristallin.
Enfin, Alhazen propose de très nombreuses
expériences de réflexion et de réfraction, utilisant des miroirs ou
des lentilles planes ou sphériques. Il montre l’interdépendance
des rayons lumineux qui se croisent sans être altérés. Il étudie
même la diffusion de la lumière par les corps opaques.
L’optique d’Alhazen est remarquable en ce sens
qu’elle constitue un travail expérimental dépourvu de préjugés.
Diffusée partiellement par Witelo (1271), elle constitue une
tentative certes fragmentaire, mais dont l’inspiration quasi
moderne est alors tout à fait exceptionnelle.

En effet, jusqu’au XIIIe siècle, le développement
d’une optique expérimentale est à peu près nul. Un certain
renouveau apparaît dans le cercle dit école de Chartres.
Néanmoins, au XIIIe siècle, après l’introduction de l’œuvre
d’Aristote à l’université de Paris, sa confrontation avec la
cosmologie issue des travaux de Ptolémée s’épuise dans des
discussions assez stériles (averroïsme). Enfin, l’école d’Oxford,
avec Robert Grosseteste, Roger Bacon (1214-1294), s’efforce de
ranimer une tradition scientifique attachée à des principes
platoniciens. En particulier, Bacon, qui connaît bien l’œuvre
d’Alhazen, essaie de rénover une tradition expérimentale très
hésitante. Au XIVe et au XVe siècle se poursuivent des
expériences systématiques sur l’arc-en-ciel et sur la
décomposition de la lumière par le prisme de verre.
Les opinions sur la nature de la lumière vont surtout
ressusciter, à travers Aristote et saint Thomas, de très anciens
préjugés. Néanmoins, les perfectionnements de la technique
s’accélèrent. Joints à la diffusion de l’optique d’Euclide et des
travaux d’Alhazen, ils vont permettre une véritable renaissance
de l’optique expérimentale.
3. Le problème de la nature de la lumière au XVIe
siècle
Le problème de la nature de la lumière est abordé au
début du XVIe siècle suivant des perspectives très variées.
Léonard de Vinci (1452-1519), qui étudie la propagation des
rayons lumineux à l’intérieur d’une chambre obscure, s’attache
aux analogies entre la lumière et le son, à la formation des
couleurs par répartition des zones d’ombre et de lumière.
L’utilisation des lentilles de verre convexes, dont
l’origine reste mystérieuse, progresse rapidement. De fabrication
probablement artisanale, ces lentilles sont utilisées tout d’abord
de façon purement empirique et utilitaire pour corriger la vue. Le
fonctionnement de ces instruments, que connaissaient déjà Roger
Bacon et Gérôme Frascator, permet d’étudier le comportement
du cristallin. Grégoire Reisch de Fribourg (1475-1523),
F. Mauricolo (1494-1575), Giambattista Della Porta (1538-1615)
écrivent des traités dont le rôle pratique n’est pas douteux
(Magia naturalis ).
La première lunette à oculaire divergent est construite
en 1590. Galilée, au début du XVIIe siècle, utilise ces appareils
pour l’exploration du ciel et, en 1610, découvre quatre des
satellites de Jupiter. En outre, il construit l’un des premiers
microscopes, s’émerveillant des observations ainsi réalisées. On
sait la polémique que soulève l’emploi de ces instruments,
créateurs de phantasmes, origine d’illusions trompeuses.
Pourtant, en 1611, sur les conseils de Galilée, Kepler observe à
son tour les «planètes médicéennes». Dès lors, le rôle bénéfique
des instruments d’optique est reconnu. La réaction des corps
éclairés par la lumière, les lois de la réflexion et de la réfraction
(il s’agit d’une loi approchée i = n . r ), le mécanisme de la
vision reconnaissant la formation d’une image renversée sur la
rétine, le fonctionnement des lentilles convergentes et
divergentes, tout cela fait l’objet du célèbre traité de Kepler Ad
Vitellionem paralipomena (1604).
La distinction entre «rayons lumineux», sans véritable
réalité physique, et «ondes sphériques isotropes» se trouve, bien
qu’en termes sybillins, au premier chapitre, «De natura lucis», du
traité de Kepler. La lumière est une action qui se propage à une
vitesse infinie et dont l’intensité, comme un effet de surface,
décroît suivant 1/r 2.
4. Le cosmos cartésien et la nature vibratoire de la
lumière
La conception de la nature de la lumière est
inséparable, pour Descartes, de l’ensemble du cosmos.
L’existence d’un univers incompressible et plein permet les seuls
mouvements tourbillonnaires. La matière la plus subtile est ainsi
pressée, et cette pression, qui se transmet instantanément à
travers un milieu incompressible, constitue l’essence même des
phénomènes lumineux. La lumière n’est donc pas un véritable
mouvement, mais une «tendance au mouvement»: c’est une
pression. Néanmoins, les lois qui régissent les phénomènes
lumineux (réflexion, réfraction) sont analogues pour les
mécanismes «en puissance» et «en acte». Descartes va donc
établir les lois de l’optique géométrique (loi des sinus) en
utilisant les règles qui régissent une balistique des projectiles
matériels. Il en résulte que l’expérience impose à la lumière une
vitesse de propagation d’autant plus grande que les milieux sont
plus réfringents (V eau O V air). L’optique de Descartes semble
pourtant souvent sybilline puisque réflexion, réfraction,
dispersion, formation des couleurs s’expliquent par des images
empruntées à une cinématique corpusculaire, tandis que la
lumière reste essentiellement une action, une «tendance», une
pression «comme tremblante» qui, par l’intermédiaire d’un
milieu, «se redouble par petites secousses».
Selon Descartes, la lumière parvient donc en un
instant du corps lumineux à l’œil (ce qui est différent, comme il
l’observe, d’une propagation instantanée, laquelle supposerait un
agent qui se propage). «Si l’on me pouvait convaincre de
fausseté là-dessus, ajoute-t-il, j’étais tout prêt d’avancer que je ne
savais rien du tout en philosophie.» Or, vingt-cinq ans après la
mort de Descartes, Olaf Römer montrait, par l’observation des
occultations des satellites de Jupiter, que la lumière se propage
 6
6
 7
7
1
/
7
100%