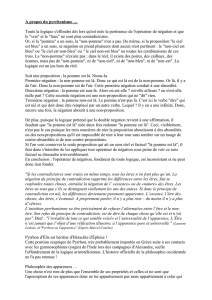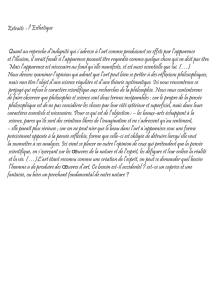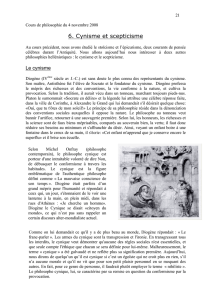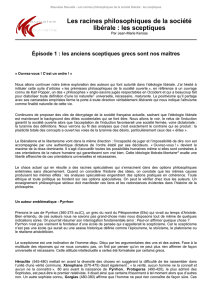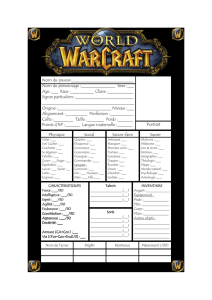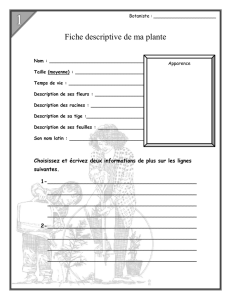Pyrrhon ou l`apparence - Philosophie Management

Pyrrhon ou l’apparence
Brève présentation du livre éponyme de Marcel Conche et quelques réflexions
Philosophie & Management
06/05/06
L’année passée, à cette même place, j’ai eu le plaisir de présenter dans le cadre de ce
séminaire une petite comparaison entre la pensée de Marcel Conche, philosophe, et celle de
Peter Senge, management «guru», bien connu auprès des managers et des consultants pour ses
livres sur la gestion du changement, la pensée systémique («system thinking» et l’organisation
apprenante («the learning organization»).
Ce texte, que vous trouverez en annexe de celui-ci, mettait en évidence l’usage un peu léger
de certains concepts par Senge et par la littérature managériale en général et permettait surtout
d’introduire quelques réflexions clés de la pensée de Marcel Conche touchant à trois binômes
et que l’on retrouve dans pratiquement tous ses livres :
Ce qui est « vraiment » réel et ce qui n’est pas « vraiment » réel
Pensée et action
Vérité et bonheur
Permettez-moi de rappeler ici brièvement la distinction que fait Conche entre «ce qui est
vraiment réel» et «ce qui ne l’est pas» au travers d’un extrait d’une lettre que Conche adresse
à son ami Gilbert Kirscher (publiée dans «Philosopher à l’infini», p. 176) et dans lequel il
résume de manière lumineuse son «attitude» philosophique :
1. L’objet de la philosophie est de penser le réel dans son ensemble, le Tout de la réalité. Ou
encore : la philosophie est la recherche de la vérité au sujet du Tout de la réalité, et de la
place de l’homme dans le Tout. De là les questions : que faut-il entendre par «réel» ?
Qu’est-ce qui mérite d’être dit vraiment «réel» ?
2. Le réel est ce qui demeure par opposition à ce qui ne fait que passer – mais peut-être
«tout» ne fait-il «que passer».
3. Il faut philosopher non à partir de la croyance, mais à partir de l’évidence de ce qui se
montre, de ce qui s’offre à tous : le monde, sur fond de Nature.
4. Le réel dans son ensemble est la Nature. Il peut y avoir plusieurs mondes (et même une
infinité), il n’y a qu’une seule Nature : Totum sive natura (le tout, c’est-à-dire la nature).
5. La Nature se donne comme infinie, donc in-compréhensible. Penser la Nature n’est donc
pas la comprendre. Penser n’est donc pas comprendre – ni connaître : on ne peut connaître
le Tout.
Ainsi, pour Conche, ce qui est «vraiment» réel, c’est ce qui demeure, ce qui ne passe pas.
C’est ce qu’il appelle la Nature, le Tout de la réalité. «Tout le reste», tout ce que nous voyons
autour de nous (être humains, animaux, plantes, pierres,…) n’est que l’expression fugace du
Tout de la réalité, un peu comme des bulles de champagne qui remonteraient continuellement
à la surface pour disparaître et cela, sans fin, dans le temps comme dans l’espace. Tout cela
est en quelque sorte «englobé» par la Nature, l’Englobant universel, en dehors duquel il n’y a
rien.
Aujourd’hui, j’aimerais, avec vous, aller un pas plus loin dans la réflexion sur «ce qui est
vraiment réel» et «ce qui ne l’est pas» au travers d’un livre que Conche a consacré à Pyrrhon,
un philosophe qui n’a rien écrit et dont on sait bien peu si ce n’est qu’il était natif d’Elis, et
pauvre, qu’il avait suivi Alexandre dans ses expéditions. Il a donc vécu autour de 330 avant
Jésus-Christ. Pyrrhon est souvent considéré comme un sceptique, au même titre que Sextus
Empiricus.

Or, comme le montre de manière très convaincante Marcel Conche dans son livre, cela n’est
pas correct. Les sceptiques pensaient ne pas pouvoir prononcer de jugement sur l’être des
choses. Pyrrhon va beaucoup plus loin : pour lui, il n’y a tout simplement pas d’ « être » des
choses.
Dans cet article, je m’efforcerai de synthétiser aussi fidèlement que possible les principales
idées du livre de Conche : toutes les idées qui sont présentées dans cet article sont donc de
Conche ; pour laisser le texte le plus fluide possible, je n’ai pas systématiquement fait
référence aux pages du livre dont les idées et réflexions sont extraites.
Pourquoi vous parler de Pyrrhon dans le cadre de ce séminaire ?
Tout simplement parce que la pensée, volontairement non écrite (on verra plus tard pourquoi)
de Pyrrhon, remet en cause, et de manière forte certaines pensées que nous avons vues lors de
ce séminaire.
Ainsi, comme nous allons le voir, la pensée de Pyrrhon, telle que comprise par Conche, refuse
le principe de contradiction et de son dérivé, le principe du tiers exclu, formulés par Aristote,
que nous avons vu avec de Praetere & de Brabandère. Pour Pyrrhon, le principe de
contradiction, confère implicitement aux «êtres» une stabilité illusoire. Cette stabilité illusoire
des «êtres» est liée au langage. Or la stabilisation qu’implique le langage contredit la fuyante
réalité, c’est-à-dire, comme je l’ai dit plus haut, que «tout» passe.
Par ailleurs, comme on le verra également, la pensée de Pyrrhon n’est pas très éloignées de
pensées orientales que nous avons également abordées durant ce séminaire, par exemple la
pensée indienne avec Joachim Lacrosse. Cela n’a rien d’étonnant : Pyrrhon a rencontré lors
des ses expéditions avec Alexandre les gymnosophistes, ces sages de l’Inde, qui loin de
s’extasier devant l’entreprise d’Alexandre, en faisaient apparaître la finale vanité – par
exemple en frappant la terre du pied lorsqu’il passait, pour indiquer que bientôt il ne lui
resterait plus de toute la terre que ce qu’il lui faudrait pour son tombeau.
Au travers de la pensée de Pyrrhon, nous allons donc aborder, sous un angle un peu différent
le thème du séminaire de cette année, à savoir «Le changement : une question de
représentations et de langage».
Avant d’entrer dans le vif du sujet, encore un mot sur Conche. Certains s’étonneront peut-être
de mon engouement marqué pour celui-ci, au point que je pourrais paraître ne jurer que par
lui. Ce n’est pas le cas. C’est d’ailleurs assez normal puisque Conche, que l’on pourrait
qualifier de philosophe anti-systémique, invite à penser librement. Si je reviens donc si
souvent à lui, c’est, outre le fait que je l’apprécie beaucoup, avant tout dû à une question de
méthode : sur les conseils d’un ami averti, je me suis donné pour discipline de lire à fond un
auteur, plutôt que de «papillonner» entre les philosophes. Depuis 5 ans, l’essentiel de mes
lectures philosophiques est donc constitué des livres de Conche dont les pensées diverses et
dont je comprend de mieux en mieux les subtilités me permettent d’avoir un regard plus sûr,
plus réfléchi, sur la plupart des questions philosophiques qui me paraissent importantes.

1. Le refus du principe de contradiction
Comme nous l’avons vu, pour Aristote, le principe sans lequel aucune connaissance n’est
possible, et dont la négation entraîne la destruction de tout le savoir humain (en physique,
mathématique,…), est le principe de contradiction, ou plus justement formulé, le principe de
non-contradiction. «A est B» et «A n’est pas B» ne peuvent être vrais en même temps. On
remarque d’emblée que le principe de contradiction est énoncé comme un principe
ontologique, c’est-à-dire concernant ce qui est – et que la pensée aura à respecter pour penser
ce qui est (c’est-à-dire pour penser).
Un tel principe n’est pas susceptible d’être démontré. Il ne peut être défendu que contre ses
négateurs. Aristote s’emploie à démontrer de diverses façons que la négation du principe de
contradiction n’est pas tenable :
Celui qui dit que à la fois «A est B» et «A n’est pas B» dit en fait que le mot B ne signifie
pas ce qu’il signifie ; il n’est pas utilisé correctement.
Le fait que nous recevions des mêmes objets des impressions différentes (le miel est doux
pour celui qui est en bonne santé ; le miel est amer pour celui qui a la jaunisse) n’a rien
d’étrange, si c’est nous qui avons changé. La contrariété de nos impressions ne nous
oblige pas à affirmer la vérité des contradictoires. Cela nous oblige seulement à rendre
précise la formule du principe de contradiction. On ne peut pas simplement dire que ce qui
apparaît est : il faut préciser que ce qui apparaît est pour celui à qui il apparaît, quand il
apparaît, au sens où, et de la façon suivant laquelle il apparaît. Ces précisions font
s’évanouir les prétendues contradictions auxquelles paraissent conduire les divergences
sensorielles.
Si les contradictoires sont vraies en même temps, tous les êtres n’en font plus qu’un :
l’homme est non-homme, a fortiori non-cheval, donc (en vertu de la négation du principe
de contradiction) cheval. La négation du principe de contradiction supprime les
différences entre les êtres, fait se confondre toutes choses, entraîne la négation de l’
«essence» ou de «nature» des êtres. Car, si un être est essentiellement homme, cela veut
dire que ce qui le fait «homme», par exemple, «animal bipède», ne peut ni ne pas lui
appartenir, ni appartenir à ce qui est «non-homme». Or, si le principe de contradiction est
nié, un caractère peut, indifféremment, appartenir ou ne pas appartenir à une chose.
Pourtant les être ne sont que s’ils se distinguent réellement les uns des autres. Si donc le
principe de contradiction est nié, les différences deviennent purement apparentes.
L’essence, l’être des choses, des êtres, s’évanouit. A proprement parler, il n’y a plus rien –
du moins il n’y a plus d’«êtres».
Enfin, ou en effet, la négation du principe contradiction entraîne la négation de cette
négation même. Si l’affirmation n’est pas plus vraie que la négation, de même l’ensemble
«A est B et n’est pas B», pris comme seule affirmation, ne sera pas plus vrai que la
négation totale correspondante. La négation du principe de contradiction, si elle est totale
(s’appliquant à toutes les affirmations et négations), et réciproque, conduit à la destruction
corrélative de l’être et du discours : celui qui affirme, en même temps, ce qu’il dit et le
contraire, ne dit rien. On ne sait plus rien dire de «sensé».
Admettre l’argumentation d’Aristote, c’est donc admettre qu’il n’y a pas de milieu entre dire
quelque chose (au sens de dire ce qui est) et ne rien dire, ou qu’il n’y a pas de milieu entre
l’être et le rien.
Or, l’intuition pyrrhonienne va être précisément de refuser l’alternative entre l’être et le non-
être.

Sa formule clé pour l’exprimer est le «ou mallon», ce qui veut dire en grec «pas plus». Le «ou
mallon» pourrait s’employer dans une phrase de la façon suivante : «Le miel n’est pas plus
doux qu’amer ou qu’aucun des deux». Mais, on l’aura compris, Pyrrhon ne se contente pas
d’utiliser le «ou mallon» pour exprimer qu’il nous est impossible de connaître ce qu’est le
miel en soi. Son intuition, qui est à la base de son refus du principe de contradiction, est de
dire «de chaque chose qu’elle n’est pas plus qu’elle n’est pas, ou qu’elle est et n’est pas, ou
qu’elle n’est ni n’est pas». L’«être» du miel n’est pas plus être que non-être, ou que l’un et
l’autre, ou que ni l’un ni l’autre.
Or, si la notion d’«être» s’évanouit, ce qui s’évanouit aussi, c’est la notion d’«apparence» en
tant que l’un des pôles de la relation duelle apparence-être. Qu’est-ce à dire ? Ce qu’il y a
(l’ensemble des choses), même si cela ne peut être dit «être», n’est pourtant pas absolument
rien. De là une nouvelle notion d’apparence : ni apparence-de (d’un «être»), ni apparence-
pour (pour un «être», le sujet), mais apparence qui ne laisse rien hors d’elle : apparence
universelle et absolue.
Cette notion d’apparence absolue permet, selon Conche, à Pyrrhon de dépasser l’alternative
d’Aristote entre l’être et le non-être. Pyrrhon découvre avec cette notion d’apparence absolue
une forme du rien qui n’est pas un rien purement négatif (le néant), une forme du rien qui ne
se pense pas par rapport à l’être. La révélation de Pyrrhon, peut-être stimulée par les sages de
l’Inde évoqués plus haut, est celle de l’irréalité de tout ce qui semble «réel», et de
l’universalité de l’apparence. Comme le dit joliment Conche (p. 38) : «Et ainsi, il lui vint à
l’esprit que le chemin à suivre n’allait pas de l’apparence à l’être, comme le crut Platon, mais
au contraire, de l’être, qui n’est jamais que l’objet d’une réification illusoire, à l’apparence
pure et universelle».
Et, comme nous allons le voir, dans la transmutation de toutes choses en apparences, Pyrrhon
va trouver le principe d’une sagesse, d’une éthique. Pour tenter de présenter ce qui caractérise
cette éthique, nous reprendrons les binômes déjà utilisés dans l’article comparant Senge et
Conche, à savoir «Pensée et Action» et «Vérité et Bonheur». Mais avant de le faire, essayons
de caractériser un peu plus ce qu’implique le pyrrhonisme.

2. Le pyrrhonisme : philosophie de l’inconstance ou « Météorisme »
Le pyrrhonisme n’est pas une théorie, un système philosophique. C’est plutôt une « sophos »,
une révélation sur les choses elles-mêmes, comme n’étant, non seulement pour nous mais en
elles-mêmes, rien d’autre qu’apparences. C’est une conversion à une certaine vue des choses
dans leur ensemble, qui permet de déconstruire le monde sensible, de percevoir, au travers de
la réification illusoire du monde commun, l’évanouissement universel des apparences, c’est-à-
dire des choses mêmes (car les choses et les apparences sont identiques).
Essayons d’expliciter brièvement cette vue pyrrhonienne des choses en considérant :
2.1. l’in-différence, l’in-stabilité et l’in-substantialité universelles ;
2.2. le jeu de la fortune et du temps ;
2.3. l’auto-dévoilement des apparences.
2.1. L’in-différence, l’in-stabilité et l’in-substantialité universelles
Pour les pyrrhoniens (Enésidème, Timon,…), les choses sont in-différentes. Cela est très
différent de dire, comme cela est fait traditionnellement, que Pyrrhon est indifférent à tout. Il
ne s’agit pas ici d’indifférence subjective. Il s’agit plutôt d’in-différence « dans » les choses et
« entre » les choses mêmes :
- « dans » les choses : comme nous l’avons vu, il n’y a pas de différence entre l’être et le
paraître ;
- « entre » les choses : cette in-différence vaut autant pour les qualités sensibles des choses
(Pyrrhon est ici proche de Démocrite qui aimait dire : « convention que la couleur,
convention que le doux, convention que l’amer ») que pour les valeurs. Il y a ce qui paraît
bien aux uns, mal aux autres, juste aux uns, injuste aux autres, mais rien n’est juste ou
injuste, bien ou mal. Les hommes, selon Pyrrhon, ne peuvent établir ou fonder aucune
différence entre les choses, pas même entre les extrêmes. Les valeurs et les anti-valeurs se
confondent. On ne peut dire qu’une conduite « est » belle ou honteuse, juste ou injuste, car
le mot « est » n’a pas ici de signification. Les valeurs ne « sont » pas, elles « valent », et
cela signifie seulement qu’elles paraissent valoir : elles s’épuisent dans leur paraître. Le
principe de contradiction ne s’applique pas aux valeurs, car il concerne ce qui est ou n’est
pas, et les valeurs non seulement n’ont aucun être, mais (en conséquence) ne relèvent pas
d’une pareille alternative. Contrairement à tout ce qu’ont pensé les Platoniciens, la
recherche du fondement n’a, dans le domaine des valeurs et de la conduite humaine,
aucun sens. Il n’est pas possible d’établir en droit une quelconque différence entre le bien
et le mal. Les coutumes et les opinions des Perses valent les coutumes et les opinions des
Grecs.
En outre, pour les pyrrhoniens, rien ne peut être pris « en délit de stabilité », « fluente est
toute substance : et elle change, et elle ne reste jamais au même endroit » (p. 260). Ici, les
pyrrhoniens sont proche d’Héraclite : « tout se meut ». Mais comment ? par translation ou par
altération ?
Comme l’explique Conche (p. 257 à 263), les pyrrhoniens réduisent tout changement
substantiel à l’altération. Les choses se réduisent à leur élément changeant. Sans cesse, elles
se font et se défont, mais sans doute inégalement dans leurs différents aspects : de là, pour un
certain laps de temps, leur identité approximative. Cette réduction du changement substantiel
à l’altération revient en fait à nier qu’il y ait des substances (ousia) au pluriel, puisque toutes
résultent de l’altération d’une substance unique ; quant à celle-ci, la « substance »
primordiale, elle est elle-même moins une substance que le principe de l’universelle in-
substantialité. In-stabilité par altération et in-substantialité universelles vont donc de pair.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
1
/
19
100%