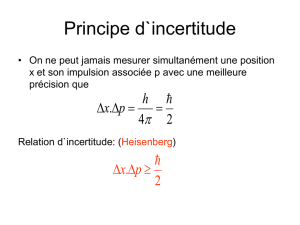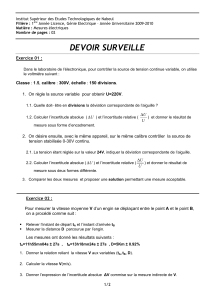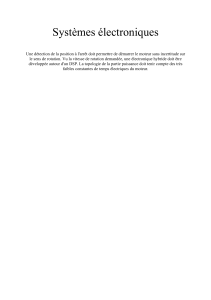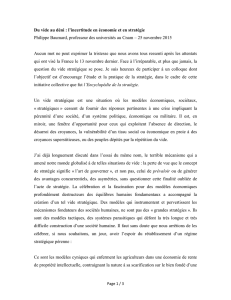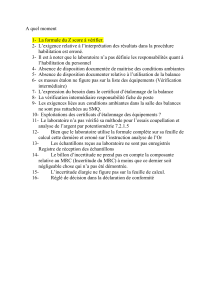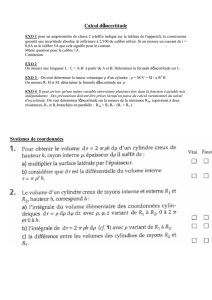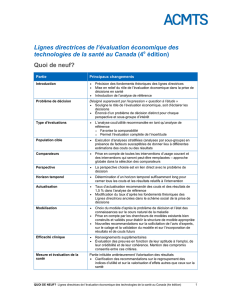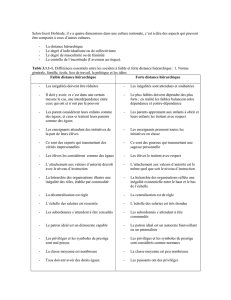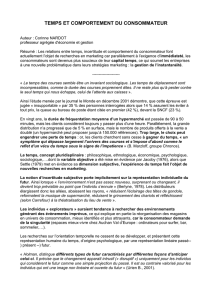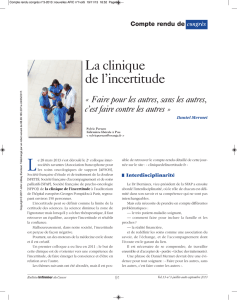Abstract de l´atelier doute en infectiologie

Comment composer avec l’incertitude en médecine générale - À
propos de situations rencontrées en pathologie infectieuse
Max Budowski – Raymond Wakim – Maxime Delrue
Le contexte
Le médecin généraliste assure les soins de premier recours et de proximité, le conduisant à
gérer des troubles de santé à des stades précoces d’évolution. L'éventail des pathologies
qu'il prend en charge est large. Il doit prendre ses décisions dans un délai court, celui de la
consultation, avec des moyens techniques diagnostiques limités. Ces caractéristiques
spécifiques des soins primaires font que nombre de décisions sont prises en situation de
relative incertitude diagnostique, générant un risque pour le patient. La plupart des actes
médicaux réalisés en médecine ambulatoire sont conséquents « d’une série de décisions
fondées sur des données incertaines : interrogatoire et examen clinique souvent imprécis et
incomplets, voire trompeurs, dont les conclusions sont souvent subjectives ; examens
complémentaires d’interprétation difficile, n’apportant souvent pas une certitude absolue ;
pronostic et risques évolutifs difficiles à apprécier, alors qu’ils vont justifier les contraintes du
traitement et du suivi ultérieur ; résultats à attendre du traitement choisi, avantages
escomptés et risques potentiels, appréciés à partir des données statistiques des études faites
sur des populations sélectionnées, différentes du patient actuel ».
1
Il est demandé au
professionnel de santé de porter un diagnostic adapté à la situation clinique. Mais avant de
porter éventuellement un diagnostic, il est préférable qu’il puisse s’assurer que les troubles
de santé présentés par son malade ne sont pas les symptômes d’une maladie grave dont
l’évolution péjorative pourrait être évitée par une intervention médicale urgente adaptée : le
risque évitable.
Les enjeux
L’incertitude est provoquée par des méconnaissances (absence de connaissance ou savoirs
erronés ou bien mal utilisés), et les comportements irrationnels des individus. L’incertitude
qui en résulte est liée :
aux savoirs sur les maladies et notamment leur évolutions ;
aux compétences des médecins portant sur le diagnostic, le pronostic et à la prise en
charge thérapeutique ;
aux patients (contextes et ATCD, environnement et mode de vie, suivi et évolution du
problème de santé) ;
à une relation médecin-patient qui peut être difficile ;
aux médias : la diffusion quasi immédiate d’une innovation médicale peut provoquer
des risques potentiels de dommage pas toujours identifiés ou identifiables.
1
GALLOIS Pierre Gérer l'incertitude de la pratique médicale Revue « Médecine » mars 2010 :124-126

Chaque moment de la décision médicale contient sa part d’incertitude, source de variabilité
dans les jugements sur l’identification de l’action la plus appropriée.
Les objectifs
Le professionnel de santé, lorsqu’il formalise sa décision médicale, doit être capable de :
poser une hypothèse conforme lorsqu’il est en face d’une pathologie plus ou moins
bien définie, avec une situation plus ou moins claire quant à la distinction entre le
normal et le pathologique (gravité, retentissement...) ;
sélectionner une ou plusieurs modalités de prise en charge dans un contexte où
l’information scientifique peut être ambiguë, contradictoire, pléthorique et
difficilement mobilisable ou synthétisable ;
estimer les probabilités de réussite de la prise en charge retenue et en observer les
résultats en tenant compte des préférences du patient.
La méthode
1er temps : réflexions à propos des déterminants de l’incertitude : brain storming.
2ème temps : courte présentation sur l’incertitude, l’irrationalité, la décision, le risque et le
principe de précaution.
3ème temps : travail en petits groupes à propos de 3 cas cliniques.
4ème temps : discussion des propositions, synthèse et conclusion
1
/
2
100%