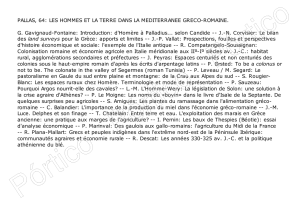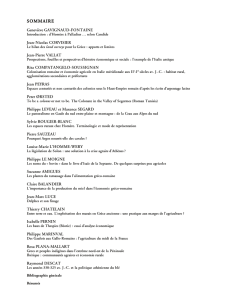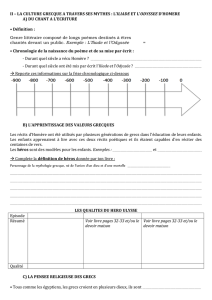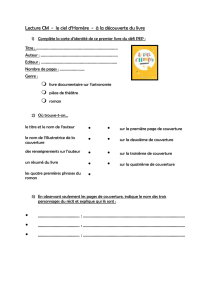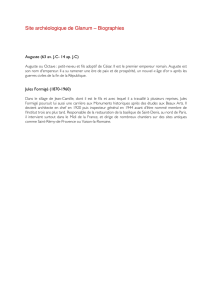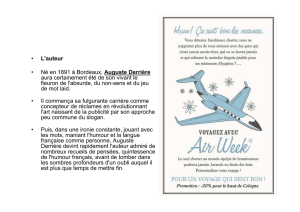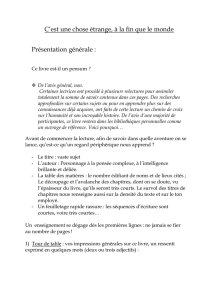de strabon - Hanatheos

http://www.hanatheos.com/
http://www.hanatheos.com/fr/librairie
GÉOGRAPHIE
DE STRABON
TRADUCTION NOUVELLE
PAR AMÉDÉE TARDIEU
SOUS-BIBLIOTHÉCAIRE DE L’INSTITUT
LIVRE Ⅸ
PARIS
LIBRAIRIE HACHETTE ET COMPAGNIE
79, BOULEVARD SAINT-GERMAIN, 79
1873
Le neuvième livre de la Géographie de Strabon est consacré à l’Hellade ou Grèce propre.
L’Auteur y insiste particulièrement sur Athènes, dont il fait en quelque sorte le panégyrique ;
puis, passant à la Béotie et à la Thessalie, il décrit ces deux contrées ainsi que la portion du
littoral qui y correspond.
CHAPITRE Ⅰ.
1. Après avoir parcouru tout le Péloponnèse, qui forme, avons-nous dit, la première et la
moins grande des cinq presqu'îles dont se compose la Grèce, il nous faut décrire les quatre
autres dans l'ordre naturellement où elles se présentent : or, on se souvient que la seconde
de ces presqu'îles n'ajoutait rien de plus au Péloponnèse que la Mégaride, augmentée
toutefois de la Crommyonie, qui, avec ce mode de division, cesse d'appartenir à la Corinthie
¹ ; et que la troisième se composait, d'un côté, de la presqu'île précédente, et, de l'autre, de
l'Attique, de la Béotie, d'une partie de la Phocide, et d'une partie aussi de la Locride
Épicnémidienne. Décrivons donc actuellement ces différentes contrées. « Si l'on conçoit, dit
Eudoxe de Cnide, une ligne partant des monts Cérauniens et se prolongeant directement
vers l'Est jusqu'au cap Sunium en Attique, cette ligne laissera à droite, c'est-à-dire au Midi,
tout le Péloponnèse, et à gauche, c'est-à-dire au Nord, toute cette suite de côtes qui, des
monts Cérauniens, s'étend jusqu'au fond du golfe de Crissa et à la Mégaride, voire jusqu'à
l'extrémité de l'Attique ». Dans la pensée d'Eudoxe de Cnide, du moment qu'on retranche de
la côte comprise entre le cap Sunium et l'Isthme la portion attenante à l'Isthme même qui

incline vers le golfe d'Hermione et l’Acté [Argolique], la courbure de la portion restante n'est
plus assez forte pour produire dans la direction générale de la ligne en question une
déviation sensible. De même, sans le brusque rapprochement de la côte opposée qui rétrécit
le passage entre Rhium et Antirrhium et dessine ainsi la figure d'un golfe, la courbure que
peut offrir la côte comprise entre les monts Cérauniens et le golfe de Corinthe ne serait pas
assez marquée pour déterminer à elle seule cette configuration particulière, et l'on peut en
dire autant de la portion du littoral où vient finir la mer [dite de Crissa] et qui forme
proprement le fond du golfe ².
1. Comme l’a très bien vu La Porte du Theil, ce que dit Strabon de la Crommyonie doit être
reporté ici et ne pas être laissé à la fin de la phrase.
2. Nous avons traduit tout ce premier paragraphe, sauf quelques détails insignifiants, d’après
l’excellente restitution de Auguste Meineke. Cf. cependant l’Index variæ lectionis de Charles
Müller, page 998, colonne 2.
2. D'après ce qui précède (et l'on peut s'en rapporter à Eudoxe de Cnide, excellent
mathématicien, expert à tracer les figures et à déterminer les climats, et qui d'ailleurs
connaissait les lieux dont il s'agit), représentons-nous donc ce côté-ci de l'Attique, c'est-à-
dire le côté qui s'étend du cap Sunium à l'Isthme (la Mégaride comprise), comme formant
une ligne légèrement concave. À peu près au milieu de cette ligne est le Pirée, port ou
arsenal d'Athènes. Le Pirée se trouve en effet à 350 stades environ de Schœnûs, port situé
dans l'Isthme, et à 330 stades du cap Sunium. Du Pirée à Pagæ il y a [par terre] la même
distance à peu près que du Pirée à Schœnûs. Quelques auteurs pourtant comptent 10
stades de plus. — Si, maintenant, l'on double le cap Sunium, et qu'on continue à ranger la
côte, on se dirige au Nord ou plus exactement ¹ au Nord-Ouest.
1. Nous avons cherché à rendre par là le mot δὲ dont Auguste Meineke a jugé ici avec raison
la présence nécessaire, Κάμψαντι δὲ τὸ Σούνιον πρὸς ἄρϰτον μὲν ὁ πλοῦς, ἐϰϰλίνων [δὲ]
πρὸς δύσιν.
3. L'Attique ¹, comme on voit, s'avance en pointe entre deux mers : très étroite en
commençant, elle s'élargit à mesure qu'elle remonte vers l'intérieur des terres ; toutefois, en
approchant de la ville d'Orope sur la frontière de Béotie, elle se replie sur elle-même pour
former ensuite un croissant dont la convexité regarde la mer. C'est là le second côté ou côté
oriental de l'Attique. Quant au troisième côté, ou côté septentrional, lequel s'étend de l'Est à
l'Ouest de l'Oropie à la Mégaride, il coïncide avec la partie montagneuse de l'Attique et est
représenté par la chaîne, qui en changeant plusieurs fois de nom dans son parcours sépare
la Béotie de l'Attique, de sorte que la Béotie, qui elle aussi s'étend d'une mer à l'autre, est
bien ce que nous avons dit ci-dessus, l'isthme de la troisième des grandes presqu'îles de la
Grèce, laquelle comprend, outre le Péloponnèse, la Mégaride et l'Attique. Ajoutons qu'on
s'explique également bien le nom d'Acté ou d'Actiké donné primitivement, dit-on, à l'Attique
actuelle, quand on voit comment, à partir des montagnes, tout le pays descend vers la mer
en se rétrécissant et en s'allongeant de manière à finir en pointe au cap Sunium. — Mais
reprenons sur le littoral du point où nous nous sommes arrêté et décrivons le pays en détail
².
1. Ἀϰτὴ δ᾽ ἐστὶν ἀμφιθάλαττος [ἡ Ἀττιϰή], στενὴ τὸ πρῶτον, etc. au lieu de Ἀϰτὴ δ᾽ ἐστὶν
ἀμφιθάλαττος, στενὴ τὸ πρῶτον, etc., correction de Auguste Meineke.

2. Ταύτας οὖν διέξιμεν ἀναλα[ϐόντες τὰς χώρας ἀπὸ τῆς π]αραλίας, etc. Nous avons traduit
d’après cette restitution de Auguste Meineke que Charles Müller déclare préférable à celle
de Groskurd ἀναλα[ϐ. τὰς πλευρὰς ἐϰ π]αραλίας.
4. Après Crommyôn, l'Acté ¹ présente les Roches Scironides, et, comme celles-ci
interceptent tout passage le long de la mer, il a fallu faire passer par derrière la route qui va
de l'Isthme à Mégare et à Athènes. On a même dû tenir cette route très près des rochers, vu
l'élévation et l'escarpement des montagnes qu'elle longe, de sorte qu'en maint endroit elle
est bordée d'affreux précipices. C'est ici du reste que la Fable a placé le repaire de Sciron et
du Pityocampte (Sinis), ces farouches montagnards dont Thésée purgea naguère le pays.
Du haut des mêmes rochers l'Argeste déchaîne souvent la tempête, aussi les Athéniens
désignent-ils plutôt ce terrible vent d'Ouest sous le nom de Sciron. — Passé les Roches
Scironides, la côte projette une pointe de terre connue sous le nom de Minoa et qui forme le
port de Nisée. Nisée est l'arsenal maritime de Mégare, une distance de dix-huit stades la
sépare de la ville, à laquelle elle est reliée par des skèles ou longs murs. Elle aussi s'appelait
dans le principe Minoa.
1. ὑπέρϰεινται τῆς Ἀϰτῆς au lieu de τῆς Ἀττιϰῆς, excellente correction de Auguste Meineke.
5. Anciennement (j'entends avant la fondation de Mégare) les Ioniens, maîtres de l'Attique,
possédaient en même temps la Mégaride, et c'est ce qui explique pourquoi Homère n'a pas
mentionné spécialement cette dernière contrée. Ayant compris sous le nom d'Athéniens tous
les peuples de l'Attique, le Poète a tout naturellement étendu cette dénomination à ceux de
la Mégaride, contrée qu'il considérait comme une partie de l'Attique. Ainsi, lorsqu'il dit dans
son Catalogue des vaisseaux ¹ :
« Et ceux qui occupaient Athènes, la ville aux belles et fortes murailles »,
il faut entendre qu'il désigne comme ayant pris part à l'expédition aussi bien les peuples de
la Mégaride actuelle [que ceux de l'Attique proprement dite]. En veut-on la preuve
démonstrative ? Les Anciens désignaient l'Attique sous le nom d'Ias ou d'Ionie et quand le
Poète dit ² :
« Là étaient les Béotiens et les Ioniens »,
il entend par Ioniens les habitants de l'Attique ; mais la Mégaride faisait alors notoirement
partie de l'Ionie.
1. Homère, Iliade, Ⅱ, 546.
2. Homère, Iliade, ⅩⅢ, 685.
6. On sait en effet qu'à la suite de longues contestations sur leurs limites respectives, et
notamment sur la possession de la Crommyonie, les Péloponnésiens et les Ioniens
convinrent d'ériger dans l'Isthme même, en un lieu déterminé, une stèle portant sur la face
qui regardait le Péloponnèse cette inscription :
« Ceci est le Péloponnèse et non l'Ionie »,
et sur celle qui regardait Mégare cette autre inscription :

« Ceci n'est pas le Péloponnèse, mais bien l'Ionie ».
J'ajoute que les Atthidographes, parmi toutes leurs divergences d'opinion, s'entendent
généralement sur un point (je ne parle bien entendu que des principaux), c'est que Pandion
ayant eu quatre fils, Ægée, Lycus, Pallas et Nisus, et ayant voulu partager l'Attique en quatre
lots, la Mégaride échut à Nisus, le quatrième fils, qui y fonda Nisée. Suivant Philochore, le
royaume de Nisus s'étendait depuis l'Isthme jusqu'à Pythium, mais Andron d’Halicarnasse en
recule les limites jusqu'à Éleusis et au champ Thriasien. Sur la distribution même des lots
entre les quatre frères, fait très diversement exposé par les auteurs, qu'il nous suffise de citer
le témoignage de Sophocle. Voici les propres paroles qu'il met dans la bouche d'Ægée ¹ :
« Mon père a décidé dans sa sagesse que j'irais prendre possession de l'ACTÉ [ou
rivage occidental de la contrée], tel est le lot qu'il m'a assigné à titre d'aîné ; [au
second de ses fils], à Lycus, il a destiné [la côte opposée], le riant jardin qui regarde
l'Eubée ; il a fait ensuite en faveur de Nisus, un domaine à part de tout le canton qui
avoisine les roches de Sciron ; quant aux terres qui se prolongent vers le Midi, elles
ont été attribuées par lui au plus rude de ses enfants, père lui-même d'une race de
géants, elles forment le lot de Pallas ».
Or, ces différentes preuves n'établissent-elles pas que la Mégaride faisait anciennement
partie de l'Attique ?1
1. Voyez dans les Vind. Strab., pages 129-130, la restitution tentée par Auguste Meineke de
ce fragment de Sophocle.
7. Mais après le retour des Héraclides et le partage du Péloponnèse qui intervint alors,
beaucoup des anciens habitants, s'étant vu chasser par les conquérants et par les Doriens
qui les accompagnaient, durent passer en Attique. Mélanthus, roi de Messène, était du
nombre, et, comme il avait été vainqueur en combat singulier de Xanthus, chef des Béotiens,
les Athéniens spontanément l'élurent pour leur roi. La population de l'Attique cependant
s'était considérablement accrue par l'arrivée de tous ces émigrants, les Héraclides alors
prirent peur, et, comme ils étaient d'ailleurs excités par les Péloponnésiens, par les
Corinthiens surtout et les Messéniens, jaloux de l'Attique, les premiers pour raison de
voisinage, les seconds parce que l'Attique avait alors pour roi Codrus, propre fils de
Mélanthus, ils envahirent l'Attique à main armée. Vaincus en bataille rangée, ils durent
évacuer le reste du pays, mais ils retinrent la Mégaride, y fondèrent la ville de Mégare, et,
ayant transformé les habitants, tous Ioniens jusque-là, en une population dorienne, ils firent
disparaître la stèle qui séparait naguère les possessions des Ioniens de celles des
Péloponnésiens.
8. Malgré les nombreuses révolutions dont elle a eu à souffrir, la ville de Mégare est encore
debout. On sait qu'elle possédait naguère jusqu'à une école philosophique, dite école de
Mégare parce qu'elle remontait à Euclide, disciple de Socrate et mégarien de naissance, tout
comme l'école d'Élée, qu'a illustrée, entre autres philosophes, Pyrrhon, remontait à Phédon
l'éléate, autre disciple de Socrate, et l'école d'Érétrie à l'érétrien Ménédème. Le territoire de
Mégare est, comme celui de l'Attique, d'une extrême stérilité ; il est, en effet, dans la plus
grande partie de son étendue, couvert par les monts Onées, longue arête qui part des
Roches Scironides et ne se termine qu'à la Béotie et au Cithéron, formant ainsi la séparation
entre la mer sur laquelle s'ouvre la port de Nisée et la mer [qui baigne Pagæ] ¹ autrement dit
la mer Alcyonide.

1. Lacune supplée par Kramer.
9. Dans le trajet de Nisée à la frontière de l'Attique, on rencontre cinq îlots qui précèdent
Salamine. Cette dernière île, longue de 70 stades environ, d'autres disent de 80, contient
une ville de même nom. La vieille ville, aujourd'hui déserte, était tournée vers Ægine et
regardait par conséquent le Midi : on connaît le vers d'Æschyle,
« Ægine regarde le point de l'horizon d'où souffle le Notus » ¹.
Mais la ville actuelle est située au fond d'un golfe sur une espèce de presqu'île qui de loin
paraît appartenir à l'Attique. Salamine, dans l'antiquité, a porté différents noms, notamment
ceux de Sciras et de Cychrea, empruntés aux mêmes Héros ² que rappellent, d'une part,
l'épithète de Scirade attribuée à Minerve, le nom de Scira donné à une petite localité
d'Attique, la cérémonie religieuse dite de Sciros et le mois de Scirophorion, et, d'autre part, le
serpent Cychridès, dont parle Hésiode, et qui, nourri d'abord par le héros Cychrée, fut
chassé par Euryloque ³, à cause des ravages qu'il exerçait dans l'île, et passa à Éleusis, où il
fut recueilli par Cérès et devint le serviteur familier de la déesse. Salamine s'est encore
appelée Pityussa, mais d'un des produits de son sol. Quant à son illustration, elle la doit et à
ses anciens rois les Æacides, à Ajax surtout, fils de Télamon, et à ce combat naval livré
dans ses eaux où elle fut témoin de la victoire des Grecs sur Xerxès et de la fuite honteuse
de ce prince. Disons pourtant qu'Ægine, tant à cause de sa proximité que de l'empressement
avec lequel elle mit toute sa flotte au service des alliés, partage avec Salamine la gloire de
ce mémorable événement. — Salamine a pour principal cours d'eau le Bocarus ⁴.
1. Nous inclinerions assez à voir, avec Auguste Meineke, une glose marginale dans cette
citation d’Æschyle. Voyez les Vind. Strab., page 130.
2. Voyez Madvig, Advers. Crit., volume Ⅰ, page 554.
3. Euryloque au lieu d’Euryclès, correction de Tzschucke.
4. Comme Charles Müller, nous n’hésitons pas à approuver la suppression proposée par
Auguste Meineke dans ses Vind. Strab., page 130, du dernier membre de phrase de ce
paragraphe, ὁ νῦν Βωϰαλία ϰαλούμενος, qui appartient évidemment à la nomenclature du
moyen âge, mais la raison, qu’il donne pour retrancher aussi celui qui précède Βώϰαρος δ᾽
ἐστὶν ἐν Σαλαμῖνι ποταμός, à savoir que « hæc inepte hoc loco ponuntur et incommode
cetera interpellant », ne nous paraît nullement concluante. Strabon vient de parler des
dimensions de l’île, de la situation respective de la vieille et de la nouvelle ville, des différents
noms que l’île a portés et des principaux souvenirs que sa vue éveille, il y ajoute, pour clore
la description proprement géographique de l’île, cette courte mention de son principal cours
d’eau. Ce détail, on le voit, n’est nullement déplacé et il n’interrompt rien, car ce qui suit n’a
plus le caractère descriptif, mais appartient à une discussion tout historique et toute
grammaticale.
10. Cette île qui actuellement dépend d'Athènes avait été anciennement un sujet de vives
contestations entre Athènes et Mégare. C'est même à l'occasion de cette querelle que
Pisistrate, d'autres disent Solon, aurait dans le Catalogue des vaisseaux, immédiatement
après le vers :
« Ajax avait amené de Salamine douze vaisseaux » ¹,
inséré frauduleusement celui-ci :
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
1
/
61
100%