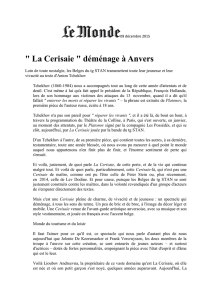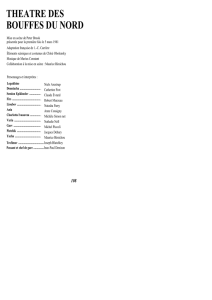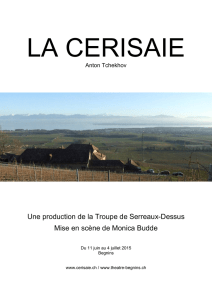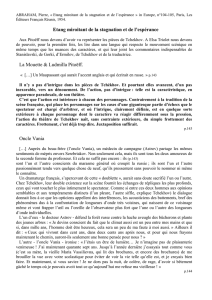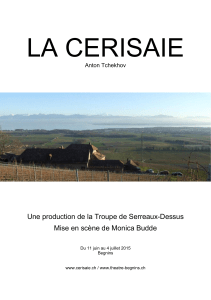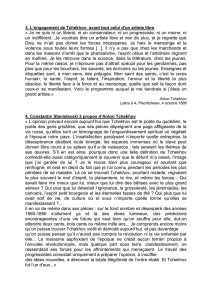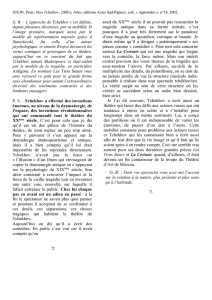Ce désordre même est le garant de ma sincérité - Fi
publicité
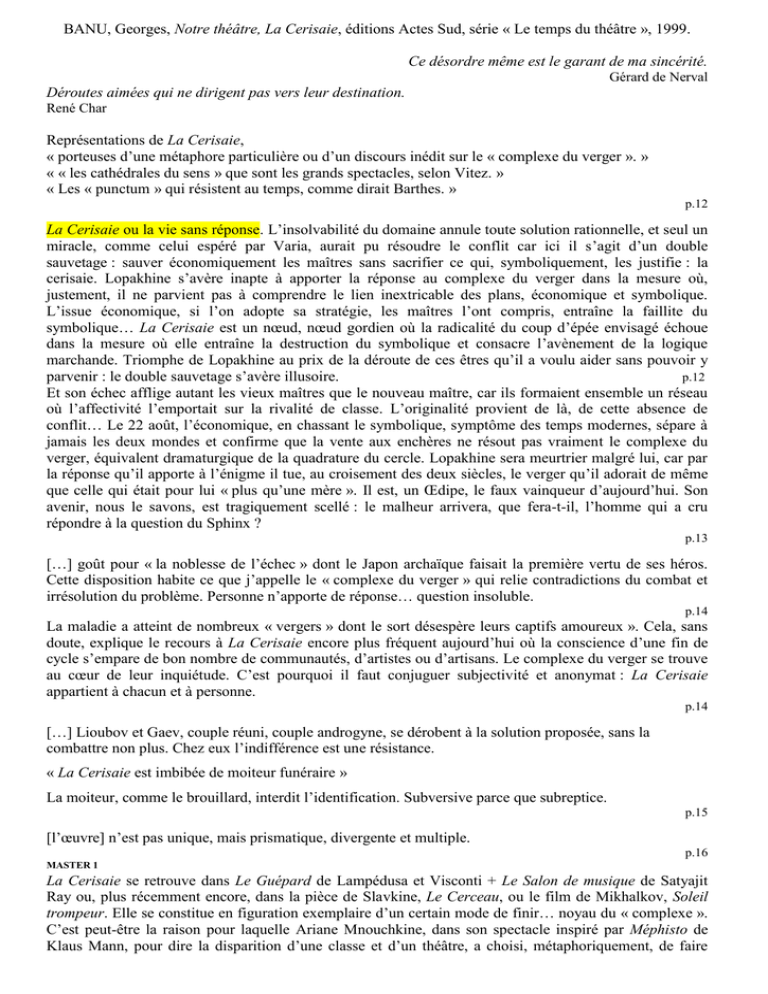
BANU, Georges, Notre théâtre, La Cerisaie, éditions Actes Sud, série « Le temps du théâtre », 1999. Ce désordre même est le garant de ma sincérité. Gérard de Nerval Déroutes aimées qui ne dirigent pas vers leur destination. René Char Représentations de La Cerisaie, « porteuses d’une métaphore particulière ou d’un discours inédit sur le « complexe du verger ». » « « les cathédrales du sens » que sont les grands spectacles, selon Vitez. » « Les « punctum » qui résistent au temps, comme dirait Barthes. » p.12 La Cerisaie ou la vie sans réponse. L’insolvabilité du domaine annule toute solution rationnelle, et seul un miracle, comme celui espéré par Varia, aurait pu résoudre le conflit car ici il s’agit d’un double sauvetage : sauver économiquement les maîtres sans sacrifier ce qui, symboliquement, les justifie : la cerisaie. Lopakhine s’avère inapte à apporter la réponse au complexe du verger dans la mesure où, justement, il ne parvient pas à comprendre le lien inextricable des plans, économique et symbolique. L’issue économique, si l’on adopte sa stratégie, les maîtres l’ont compris, entraîne la faillite du symbolique… La Cerisaie est un nœud, nœud gordien où la radicalité du coup d’épée envisagé échoue dans la mesure où elle entraîne la destruction du symbolique et consacre l’avènement de la logique marchande. Triomphe de Lopakhine au prix de la déroute de ces êtres qu’il a voulu aider sans pouvoir y parvenir : le double sauvetage s’avère illusoire. p.12 Et son échec afflige autant les vieux maîtres que le nouveau maître, car ils formaient ensemble un réseau où l’affectivité l’emportait sur la rivalité de classe. L’originalité provient de là, de cette absence de conflit… Le 22 août, l’économique, en chassant le symbolique, symptôme des temps modernes, sépare à jamais les deux mondes et confirme que la vente aux enchères ne résout pas vraiment le complexe du verger, équivalent dramaturgique de la quadrature du cercle. Lopakhine sera meurtrier malgré lui, car par la réponse qu’il apporte à l’énigme il tue, au croisement des deux siècles, le verger qu’il adorait de même que celle qui était pour lui « plus qu’une mère ». Il est, un Œdipe, le faux vainqueur d’aujourd’hui. Son avenir, nous le savons, est tragiquement scellé : le malheur arrivera, que fera-t-il, l’homme qui a cru répondre à la question du Sphinx ? p.13 […] goût pour « la noblesse de l’échec » dont le Japon archaïque faisait la première vertu de ses héros. Cette disposition habite ce que j’appelle le « complexe du verger » qui relie contradictions du combat et irrésolution du problème. Personne n’apporte de réponse… question insoluble. p.14 La maladie a atteint de nombreux « vergers » dont le sort désespère leurs captifs amoureux ». Cela, sans doute, explique le recours à La Cerisaie encore plus fréquent aujourd’hui où la conscience d’une fin de cycle s’empare de bon nombre de communautés, d’artistes ou d’artisans. Le complexe du verger se trouve au cœur de leur inquiétude. C’est pourquoi il faut conjuguer subjectivité et anonymat : La Cerisaie appartient à chacun et à personne. p.14 […] Lioubov et Gaev, couple réuni, couple androgyne, se dérobent à la solution proposée, sans la combattre non plus. Chez eux l’indifférence est une résistance. « La Cerisaie est imbibée de moiteur funéraire » La moiteur, comme le brouillard, interdit l’identification. Subversive parce que subreptice. p.15 [l’œuvre] n’est pas unique, mais prismatique, divergente et multiple. p.16 MASTER 1 La Cerisaie se retrouve dans Le Guépard de Lampédusa et Visconti + Le Salon de musique de Satyajit Ray ou, plus récemment encore, dans la pièce de Slavkine, Le Cerceau, ou le film de Mikhalkov, Soleil trompeur. Elle se constitue en figuration exemplaire d’un certain mode de finir… noyau du « complexe ». C’est peut-être la raison pour laquelle Ariane Mnouchkine, dans son spectacle inspiré par Méphisto de Klaus Mann, pour dire la disparition d’une classe et d’un théâtre, a choisi, métaphoriquement, de faire jouer aux vaincus du roman, comme un double de leur destin privé, le dernier acte de La Cerisaie. Texte qui éclaire un événement autant qu’il élucide une situation. Comme tout « complexe ». p.16 La Cerisaie éclaire nos « tourments ». Elle agit comme « les grandes oeuvres… ces êtres secrets dont la vie ne finit pas et côtoie la nôtre qui passe. » (Rainer Maria Rilke). p.16 Le complexe du verger nous place toujours au centre d’une contradiction en manque d’issue. p.17 Lire La Cerisaie dans la perspective du siècle. De là vient le tragique. Au fond, le scénario initial consigne le déclin historique d’une classe qui entraîne son remplacement irrémédiable. p.17 Le « soleil » de Pétia n’a pas tenu ses promesses, et c’est justement ce que raconte Soleil trompeur, le film de Mikhalkov. p.18 « Rien ne peut être théâtral qui n’est pas en même temps symbolique, qui ne représente pas une activité renvoyant à une autre plus importante qu’elle-même. » Ce propos de Goethe convient à La Cerisaie car il réclame l’équilibre, ici atteint, entre ouverture parabolique et enracinement réaliste. Œuvre révélatrice, elle fait ressortir, comme en chimie, bon nombre des mutations qui traversent le siècle. p.18 Pétia / mise en scène Andreï Serban : « […] il incarne dérisoirement un militant léniniste hystérique prisonnier de la langue de bois, tandis que dans celle de Peter Zadek il parle comme s’il avait déjà intégré l’échec futur de ses projections illuminées. Ce Pétia-là a conscience de la défaite à venir… » p.18 Pétia / mise en scène Andreï Serban, « Pétia se rattache à la déclamation politique des animateurs de meetings » « pour Zadek il est un vaincu avant même de livrer bataille. » « A travers l’étudiant, les spectacles mettent en scène l’illusion du siècle, son émergence […] » p.18 Le siècle […] de l’efficacité. Celle-ci a comme pendant la rapidité. […] La rapidité introduit le règne du circuit court où le désir doit se satisfaire dans un laps de temps bref, sans obstacle ni ralentissement. Lopakhine entend exploiter cette mutation dont il est le premier à relever les conséquences : le domaine rapproché par la voie ferrée est désormais susceptible de se rattacher au circuit court. Le train retire à la cerisaie sa position insulaire et le capitaliste comprend que désormais un nouveau loisir pointe, les vacances brèves. La cerisaie en est la première victime. On peut s’y rendre… donc on peut vendre, voilà le syllogisme de Lopakhine. p.19 La cerisaie ou l’équivalence tragique. […] De même que les maîtres et Lopakhine : le complexe de la cerisaie se nourrit de cet indécidable tragique. De cet équilibre entre l’utile économique et l’utile symbolique que chacune des parties en présence conteste au nom de son appartenance à un autre système de valeurs. p.19 La Cerisaie ne parle pas seulement du passage inéluctable d’un monde à l’autre, mais aussi d’une inadaptabilité érigée en résistance passive, d’un refus presque tacite, irrépressible, de brocarder les valeurs qui fondent l’identité des perdants… Même si leur pertinence sur le plan économique décline, elle reste entière sur le plan symbolique. Toujours est-il que de cet abandon les maîtres ne s’accommodent pas. p.19 […] comme Gaev et Lioubov. Ils ne sont pas insouciants, bien au contraire, ils ne se rendent pas malgré la défaite annoncée. Et cela avec discrétion, sans discours explicite ni résistance clamée… ils se laissent flotter en attente d’une solution introuvable faute d’admettre celle qu’on leur propose. p.20 choix scénographique / mise en scène par Radu Penciulescu, « où ce monde semblait voguer sur un radeau sans attaches ni sens de l’orientation. Radeau déboussolé qui emporte les prisonniers du verger. p.20 Stanislavski : « Tchekhov a mis longtemps pour passer du Verger des cerisiers à La Cerisaie. » Précision importante qui confirme le désir de dépasser l’histoire d’une propriété pour dessiner la parabole de sa destinée. Le complexe du verger naît de la jonction de ces deux termes réunis. Aujourd’hui nous échappons à la problématique de la faute et de la réponse juste. Il n’y a ni l’une ni l’autre… lorsque la roue tourne elle devient destin. Défaites et victoires sont également inscrites. p.20 Malgré cette gesticulation vouée à l’échec, la vente aura lieu et l’anglais s’imposera… Les exemples profanes de cette roue de l’histoire érigée en destin peuvent se multiplier. Destin qui ne sacrifie pas les innocents, mais qui chasse douloureusement l’ancien et tout ce qu’il comporte comme patine de l’être et propension à l’inutile. p.21 […] Richard II et La Cerisaie, pièces sur la dépense et la consommation, sur l’appétit inassouvi de désirs, sur l’incapacité à se dérober à leur commande. Pièce sur l’écoute de soi-même réfractaire à toute précaution […] [La tragédie] les emporte vers la suprême douleur des monarques : la déposition. Le danger est indissociable du principe de plaisir. p.21 Louis II de Bavière (…) a été déposé, telle une autre Lioubov, pour « satisfaction abusive du principe de plaisir assimilé toujours, en termes de pensée économique, à la production de l’inutile avec tout ce qu’il suppose comme déni du principe de réel. » p.21 « Logique à long terme inconnue des marchands cloués au présent, soumis à la logique de l’immédiat : la cerisaie non abattue aurait pu devenir dans « cent ans », comme dit Pétia, un parc réputé, source de profit. A l’heure des désastres écologiques, la cerisaie avait toutes les chances de retrouver son statut initial de lieu d’attraction de la région. Pour cela il fallait préserver le goût pour l’inutile que tout le XXe siècle s’est employé à sacrifier. p.21-22 « La haine de la dépense est la raison d’être et la justification de la bourgeoisie » - cette phrase de Bataille traverse tout le texte. p.22 Lorsque le verger sera détruit, la région disparaîtra dans la neutralité des plaines sans nom. On ne pourra plus se réclamer d’un territoire identifiable grâce à la cerisaie. C’est elle « la seule chose remarquable » qui le rendait repérable… p.22 La Cerisaie ou le passage de la bibliothèque au site Internet : mutation similaire. Tout spectacle avec La Cerisaie qui s’interdit le moindre grain de nostalgie pactise avec les maîtres récents en se joignant précipitamment au camp des vainqueurs, et disqualifie ainsi leurs précurseurs au nom d’un discours que l’histoire, à son tour, se chargera de démentir. La nostalgie n’est qu’un dernier soubresaut, une manière de ne pas trahir. p.23 Ce n’est pas tant la passation de la propriété qui blesse que l’accélération du processus enclenché. […] Encore plus que la chute, c’est la précipitation qui est insupportable - les nouveaux maîtres font de la vitesse leur vertu cardinale. […] Lopakhine regarde sans cesse la montre et n’oublie jamais le calendrier. Il agresse justement en raison de cette relation au temps, par le refus de la lenteur, de son repos et de son inconscience. p.24 La vitesse interdit à la défaite d’être intégrée et au vainqueur de s’assumer comme tel. […] Lioubov se résigne à la vente, mais refuse d’assister au sacrifice du verger - c’est pourquoi, comme une reine déposée, avec ce qui lui reste d’autorité, elle exige qu’on retarde la décapitation des arbres. p.25 « A travers les larmes » on voit le monde flou, incertain… regard de myope sans lunettes. Il ne s’agit pas de larmes, mais de l’état qui conduit au regard embué sur le réel. p.25 A travers les larmes, équivalent de l’entre-deux au plus profond de soi-même. p.26 La stabilité traverse comme un leitmotiv cette œuvre ayant au cœur le changement. C’est la phtase qui résonne comme s’il s’agissait de la pensée fondatrice de cette communauté, phrase reprise par des personnages aux positions entièrement opposées. Lopakhine conseille à Douniacha : « Reste à ta place. » Lioubov prodigue le même conseil à Gaev : « Reste donc à ta place. » Firs, lui aussi, affirme que l’on doit « rester à sa place ». L’idée d’un équilibre hérité, d’un ordre institué, garant de la bonne marche et de la bonne conduite, semble être consensuelle et pourtant, malgré l’avis unanime, celui-ci s’écroulera. Comme si les convictions des êtres ne pouvaient en rien affecter le cours de l’histoire qui, lui, les ignore et balaie la stabilité tant propagée. Si les professions de foi se confondent, les agissements diffèrent. Là où tout le monde s’accorde pour que « chacun reste à sa place », personne ne le restera. p.26 La Cerisaie renvoie aux termes récurrents de l’histoire allemande récente : la chute et le tournant. Transition convulsive. p.26 Firs, lorsqu’il va évoquer l’ancienne pratique de préparation des griottes - et non pas des cerises, comme le veut, par erreur, la traduction française - rejoint le ton de l’historien grec [Hérodote]. Les cerisiers n’apportent plus aucun bénéfice économique, car même la vieille recette pour en faire des alcools, dit Firs, a été perdue… ainsi ils ne sont plus que source de beauté passagère et de projection mentale. Tchekhov les rend entièrement « inutiles » sur le plan financier, sans que leur portée symbolique soit pour autant affectée. Disons même qu’elle en sort agrandie, car libérée de toute légitimité autre. La cerisaie se constitue en figure de cet inutile que le capitalisme se chargera d’exclure tout comme le communisme, deux versions d’une même pensée « économique ». p.27 Faut-il représenter la cerisaie ? C’est l’interrogation, décisive. Faut-il ou non représenter les fantômes ? p.27 […] les solutions avancées […] portent la marque des combats esthétiques, des refus d’une époque ou de ses affirmations. p.28 Stanislavski laisse apparaître des bouts de cerisiers dans le cadre des fenêtres […] il intègre, discrètement, sur les murs de la maison, des fleurs et des troncs frêles : la cerisaie est expérience subjective, et la bâtisse tout entière, cloisons et êtres vivants réunis, participe au complexe du verger.p.28 […] Pintilié conjuguait secrètement le blanc avec le bordeaux afin de produire de manière, disons, « subliminale » l’effet chromatique d’une cerisaie présente/absente. Le plus souvent la moindre trace matérielle fut écartée… revanche du symbolisme ! Métaphoriquement, Strehler et Damiani l’ont converti en voile couvert de feuilles mortes qui surplombait salle et scène confondues. L’immense tissu palpitait ou s’apaisait telle une chambre d’écho qui enregistrait et communiquait, à la salle aussi, l’état de ces personnages fébriles. Thermomètre de l’âme. Si belle et juste que fût la réponse avancée, car Lioubov aussi bien qu’Ania reconnaissent que les âmes des ancêtres, nobles ou serfs, se sont réfugiées dans le tronc des arbres, [p.28] il lui manquait tout de même le poids du concret. Sans épaisseur, la cerisaie-voile se rattachait trop à une esthétique fin de siècle où, comme chez Maeterlinck, auteur qui compte pour Tchekhov, on cultivait la transparence et la légèreté, expression d’un refus obstiné de la représentation du verger. Par cette insistance sur sa dimension symbolique, le spectacle sacrifiait l’enracinement indispensable à toute parabole. Strehler trahissait son observation décisive concernant le devoir imparti à tout metteur en scène de respecter les "trois boîtes chinoises" dont la coexistence fonde l’écriture tchékhovienne : le quotidien, l’historique et le cosmique. Sa représentation de la cerisaie péchait par abus d’évanescence. De même chez Lassalle, à Oslo, lorsqu’il projette en surimpression sur le mur de la chambre des enfants des images oniriques d’un verger sublime: aujourd’hui ce visible-là, emprunté à un autre art et non pas engendré par la scène elle-même, pèche par manque d’épaisseur. Le concret théâtral apporte de la profondeur, la projection reste bidimensionnelle. Cette performance technologique autrefois surprenante a perdu sa magie de jadis et ne fournit plus la caution de la matière indispensable aux fantômes autant qu’aux vergers que l’on abat à coups de hache. Alain Françon, lui, reviendra à la solution initiale, stanislavskienne, pour incruster discrètement les cerisiers en fleur sur les murs décrépits de la demeure en voie de disparition ... la solidarité psychique entre la cerisaie et les personnages est explicite. Le verger, c’est le secret que l’on porte avec soi sans qu’il devienne visible aux autres ... Une cerisaie incrustée sur le cyclo ... elle invite à réfléchir non pas sur le verger comme présence, mais comme empreinte. Empreinte mentale ineffaçable telle la fixation définitive du souvenir des morts. L’empreinte annonce l’effet de fantôme dont la cerisaie sera la source pour les maîtres dépossédés. Mais nous, spectateurs, nous p.29 sommes exclus : la dimension mythologique s’absente. Serban, lui, planta quelques cerisiers disparates et rabougris, inaptes à susciter le moindre effet fantasmatique ... ils avaient tout de même le mérite d’effacer les frontières entre le dehors et le dedans pour dresser un espace homogène. La maison et le verger communiquaient. .. et cette fusion attestait la portée intérieure de la cerisaie simplement désignée, car dépourvue d’une charge visuelle forte. Elle ne se constituait nullement en source de projection imaginaire, de même que dans le spectacle d’Efros chez qui les mêmes cerisiers gringalets surgissaient parmi les pierres tombales. Mieux vaut ne pas les montrer ... Le concret du verger à ce point diminué légitime la position de ses adversaires qui, comme Brook, invitent à l’exclure pour le laisser s’épanouir librement, sans confrontation avec les limites du représentable. Zadek, sans hésitation, adopte cette position et s’il montre, médiocrement, des cerisiers, c’est pour prouver ainsi l’incapacité dans laquelle il tient la scène de produire l’équivalent de ce lieu investi par les fantômes, verger imaginaire, verger mensonger. Car, laisse-il entendre, il ne faut pas oublier que les maîtres, en raison de ce mirage, se racontent un bonheur inexistant, un passé factice. Et pourtant ... ces metteurs en scène que personne ne peut soupçonner de lyrisme, Karge et Langhoff, vont laisser s’épanouir la joie de Lioubov et Gaev lorsque, réunis après cinq ans, il les fait danser à l’aube comme un couple adultère et ingénu parmi les arbres que l’on aperçoit d’une cerisaie que l’on devine. Elle existe alors comme métonymie agissante ... et la danse presque grotesque de ces deux enfants vieillis ouvre les vannes d’un imaginaire dérisoire A Tôkyô, Clifford Williams, metteur en scène anglais, avait fait le pari de la représentation métonymique: un seul arbre, géant et sublime, p.30 comme unique pilier du monde. Réduction suprême de la cerisaie à cet axis mundi dont parlait Mircea Eliade ... Elle est le pivot qui organise un univers et dont la chute entraînera sa désintégration. L’arbre mythique, tout au long des quatre actes, tournait autour de son axe pour indiquer par le changement des feuillages, de l’épanouissement à la chute, le passage des saisons; il parvenait, lui, aux fiançailles du concret et de l’imaginaire. Métonymie accomplie. Et pourtant le sentiment d’une absence me poursuivait. .. car moi-même, j’avais vécu, au Japon, à côté d’un être cher, l’éblouissement des cerisiers en fleur. Abrités sous une voûte rose, nous avons pensé ensemble à cette beauté saisonnière que Lioubov et Gaev, depuis leur enfance, partagent. Fête de l’instant, comme dirait un homme de théâtre ! Rien ne passe plus vite qu’un spectacle ou la floraison des cerisiers. Les Japonais sont fiers de ce culte voué à l’éphémère! Ils y voient un signe de noblesse ... C’est là, au cœur du vieux Japon, que j’ai éprouvé le manque de toutes ces cerisaies : il faut voir les milliers de cerisiers fleuris pour éprouver, en tant que spectateur, la séduction qu’ils exercent de l’autre côté, du côté des personnages. La lumière change à travers le feuillage épais, et les arbres gros de leur beauté passagère enivrent les habitants du verger tchékhovien censé avoir huit fois la dimension de Hyde Park. L’étendue s’ajoute à la beauté ... "Béatitude", comme dirait Varia. Expérience des limites, narcotique dont chacun finit par éprouver la dépendance. La cerisaie étreint le frère et la sœur, "damnés" par leur destin qui assimile la beauté perdue au synonyme d’un deuil définitif. Peter Stein, le seul, comme Chéreau dans son Hamlet qui fait apparaître agressivement le fantôme du père sur la selle d’un cheval agité, montre la cerisaie ... Varia tire le rideau qui la dissimule pour la découvrir clans toute son envoûtante splendeur ... sensuelle et "grandiose". Alors le théâtre plonge dans la littéralité extrême et, p.31 parce qu’il accepte le concret poussé jusqu’aux ultimes limites, il parvient mieux que jamais à produire de l’imaginaire. Ici le naturalisme ne prend pas le dessus et la cerisaie qui se montre avec un pareil éclat devient l’ultime, suprême expérience fantomale. En la voyant, comment reprocher aux maîtres, prisonniers de ses pouvoirs, de ne pas être à même d’envisager sa suppression ? Comment détruire la beauté du monde? Comment ne pas l’écouter de même qu’Hamlet écoute le fantôme qui se montre ? Lorsqu’on se confronte à sa réalité, théâtralement accomplie, on éprouve l’ampleur du désastre programmé. La matière parle, et elle nous invite à partager le refus de Lioubov et de Gaev qui ne se résignent pas à la sacrifier. Sont-ils simplement des irresponsables ? Eux qui ne veulent pas gagner une guerre, comme Agamemnon, ne parviennent pas à signer l’arrêt de mort de leur Iphigénie. Et ils ne parviennent pas à admettre qu’on l’abatte, même si l’indice en bourse Nikkei en dépendait. Une forme d’inconscience, ou de résistance ? Représenter ou pas? Nullement ou absolument, c’est la réponse. Toute solution moyenne déçoit, elle transige avec ce défi suprême, le défi de l’invisible accompli par le visible. L’imaginaire extrême ou le physique suprême : les hypothèses radicales pour répondre aux exigences de l’excès auquel Tchekhov soumet la scène de son temps. Deux Cerisaie historiques. Celle de Strehler et celle de Brook. De quoi se souvient-on ? De l’image de l’une - blanc sur blanc, absorption réciproque des êtres et du monde - et du mouvement de l’autre accélération affolée vers la fin libératrice. C’est le propre des grands spectacles de parvenir à se cristalliser en un mot. p.32 Dans les deux mises en scène, la séparation salle-scène se voit nettement atténuée, sinon supprimée. Nous appartenons au même monde et il nous est interdit de nous constituer en juges. Nous ne sommes pas de l’autre côté ... et l’espace des personnages n’est pas celui de la faute. Chez Strehler, un voile nous recouvre, personnages et spectateurs réunis, chez Brook un espace nous relie, l’espace du théâtre assimilé à la vieille maison. Chacun parle d’une parenté et non pas d’une division, d’une ligne de partage et non pas d’un espace de surveillance. Le sceau visuel de chaque mise en scène : le blanc chez Strehler, la polychromie des tapis chez Brook. Francis Fergusson assimile les personnages de La Cerisaie à des "négligents" qui attendent dans l’espace transitoire qu’est l’Antépurgatoire. Sur cette intuition, Strehler a fondé sa mise en scène. Parfois, une seule phrase suffit: elle vaut plus qu’un dossier dramaturgique. L’Antépurgatoire, ou "les limbes" dont Pontalis vient de découvrir l’attrait secret, est ce lieu incertain qui se place entre les deux extrémités, l’Enfer et le Purgatoire. Là se trouvent réunis les enfants non baptisés et, surtout, les "négligents", ceux qui ont vécu sans but ni direction, sans vice ni vertu, errant jusqu’à l’ultime moment de l’invocation et du pardon. Ranevskaïa n’est-elle pas une "négligente" qui achève La Cerisaie sur une prière ? "Que de péchés nous avons commis ! Seigneur sois miséricordieux !" Le spectacle de Strehler esquisse le paysage dantesque où règnent l’attente indéfinie et les jeux enfantins des "négligents" incurables. A cet Antépurgatoire fantomatique, p.33 Brook oppose la panique de la peste menaçante. A un adagio qui se meurt lentement répondent les soubresauts d’un prestissimo exaspéré. Que choisir? L’engloutissement lent, progressif ou le spasme violent de la dernière fête ? Brook, lui, s’inspire d’une phrase de Granville Barker : "Dans Hamlet, ce n’est pas le temps qui est important, mais le tempo ... " C’est sur quoi il fonde son approche de La Cerisaie. "Je voudrais substituer une poésie du théâtre à la poésie dans le théâtre. La poésie dans le théâtre est un morceau de dentelle qu’il est impossible de voir à distance, la poésie du théâtre va être une dentelle de cordes, un bateau sur la mer." (Cocteau à propos des Mariés de la tour Eiffèl.) Dans cette opposition, l’on retrouve l’antinomie entre les mises en scène intimistes de Tchekhov et les autres, libres, ouvertes, mises en scène qui respirent. .. Elles se nourrissent de "la poésie du théâtre". La mort sous-tend ce monde, elle lui sert d’assise. "La moiteur funéraire." Elle n’atteint pas seulement les êtres, mais elle s’immisce aussi dans les choses et contamine le sol. Dans La Cerisaie de Krejca, un immense voile blanc surplombe la maison tout entière dont, malgré l’absence de cloisons, les nombreux petits meubles dessinent distinctement la topographie complète, cuisine et chambre d’Ania, salle de billard et salon ... Lors du passage au second acte, ce voile tombe sous nos yeux, flottaison étrange d’un ciel de théâtre qui se pose sur les tables de nuit et les guéridons éparpillés. Devenu linceul, il les convertit en pierres tombales. La maison n’était qu’une nécropole potentielle ... la mort p.35 l’avait déjà investie et il a suffi d’une légère palpitation de voile pour qu’elle bascule de l’autre côté. Mais, en maintenant allumé le lustre familial, Krejca refusait de rendre étanches non seulement le dehors et le dedans, mais aussi la mort et la vie. Un dialogue persiste ... Chez Efros, la mort s’impose avec encore plus d’agressivité, au point de susciter par son évidence certaines appréhensions: le symbole l’emporte sur le réel et l’écriture tchékhovienne perd son équilibre. Mais en voyant un spectacle, il est nécessaire parfois de ne pas oublier le combat des formes auquel la représentation participe : dans la Russie des années soixante-dix, dominée par un réalisme qui avait fini par se galvauder, le symbolisme excessif d’Efros se chargeait de fortes valeurs polémiques. Il aidait à libérer l’œuvre, à la dégager de l’emprise oppressante d’une esthétique pétrifiée. Ici, le lieu est investi et le cimetière occupe le cœur même du plateau, au point que meubles et pierres tombales se confondent comme si les morts cohabitaient avec les vivants. On vit parmi des croix et des caveaux ... la mort les tient tous ! Métaphorisation forte du discours de Pétia qui repère les fantômes dans les troncs d’arbres. Chez Efros, à la résurgence funéraire dans l’espace familial s’ajoutait un redoublement symbolique : l’endroit qui réunit pierres tombales, mobilier et cerisiers se dresse sur un coussin dont les franges restent visibles. Il renvoie au sommeil des maîtres, préambule de la "maladie de la mort" qui s’empare d’eux. "Dormir, mourir" - Efros rejoint le motif hamlétien déjà inscrit par Tchekhov dans le texte. Zadek respecte la didascalie du deuxième acte; l’acte de l’extérieur, qui réclame la présence des pierres tombales, mais il ne leur accorde pas une importance scénographique particulière. Subtilement, il se contente d’immobiliser Firs dans leur proximité ... et ainsi d’en faire l’emblème de p.36 la mort qui le guette, lui et le domaine. Elle rôde autour et menace le verger. Dans une lettre, Tchekhov parlait même des pierres tombales sur lesquelles des cerises se seraient écrasées comme des gouttes de sang. Lui, qui en crachait périodiquement, connaissait l’effroyable effet. Interrompu par de nombreuses hémoptysies - le sang lui envahit les poumons de plus en plus souvent - et conscient de la portée de ce sujet qu’il qualifiait lui-même, l’écrivain réservé, de "splendide", Tchekhov écrit lentement La Cerisaie pour le plus grand désespoir de ses commanditaires de Moscou qui l’assaillent de télégrammes. Mais la lenteur a des raisons autres, raisons d’artiste parvenu au terme d’un cycle. "Après La Cerisaie, je vais cesser d’écrire comme auparavant", note-t-il. L’écrivain concentre son monde tandis que l’homme vit avec les yeux rivés sur la perspective de la fin imminente. Il refuse, malgré cela, d’engager une course contre la montre et, étranger à toute précipitation, égrène les répliques, profite du soleil, tempère les appels affolés du Théâtre d’art. En regardant la mer de Yalta, Tchekhov sait qu’il travaille à une œuvre testamentaire et également à son œuvre ultime. Il accorde à La Cerisaie cette double vocation: résumé d’un parcours d’écrivain et clôture d’une biographie. Le dernier mot ne sera-t-il pas "rien", preuve indiscutable qu’ici la mort n’est pas perspective ontologique comme dans ces Vanités où le crâne gît sur les tables de travail, mais expérience personnelle qui se confond avec l’écriture même ? Finitudes partagées. Dans ce sens pourrait être interprété le qualificatif de "comédie" que Tchekhov donna lui-même à son texte. Certes, disséminés, des accents comiques ponctuent La Cerisaie, mais l’assimilation au genre reste, malgré tout, problématique: c’est plutôt à la "comédie de la vie" que le moribond p.37 qu’il est se réfère. Il prodigue la morale d’une séparation légère, d’un éloignement ironique afin que "la visite inopportune" ne soit pas compromise par excès de drame. Une coupe de champagne et "ich sterhe" le "je meurs" en allemand d’un auteur russe qui s’éteint sans crispation à Badenweiler. Il a évité le célèbre adage dévalué par usage abusif, finita la commedia ", mais il ne serait pas exclu qu’il y pensait lorsqu’il qualifiait de "comédie" son œuvre ultime. Malgré l’insistance de Tchekhov sur l’intitulé "comédie", il est permis de douter de sa pertinence. S’obstinet-il là-dessus pour prendre ses distances par rapport aux Trois sœurs auxquelles l’on avait reproché la dominante mélancolique, ou pour atténuer le penchant pour les affects du maître du Théâtre d’art ? Le comique rapproche et il censure la propension au monumental propre au tragique. Et sans doute craignait-il que le détachement dont il avait imprégné sa vision testamentaire ne soit occulté par le sentimentalisme stanislavskien. Sourire, une manière pudique de finir. Ne conseillait-il pas à Olga Knipper de siffler lorsqu’elle souffrait ? "Les mots sérieux sont les plus vulnérables", dit un auteur russe inscrit dans la filiation tchékhovienne. La Cerisaie conjugue le tragique et le comique; opter pour l’un ou pour l’autre fait encourir le risque d’amputer d’un de ses termes ce couple de contraires. L’option peut intervenir quant aux accents qui permettent d’accorder à l’un ou à l’autre des éléments la priorité afin de l’ériger, comme on le disait jadis, en aspect principal ou secondaire de la contradiction qui, de toute manière, les réunit. Ici où s’allient et l’écroulement des valeurs qui fait le domaine du tragique et le retournement des valeurs, exercice propre à la comédie. Il ne faut pas sacrifier l’un pour l’autre: il faut jouer les deux. On peut se demander ... Et si Tchekhov, en insistant sur l’assimilation de La Cerisaie à une p.38 comédie, s’était trompé, comme souvent cela arrive aux auteurs habituellement rétifs à l’égard des choix de mises en scène rebelles dans leur vision prédéterminée du spectacle ? Ionesco ou Beckett n’ont-ils pas rejeté la mise en scène dans son acception moderne au nom d’une interprétation à la lettre du texte proposé ? Tchekhov, de même qu’il revient sur les personnages de ses nouvelles, réactive ici des procédés originaux de ses premiers textes farcesques, comme s’il faisait retour sur l’ensemble des identités dessinées et des techniques utilisées. Plus que jamais, les numéros primitifs des farces et du cirque abondent: un clown mange un concombre, l’autre fait craquer ses bottes tandis qu’un autre retrouve son argent dans la doublure du manteau; tout le répertoire de l’Auguste. Les fleurs de cerisier agglutinées en grappes blanches apparaissent ici, sur fond de fin de cycle, comme une intempestive et ultime éclosion de l’existence. Elles en confirment le caractère extrême tout autant que passager ... Ainsi, par la beauté intense de la floraison fugitive, Tchekhov parvient à un contraste poétique où se relient morale de l’intensité et ascèse du périssable. L’origine asiatique du cerisier, semble-t-il, explique l’importance que le shintoïsme lui accorde, de même que sa fréquence dans le répertoire poétique traditionnel. En japonais, le même mot, hara, désigne la fleur de cerisier et la fleur comme terme générique ... Tchekhov accroît l’assimilation au point de confondre l’éclat d’une cerisaie et le bonheur d’une vie. Il rejoint ainsi un second terme associé aux fleurs de cerisier dans l’Empire du Soleil levant: elles désignent aussi la mort idéale, libérée des biens de ce p.39 monde et oublieuse des épreuves de l’existence. Mais nous aussi, lecteurs ou spectateurs, nous le savons : les cerisiers ici fleurissent pour la dernière fois et le nouveau monde signe leur arrêt de mort. […] Vivre une heure à l’ombre des cerisiers en fleur qui, par milliers, envahissent Kyôto ... l’expérience à faire pour comprendre les raisons du refus et l’ampleur du désastre. Motif biographique qui accompagne l’intimité avec l’œuvre et ses variantes scéniques. Tchekhov a constamment souhaité réduire le nombre des personnages afin que l’ensemble soit "plus intime". La parabole n’exige pas des masses ... Avec son génie de metteur en scène, Meyerhold observe l’inédit de la construction : "un groupe de personnages dépourvu de centre". Mutation dramaturgique essentielle. Ici, si centre il y a, il ne pourrait être que le verger, le reste se présentant comme une atomisation où l’on peut identifier des éclats d’un centre jamais à même de se constituer comme tel. Cela explique la "choralité" tchékhovienne ... Elle renvoie La Cerisaie du côté de ce que Gertrude Stein appelait la "piècepaysage". p.40 Tchekhov brise le centre en le diffractant, d’un côté, Lopakhine et de l’autre, Lioubov-Gaev, centre fracturé. Ainsi, géométriquement parlant, il passe du cercle à l’ellipse qui se dessine autour de deux centres. Mais même l’ordre de cette figure ne s’impose pas pleinement en raison des explosions successives du centre. "Pensez-vous que les pièces de Tchekhov parviennent à la même ouverture que les textes de Shakespeare ?" Barthes dans S/Z corrige l’illusion, entretenue par certains discours des années soixante-dix concernant l’ouverture absolue des classiques, pour l’atténuer en parlant, lui, d’une "ouverture limitée", de sa réduction à un certain nombre d’approches. Mais, malgré cette réserve, que Vitez partageait aussi, la question du degré d’ouverture reste posée, surtout lorsqu’on procède à d’imprévisibles confrontations ... est-il le même chez Tchekhov et Shakespeare? Il y a d’abord une première précaution à formuler : peut-on parler d’une égale ouverture dans Le Roi Jean et Hamlet, dans Titus Andronicus et Le Roi Lear ? Sans doute pas. Mais si l’on se replie sur les grands textes shakespeariens, alors, pour Tchekhov aussi, il faut sacrifier les premières pièces en un acte au profit de la tétralogie qui débute avec La Mouette et s’achève avec La Cerisaie en passant par Oncle Vania et Trois sœurs. Et même au sein de cet ensemble, chacune des pièces dispose d’un degré d’ouverture distinct, semblable à celui qui différencie les textes shakespeariens. p.41 Et si, pour répondre à la question provocatrice, l’on rétrécissait encore plus le champ, afin de se confronter aux deux œuvres ultimes, œuvres testamentaires : La Tempête et La Cerisaie ? Leur ouverture est équivalente, au point de nous faire dire que La Cerisaie est La Tempête de notre siècle. Elle enregistre ses crises et dessine son relief. .. Les deux textes font également le constat d’une fin de cycle et se terminent par des adieux qui débordent la scène pour renvoyer aux derniers, aux ultimes départs. Ce que La Tempête illumine, La Cerisaie l’assombrit. Chez Tchekhov, les échos explicites ou les coïncidences shakespeariennes abondent. Outre l’écriture, ces rapprochements découvrent un regard apparenté sur le monde. Je ne sais pas si Tchekhov parvient à j’ouverture de Shakespeare, mais parmi les classiques, "nos contemporains", comme dirait Jan Kott, c’est lui qui s’en approche le plus. Le "shifting point of view": voilà ce qu’un philosophe irlandais a enseigné à Brook. Autour d’une œuvre, comme autour d’une statue, il faut tourner afin d’en saisir toutes les contradictions, car ce sont elles dans leur totalité qui constituent son essence. Il ne s’agit pas de les relativiser, mais de les préserver et de mettre à nu les tensions qui les animent. Le complexe du verger intéresse dans la mesure où il ne procède à aucune exclusion, ni n’avance aucune solution : il est question. Mais question juste. L’essence du rythme tchékhovien : le courant alternatif. Accélération et ralentissement, sans que nul ne l’emporte. Tout se joue entre la langueur du deuxième acte et la précipitation désespérée du quatrième, entre l’effervescence du premier acte et le mouvement saccadé du troisième. Pour des raisons de polémique antistanislavskienne, p.42 aujourd’hui l’ancienne lenteur se voit bannie au profit de la vitesse et de l’accélération. Ainsi, on finit par sacrifier la dimension "antonionienne" de l’œuvre. La vitesse imposée ces derniers temps tout autant que la lenteur de jadis atténuent l’alternance des mouvements propres à cette œuvre fondamentalement musicale. La Cerisaie n’a pas un rythme unique, mais un rythme affolé, qui par ses zigzags témoigne de l’agitation syncopée qui trouble ce monde. Brook, en montant La Cerisaie, a proposé aux comédiens d’improviser à partir de situations extrascéniques : par exemple, la scène du restaurant où les maîtres ont déjeuné avant le second acte. Tchekhov, à sa manière, a pratiqué le même exercice en jouant avec des personnages qui appartiennent à son monde et dont il nous permet de suivre la destinée. La jeune fille de la nouvelle La Fiancée procède à la rupture familiale qu’Ania théorise et applique ... La comédienne en lisant la nouvelle peut nourrir son rôle de l’avenir désenchanté que Tchekhov dessine pour cette autre Ania. Exercice intéressant: la circulation dans l’œuvre à la recherche de réponses aux destins que La Cerisaie laisse ouverts. Brook invitait les comédiens à avancer des hypothèses, mais Tchekhov, le plus souvent, l’a fait déjà lui-même. Relecture de bon nombre de nouvelles de Tchekhov. Au hasard de cette visite non systématique, la découverte de presque tous les personnages de La Cerisaie trouble : l’homme qui passe sa vie à emprunter de l’argent, le valet qui s’habille à l’occidentale, la jeune fille qui rompt avec sa famille et revient ensuite, la femme dépensière et le serviteur qui parle de "néant" à tort et à travers ... Cela révèle à quel point Tchekhov a souhaité convoquer son monde dans ce texte p.43 testamentaire. Il en a donné la version concentrée sur fond d’imminente disparition. Jamais plus qu’ici pareille réunion ne s’est constituée, et en même temps jamais la présence de la mort ne s’imposa avec autant de persistance. Tchekhov fait ses adieux à ses personnages de même que Lioubov et Gaev font les leurs au verger à abattre. Tchekhov pratique le regard de près. Point de f1ou, d’incertitude des contours ... Tout est net. Cela garantit l’équilibre entre l’autonomie de chaque identité et la choralité "démocratique" des ensembles. Il est impératif de faire entendre la vérité de chacun. Elle se formule dans des aphorismes dont la pertinence, procédé tchékhovien récurrent, concerne toujours seulement la personne et jamais l’œuvre tout entière. La maxime avancée ne se constitue pas en profession de foi de l’auteur, dans la mesure où elle se rattache à un personnage qui, à tout instant, peut être contredit. L’originalité de Tchekhov réside dans ce refus d’affirmer, fût-ce dans un raccourci, "la vérité" de l’œuvre: en cela, il est "shakespearien". Bonheur romanesque. Oui, il y a dans les grandes Cerisaie des moments de véritable bonheur romanesque. Ce bonheur que procure l’injection de vérité humaine dans des situations et des répliques depuis longtemps fréquentées. Sans doute comme dans le théâtre asiatique où la nouveauté d’une intonation ou la surprise d’un geste troublent dans la mesure où elles craquellent l’héritage. Le théâtre occidental ignore la solidité d’une telle transmission, mais il pratique p.44 tout de même l’art de la situation dramatique établie : le texte la fonde et la scène la réconforte. Parfois, ici et là, un tremblement intervient ... il émeut plus que l’anéantissement de la table rase autrefois exalté. Ainsi, des réponses nouvelles découvrent des territoires inédits où l’humanité des personnages s’épanouit sans qu’il y ait intervention autoritaire, polémique et explicite du metteur en scène. Une étudiante, fille d’acteurs, avance la plus belle assimilation de la cerisaie à une réalité actuelle : "La pièce de Tchekhov me fait penser au Berliner Ensemble qui fut la cerisaie des gens de théâtre. Après la réunification, on cherche vainement des solutions pour le sauver, mais rien ne convient, comme s’il n’y avait plus de place pour le Berliner." Elle se tait ... Lorsque je suis allé à Berlin, à côté de la Friedrichsbahnhof, la "gare en pleurs", lieu de séparation entre Allemands après une brève visite à l’Est, j’ai vu la silhouette du théâtre et la statue de Brecht, ce Confucius de notre siècle agité. Tout était vide, délabré, abandonné ... comme la cerisaie que Lopakhine va anéantir. Comment se résigner à fermer le Berliner, notre théâtre ? p.45 Lopakhine entre, un livre à la main, en préfigurant cet Hamlet auquel, ironiquement, il va s’identifier plus tard pour renvoyer son "Ophrélie" qu’est Varia au monastère, tel son double danois. Et d’ailleurs, d’entrée, peu importent les motifs, ne jette-t-il pas son livre par terre de même qu’Hamlet avant la rencontre mise en scène par Claudius et Polonius ? Depuis son début jusqu’à la fin, Tchekhov reviendra toujours sur Hamlet, la pièce à laquelle il emprunte citations, scènes et personnages. Elle restera son centre de référence. Symétrie, toujours discrète chez Tchekhov, mais symétrie visible: la pièce débute par l’oubli dans le sommeil du futur maître et s’achève par l’oubli dans la mort de l’ancien serf. La Cerisaie est bordée par le monologue hamlétien : dormir, mourir. Chaque fois, les coupables de ces oublis en abyme, ce sont les serviteurs: Douniacha d’abord et Yacha à la fin. Ainsi une relation se noue entre ces deux ahuris peu soucieux des autres. L’oubli, une forme d’indifférence. Lopakhine imite les maîtres mais, à la différence des autres serviteurs qui procèdent au même travail mimétique, lui, il éprouve la conscience de l’échec. Il préserve toujours une distance critique à l’égard de lui-même: "On dirait un cochon dans un salon de thé" ou : "On dirait un cochon qui écrit" ou, enfin, conclusion encore plus appuyée: "Moujik je suis, moujik je reste." Lopakhine vit dans cet entre-deux insoluble. S’il ne joue pas cela, tout interprète l’affaiblit en lui retirant la tension contradictoire qu’il éprouve comme une blessure ouverte. p.48 Les serviteurs, double "renversé" des maîtres. Plus que le statut social, la servitude se reconnaît par cette propension au simulacre. Lopakhine qui se déteste avec ses "chaussures jaunes" en a conscience, mais l’imitation enchante Douniacha ou Yacha. Combien de "nouveaux maîtres" dans le siècle n’ont-ils pas repris les anciens insignes du pouvoir ? Déréglé, Epikhodov l’est. Et certains metteurs en scène traduisent cet état par un dérèglement vestimentaire. Le costume comme double du vocabulaire, de son identité même. Douniacha, pour sortir, et Firs, pour rentrer, empruntent, dans le spectacle de Brook, exactement le même trajet, comme s’il était réversible: son rêve à elle s’annonce déjà, partir, et le programme de Firs se confirme aussi, ne jamais partir. L’envers et l’endroit d’une relation au lieu d’attache. Le bruit précurseur de l’arrivée ... technique propre aux contes où le protagoniste avant d’apparaître se fait annoncer par le bruit de son arme, par la puissance de son cri, bref par un message sonore. Ici aussi, Lopakhine d’abord entend Lioubov et ses accompagnateurs, et ensuite se précipite pour les voir. Encore plus que la vue, l’ouïe éprouve l’importance de l’événement à venir et Tchekhov adopte ce procédé ancien que Propp analyse dans La Morphologie du conte. La grande question: l’arrivée de Lioubov. Comment satisfaire une attente et confirmer un événement ? Chez Strehler, c’est en grande comédienne qu’elle pénètre dans la maison blanche, chez Stein p.49 elle s’avance comme dans un rêve - extase des retrouvailles -, chez Karge et Langhoff, délibérément, elle paraît telle une vieille femme ruinée par l’âge, l’alcool et le tabac ... L’arrivée de Lioubov tient de ce que l’on appelle les procédés d’ouverture. Dès son entrée, Angela Winkler, l’interprète de Lioubov chez Zadek, revêt un peignoir "japonisant" qui rappelle certains tableaux impressionnistes. Elle laisse voir avec désinvolture son épaule, et tout indique la séparation, minime pour elle, entre être vêtue et être dévêtue ... Le peignoir moulant peut glisser à tout instant, d’autant plus que cette Lioubov touche les hommes, s’agite, relève son habit incertain. Désirée par tous, comme l’héroïne de Wedekind qui fit scandale au début du siècle, elle les désire tous aussi. Lioubov ouvre la porte et Lulu arrive. La pièce commence par une inversion: on se couche à l’aube. La topographie de la maison et le respect qu’elle impose intègrent les mutations intervenues: si jadis le père de Lopakhine n’avait pas même accès à la cuisine, maintenant la mère de Yacha qui se promène dans les salons l’attend à la cuisine et enfin, le vieillard qui, tel un Tirésias, vient dire ce qui s’est passé à la vente ne s’attardera pas à la cuisine dont il ne franchit pas le seuil, laissant dans l’angoisse les spectres qui continuent à danser. Il passe sans entrer dans ce lieu à la dérive, bateau fantôme que la sagesse conseille de fuir. Chez Jacques Lassalle, la maison s’impose par sa démesure, volume presque vide parsemé de p.50 quelques traces de l’enfance, fixées dans la chambre vouée à la conservation du temps. Mais, détail admirable, à travers les objets une modification se donne à lire: ainsi l’on voit comme d’habitude, depuis Strehler, les signes de la première enfance, mais l’on repère aussi le tableau noir sur lequel Lopakhine, tel un professeur de réalisme, inscrit en grand, le 22 août, la date fatidique de la vente aux enchères et des planches de zoologie, qui, outre l’étrangeté qu’elles introduisent, marquent le passage aux études de l’adolescence : la chambre des enfants se constitue en feuilleté des durées. L’espace nous permet de les enregistrer et de les suivre. Intuition subtile: à la frontalité, avec tout ce qu’elle suppose comme évidence, l’on oppose ici la vue. d’angle. L’espace familial cesse de se présenter alors comme sécuritaire et cette perspective de biais inscrit d’emblée le trouble, l’imminence de la fin. Nous sommes au cœur d’un déséquilibre ... la vie sur une pointe ! Et Kantor dans La Classe morte ne parlait-il pas de "la mort dans un coin" ? Par cette option, le spectacle se place sur le territoire de l’incertitude où l’on guette les défaites et où l’on admet les chutes. Le sentiment de détresse s’accentue aussi par l’état de la maison, non pas délabrée, mais défraîchie: ici une tache s’aperçoit, là-bas un papier se décolle. Les murs témoignent de l’état de la famille, tandis que les objets, eux, entretiennent encore les illusions nécessaires. Chez Brook, Firs arrive intégré dans l’ensemble, en désignant la vieillesse, tandis que chez Strehler, isolé, masse noire, vestige désarticulé, il avance comme messager d’une cérémonie funèbre. "Le jardin est tout blanc", constate Gaev tandis que Lioubov poursuit: "C’était tout comme p.52 aujourd’hui, rien n’a changé. Blanc, tout blanc", "regarde, maman qui marche dans le jardin ... En robe blanche", "il y a un petit arbre blanc penché, on dirait une femme", "les masses blanches des fleurs". Une seule page de texte et le blanc se diffracte en faisant se confondre les fantômes et les arbres, en attachant, par la beauté et la mémoire, les maîtres à leur cerisaie. Lorsqu’ils arrivent, ils la regardent tout à fait épanouie, et parce qu’ils revivent alors l’éblouissement qui remonte à leur enfance, son abandon leur semble encore moins envisageable. Non, Tchekhov insiste, la cerisaie ici n’est pas seulement mentale, sa beauté enivre, sa splendeur emporte. Lioubov et Gaev la voient avec le sentiment que le verger fleurit pour eux seuls, de même que le fantôme du père assassiné n’accepte de parler qu’à Hamlet. Et, comme pour lui aussi, la rencontre a lieu avant l’aube, avant "le chant du coq", à l’heure où les morts voyagent. .. D’ailleurs, dans le clair-obscur de la "nuit blanche", Lioubov n’aperçoit-elle pas sa mère qui dans une robe lumineuse, linceul fantomal, se faufile à travers les arbres fleuris à peine éclairés par le lever du jour ? Tout atteste ici l’ambivalence du blanc. L’exil est une fuite, toujours. Peu importent les motivations ... Lioubov s’est enfuie à l’étranger. Le départ précipité, le désir d’échapper à son destin, la volonté de transgresser les interdits, de s’extraire de l’étreinte tragique ... autant de motifs. On fuit un monde, mais on peut fuir aussi des gens, une dépression. Fuir, c’est reconnaître l’incapacité à se résigner à ce qui prend l’allure du destin, à trouver réponse au présent, à résoudre les inquiétudes persistantes. L’exil est une révolte autant qu’un délit de fuite. Et ceux qui s’y refusent, par morale ou par lâcheté, ne manqueront jamais de le ressentir ainsi, qu’ils l’approuvent ou le réprouvent. p.53 Lioubov frappée par une double mort se réfugie à l’étranger. Exil affectif qui s’accompagne, Ania le raconte, d’une déchéance progressive. L’exil des non-intégrés s’inscrit souvent sur cette courbe déclinante, où déperdition économique et échec psychique se conjuguent. Pour eux, l’exil se mue en épreuve de survie, substitution et non solution au drame qu’ils ont fui. En France, Lioubov qui perd progressivement ses ressources et son statut annonce presque le déclassement des futurs émigrés russes chassés, eux, par la révolution et ses massacres. Leurs chutes se ressemblent, car de même qu’ils finiront souvent en chauffeurs de taxi ou en maîtres d’hôtel, Lioubov, après avoir perdu sa villa de Menton, échoue dans un appartement enfumé au cinquième étage où s’entassent des reclus en manque d’insertion. Egarée parmi eux, Lioubov se désespère mais craint de rentrer car, pour tout exilé, faire retour est un acte de courage. Et elle s’y montre inapte. De Russie, en inversant les rôles de la parabole biblique, on envoie la fille pour reconduire à la maison la mère prodigue ... et de même qu’Ania va lui parler après la vente pour l’encourager, de même elle a dû parler, "à travers les larmes", pour convaincre Lioubov. Celle-ci finit par se résigner, mais sans abandonner pour autant son statut social qu’elle affiche tout au long du voyage: comédienne qui dissimule une défaite. Lioubov est une vaincue en représentation. Lorsqu’elle regagne la propriété, il est important de la montrer comme prise par ce jeu de la victoire feinte et de l’échec camouf1é. Cette ambiguïté dénonce l’entre-deux de son identité présente, ancienne grande dame rebelle et actuelle émigrée revenue de son pigeonnier parisien. Chez Karge et Langhoff, elle restait trop prisonnière du récit qu’en fait Ania : seulement une femme décrépite. Les autres, Brook, Strehler, Efros, occultent le témoignage sur l’échec pour n’exposer que l’éclat de la maîtresse séduisante. p.54 Chaque option sacrifie une pièce de ce puzzle contrasté qu’est la vie de Lioubov. Seulement chez Zadek, Angela Winkler parvient à l’ambivalence en montrant une Lioubov qui joue son rôle sans parvenir tout à fait à cacher son état. De derrière le personnage en représentation surgissent les détails qui viennent démentir l’image affichée. Sa splendeur est un leurre. Au quatrième acte, Lioubov s’enfuit une seconde fois ... le faux vainqueur du début repart en vrai vaincu ! Comme si les trois actes avaient détruit l’initiale pellicule illusoire pour faire ressortir crullement la réalité de la défaite, de toutes ses défaites. La représentation s’achève. "Finita la commedia. " Fuir. .. fuir ! Tout se passe comme si Lioubov était revenue de l’exil pour le regagner à jamais une fois la vente accomplie. Elle ne pouvait apporter aucune solution, on s’en doutait, mais la famille l’a conviée pour qu’elle aussi éprouve jusqu’à la lie le désastre. Solidarité de l’échec. Elle rentre de Paris en vaincue dissimulée pour reprendre, en vaincue démasquée, le chemin du non-retour. Définitif exil ! Elle le sait ... mais cela ne l’empêche pas de jouer une ultime fois pour entretenir les illusions d’Ania qui lui fait promettre qu’un jour elle va revenir. Non, c’est la dernière fois et Lioubov part sans regarder derrière, là où les cerisiers tombent et où le verger disparaît. Mirage qu’elle emporte dans le train qui traverse l’Europe. Paris ... le départ. .. le voyage ... les wagons, les calèches, l’exil passager converti en exil sans recours. C’est aussi cela le complexe du verger. La page blanche d’un cerisier en fleur. .. Ici, en dehors de l’espace russe, il n’y a que Paris, ville de l’extravagance - on y mange des grenouilles, Ania, comme Sarah Bernhardt, monte p.55 en ballon et les robes sont sans pareilles - et de la déchéance - on y tombe malade, on se fait trahir, on s’enferme dans des appartements de bonne. Ville des excès. Elle convient à Lioubov et à ... Yacha, les êtres les plus cosmopolites de La Cerisaie. Si la maîtresse, avant même de connaître le résultat de la vente, envisage d’y revenir - pour des raisons de dépendance sentimentale -, Yacha, lui, déclare ne pouvoir vivre que dans la capitale exotique. A son tour, Douniacha, elle aussi, se montre particulièrement excitée par cette profession de foi. Eux seuls sont des exilés potentiels ... Pour Lioubov, la rupture avec Paris semble être accomplie mais Yacha, lui, ne rentre-t-il pas et ne quittet-il pas le domaine en refusant de voir sa mère à laquelle les Russes ont l’habitude d’assimiler le pays ? Indifférent à tout, il tourne le dos, claque des talons et, une coupe de champagne à la main, hurle hystériquement : "Vive la France." Si Lioubov est déchirée au nom de ses racines perdues, Yacha circule aisément entre Paris et la propriété en raison du refus explicite de toute racine. Mais cette absence de tout attachement aux origines n’est pas pour plaire à Tchekhov, pourtant sceptique à l’égard de la russophilie tolstoïenne. La question de la reconnaissance ... Le temps modifie les visages, l’espace transforme les comportements. Cinq ans, c’est beaucoup et la France est loin ... on ne reconnaît pas Yacha, ni Douniacha - effet d’écriture qui les rapproche d’emblée -, on n’identifie pas Pétia non plus. Il a vieilli, a perdu ses cheveux ... voilà ce que peut faire le temps à l’homme. Dans cette incertitude initiale, presque par provocation, on érige en principal compliment le constat du non-changement de Lioubov. Est-il mensonger ou réel ? La mise en scène doit poser et résoudre la question. p.56 Chez Tchekhov, les cinq ans représentent l’intervalle de séparation maximal. Par rapport à cela, il faut percevoir l’immensité des "cent ans" invoqués dans ses discours par Pétia comme l’équivalent dans le temps de l’illimité spatial de la steppe. Lioubov, chez Zadek, se comporte en maîtresse non distante. Elle est sexuellement "démocratique" car elle touche les hommes sans tri ni distinction aucune, elle ne se montre ni fermée, ni inexpugnable. Parce qu’elle est éprise à un tel point du corps, elle se présente comme prenable et... rejetable. Au fond elle n’est qu’une Lulu vieillissante. Lioubov, dès son entrée, en scrutant Varia voit, dans le sens profond du terme, son avenir: "On dirait déjà une nonne." Là aussi, et non seulement pour ce qui est de la cerisaie, le futur se présente comme scellé : le mariage envisagé n’aura pas lieu, de même que le domaine ne sera pas sauvé, Varia ira comme gouvernante chez les Ragouline, mais son vœu secret reste religieux. Lioubov, la pécheresse, a reconnu d’entrée que sa "fille" rêve plus de se fiancer avec Jésus qu’avec Lopakhine, son double aussi actif qu’elle. Seul le degré de réussite les distingue car, par ailleurs, ne reconnaissent-ils pas leur névrose commune en employant presque les mêmes mots pour admettre qu’ils "ne peuvent se passer du travail" ?... Mais au-delà de cet engouement tout les sépare, car l’un rêve de beauté productive et l’autre de retraite monastique. Tchekhov, dans une première version de la pièce, envisageait d’appeler Varia "Bonne à rien", p.58 selon l’expression chère à Firs. Il y a renoncé en raison de l’inscription onomastique trop évidente de l’échec dont sont frappées toutes ses initiatives, dans le domaine pratique aussi bien qu’érotique. "Je n’ai pas d’amour" - aveu de stérilité affective que dans Trois sœurs fait Irina résignée. Varia, par contre, ne peut pas engendrer de l’amour. Si Lioubov dépense, Varia économise. Deux conduites distinctes. La maîtresse finira par s’assimiler à Marie Madeleine et quémandera le rachat, tandis que Varia érige son comportement sacrificiel en vertu jetée au visage des autres. Comment peut-on l’aimer ? Varia ou la conservation. Elle ressemble à ces êtres improductif, convaincus qu’un maximum de préservation peut servir de remède à l’état général. "Vos chambres sont restées les mêmes", dit-elle, tandis que Lioubov fait le même constat pour la qualifier: "Et Varia est toujours la même" - ce qui n’est pas un compliment dans la bouche de la femme dépensière. Varia fait de l’immobilisme son projet et de la rétention sa solution. Lopakhine invente, Lioubov se consomme ... Varia se mortifie. Elle ne produit rien, elle fournit des services, mais ce qui aurait suffi auparavant devient caduc aujourd’hui. Varia a conscience de l’échec et elle prend sa revanche sur les serviteurs qu’elle ne nourrit pas ou sur son subalterne, Epikhodov, qu’elle n’hésite pas à frapper. Défoulement de personnage en crise, mortifié et insatisfait des autres ! Varia se dévoue tout en développant l’attente d’une récompense affective due à l’excès de travail accompli. Elle se sanctifie elle-même. p.59 "Il fait moins trois" la nuit du retour de Paris. Les cerisiers fleuris, le gel va les brûler. Ce "printemps froid", si éblouissant soit-il, annonce par un tel oxymoron le désastre à venir. Demain les fleurs écloses vont se rabougrir et les arbres se noircir. Oui, le climat n’est pas "coopératif", pour adopter le constat bouffon d’Epikhodov que personne ne prend au sérieux. Sous cet éclat de nuit la mort déjà ... Tous croient qu’il s’agit d’un prolongement de l’hiver météorologique tandis qu’en réalité c’est le préambule d’un autre hiver, destructeur et mortifère, l’hiver de la fin. Ania, envoyée en mission pour ramener la maîtresse en fuite, raconte avoir été prise dans les tenailles d’un froid européen, froid généralisé. "Je suis partie la semaine avant Pâques, il faisait froid ... On arrive à Paris, il fait froid, il neige." Cet extérieur dépourvu de la moindre clémence s’accorde avec l’hiver intérieur de la jeune fille ... double froid dont elle se souvient dans son récit comme d’une expérience de la mort. C’est pourquoi, à son retour, Ania réagira tellement aux mots de Pétia. Physiquement, ils la réchauffent. L’hiver absent ici comme saison distincte se diffracte car soit il se poursuit jusqu’au mois de mai, soit il débute prématurément dès le début d’octobre: aux deux bouts le même froid, toujours "moins trois" comme si le thermomètre s’était irrémédiablement bloqué. Lopakhine, pour faire une plaisanterie incongrue, jaillit de derrière une porte en bêlant "mée" ... Symptôme de son malaise, voire même de sa difficulté à s’intégrer. Zadek, à partir de là, construit une histoire plus complexe en mettant sur l’armoire un petit mouton en laine qui a dû faire l’objet des jeux d’enfants de jadis. Par son "mée" Lopakhine plaisante tout en ressuscitant le souvenir de ce temps-là et il affirme ainsi son p.60 appartenance à l’univers familial. Le petit moujik savait à quoi on jouait dans la maison qui lui était alors encore interdite ... Aujourd’hui, par son "mée", il surprend la maîtresse qui lui tombe dans les bras. Dans la mise en scène d’Andreï Serban, pour Lioubov, le fantôme de la mère littéralement s’incarne. Elle la voit traverser furtivement le verger, image de la femme "impressionniste", son double. Ce n’est qu’ellemême qui nous semble glisser parmi les arbres ... Lioubov est déjà du côté de la mort et son corps rappelle celui de la mère depuis longtemps disparue. Et pourtant rien n’indique cette distance, rien ne les sépare, sauf leur degré de réalité. Le petit Gricha s’incarne aussi, garçon issu d’une toile de Renoir. .. Lioubov voit ce que les mots disent et ainsi, pour un instant, elle s’isole. Effet de solitude. La douleur produit cet excès du visible qu’est le fantôme qui se montre ... soit par appel de l’être aimé, soit par crainte de l’adversaire assassiné. D’entrée, Tchekhov fait de la cerisaie un foyer de fantômes. Dissémination secrète du même Hamlet que Kostia citait au début de La Mouette, et que Lopakhine parodiera plus tard ici. Quand Lioubov aperçoit sa mère dans le verger, Gaev ne se scandalise pas et demande : "Où ?" Cela suppose qu’il n’exclut pas l’hypothèse. Peut-être, lui aussi, l’a-t-il vue parfois. Plus tard, Pétia parle des fantômes qui se dissimulent dans les arbres, les fantômes des serfs qui réclament vengeance. Pour tous, plus ou moins, la cerisaie est un site fantomal. La cerisaie aux esprits ... Mais pour Lioubov seule la p.61 mère est "une apparition effective", preuve de son plus profond attachement au verger et à ses âmes défuntes. Strehler a fait de l’enfance non pas un souvenir, mais un thème. Il irradie dans l’œuvre tout entière. Chez Karge et Langhoff, un petit mannequin continue à se dresser au cœur du salon: souvenir de Gricha et de ... Kantor. Car, comme dans La Classe morte, la famille cohabite avec l’enfant emporté par la rivière. Dans La Cerisaie de Pintilié, à Washington, de même que dans le film de Mikhalkov Partition inachevée pour un piano mécanique, un petit garçon, le double fantomal de Gricha, erre tout au long du spectacle parmi les êtres et les épis de blé. L’enfant mort hante le domaine. Une constante chez Tchekhov, car La Mouette s’achève avec le récit du décès de l’enfant de Nina, tandis que La Cerisaie commence par le même souvenir. La mort de l’enfant - motif récurrent. Chez Stein, la cerisaie fait une apparition majestueuse lorsque Varia tire le rideau et la fait découvrir. Alors la difficulté de la sacrifier devient compréhensible, car il s’agirait d’une mutilation à laquelle les maîtres ne sont pas prêts à consentir ... Au prix de la survie "économique", ils ne parviennent pas à se décider. Le prix est trop élevé. Perdre cette merveille, c’est se perdre. La cerisaie, mon amour. .. Une rivière traverse le verger selon le modèle du jardin parfait depuis longtemps élaboré et que, sans doute, Tchekhov n’ignorait pas. Elle dispose des ressources plurielles qui en font un pôle p.62 symboliquement contradictoire. L’incertitude adoptée pour qualifier les êtres, véritable règle tchékhovienne, se retrouve aussi au niveau des lieux. La rivière qui a englouti Gricha ne renvoie-t-elle pas au Styx et n’est-elle pas aussi argument qui accroît la valeur marchande du domaine ou refuge délectable pour Ania et Pétia ? Rien n’est univoque ici, ni un être ni une rivière, sans parler d’un verger. Chacun possède ces vertus multiples toujours capables d’un retournement. Il faut aimer Lioubov ! L’aimer pour ce que la pédagogie courante enseigne à corriger, voire même à combattre. Elle est "inassouvie" et l’expérience vécue, malgré les sanctions infligées, n’a pas de répercussions sur ses choix de vie, ni sur ses passions. Ce second sens doit s’ajouter à l’autre, f1atteur, de la réplique avec laquelle chacun l’accueille: "Vous n’avez pas changé ... toujours la même." Chez elle, la conservation physique confirme son inaptitude à se transformer, à intégrer le vécu et à se soumettre aux impératifs du quotidien. Il serait facile de la désavouer au nom de la surdité au principe de réel, source permanente d’agacement pour Varia l’économe aussi bien que pour Gaev l’indifférent. Lioubov les exaspère lorsqu’elle dispense son argent modique au passant ou aux moujiks qui l’accompagnent lors du départ. Ania, sur le chemin du retour, sera excédée par le même pouvoir de dilapidation dans les trains, dans les restaurants ... Dépenser, dépenser. .. mais sans jamais demander, comme Timon d’Athènes, de l’amour en échange. Dépense gratuite. Lioubov semble conforter et confirmer les théories de Bataille sur la dépense comme accomplissement. Jusqu’au bout. .. Ania ne l’ a-t-elle pas retrouvée avec horreur dans un appartement à l’ambiance délétère ? Alors Lioubov a pleuré sur l’épaule de sa fille, mais l’épreuve ne l’a pas corrigée, ni "apprivoisée", p.63 comme dirait Tchekhov. Prisonnière d’elle-même, fidèle à son inconstance, Lioubov s’enfonce dans le drame sans trahir ni ployer. Plutôt "faire une bêtise", car si elle reste réfractaire à toute adaptation au réel, elle n’en est pas moins suicidaire. Lioubov abhorre la précaution, elle cultive l’intensité des actes brusques: fuir, revenir, mourir. Lioubov théâtralise la vie en affichant son goût pour l’imprévisible et l’excès propre aux stars. Pour la comprendre, il ne faut pas penser à cette stratège que fut sa première interprète Olga Knipper, à laquelle Tchekhov avait réservé le rôle de Charlotte, mais aux passions de Sarah et aux turbulences d’Isadora, ses contemporaines. Comme Lioubov, elles non plus n’épousent pas le cours de la vie, elles le bousculent, l’agressent, elles rêvent d’en être les maîtresses ... celles des hommes autant que de la destinée. Le tracé affolé de ces prisonnières de leurs désirs enregistre l’agitation des secousses et des volte-face chaotiques jusqu’à l’instant où un voile vient étrangler le cou de la danseuse de génie ou les barbituriques posés sur la table de chevet tenter l’aristocrate russe en détresse. Les stars ne se rendent pas, elles se désintègrent. De Lioubov, personne ne pourra raconter la défaite. Dans la solitude de son amour dévasté et toujours recommencé, elle saura retrouver un ultime réconfort. Elle saura disparaître avec violence ou se réfugier, qui sait, dans une sénilité sereine. Elle ne se soumettra pas au monde dont les lois lui sont toujours restées étrangères. Lioubov "ne changera pas". Lioubov arrive de Paris comme moi l’hiver dernier pour veiller au chevet d’un moribond ... mais, de surcroît, la maîtresse en fuite se fait appeler par un messager et cela bien que le courrier, comme la pièce l’atteste, fonctionne parfaitement. Si l’amant peut lui expédier les télégrammes qui lui parviennent et qui scandent les trois actes, p.64 nous pouvons imaginer, en sens inverse, la multitude des appels au secours câblés par Gaev, messages qui ne l’ont pas décidée ... Les lisait-elle ou les jetait-elle à la corbeille? Son silence obstiné explique l’envoi d’Ania afin de ramener impérativement à la maison la mère prodigue. Lioubov n’osait pas faire retour. .. Mais en même temps l’insistance accordée à ce retour confirme le rôle décisif qui lui est imparti à l’heure du danger. Gaev en fait même la protagoniste ... Faute de maître, elle sert de substitut. Personne ne la pense en sauveur, mais chacun espère que son pouvoir charismatique pourra débloquer la crise et chasser le brouillard du manque de solutions. Je reconnais là la foi de ces intellectuels roumains qui croyaient que le retour du roi aurait pu apporter la solution aux troubles postcommunistes en raison même de sa légitimité symbolique. Lioubov est la reine que les vaincus imminents investissent d’un pouvoir, disons, "magique". Les monarques peuvent revenir, mais dans un monde où le corps du roi ne légitime plus son rôle, ils cessent d’être à même d’infléchir le cours du monde. Lioubov sommée de faire retour, malgré ses réticences, ne pourra que vivre en direct le naufrage de sa déposition. Ainsi, la perte de la cerisaie ne sera pas simplement expérience mentale, mais expérience concrète, pareille à l’enterrement, selon le rite orthodoxe, où l’on voit le visage du défunt et cela vous reste collé à la mémoire toute une vie. Oui, Lioubov a vu la mort et horrifiée s’est enfuie vers Paris. Si le récit de la vente prend valeur d’avis de décès, le bruit des arbres que l’on coupe ressemble au grondement des premières mottes de terre que l’on jette sur le bois du cercueil. Cette expérience a commencé à Pâques avec l’arrivée d’Ania ... Mais ici il n’y aura pas de résurrection. Et la Marie Madeleine russe ne connaîtra pas de pardon. p.65 Ania est d’abord intermédiaire entre deux mondes, Paris et la Russie, pour assurer ensuite la liaison entre deux durées, entre le passé qui l’a estampillée et l’avenir qui l’aspire, le verger et Pétia, l’Ancien qui s’achève et le Nouveau qu’elle espère. Lioubov et la dépense somptuaire. Elle participe au monde des stars qui se consomment. Comme Isadora Duncan ... Duncan fait l’expérience russe et Lioubov l’expérience parisienne et toutes les deux meurent en France. En Ania, Gaev voit d’abord le double de Lioubov : "Comme tu ressembles à ta mère ! Toi, Lioubov, tu étais exactement comme elle à son âge." Mais, quelques minutes plus tard, en son absence, il qualifiera sa sœur de "dépravée". Faut-il mettre en relation les deux commentaires ? Le jeune "double" va-t-il finir par ressembler au "modèle" maternel ? Les répliques de Gaev se tiennent, et les mettre en scène exige aussi que l’on esquisse une réponse à cette assimilation mère-fille. Firs savait servir le café à Lioubov, Yacha est chargé de ses pilules. Les vieux serviteurs s’occupent de l’entretien des nerfs de la maîtresse. Complémentarité absolue. Antoine Vitez disait jadis, du temps du communisme dont nous n’avons pas la nostalgie, le temps de l’Union soviétique, qu’à Moscou le public se réjouissait de voir sur la scène du Théâtre d’Art des objets disparus dans la vie quotidienne, argenterie et porcelaines qui faisaient le bonheur des spectacles tchékhoviens. p.66 A Oslo dans sa Cerisaie, Jacques Lassalle donne à voir non seulement des objets, mais aussi des gestes oubliés en transformant le théâtre en une sorte de conservatoire comportemental. Qui sait encore comment l’on moud le café ?... Ce geste-là est repris par Douniacha lors de l’arrivée de Lioubov. A le voir, pour certains, toute une civilisation ressuscite, tout un passé surgit. L’on se rappelle alors les tantes et les grands-mères, l’on revit des souvenirs de lectures ou les agacements du jeune homme auquel la tâche ingrate était parfois impartie. Le geste retrouvé est une madeleine pour le spectateur renseigné. Dans la mise en scène de Jacques Lassalle, Lioubov, dès son entrée, fait honneur à l’alcool et boit allégrement de petits verres d’eau-de-vie. Elle va baigner ensuite dans l’image projetée de la cerisaie fleurie - surimpression qui évoque nostalgiquement un cinéma disparu - tandis que l’on entend au loin quelques notes. En même temps, elle déplace légèrement les jouets : un moment de bonheur passé. Auquel répondra bientôt un autre, plus étonnant, lorsque Yacha joue à l’harmonica et que Lioubov danse avec Gaev comme un couple d’amoureux: tout dit alors le bonheur des retrouvailles sur fond de réel suspendu. Lors de cette onirique danse au ralenti, Varia s’avance en sommant les deux partenaires presque incestueusement enlacés d’arrêter car "Ania s’est endormie". Cette réplique, combien de fois ne l’ai-je pas entendue? Elle fut dite comme un chant ou comme une illumination, comme un constat ou comme une défaite. Ici Varia arrive pour briser l’état de grâce par l’interdit que le sommeil d’Ania exige. Au nom d’un principe de vérité qu’elle incarne avec délectation, Varia censure et ainsi elle annonce son inaptitude à produire du désir, prémonition de sa défaite future. Au terme de l’acte, Varia va ranger p.67 avec minutie la chambre dite des enfants, comme si la venue si attendue des maîtres avait perturbé son ordre. Ses gestes sont mécaniques, une aliénée de l’ordre. Au fond, elle déplore les troubles suscités par l’événement. Son espoir: l’immobilité. Varia n’existe que par les autres ... et plus que jamais le spectacle de Lassalle le confirme car lorsque, au deuxième acte, elle crie au loin le nom d’Ania, ce n’est point pour veiller sur sa jeune "sœur" mais pour dire son inguérissable solitude à laquelle seule celle-ci peut apporter des palliatifs passagers. Les cris de Varia sont les cris d’un oiseau blessé qui, plutôt que d’appeler au secours, convertit sa fragilité en apparent désir de protection. Mais le malheur de Varia vient du fait qu’elle n’ose jamais avouer. .. Le spectacle de Lassalle nous confronte à l’émotion de ces aveux détournés que les personnages de la scène ne saisissent pas tandis que nous, dans la salle, nous parvenons à les entendre. Pourtant nous sommes impuissants. Nous voyons de loin, de l’au-delà de la rampe, ce que les autres qui sont près n’aperçoivent pas. Ici tout dit la crise du père: père mort ou père bouffon. Pas de chef de famille. On n’entre pas dans la cerisaie, on la regarde ... sauf dans le spectacle de Karge et de Langhoff où Lioubov et Gaev dansent parmi les arbres en fleur. Comble du bonheur dans cette mise en scène antisentimentale ! Pourquoi, de toutes les pièces de la tétralogie, est-ce seulement dans La Cerisaie qu’il n’y a pas de médecin ? Peu importe qu’ils soient sceptiques et doutent de la nécessité ou de l’efficacité p.68 de leur intervention, qu’ils ratent une opération ou se préparent à abandonner l’exercice de leur profession, ils sont, sauf ici, chaque fois présents. Médecins désœuvrés, certes, mais en même temps amoureux et séducteurs, sensibles aux débuts de Kostia, épris d’écologie, gaffeurs ... Humains ! Ainsi Tchekhov, écrivain-médecin, passe par là, non pas, certes, avec l’évidence de Hitchcock dans ses films, mais tout de même telle une ombre identifiable. Dans La Cerisaie, il n’y a plus de médecins ... comme s’ils étaient incompatibles avec une œuvre ultime. Il n’y a plus de place même pour la dérision à l’égard des malades et des soins réclamés, des remèdes et des soigneurs désemparés. Quand la mort approche à pas de loup, la médecine se tait et le médecin disparaît. C’est le diagnostic que Tchekhov avance ! Il ne préserve que les réf1exions de Gaev, inspirées par la médecine, sur l’échec garanti lorsqu’on est inapte à trouver la réponse unique à même de sauver le malade condamné. Les absences valent d’être interrogées. Chez Tchekhov, l’hypothèse de l’oubli ne peut être avancée ... De quel refus s’agit-il ? Quel sens peut-on lui accorder ? L’absence est un discours. Sur la médecine, de même que sur son équivalent spirituel, la foi. De curé, il n’y en a que dans l’appartement parisien et sa présence se justifie plus par des raisons d’appartenance au ghetto des immigrés réfugiés sous les combles d’un immeuble haussmannien que pour des motifs ecclésiastiques, sans parler d’une quelconque référence à la foi orthodoxe. Au domaine, où Varia invoque névrotiquement la volonté de Dieu et où Lioubov, Marie Madeleine en quête de rachat, lève si souvent les yeux vers le ciel, pourquoi n’y a-t-il pas de pope, même parmi les invités de la fête du troisième acte ? Peut-être parce que Tchekhov souhaite préserver le religieux tout en rejetant p.69 l’Eglise et ses fonctionnaires douteux. L’appel au pardon refuse la médiation des intermédiaires institutionnels. La Cerisaie ne dispose ni de médecin, ni de curé: monde insauvable. Nietzsche avait clamé : "Dieu est mort" - et l’on peut se demander si Tchekhov en invoquant son nom ne pensait pas plutôt à cette affirmation qu’à d’extravagantes théories sur la fausse monnaie. Son absence est ici totale, malgré quelques invocations dérisoires de Varia et des postures extatiques de Lioubov. Non, Dieu s’est retiré et le ciel de la cerisaie est vide. Tchekhov, tout en écartant l’Eglise, n’occulte pas pour autant la dimension chrétienne; Strehler l’a compris et sa Lioubov porte avec évidence un crucifix autour du cou. Elle a la foi, mais elle se dispense du confessionnal et de l’oreille du confesseur. Lioubov avoue en prenant Dieu pour seul témoin. Comportement religieux réfractaire à toute institution ... La géographie du théâtre tchékhovien ignore systématiquement Saint-Pétersbourg et La Cerisaie le confirme. Refuser Saint-Pétersbourg, c’est une évidence, surenchérit sur le rattachement à la vieille capitale, Moscou, garant de l’identité russe. La question se pose toujours dans des pays comme le Japon, la Roumanie, la Pologne où ce sont Kyôto, Jassy ou Cracovie qui conservent la mémoire nationale et non pas les nouvelles capitales, toujours dépourvues de la charge imaginaire dont la première capitale sera à jamais investie. Comment comprendre chez Tchekhov, ouvert vers l’Occident, pareil choix ? Serait-ce pour ne pas s’inscrire dans la filiation p.70 Gogol-Dostoïevski ? Mais cela ne risquait-il pas de le rapprocher trop de la position slavophile ayant Tolstoï pour leader ? Serait-ce par souci d’équilibre d’un auteur qui innove sur le plan de la forme et qui souhaite sauvegarder les liens avec le territoire d’origine ? Serait-ce parce qu’ici il fait de Paris le pôle de référence par rapport à une Russie que l’on abandonne ? Si la réponse reste en suspens, la question mérite d’être posée: pourquoi chez Tchekhov, amateur de voyages et de cartes, Saint-Pétersbourg manque-t-il toujours ?... Tchekhov a écrit pour les acteurs, comme Shakespeare ou Molière, mais lui, il a même avancé des esquisses de distribution et tout le monde s’accorde pour admettre que distribuer, c’est interpréter, lire, choisir. Lorsqu’il invite Stanislavski à jouer Lopakhine, vu la réputation d’élégance scénique du célèbre comédien, Tchekhov, insiste sur la nécessité de souligner, non pas tant l’écart extérieur, vestimentaire et de posture corporelle, que l’écart intérieur, traumatique et insurmontable, qui sépare l’ancien fils de serf des maîtres du verger. Si Stanislavski avait accepté la proposition de Tchekhov, une autre tradition du rôle aurait pu se constituer: l’écrivain le savait, le metteur en scène ne l’a pas compris. Lopakhine souffre de troubles identitaires ... ses essais pour faire rire échouent en actes manqués, son projet d’accueillir les maîtres rate aussi et même la cerisaie, il l’achète presque malgré lui. Partout il s’avère décidé et résolu, sauf dans la proximité des maîtres où il semble être constamment en porte-àfaux: le passé pèse encore et la libération ne s’est pas tout à fait accomplie. (A cela s’ajoute aussi la maladresse du séducteur qu’il souhaite être sans y parvenir.) p.71 "GAEV. Tu sais l’âge de cette armoire, Liouba ? Il y a une semaine, j’ai ouvert le tiroir du bas et j’ai vu des chiffres gravés au feu. Cette armoire a été faite il y a exactement cent ans. (...) On pourrait fêter son jubilé. (...) Chère et très respectée armoire ! Je salue ton existence dévouée depuis cent ans au glorieux idéal du bien et de la justice. Ton appel silencieux au travail fécond ne s’est pas affaibli au cours de ces cent ans, soutenant bravement (...) la foi en un lendemain meilleur, et raffermissant en nous le goût du bien et de la conscience sociale." Le fameux monologue de Gaev convient au centenaire du Théâtre d’Art de Moscou que les gens de théâtre ont fêté en 1998. En se rappelant cela, le verbiage de Gaev cessera, peut-être, d’agacer car, comme chez Strehler où de l’armoire-mémoire se déversaient les jouets des maîtres, cette fois-ci vont ressurgir les souvenirs et les phrases dont le Théâtre d’Art fut la source. Ceux qui l’honorent aujourd’hui ressembleront tous à des Gaev virtuels pour la jeune génération qui écoutera leurs mots avec autant de détachement agacé que celui que la famille adopte à l’égard de l’oncle trop bavard. Cette distance ironique provient, profondément, du fait que l’éloquence de Gaev se déploie sur fond d’hommage au passé et d’oubli de la cerisaie menacée. A l’heure où l’on salue le centenaire du meuble prestigieux, le verger se trouve sous le couperet d’une date immédiate, proche, date fatidique : le fameux 22 août que Lopakhine se charge opiniâtrement de rappeler. La date de la vente. Les cent ans de Gaev ne sont dérisoires que par rapport à la terrible imminence temporelle de la vente. De même que l’éloge du théâtre d’art à l’heure de l’Internet. Brecht formule dans son journal de travail un éloge au bois, aux objets artisanaux, à l’ébéniste p.72 qui les a fabriqués et, en 1934, il écrit : "En voyant un meuble pareil, il nous venait de meilleures pensées." C’est le sentiment qui s’empare de Gaev au moment du discours. Une alternative de mise en scène opposée à celle, habituelle, qui consiste à ironiser sur la péroraison de l’oncle bavard: rendre l’armoire splendide et justifier ainsi l’élan qu’elle inspire et les aveux qu’elle suscite. De l’importance des objets ... L’armoire centenaire, Zadek la place de profil en ménageant une réserve imaginaire car l’objet salué ne se montre qu’en partie: nous ne le voyons pas intégralement et nous ignorons aussi ce qu’il contient. Exclus, comme les personnages sur le plateau, il ne nous reste qu’à écouter l’hommage de Gaev. Nous pouvons être, certes, exaspérés par sa propension à l’éloquence ampoulée, mais, Strehler l’a compris, l’armoire est le dépôt mnémonique de la famille. De là vont se déverser les jouets de cette enfance embaumée sous le signe de laquelle est mis le spectacle tout entier: ensuite, il n’y aura plus de Cerisaie sans jouets. Perdre le domaine, c’est perdre l’enfance ... Double expulsion. A l’heure du départ, l’armoire strehlérienne couverte par un linceul se dresse tel le totem funéraire de la famille défaite. Brook banalise à l’extrême l’armoire: rien, sauf la mécanique oratoire de Gaev, ne légitime son discours. Il se saoule avec des mots ... Mots qui, grâce à l’armoire, le rattachent par contre, dans le spectacle d’Andreï Serban, à l’éloquence d’une génération combative. Ici Gaev grimpe par derrière et s’adresse du haut de l’armoire érigée en tribune à la communauté de la famille réunie. L’oncle bavard n’est que le précurseur de Pétia ... La même rhétorique les lie. En voyant Gaev perché là-haut, je me suis rappelé le début du roman de Kundera, Le Livre du rire et de l’oubli, où un politicien rendu obsolète par l’histoire p.73 clame, lui aussi d’un balcon-armoire de Prague, l’éloge d’une démocratie que ses adversaires vont prochainement balayer. Gaev est, chez Serban, le dernier démocrate d’avant "la catastrophe", non pas celle du passé que rappelle Firs, mais l’autre, à venir, que programme Pétia. Si l’armoire, chez Strehler, raconte le siècle passé, chez Serban elle annonce le siècle qui débute. Roberto Ciulli a assimilé l’armoire au théâtre moderne: de là sortent les personnages et c’est là qu’ils retournent. La métaphore convient surtout aujourd’hui où une crise endémique touche notre théâtre. Quel ton adopter une fois de pareilles assimilations avancées ? Comment mettre en scène son discours à l’heure où l’identification avec l’oncle se profile ? Cela appelle-t-il un excès d’indulgence ou un surplus d’exigence ? Gaev se réclame de la génération des années quatre-vingt. Et ceux qui se réclament de 68 ?... Sont-ils tout aussi dérisoires que l’on veut nous faire croire qu’est Gaev ? Pour qui ? Il faut toujours interroger ces équivalences. De la réponse retenue dépend la relation à une réplique, à un contexte ou à un personnage. Le rapport entre la solitude du joueur de billard qu’est Gaev et son éloquence excessive se présente comme les deux versants d’un même être: un isolé en manque d’assistance. Dès qu’il intègre un groupe, le discours du rhéteur prend la revanche sur le mutisme du joueur. Mozart a écrit certaines de ses partitions à même la table de billard, en passant à la hâte des notes jetées sur les portées aux boules du tapis vert toujours soumises au hasard et à l’adresse. Certains avancent l’idée qu’entre le jeu et la musique de Mozart, il y a parfois des rapports de parenté: le même esprit les anime. Par extension, p.75 il n’est pas interdit de repérer la trace des combinaisons sophistiquées du billard dans les hypothèses également compliquées que Gaev formule pour sauver la propriété. Le billard a contaminé sa manière de penser. Gaev, interprété par Andrzej Sewerijn, dans la mise en scène d’Alain Françon, préserve l’enfance en lui et pas seulement dans une armoire comme chez Strehler. Il joue sans cesse, met son chapeau de travers, baisse son pantalon, se promène en chaussettes tout au long du premier acte ... se cache dans le lit. Ce Gaev enjoué et désordonné rend plausibles les soins que lui porte Firs, qui échappe ainsi à cette impression d’inutilité dont toutes ses précautions semblent être d’habitude frappées. L’immaturité de Gaev le justifie pleinement. Pourquoi T’chekhov a-t-il gardé une telle incertitude sur la biographie de Varia? C’est à elle que conviennent les mots de Charlotte : "Qui suis-je? Qui ont été mes parents, je ne sais pas." Si Charlotte affirme sa filiation incertaine, Varia ]a tait: et c’est plus troublant. Pourquoi, sinon parce qu’il y a risque de différenciation, Lioubov a-t-elle besoin d’insister en s’adressant à Ania et à Varia: "Je vous aime toutes les deux" ? Malgré tout ce qui nous sépare ... - c’est le sous-texte à jouer. Varia et Dachenka - chacune se fait appeler "fille" soit par Lioubov, soit par Pichtchik. Mais ni l’une ni l’autre ne semblent être le fruit d’un mariage: aucune référence à un conjoint défunt ou à une épouse en fuite. Amours illicites ou accidents domestiques, faits courants à l’époque - voilà ce dont les deux "filles" paraissent être le p.76 produit. Mais la pudeur règne et personne ne rappelle leur origine. Dans leur Cerisaie, Jacques Lassalle et le scénographe Rudy Sabounghi proposent un réalisme parcimonieux, une contraction du réel sans que ses lois en soient affectées et sa présence mutilée. Ils sauvegardent le vide entre les objets, ils refusent l’accumulation autant que l’abstraction, ils préservent des lambeaux de réel à travers lesquels l’air circule et l’inquiétude émerge. D’emblée se dessine le spectre de l’effacement ultime ; ce monde léger est fait pour disparaître. Il possède encore des points d’attache, mais sa fragilité est extrême et son évanouissement imminent. C’est un monde où l’on vit encore ... jusqu’à quand ? Strehler. Sa Cerisaie reste le plus bel essai sur le blanc au théâtre. Ici, sur fond de blanc, se dessine une telle parenté entre costumes et décor que les personnages, pour reprendre une étrange formule d’André Biely, sont "comme translucides, comme des ombres". Un effet d’absorption réciproque instaure l’unité que Tchekhov envisageait dans la lettre célèbre dont Strehler s’est inspiré: des dames vêtues de blanc dans la cerisaie blanche. Rien ne les sépare. Elles appartiennent à la même essence. Un grand photographe m’offre une "épreuve au bromure d’argent". Le terme évoque, pour moi, la contamination métaphorique qui relie le blanc de la neige, des cerisiers en fleur et des femmes en robes immaculées. Les pratiques de la photo au temps de Tchekhov rejoignent ses raffinements technologiques d’aujourd’hui. p.77 Dans Trois sœurs, l’appareil photographique immortalise le bonheur de l’anniversaire d’Irina, dans La Cerisaie, c’est par le détour d’une surexposition photographique - le blanc des femmes sur le blanc du verger - que Tchekhov procure un sentiment de bonheur réconciliateur entre les gens et le monde. La photo est là. Strehler l’a compris. Le blanc des dessous et des vêtements confondus dessexualise les corps. Ceux-ci sont emmaillotés dans des couches blanches et le vêtement n’agit plus comme interdit ni comme censure: l’érotisme devient alors infantile, maternel, en rien adulte. C’est seulement chez les enfants qu’il n’y a point de distinction entre le montré et le camouflé. Sans danger ni frisson, cet érotisme ne perturbe pas. Il est simplement frivole. Ici les maîtres se couvrent pour l’extérieur de capes, manteaux longs et légers. Ainsi ils échappent à la lourdeur propre à tout vêtement d’autorité et en même temps ils en gardent le souvenir. Ces capes de rois déchus ne sont plus que des insignes vidés de tout pouvoir. Les maîtres se montrent trop grands pour les jouets et trop petits pour leurs manteaux qui touchent presque le sol comme des habits royaux. Strehler sait cristalliser les grands thèmes poétiques de l’œuvre grâce à des noyaux scénographiques concrets: les pupitres fixent l’enfance, l’armoire l’embaume, les chaises disent l’attente et les valises annoncent le départ. La vérité, dans le théâtre tchékhovien, passe par les relations. Et Strehler construit un système raffiné qui alterne le sentiment communautaire et l’isolement des êtres. Dès qu’ils se lancent dans les aveux des monologues, les personnages p.78 quittent discrètement l’assemblée pour se diriger seuls vers l’obscurité de l’avant-scène, seuil d’où, en s’adressant à eux-mêmes, ils s’adressent à nous aussi, témoins dans l’ombre. Pour avouer, ils se placent dans l’entre-deux scène/salle. Chez Strehler, le plancher du sol accentue d’acte en acte son inclinaison, comme s’il s’agissait de dessiner ainsi la courbe de ce combat pour le verger, courbe qui chute brutalement au dernier acte. Alors, la scène redevenue plate marque le terme du conflit et en quelque sorte atteste l’apaisement final. Non seulement les jouets sont proustiens, ils participent aussi à la lecture dramaturgique : si Gaev continue à jouer avec, Lopakhine, futur démolisseur, les renverse lorsqu’il s’engage dans l’exposition de ses projets transformateurs ou, vain espoir, essaie de s’en servir comme médiateurs pour le dialogue secret qu’il souhaite nouer avec Lioubov. Le génie d’un metteur en scène consiste à rendre mouvants les signes, à ne pas les fixer, ni à les rattacher à une seule interprétation. Ici le jouet est, musicalement parlant, un leitmotiv chaque fois légèrement décalé. Dernière didascalie du premier acte : "On entend au loin un berger qui joue du pipeau." Sortie de l’histoire, entrée dans le temps étranger aux spasmes dont le monde de la cerisaie est secoué. Le berger ou l’au-delà du temps ... la durée pure. p.79 Mettre en scène, c’est parfois simplement prendre en compte les informations complémentaires fournies par le texte des personnages: si, au début de l’acte II, Charlotte exaspérée déplore que ses partenaires chantent "comme des chacals", seul Zadek fait entendre cette horrible cacophonie sonore. La gouvernante n’exagère pas et le plateau confirme son dire. La gouvernante androgyne ... incertitude sexuelle qui répond à une incertitude d’origine. Elle est inclassable. Les serviteurs ne parlent pas, ne dressent pas des projets, mais ils savent faire l’amour. Toutes les mises en scène, de Krejca à Strehler et à Françon, insistent sur l’intensité de leurs relations sexuelles, sur la puissance de leur étreinte et les spasmes violents de leur accouplement. La névrose est réservée aux maîtres, le sexe aux serviteurs ... avant que ceux-là se prélassent dans une prairie, ceux-ci s’enlacent en lever de rideau. Yacha saute Douniacha et confirme les prévisions de Firs : "Tu vas chuter." Gaev n’est-il pas le double complémentaire de sa sœur ? Si elle n’est que sexualité, lui semble y être tout à fait étranger. Sa vocation se réduit à cet érotisme de substitution que lui permet le recours obsessionnel aux bonbons. Erotisme infantile, et d’ailleurs chez Zadek il en adopte le comportement voyeur, car le frère quinquagénaire fouille le paysage à l’aide de jumelles et surveille avec excitation les violents ébats amoureux de Yacha et de Douniacha. Gaev ne semble pas avoir connu l’amour et finalement sa sœur, qualifiée avec amertume de "dépravée", reste la seule femme qu’il a approchée. Chez Strehler, lorsqu’elle p.82 revient ils s’embrassent et s’installent sur le canapé en revivant le jeu de rôles de jadis - papa, maman - et en même temps en se livrant à un érotisme trouble que Gaev n’a jamais tout à fait surmonté. Charlotte est un vestige des troupes ambulantes, troupes des foires qui, du temps de ses parents, sillonnaient la Russie ... Maintenant Lopakhine voit Hamlet et écorche le nom d’Ophélie. La gouvernante d’emblée est une errante, comme les maîtres le seront à la fin : elle n’a pas d’attaches, elle en a été dépourvue. Charlotte, être à la dérive, sans adresse ni identité, développe, pour l’amusement général, les attractions d’une forme défunte. Morte avant le verger. Montrer chez Yacha le côté "moraliste" lorsqu’il chasse Douniacha à la venue des maîtres ... la canaille a des principes ! Et ceci pour mieux dilapider, louvoyer, frimer. Yacha embourgeoisé a la noirceur d’un personnage de Brecht. Le valet Matti, par exemple. Ces derniers temps, les metteurs en scène l’ont compris et ils le montrent: ici seul Yacha couche avec les femmes. Au domaine règne un manque manifeste, flagrant de sexualité. Chez Gaev, l’éros de substitution l’emporte , chez Lopakhine les interdits restent insurmontables, Epikhodov s’égare dans les mots, Pétia est "au-dessus de l’amour", tandis que Pichtchik, lui, au moins simule une fièvre qui confirme l’existence des appétits anciens, dépourvus aujourd’hui de toute réalité. Au fond, au domaine, on ne repère de sexualité qu’aux deux extrêmes: chez Lioubov et chez Yacha. Cela, comme dans les romans policiers, valide l’hypothèse, souvent avancée, de leur possible relation physique. Quand Gaev, épris de p.83 sa sœur, lance après l’affront délibérément provoqué par Yacha ; "C’est lui ou moi", ne peut-on pas déceler l’écho d’une compétition secrète ayant Lioubov pour enjeu ? Le frère qui avance cette offre d’arbitrage confirme peut-être ainsi qu’il y a parité entre la relation familiale dont il est le garant et le lien sexuel qui explique les libertés prises par le serviteur indocile. Lioubov ne confirme-t-elle pas que l’état de son amant abandonné à Paris ne permet plus d’envisager le moindre rapport érotique ? Malade, il lance des appels désespérés au secours ... et non pas à l’amour. Lioubov le sait et "jamais assagie", comme la qualifiait Tchekhov, peut entretenir une liaison non avouée avec Yacha, de même que Mademoiselle Julie avec Jean. (D’ailleurs Yacha, sur le plan onomastique, est presque la traduction de Jean.) Tchekhov connaissait la pièce de Strindberg, et il en avait parlé à Gorki. Lopakhine vit sous la pression du temps, il en est le gardien et le prisonnier. Dès sa première réplique, réplique d’ouverture qui le place sous ce signe, il interroge Douniacha : "Quelle heure est-il ?" Ensuite il invoque la date fatidique, le 22 août, il consulte sa montre de gousset, donne des indications horaires sur son emploi du temps. Mais il ne se contente pas de sectionner la durée pour des raisons simplement financières, il en éprouve par ailleurs l’inéluctable passage. Et avec frayeur il le constate et il en fait part à Gaev, lui, un véritable irresponsable: "LOPAKHINE. Oui, le temps passe. GAEV. Pardon. LOPAKHINE. Je dis que le temps passe." Le capitaliste vit avec la crainte de cet écoulement du temps auquel les autres restent insensibles. Et pour atténuer la panique, il se livre à un travail forcené ... qui le libère de cette angoisse première de même que de la solitude à laquelle p.84 il ne parvient pas à trouver d’autre remède. Jankélévitch disait ; "L’activité est une affectivité manquée." Phrase qui convient à Lopakhine. De même que son contraire à Lioubov : "L’affectivité est une activité manquée;" Lioubov se réfugie dans l’amour de même que Lopakhine dans le travail, l’un comme l’autre prisonniers de leur vocation érigée en destin. Tous deux se tiennent comme les deux versants d’un Janus bifrons. Pendant la partie de campagne, Lopakhine regarde sa montre, Lioubov le soleil. Stein, au deuxième acte, développe l’étendue de la propriété, espace vaste, démesuré ... il réconforte Gaev dans son argumentation, car ici, pour de vrai, "la cerisaie est la seule chose remarquable". Andrzej Sewerijn insiste sur la nécessité des tombes au deuxième acte. La mort a besoin de cette cristallisation physique. Strehler utilise un train miniature pour désigner la vision infantile que les maîtres projettent sur le monde. Zadek affuble Gaev d’une paire de jumelles dont il se sert pour mettre à distance Lopakhine quand celuici dresse ses plans - éloignement explicite - ou pour surveiller les rapports sexuels des serviteurs rapprochement tout aussi évident. Pareil à un enfant, Gaev joue avec les distances à l’égard d’un monde qu’il épie ludiquement. Au deuxième acte, tout concourt à première vue à instaurer ce climat propre à la conversation : "Un moment de loisir ressenti comme une p.85 fin en soi, durant lequel chacun se voit accorder le droit de parler aussi bien que d’écouter" et où l’ensemble des participants se ressent comme "coupé des tâches matérielles." (Erwin Goffman, Façons de parler.) Si les habitués de la conversation se livrent avec délices à cet exercice, Lopakhine, lui, tente de le briser. Il s’affirme ainsi comme étranger, comme personnage réfractaire aux codes de non-ingérence dans le concret strictement observés par tous les autres convives. Lopakhine essaie vainement de rappeler au réel les maîtres qui viennent d’accéder à la prairie ouverte sur une belle vue panoramique. Faute de pouvoir les réveiller de leur douce léthargie, de cet abandon cosmique ... postdigestif, il reprend, dans le spectacle de Stein, le geste célèbre de Khrouchtchev à l’ONU qui, pour se faire écouter, tape avec sa chaussure sur la tribune. Le metteur en scène évoque cet événement et, en quelque sorte, établit une filiation entre le prochain maître de la cerisaie et les récents dirigeants soviétiques. Chez Strehler, Lopakhine a intégré, comme Tchekhov le souhaitait, le monde des maîtres, mais ainsi la différence s’efface trop et le nécessaire principe alternatif qu’il incarne manque. Lopakhine appartient à cet univers en blanc dont il devient un des protagonistes sans qu’il apporte cette identité autre qui révulse et séduit tout à la fois. Rien ne le distingue des maîtres ... l’excès d’assimilation nuit autant que l’excès d’éloignement. La difficulté vient de là, de la nécessité de jouer les deux. Lopakhine a vu Hamlet qu’il a trouvé "très drôle" ... Serait-ce parce qu’il a reconnu dans les hésitations du prince celles des maîtres qui l’agacent ? p.86 Lucian Pintilié, le premier, a reconnu chez Lioubov la parenté avec Winnie d’Oh les beaux jours qui lui succédera, mais si l’héroïne beckettienne s’enfonce dans le sable, chez lui, la maîtresse russe se laisse engloutir dans un champ de blé. C’est de là qu’elle lève les yeux vers le ciel et égrène, de même que chez Beckett, la somme d’insignifiances que peut constituer une vie. Le blé, sable doré ... Pintilié raconte l’origine de cette métaphore: un jour, conducteur débutant, il rata un virage pour atterrir par miracle dans un champ de blé où il s’enfonça comme dans un matelas béni. Dans l’abri protecteur du blé, il déclina fugitivement sa vie. L’accident fut converti et intégré, comme chez les poètes, dans la mise en scène qui ainsi, à l’insu du spectateur, préservait une trace autobiographique. De ce spectacle, ceux qui l’ont vu n’ont pas oublié le champ de blé où Lioubov, telle une poupée de porcelaine, avouait ses fautes et invoquait le pardon. "Beaucoup de péchés lui sont remis parce qu’elle a beaucoup aimé." (Luc, VII.) Si, chez Pintilié, Lioubov s’assoit dans le champ de blé qui recouvre le plateau, chez Stein elle se hisse au sommet d’une meule de foin comme une reine en équilibre fragile, encore entourée par la cour, mais près de la chute ... Dernières heures d’un royaume qui s’effondre et d’une reine vouée à la déposition imminente. […] Qui est adulte ici ? Lopakhine seul. .. et encore, lui aussi ne cesse de combattre avec l’enfance, de se la rappeler, de la revivre. Au fond, seul Yacha répond aux données de l’âge adulte ... lui qui p.87 rejette sa mère et entend conduire son destin de main de "maître". Peut-être que la pièce parle aussi de cela: si ces personnages séduisent autant c’est parce qu’ils n’ont pas abandonné tout à fait l’enfance, parce qu’ils en portent encore l’empreinte. Ne pas se fier aux commentaires formulés sur Pétia à partir de ce que subtilement lui-même avance en premier. Varia, en l’appelant "monsieur mité", ne fait que reprendre le récit de la dame qui, dit-il, dans le train, l’a traité ainsi. .. Il se qualifie d’ ‘‘éternel étudiant" et les autres n’hésiteront pas à abuser de cette désignation désobligeante. Pétia pense désamorcer l’ironie des autres à son égard en étant auto-ironique, mais, signe d’une certaine cruauté, les noms dont il s’affuble se retournent, comme un boomerang, contre lui. Personne n’a la discrétion de les lui éviter. Et s’il s’agissait d’une stratégie plus subtile ? S’il détournait délibérément l’attention sur les détails afin de camoufler l’essentiel ? Est-il simplement un gauchiste radoteur ? Pourquoi ne pourrait-il pas être un terroriste qui cherche refuge ici, loin de ses attentats ? Ceux-ci se multiplient à l’heure de La Cerisaie et les étudiants en sont les principaux initiateurs. Il serait plausible de lire Pétia en se rappelant la pièce de Camus, Les Justes; elle évoque un contexte et désigne une autre famille de choix, autrement plus violente que celle, molletonneuse, du verger. S’il accepte de raconter aux habitants d’une province éloignée des récits sur l"‘avenir radieux", par ailleurs il endoctrine Ania. Pétia adopte le type de cooptation pratiqué par les cercles secrets qui, conscients de ne pas pouvoir toucher les foules, cherchent à sélectionner et à convertir les élites prêtes à se sacrifier pour la cause. Pétia a gagné Ania. Il ne repart pas seul. p.89 Gaev, Pétia ... deux générations réunies par le même besoin de discours. Parler, c’est une jouissance. Non pas badinage banal, conversations de commères, mais projection historique, engagée et responsable. Des personnages qui se dérobent à eux-mêmes pour se placer toujours du côté de l’impersonnel et de la vision prospective. Le discours est un substitut érotique ... ils se satisfont du plaisir produit par la rhétorique développée. A ces deux asexués, leurs paroles suffisent. Gaev et Pétia - des séducteurs séduits. Grâce au discours du jeune pédagogue, Ania non seulement changera d’opinion, mais éprouvera aussi la révélation du désir qui surprend et déroute Pétia. C’est ce que montraient deux metteurs en scène bulgares, Mladenova et Dobtchev, lorsque, à la fin du deuxième acte, la jeune fille cessait d’écouter pour enlever ostensiblement ses atours tandis que Pétia, indifférent à cette proposition inattendue, jouissait seul en formulant ses rêves futurs. A Ania, les mots ne suffisent plus ... mais ses avances restent sans réponse. Le discours, par son engagement, engendre de l’érotisme, tandis que l’orateur reste étranger à d’autres satisfactions que celle de la parole proférée. Elle est source uniquement de sensualité orale, de même que les caramels pour Gaev. L’oncle laissera apparaître, par ailleurs, sa sensualité olfactive qui lui rend répugnante l’odeur de Yacha ... l’homme parfumé au patchouli tant détesté, surpris par les maîtres après avoir fait éperdument l’amour à Douniacha, sent peut-être aussi le sperme mal essuyé qui révulse l’aristocrate vierge qu’est Gaev. Lopakhine se rattache au temps, les autres à l’espace. p.90 Ici tout est compté ... en jours, en minutes. Lopakhine regarde sa montre, les maîtres les astres. Mais tous savent que "le temps passe". Seuls les rythmes diffèrent. Il n’y a d’étudiant chez Tchekhov que dans La Cerisaie, mais son statut semble incertain ... les références tchékhoviennes à l’université sont source de disputes et de dérision, ici aussi bien que dans Trois sœurs ou dans Oncle Vania. Comment comprendre cette récurrence? Signe de déchéance chez Tchekhov : le territoire ouvert, sans clôture ni délimitation précise, finit en étendue dépourvue d’identité. La clôture tombée, qui permet aux musiciens de prendre un raccourci par la cour devenue lieu de passage, atteste la déchéance de la maison des trois sœurs ... et la cerisaie, elle aussi, semble avoir perdu ses vertus protectrices lorsqu’un mendiant surgit en pleine prairie parmi les maîtres. L’espace ne protège plus, il se délite. Le passant qui énerve l’assistance, confortablement allongée au milieu du pré, est sans doute tuberculeux. Il "toussote légèrement", indique Tchekhov qui ainsi, discrètement, fait s’introduire la maladie qui le minait. Plan sur l’auteur. .. le passant ne porte-t-il pas aussi cette casquette blanche si chère au reclus de Yalta qu’était Tchekhov? Le cycle cosmique : "GAIN. Le soleil s’est couché. ANIA. La lune se lève." p.91 Dans La Cerisaie de Mladenova et Dobtchev, une immense lune se détachait sur le cyc1o ... comme si ce monde passait sous le signe troublant de l’astre qui investit "une nuit d’été". Echo shakespearien? Roger Caillois observe l’existence d’un fantastique institutionnel qui entraîne la désorganisation des principes d’ordre, la déstabilisation de la cohérence et la ruine de la logique : le monde se fend, vacille, se dé-fait. Et cette déroute se trouve à l’origine des effets de panique et de perplexité que le fantastique institutionnel produit. Mais il y en a un autre, le fantastique insinué, qui, lui, signale des fêlures discrètes, des menaces souterraines, bref qui inquiète parce qu’il est à peine perceptible. Son émergence n’a rien de radical, elle pointe, dans un espace sécurisant, ou qui en a l’air, la virtualité d’un retournement possible, d’une secousse à craindre. Tchekhov, lorsqu’il fait résonner l’étrange bruit qui trouble l’assistance repue et détendue au deuxième acte, produit du fantastique insinué. Si celui-ci n’engendre nul écroulement du réel, il révèle par contre l’existence des signes que chacun interprète différemment, selon les relations qu’il entretient justement avec le réel. Le fantastique insinué permet à Tchekhov de lézarder un édifice trop sûr de lui-même et, partant, de décliner les rapports que les êtres réunis sur la prairie entretiennent avec le son non identifié. Il est un test. Si, d’abord, Lopakhine ne réagit pas au son de l’orchestre juif, plus tard, c’est le groupe tout entier qui entendra l’étrange bruit. Tous sont concernés. Et, inquiets, ils le commentent en proposant chacun une interprétation autre, esquisse cachée d’autoportrait . "LOIPAKHINE…peut-être dans la mine, une benne qui s’est détachée. p.92 GAEV. Ou peut-être un oiseau ... Un genre de héron. TROFIMOV. Ou un hibou. LIOUBOV. C’est désagréable. Je ne sais pas pourquoi. FIRS. Avant la calamité c’était la même chose. Le hibou hululait, et le samovar bourdonnait, ça n’arrêtait pas." Pour résoudre l’énigme, les hypothèses avancées diffèrent, mais, par-delà tout, un trouble s’installe. Lioubov et Firs, qui, chacun à sa manière, sont les plus concernés par l’inquiétude de la fin, le son ils le perçoivent comme tel: ils se désintéressent de la source pour faire état de l’effet. Le son concerne un souvenir et préjuge d’un avenir. Le fantastique insinué, souvent présent chez Tchekhov, a des ressources prémonitoires ... c’est ce que Firs rappelle et que Lioubov ressent. Les objets cassés, fendus, brisés ... autant d’annonces confirmées plus tard par le son de la fêlure finale, le son de la corde. Le thermomètre est cassé et la soucoupe se brise ... Je suis resté sourd à ces annonces furtives, comme on dit dans Trois sœurs, jusqu’à la mort du "père". Dans la nuit de son accident fatal, la montre s’est bloquée à 4 h 20 du matin ... est-ce que ce sera l’heure de sa mort ? Ensuite, de retour à la maison, une bouteille de vin rouge s’est brisée et la nacre de mon bouton de manchette s’est fendue en deux ... Langage de la perturbation, comme celui d’avant "la calamité" dont Firs se rappelle les signaux. Chez Lassalle, une pente en bois désigne le plein air tandis qu’à l’avant-scène l’on remarque une faille comme si la terre avait bougé, brisure destinée à annoncer le futur tremblement de terre: l’espace, tout en restant concret, s’avoue p.93 travaillé par des prémonitions dont il nous livre discrètement les signes. Dans un roman de Kawabata, comme ici, la montagne gronde, prémonition funèbre. Ceux qui l’entendent prennent peur car ils y reconnaissent le signe de la fin à venir, comme si de même que dans Shakespeare ou ... Tchekhov, entre la nature qui vacille et les êtres voués à la disparition, il y avait un lien secret, un accord rendu sensible. "Il ressemble, ce grondement, à celui du vent lointain, mais c’est un bruit d’une force profonde, un rugissement surgi du cœur de la terre ... Le bruit cessa. Alors Shinga fut effrayé. · Il frissonna comme si l’heure de sa mort lui a vait été révélée." Plus tard, l’appréhension sera confirmée: "Un jour notre mère a raconté que vous avez entendu gronder la montagne juste avant le décès de sa sœur." La cerisaie gronde aussi, frottement tellurique duquel chacun propose des interprétations distinctes, mais peu importent les écarts d’analyse: comme dans Kawabata, tous "frissonnent". Ils ont entendu le bruit qui, sur le plan visuel, aurait pour équivalent le fantôme ... un fantôme commun, le fantôme du lieu que l’on s’apprête à assassiner. Chez Strehler, ils s’avançaient alors vers l’avant-scène plongée dans l’ombre et chacun, rendu seul par la présence du son fantomal, scrutait inquiet l’obscurité de la salle sur laquelle le soleil s’était couché: ils avaient entendu "le grondement de la cerisaie", et ils n’étaient plus que silhouettes fondues dans le noir, comme dans le théâtre de Maeterlinck si cher à Tchekhov. Quand tout sera fini, la maison clouée et Firs abandonné, le grondement résonnera de nouveau ... désormais il n’y a plus personne pour p.94 l’interpréter, il confirme la chute déjà annoncée aux spectateurs qui, cette fois, deviennent ses destinataires. Les hypothèses ont cessé de se contredire. C’est le gémissement de la terre, craquement d’une fin de règne, qui fait de nous, spectateurs, les témoins de la cerisaie engloutie. C’est ce que Brook nous invitait à comprendre lorsque nous nous retrouvions, enfermés avec Firs, dans le théâtremaison, tandis qu’alors le second "grondement de la cerisaie" vibrait à l’extérieur sur le pourtour de la salle qui, ensemble, nous enfermait. Après la mort de ma grand-mère, longtemps les meubles ont continué à craquer. .. écho prolongé du grondement entendu avant la fin. Solution subtile de Zadek : pour tempérer l’élan du discours annonciateur des temps nouveaux de Pétia, il place de profil le jeune couple qui, cette fois, reste éloigné de l’avant-scène. Il ne s’adresse pas à nous, mais à un espace démesuré, chambre sans écho des coulisses qui évoque l’étendue russe. Sans dérision aucune, le spectacle désamorce l’optimisme du discours. Dans le spectacle du Trusttheater, c’est d’un groupe d’errants que se détache le visiteur du soir. Il n’est pas seul, il appartient à une communauté sans domicile ni ressources. Cette solution inscrit le passant dans une dérive de masse et désigne un phénomène de société. p.95 Lors de la fête c’est Trofimov qui tire « la dame de pique ». La mort, la mort pour celui qui ne parle que d’avenir. Et lui qui a lu Pouchkine et n’ignore pas la prémonition de la carte maudite, qu’éprouve-t-il ? Aujourd’hui, nous pouvons imaginer Pétia abattu un an plus tard, en 1905, lors du fameux dimanche sanglant qui aurait pu lui apparaître comme une confirmation de ses pronostics… au prix de la fatale « dame de pique ». […] Pétia ne se contente pas de parler, il passe à l’acte, fût-ce pour mourir. p.98 Epikhodov et Dachenka, la fille de Pichtchik, imitent, eux, non pas tant les maîtres russes que les idées maîtresses de l’Occident - dérision chère à Tchékhov -, exaspéré tout autant par les excès des russophiles que par ceux des « occidentalistes » de la fin du siècle. A travers ces deux « précieux ridicules », il laisse reconnaître son inquiétude à l’égard d’une occidentalisation précipitée qui renvoie à ce que l’on a appelé « les formes sans fond », pour désigner justement ce désir de rattachement superflu à un Occident érigé en modèle. Tchekhov n’invite pas à se replier sur le fondamentalisme slave, mais il ne s’interdit pas d’indiquer les risques identitaires qu’encourt toute affiliation trop rapide aux valeurs p.98 étrangères, calquées, importées… Epikhodov et Dachenka en apportent la preuve. p.99 […] Douniacha tombe en pamoison comme les grandes dames et Epikhodov parodie le discours des « décadents »… ils ne parlent pas, ils sont parlés, aliénés par l’assimilation à un modèle surévalué. p.99 Vakhtangov est le premier qui parle à propos du troisième acte de « festin pendant la peste ». p.99 Belle indication de mise en scène : « Faites la fête, saoulez-vous, mangez, jouez aux cartes, mais, sans arrêt, regardez la porte d’entrée. » p.99 Stanislavski, au moment de la fête, insiste sur la condition modeste des invités. p.99 « la fête pendant la peste » : elle permet d’apaiser la panique de l’imminente nouvelle funeste. p.100 La fête - divertissement pascalien. Chez Strehler, elle semble être imprégnée par l’humeur mélancolique de Lioubov. La musique parvient comme assourdie, retentissement lointain de la tristesse qui enveloppe la famille et que Charlotte, un instant, réussit à faire oublier grâce à ses numéros ... Chez Karge et Langhoff, les danseurs envahissent la maison et traversent sans arrêt la pièce où la maîtresse et le pédagogue se disputent, tandis que chez Brook ils restent séparés de la fête qui bat son plein. Si elle devient, chez Serban, déferlement paroxystique, chez Zadek, elle finira en banquet dérisoire, carnaval médiocre, décomposition débridée. Le divertissement, vertige de l’oubli. .. on s’y engouffre, on y plonge, on s’y réfugie. Contrepoison indispensable à la lemme étranglée par la peur. S’abandonner à la fête, c’est dresser un barrage de fortune face à la tempête depuis longtemps annoncée. Dans La Cerisaie, il n’y a pas d’enfant... mais Zadek en introduit lors de la fête. Enfants déchaînés, capricieux, imprévisibles ... rien de tendre, la cruauté même, l’arbitraire absolu. Echo des enfants de Natacha qui terrorisent la maison des trois sœurs et que tout le monde déteste car la nouvelle maîtresse s’en sert pour mieux asseoir le pouvoir auquel ils servent d’alibi. C’est à eux que Zadek pense lorsqu’il les multiplie dans la salle de bal érigée en antichambre de la chute attendue. Enfants sauvages, indomptés, destructeurs. p.100 Au début de l’acte, dans le spectacle qu’elle offre, Charlotte simule la vente qui va réellement avoir lieu au terme de l’acte. Double vente, d’abord ludique, ensuite tragique. Chez Braunschweig, lorsque Varia interpelle l’assistance en demandant: "Qui veut acheter ?", Ania surgit de derrière la couverture qui la dissimule en ayant sur l’épaule une branche de cerisier. .. symbole de l’imprégnation autant que de la perte à venir. Ainsi le spectacle de Charlotte s’érige en lever de rideau pour l’autre, terrible, dont Lopakhine fera le récit à son retour. La pomme que Lioubov mord lors de la fête dans le spectacle de Strehler ... elle invite à cette lecture à trois niveaux que le texte tchékhovien permet et réclame. La pomme comme signe qui atteste la pénurie de la maison. Absence de plats, manque d’abondance, confirmation du désastre économique. Mais la pomme renvoie aussi à l’identité de cette Lioubov strehlérienne réfractaire à l’alimentation, prisonnière de sa minceur, comédienne de sa fragilité. Une Lioubov qui se dérobe aux pratiques nutritives habituelles (d’ailleurs ne reproche-t-elle pas à Gaev, après le repas au restaurant, l’abus de consommations ?) pour les réduire à un simple exercice décoratif. Mais la pomme renvoie aussi au troisième registre ... celui de la parabole biblique, pour reprendre les termes de Strehler. Lioubov désabusée croque la pomme quelques instants avant même d’apprendre le résultat de la vente, synonyme d’exclusion du paradis. Paradis perdu par péché, paradis racheté par fascination. Désormais, entre Lioubov et Lopakhine, les êtres dont les initiales, un double L, s’enlacent, il n’y aura plus de rencontre possible. "Les vrais paradis sont les paradis qu’on a perdus", disait Proust. Lioubov se voit dépossédée du paradis que Lopakhine va abattre: deux exclus. p.101 Lioubov, lors de l’altercation avec Pétia, scène qui rappelle l’autre conflit, d’Arkadina et de Kostia, oublie qu’auparavant elle écoutait avec délices les prévisions sur le futur de l’étudiant utopiste pour lui interdire maintenant, en raison de son manque d’expérience amoureuse, tout commentaire à l’égard de son comportement. Il pouvait pérorer sur l’avenir, mais il ne peut émettre nul jugement sur le passé de la maîtresse en déroute: voilà la contradiction de Lioubov ! Lorsqu’il s’agit de destins personnels, seul le vécu, dit- elle, accorde le droit au jugement moral. Cette dispute s’avère être la pierre d’achoppement de presque tous les spectacles. Serait-ce en raison d’un vice d’écriture ? d’une découverte trop explicite des personnages ? Trop lyrique ou trop dramatique ... Pour contourner la difficulté, la plupart des metteurs en scène la scandent par les traversées des danseurs agités. Une manière de l’interrompre. Ainsi son intensité extrême s’apaise et la solitude des deux adversaires irrités s’accroît. A entendre les paroles qu’ils se jettent à la figure avec une violence digne de Strindberg ou, plus tard, de Tennessee Williams, au-delà de la surprise, nous percevons l’opposition irréductible entre deux points de vue paritaires. Tchekhov fait du théâtre des idées dans le sens où Vitez l’entendait: chaque position bénéficie d’une égale légitimité. Il faudrait jouer cette équivalence entre le jugement moral dont Pétia s’arroge le droit et le vécu dont Lioubov exige la caution pour tout discours. Souffrir d’abord et ensuite seulement parler, dit-elle. Pétia conteste pareil préalable: l’expérience ne doit pas s’arroger le droit de censurer l’appréciation et le commentaire sur les comportements des êtres. Deux positions équivalentes qui refusent de transiger. .. comme Electre et Chrysotémis. Zadek exaspère l’agressivité de Pétia à l’égard de Lioubov pour des raisons d’affectivité déçue; il p.102 l’aime. Ainsi on avance un argument au conflit, mais au prix d’un affaiblissement de la parité des deux postures qui, par Lioubov et Pétia interposés, s’affrontent. La scène de la fête, les metteurs en scène l’ont compris, ne peut plus se résoudre sans un traitement cinématographique qui permet au premier plan et au second plan de dialoguer, de s’interpénétrer, bref d’interdire au conflit entre Lioubov et Pétia de s’installer comme une grande "scène à faire". Les danseurs, la musique, tout doit l’interrompre, le perturber pour en faire un épisode produit et exaspéré par cette fête de malheur. Chez Strehler, ce qui frappe c’est la raréfaction de la nourriture, l’absence presque absolue de tout aliment. Par rapport aux indications du texte, Strehler n’introduit qu’une seule référence alimentaire: la pomme que mord cette Eve chassée de son paradis qu’est Lioubov. Cela le distingue radicalement de Zadek ou de Karge et Langhoff chez qui les aliments envahissent le plateau, le polluent et l’encombrent. La mise en scène allemande exige souvent de la matière: le discours passe par là. Par sa présence, et non par son absence. Une exception: Grüber. Au troisième acte, Zadek prépare la vente par une véritable déclinaison des motifs de la destruction, nourriture renversée, confettis dispersés, portes ouvertes, tasse à thé brisée ... la déroute du lieu comme figure de celle des êtres. Danses violentes, séduction dérisoire de Yacha avec son sempiternel refrain Valentine, tandis qu’au loin on perçoit parfois Lioubov qui arpente le salon comme une louve harcelée. Elle passe d’ailleurs de p.103 la gaieté névrotique à cette inquiétude profonde qui culminera avec le hurlement d’une poignardée, jailli de ses entrailles au terme du récit de la vente. Si ailleurs, chez Brook, Strehler ou Stein, elle pleure, ici Lioubov, un instant, accède au cri tragique. Cri antique. Lopakhine alors veut la consoler, en la caressant comme autrefois, mais la victime se dérobe avec violence aux attouchements de son assassin. Elle devient "intouchable". Signe de défaite qui confirme la victoire incomplète du nouveau maître. Yacha dans la salle de billard de Gaev ressemble aux deux envahisseurs de Biderrnann et les Incendiaires de Max Frisch. Comme eux, il investit progressivement la maison qui ne résiste pas à ses assauts. Lopakhine, autrefois rejeté au seuil de la cuisine, a conscience des progrès enregistrés, au point d’éprouver encore sa présence dans la maison comme transgression justifiée seulement par la réussite économique qu’il affiche, tandis que Yacha, libre de tout interdit, se meut sans réserve dans l’espace familial et surtout ne se décide jamais à retourner à la cuisine où sa mère l’attend. Indifférent aux normes et aux frontières aussi bien dehors que dedans, sans nul sentiment d’exclusion sociale, lui, le serviteur nouveau, confirme ainsi la crise généralisée des valeurs. L’’’incendiaire’’ de demain, c’est Yacha. D’ailleurs Vitez, expert de l’Union soviétique, voyait dans Yacha, et non pas dans Lopakhine, le futur maître, un arrogant dirigeant communiste. Dans le spectacle de Zadek, Yacha s’affiche avec ostentation comme un Parisien directement issu d’un tableau de Renoir, séducteur à souhait grâce à une chansonnette montmartroise ... rengaine manipulée avec adresse par le valet qui p.104 sait profiter de son aura de voyageur revenu de Paris. Si Douniacha mime la maîtresse, ici, plus que nulle part ailleurs, Yacha mime la France et sa mythologie. Il laisse supposer une intégration dont nous, spectateurs, nous pouvons douter, mais non pas les jeunes filles de la lointaine province russe. Le procédé réussit aussi en raison même du désir intense de Yacha de dépasser sa "russité", de se constituer et de se présenter en étranger chez lui. Ainsi il finira par caricaturer l’occidentalisme que Tchekhov stigmatise et que Zadek exacerbe. Yacha vend une image. Et les femmes, toutes, y succombent. Yacha sait la portée que peut avoir à la propriété son allure européenne ... c’est l’équivalent d’un titre de noblesse. Et il s’en sert de même qu’autrefois don Juan face aux deux jeunes paysannes, excitées par le prestige de leur séducteur. Par son français rudimentaire, Yacha rappelle la Natacha des Trois sœurs qui, elle aussi, singeait la langue des salons. A l’opposé, on peut remarquer l’absence de toute insertion de français dans le parler de Lioubov qui, elle, échappe au moindre dérapage linguistique et se préserve de toute déroute de vocabulaire. Si le français n’affecte pas son russe d’origine, la maîtresse sacrifie tout de même la coutume slave du thé sur l’autel parisien du café. Ainsi elle transporte au fin fond de la Russie, déjà visité par des capitalistes en quête de marchés, les coutumes de la ville où, chaque fois, elle s’enfuit affolée, attirée par sa lumière comme un aveugle papillon de nuit. Les impressionnistes servent de référence plastique aux metteurs en scène. Ils ont compris que Tchekhov jouit à Yalta du plein air que les peintres français avaient découvert à Paris. Lioubov et Ania apportent la trace de cette victoire sur l’intérieur ... et Yacha en fournit la preuve dérisoire p.105 car il incarne le modèle de ces personnages secondaires qui pullulent dans les toiles de Renoir. Varia, crispée et insatisfaite, dévouée par programme et béatifiée par auto proclamation, se défoule. Elle poursuit, avec un énervement démesuré, Epikhodov fautif d’avoir brisé la canne de billard, elle se rebelle contre l’inaptitude à l’économie de Lioubov, elle jette à Pétia ses caoutchoucs introuvables, elle effraie Lopakhine en ouvrant avec rage son parapluie ... De la nécessité de jouer l’humilité et l’agressivité, double visage d’un être non réconcilié avec lui-même, ni avec son sort. Elle se place toujours en porte-à-faux et passe, avec une inconséquence qui la rend insupportable, de l’excès d’affectivité à l’autre excès, revanchard, répressif, excès de frustration. Lorsque Lopakhine rentre, Varia, par mégarde, le frappe avec la canne de Firs. Ce sera pour la dernière fois. Procédé farcesque chargé d’une souterraine force symbolique. En termes brechtiens, on pourrait y déceler un véritable "gestus social". Le concret de la canne du vieux serviteur malencontreusement manipulée - mais les actes manqués, on le sait, ont aussi leur logique ! - dit à lui seul le retournement radical qui vient de se produire. Tchekhov a eu l’intuition du "gestus social" et les metteurs en scène ne doivent pas le laisser inaperçu : un destin historique se donne à lire. Gricha, son enfant, se noie ... puis, son amant, Lioubov le ressent comme une "pierre autour du cou ... elle m’entraîne, je me noie, mais j’aime cette pierre". Amour, deuil, noyade : souvenir de l’eau noire bachelardienne. p.106 Au troisième acte, Pétia, après la dispute avec Lioubov, tombe dans l’escalier et Lopakhine en sortant renverse une petite table : symptômes de l’état de crispation qui fait perdre au corps ses réflexes et ses repères. Ce discours-là est encore plus éloquent que toute autre prise de parole. Tchekhov le sait et il l’emploie. Le metteur en scène, sans procéder à la moindre agression à l’égard du texte, peut parfois produire du sens seulement par l’introduction des personnages que l’auteur n’avait pas prévu de faire se rencontrer dans une scène bien précise. Ainsi, dans la fameuse, et toujours ratée, scène de la confrontation de Lioubov et Pétia, scène violente sans refoulement ni censure, Lassalle introduit Firs, témoin sourd à l’impudeur des autres. Entend-il ce qu’ils se disent, ces êtres qui s’entre-déchirent ? Brusquement, ce qui tenait du conflit duel, par la présence de ce tiers devient scène à double fond pour une salle qui en prend conscience. La mise en scène engendre non pas de la sécurité, mais de l’ambiguïté. Chez Zadek, lors du même conflit entre Lioubov et Pétia, au deuxième acte, un invité oublié dans un fauteuil s’efforce d’apprendre le poème sur Marie Madeleine, double de Lioubov, qu’il projette de réciter devant l’assemblée ... et, plus tard, Ania, promise à Pétia, se glisse dans la chambre et assiste, ignorée par les protagonistes, à ce qui n’est ici qu’une dispute agressive d’amants à peine dissimulés. Si le récitant reste indifférent au conflit, Ania, blessée, l’éprouve comme double trahison, de la mère aussi bien que de Pétia. Et, meurtrie, elle s’enfuit. Stein procède selon un principe similaire lorsque, dans la scène des adieux du quatrième acte, il fait entrer Lopakhine pendant que Lioubov et Gaev s’embrassent. .. Il est "le troisième homme". Nous ne sommes plus les seuls témoins car, p.107 entre la scène et la salle, quelqu’un d’autre s’insinue et corrige ainsi notre propre regard. Ces mutations modifient le climat et relativisent les relations autant que la portée des paroles. Ici il y a un messager qui précède les protagonistes, mais, comme dans la tragédie, dont Tchekhov connaissait bien les principes, les prophéties de Tirésias ne sont pas entendues. A la propriété, personne non plus ne saura ni retenir, ni faire parler le passant chargé de la terrible nouvelle. Qu’en savait-il ? D’où ? Comment l’a-t-il appris ou ... deviné ? Le secret reste entier et il déstabilise, un instant, les données concrètes de la situation. Comme lors du son non identifié au deuxième acte. Tchekhov ouvre avec parcimonie, mais il ouvre ces brèches vers l’inconnu au cœur même d’une situation réaliste. Ce contraste qu’il pratique empêche l’affiliation trop soumise de l’œuvre à une esthétique ou à une autre: il ne cherche pas à les fondre, mais, fugitivement, à les faire alterner. Une autre possibilité de traitement de la fête: comme nous l’apprendrons à leur retour, Gaev et Lopakhine étaient attendus plus tôt, mais ils ont raté le train ... de là l’exaspération de Lioubov, perturbée par ce retard qui prolonge indéfiniment l’attente. La fête alors pourrait se languir, n’en finir pas de mourir car elle a été conçue comme parade minutée contre le désastre. Mais les protagonistes de la vente ne viennent pas et, épuisée, elle décline ... Parmi les danseurs désemparés, un récitant éberlué, Douniacha avec ses délires de transgression sociale ou Pichtchik qui fait le pitre tandis que Charlotte a tiré depuis longtemps sa révérence ... tout s’étire ! Même Pétia et Lioubov s’accrochent par désœuvrement. p.108 Il se fait bien tard lorsque Lopakhine arrive, 10 h 30 du soir. La nuit commence. Firs a toujours froid. Comme les vieilles gens que rien ne peut plus réchauffer. L’utilisation du hors-champ. Les événements n’ont plus lieu à la propriété et le centre s’est déplacé à l’extérieur. De là reviennent les protagonistes ... Désormais jusqu’à la cerisaie ne parviennent plus que les échos des actes accomplis ailleurs. Spatialement, le verger a perdu sa centralité symbolique. Il est devenu marginal et, déserté par les maîtres, il sera réduit à un lieu de loisir. Il se décompose et s’anéantit. Gaev, "un grand enfant qui ne peut se passer de laquais", disait Stanislavski. Observation importante: elle enlève tout ridicule aux soins prodigués par Firs qui, lui, a compris la nature de son maître. Gaev se montre agacé par les précautions constantes du valet. .. sauf une seule fois, après la vente! Alors, il demande à Firs de l’accompagner, preuve d’un épuisement qui rend nécessaire la sollicitude encombrante du vieux serviteur. S’il le soupçonnait auparavant de vouloir l’infantiliser, maintenant, pour de vrai, il appelle à l’aide: il faut jouer cette défaite secrète. On doit imaginer Gaev seul, en ville, fonctionnaire sans serviteur. Imaginer son inaptitude à s’accommoder du quotidien, à se débrouiller, à gérer un ordre autrefois surveillé presque avec maniaquerie par le valet dévoué ... Ainsi le maître perd définitivement son enfance car avec Firs disparaît le dernier être pour lequel Gaev restait jeune. Vieillesse prématurée d’un banquier voué à l’échec. p.109 Après le succès de la vente aux enchères, Lopakhine boit du cognac, de même que, plus tard, afin d’honorer le départ, il va offrir du champagne. Sans adopter le comportement simiesque de Yacha, lui aussi subit l’attrait de la France. Elle se situe toujours du côté des plaisirs. Si le nouveau maître rentre grisé, Gaev, lui, avoue n’avoir rien pu consommer en ville. Mais cela ne l’empêchera pas d’apporter un "petit cadeau" ... cadeau lié à un plaisir culinaire, à un raffinement nutritif. Gaev vaincu sauvegarde, par sa dernière attention, une valeur qui lui était chère: l’amabilité. Et Tchekhov apprécie cette gentillesse qui se dit par de petits cadeaux : si dans Trois sœurs l’immense samovar offert par Tcheboutykine exaspère Irina, les carnets, les crayons et les broutilles apportés par Fédotik la touchent. Par contre, Zadek, en rien sensible à la lassitude de l’oncle défait, lui fait porter une boîte conséquente, tandis que dans toutes les autres mises en scène la miniaturisation du paquet rattache le geste de Gaev à une attitude plutôt esthétique, contraire à la violence du pouvoir économique affichée par Lopakhine. C’est le dernier rempart du maître qui fut. Lorsque Lopakhine annonce le résultat de la vente, Varia se rend en jetant les clefs. A ma mère, lorsqu’elle avait à peine dépassé les vingt ans - une sorte d’Ania -, les nouveaux maîtres sont venus réclamer les clefs. Elle restera à jamais orpheline de ses clefs ... Ce souvenir traverse ces pages, comme l’autre, celui du froid qui s’est [installé à la mort du "père". L’hiver d’une classe, l’hiver d’une vie. Les émissaires du pouvoir en place auraient pu forcer les portes, fracturer les serrures, mais non, ils réclamaient les clefs, symbole de reddition sans condition, de capitulation et non pas d’armistice. C’est ce que dit Varia en lançant rageusement ses p.110 clefs, geste que Lopakhine commente, pour une fois, avec grossièreté. Elle se démet d’un pouvoir, certes, affaibli, mais tout de même pouvoir, au profit du vainqueur, son hypothétique et incertain fiancé. Ma mère aussi rendait ses clefs à de jeunes gens dont elle aurait pu être éprise ... mais chacun se trouvait dans des camps inconciliables. Seul échange possible, les clefs, preuve d’une victoire légale ou qui au moins en a l’air, victoire consentie qui suspend tout désir. Ce deuil-là attend Lopakhine, désormais inapte au désir de même qu’indésirable. La vente accomplie, Lioubov ne se préoccupe pas du montant du prix obtenu, mais seulement du nom de l’acquéreur. Qui sera son successeur? Qui l’a déposée? Tout est alors une question de personne, et non pas de roubles. Une fois la cerisaie perdue, Lioubov comprend que pour elle il n’y aura plus de lieu de retour. Elle bascule dans l’exil définitif. Tchekhov s’est toujours montré réservé à l’égard du romantisme des états d’âme excessifs et il ne faudrait pas oublier cette méfiance teintée d’ironie lors du récit de la vente. Stanislavski, par contre, n’envisageait nulle retenue et demandait que Lopakhine se mue en "héros de légende", comme s’il entrait dans le conte qu’il s’est raconté lui-même depuis des années. Ainsi il confirmait la prophétie sur les géants nécessaires, prophétie tournée en dérision lors de la partie de campagne. Le passé non seulement prend sa revanche mais s’accomplit aussi comme une mythologie personnelle. p.111 Le récit de la vente, c’est la pièce maîtresse, car ce qui se joue là concerne le passé autant que l’avenir, la haine résiduelle irrésolue, le transfert fantasmatique de même que la perspective rassurante d’un projet financier solide. Lopakhine paie les dettes de la cerisaie pour faire payer aux maîtres les dettes de classe. Mais il confirme, implicitement, avoir livré bataille pour le verger en raison aussi de l’intériorisation du discours des maîtres, car ne pense-t-il pas avoir acheté "la chose la plus belle du monde" ? Il excède ]’argument du Dictionnaire encyclopédique invoqué par Gaev : Lopakhine hypertrophie les propos des maîtres. Chez lui, la motivation économique et l’autre, symbolique, se joignent dans ce nœud d’aveux qu’est ]e grand récit. .. récit non seulement de victoire mais d’échec aussi car "le nouveau maître" sait qu’au prix du pouvoir acquis, il s’éloigne à jamais de celle qu’il aime comme quelqu’un de sa famille, "même plus que ça". Lopakhine est au cœur d’un écartèlement violent que seuls certains interprètes parviennent ~l rendre. Il s’agit de clamer une victoire et également d’admettre une défaite. Dans le spectacle d’Anatoli Efros, la danse folle de Vyssotski LLÎsait trembler les fondations de ce monde OlI les êtres errent parmi les cerisiers et les stèles funéraires: alors se réveillait en ]ui une pulsion enfouie, se libérait un ressentiment qui sommeillait, et ainsi s’accomplissait, des années plus tard, la revanche du père. Sans réserve ni pudeur, soutenu par le son de l’orchestre juif que Lioubov avait engagé orchestre mercenaire qui change de camp -, ce Lopakhine-E’l f~LÎt déferler sa joie absolue. A la dose importante de cognac ingurgitée en ville s’ajoute l’impact de la musique qui intensifie l’excitation d’un Lopakhine plongé dans ]e récit comme dans un psychodrame OlI il joue son avènement à la classe des maîtres. Ici il raconte ]a vente autant qu’il révèle le désir secret qui l’emporta lorsqu’il se lança dans la vertigineuse course p.112 aux enchères: l’acte et l’aveu réunis. Au fond, cet interdit de parole qu’est Lopakhine, jusqu’alors plus à l’aise dans l’onomatopée, l’interjection ou la proposition brève, acquiert pour ]a première fois le droit au monologue. Il parle ... Le pouvoir fraîchement acquis fait tomber toutes ses inhibitions et en même temps impose l’écoute. Ecoute consternée, mais tout de même écoute et non pas comme jadis ricanement, dérision, voire même surdité ... Il déverse sur J’assistance un not de mots chargés d’une énergie physique inouïe faisant penser au jeune Essénine lors de ses célèbres débauches, où chant et destruction effrayaient les hôteliers des grandes maisons où Isadora Duncan, comme une Lioubov conquise, le conduisait. Il affirmait alors "le génie russe" face à un Occident dévalué, pareil à Lopakhine qui explose face aux maîtres anéantis. Sans nulle censure, il se libère en parlant. .. et le constat de victoire vient de cette éloquence qui auparavant lui était étrangère, de même que du silence qui s’instaure. Personne n’interrompt le maître ... sauf, au terme du calvaire, les sanglots de "la reine" déposée. Maintenant, ce sont les maîtres, comme jadis Lopakhine, qui ne parlent plus. Ce déplacement de l’éloquence d’un camp à l’autre est un "gestus" verbal qui confirme la portée de la mutation qui vient de s’opérer. Niels Arestrup, dans la version de Brook, sans se lancer dans une danse tout aussi débridée que Vyssotski, fournit un récit plein de fureur et de passion. Il crie, traverse en courant le plateau, arrange avec hargne ses cheveux, essuie son visage humide, ouvre pathétiquement les bras face à une assistance stupéfaite. Celle-ci subit plus qu’elle n’écoute car, à J’exception de Lioubov prostrée sur une chaise au premier plan, les invités se sont réfugiés derrière les paravents et ne laissent apercevoir que leurs visages ébahis. Assemblée d’êtres paralysés par le retournement de l’ordre séculaire, réduits au statut de spectateurs rejetés p.113 sur les marges qui suivent la représentation d’un événement auquel Lopakhine, le protagoniste, par l’envergure de son jeu, accorde la plus extraordinaire importance. Un monde s’écroule et ils en sont les témoins. Craignant pour leur sécurité, ils se protègent en s’écartant face à la déferlante libération du nouveau maître. Lopakhine, comme le souhaitait Stanislavski, incarne alors un de ces "géants" dont vainement il essayait de faire l’éloge auprès des maîtres qui, au deuxième acte, se prélassaient, incrédules, sur la prairie. Ce qui alors semblait être une projection rudimentaire s’accomplit maintenant et Lopakhine affirme son aptitude à changer le cours de l’ancienne vie. Le romantisme de Lermontov, dont bizarrement le nouveau maître cite un vers, l’habite pleinement à l’heure du récit. Il est un héros et il en a l’énergie. L’achat du verger lui insuffle une vitalité hors normes. Mais, on le sait, les mots seuls ne comptent pas. L’impact dépend aussi de l’étrangeté de l’acteur. Etrangeté dans la mesure où il apparaît non seulement comme un bourgeois dévoreur - la version banale de la plupart des Lopakhines - mais aussi comme un étranger qui inquiète et fascine, pareil à un archange, destructeur et déchu ... Vyssotski, Arestrup. De grands comédiens solitaires. L’interprète de Strehler, Graziosi, se rattache par son identité corporelle à la communauté des maîtres et, physiquement, il en fait d’emblée partie. Il rejoint ainsi le souhait de Tchekhov qui insistait auprès de Stanislavski pour qu’il accepte ce rôle, afin d’échapper justement à la tentation première qui consiste à réduire Lopakhine à un nouveau riche mal dégrossi. Stanislavski refusa et ainsi s’instaura l’interprétation que l’écrivain craignait. Mais si Graziosi répond a priori au vœu de Tchekhov, il fait erreur en s’appliquant à jouer malgré tout une différence de classe que pourtant son corps nie. Certes, la situation est la même, mais il n’a ni la vitalité insoupçonnée p.115 de Vyssotski, ni l’érotisme sauvage d’Arestrup. Graziosi ne paie pas comme eux une dette de classe ... son corps a oublié ou a gommé son passé de serf. Strehler se trompe, il ne respecte pas les données d’un corps qui suppose un jeu autre. Ce Lopakhine aurait pu développer l’intuition tchékhovienne, mais en sacrifiant au goût pour l’excès d’une approche incompatible avec sa réalité physique, Graziosi échoue. La violence est feinte et l’intégration réelle; il est l’amant plausible de Lioubov, mais le démon de l’argent le détourne, voilà ce dont l’acteur strehlérien aurait pu témoigner. Lui, il rappelle que le rôle se nourrit du pouvoir des mots, mais aussi de la chair du comédien ... les deux communiquent. Ils sont indissociables. Zadek met en scène le récit de la vente sur un mode, à première vue, désabusé: rien d’exaltant dans l’évocation du combat, nul oubli de soi. Assis sur une chaise avec un porte-documents serré contre sa poitrine, ce Lopakhine-là ne hurle pas sa victoire contre le passé enfin dépassé, mais en quelque sorte fait le deuil de son romantisme pour se situer du côté des banquiers et des apparatchiks dont il se présente déjà comme l’évident précurseur. D’énergie, il n’en a plus, et pris dans "les eaux froides du calcul égoïste", célèbre formule de Nazim Hikmet pour désigner le capitalisme, il ne pense plus qu’en termes de stratégie financière. De sa mémoire, il a fait table rase, et l’achat du verger ne semble avoir pour lui guère d’impact sur le plan symbolique - ni revanche familiale, ni projection enfin résolue -, non, seulement une inespérée et éclatante victoire économique. Il est un bureaucrate de la finance. Zadek interdit à son interprète toute envolée afin d’assimiler Lopakhine à un homme d’affaires embarqué dans une aventure à l’issue incertaine. Elle l’a emporté, mais, l’enthousiasme une fois éteint, il se contente maintenant de la raconter sans la revivre. Rien chez lui ne parle d’une victoire ... Au p.116 romantisme du geste succède la lucidité du récit. Et à la revanche du passé, le désenchantement de ce qu’il pressent comme avenir. Enfin, solution plutôt scénographique, chez Stéphane Braunschweig, lors du récit, Lopakhine s’attelle à d’immenses praticables qui, théâtralement, désignent la cerisaie et qu’il s’efforce de déplacer, pareil aux serfs qui, dans un célèbre tableau de Répine, tirent un bateau de marchandises sur la Volga. Lui, fils de serf affranchi, finit en serf de la cerisaie. Cette victoire sur les maîtres le renvoie à son ancien statut. .. serf de son désir accompli dont le harnais symbolique lui écrase les épaules. De la cerisaie, il ne fera jamais l’expérience paradisiaque, il devra se contenter de son expérience prosaïque. Lopakhine, prisonnier du fantasme de la cerisaie comme "la plus belle chose du monde", pense le surmonter en la détruisant. Sa défaite vient de cette erreur d’analyse: il n’apprécie pas l’écart qui séparera à jamais une victoire économique d’un épanouissement symbolique. Il se piège lui-même. Il détruit son objet de désir. Le Lopakhine du Trusttheater, dans l’affolement d’une fête débridée, pose sur sa tête une couronne royale ... peu importe qu’elle soit de carnaval. Il dépose la reine et se charge des atours du monarque. Autour du récit de la vente se joue tantôt la libération explosive de Lopakhine, tantôt sa dépendance à l’égard de la propriété conquise ... affranchissement symbolique ou asservissement économique! Ce que l’on repère alors, c’est la fracture du personnage, son identité disloquée. Mais c’est justement ce qu’il faut jouer. Le génie de Tchekhov : c’est Pichtchik, le bouffon, qui s’approche de Lopakhine emporté pour lui réclamer plus de réserve. "Elle pleure" - seul le clown est sensible aux larmes de la p.117 maîtresse défaite et invite le vainqueur à se retirer. Le transfert de Lopakhine : pour lui la beauté de Lioubov - "toujours splendide" - se meut en splendeur inouïe de la cerisaie - "la plus belle du monde". Il peut acheter celle-ci faute de parvenir à l’autre. Succès qui camoufle un échec. Si pour Lopakhine la cerisaie est "la plus belle propriété du monde", ou, encore plus, selon le texte "la chose la plus belle du monde", pour Ania, ses vertus pourraient contaminer la Russie tout entière. Une même projection fantasmatique les apparente ... La vente de la cerisaie, ou sa perte, les maîtres chassés la vivent comme amputation d’un organe qui les laisse intérieurement infirmes. Les maîtres et Lopakhine par rapport à la cerisaie : différence entre un bien hérité et un bien acquis. Entre une mémoire et une victoire. Pour Lopakhine, Lioubov dont il ne parvient pas à oublier Je regard est "la bonne mère", et son désir inavouable s’arrête toujours au seuil de l’aveu ... La libération n’aura pas lieu. Oui, Lioubov peut demander qu’on lui prête de l’argent, jouer, séduire, mais, finalement, elle ne se rend pas et Lopakhine, qui n’est pas Rogojine, ne jette pas à ses pieds la cerisaie comme monnaie d’échange. Chez "le nouveau maître", la pulsion dostoïevskienne s’est affaiblie mais il en garde la nostalgie, surtout lorsqu’il parle des "géants", propos que les maîtres, satisfaits de leurs banales dimensions, tournent en dérision. Le romantisme leur reste étranger et ils donnent p.118 le sentiment de s’accommoder du réel qui, comble de l’ironie, leur échappe. La perspective des "géants" semble être inopérante et la "cruauté" tchékhovienne dont parlait Chestov se retrouve là aussi: il n’y a plus de place pour les passions vertigineuses qui agitent les personnages de Dostoïevski. Nous entrons dans la modernité ... Le Lopakhine de Brook se rattache plus à son passé et s’inscrit dans la filiation de Rogojine, le Lopakhine de Zadek, homme d’affaires replié sur lui-même, annonce plutôt l’avenir d’un gestionnaire de la propriété. Au moment du récit, chez Strehler, Firs épuisé s’assoit. Même lui ne respecte plus les règles. Ensuite Lioubov, vaincue, s’agrippe au vieux serviteur que Gaev, à son tour, appelle ... jamais il n’a été aussi indispensable. De la cerisaie perdue il ne leur reste que lui. "Musique, plus fort", exige, excité, Lopakhine. Premier signe d’une prise de pouvoir attestée simplement par l’exaspération de l’intensité sonore qu’il ordonne. Le nouveau maître n’impose pas un autre plaisir, à lui, mais entend confirmer sa mainmise sur le domaine par la simple surenchère du plaisir des maîtres. Faire crier les violons de l’orchestre juif - voilà la provocation de Lopakhine ! Si, au deuxième acte, c’est lui qui n’entend pas l’orchestre juif et Lioubov qui s’interroge sur la survie de celui-ci, au troisième c’est elle qui le convie, tandis que lui le met sous sa férule en lui réclamant non pas de jouer autre chose, mais, prosaïquement, de "jouer plus fort". Aucune invention, seulement une intensification. Les sons qui ne parvenaient pas aux oreilles de Lopakhine dans l’étendue calme de la prairie doivent vibrer agressivement dans la maison dont il entend ainsi confirmer la déroute. Agression acoustique contre p.119 la maîtresse qui, elle, cette fois-ci, se voit obligée de boucher ses oreilles pour échapper aux décibels d’un orchestre soumis aux ordres du nouveau maître emporté par sa pulsion totalitaire. La mise en scène peut ignorer les didascalies - combat depuis longtemps gagné - ou procéder, parmi tant d’autres hypothèses, à un travail de grossissement des indications, à ce que l’on pourrait désigner comme un "effet de loupe". En sortant, indique Tchekhov, le nouveau maître fébrile renverse une petite table et f~lit trembler un chandelier. Indication clinique: après avoir procédé au désordre sonore, il trouble, malgré lui, l’équilibre de l’espace ... Son corps affirme ainsi son pouvoir. Certes, la fièvre de la vente et l’effet du cognac expliquent cette motricité incertaine, mais le metteur en scène comprend que la didascalie de Tchekhov renvoie déjà ;1 un début de destruction. Destruction ainsi annoncée, de même qu’au premier acte Lopakhine prévenait les maîtres de la vente fatidique fixée au 22 août. Ce qui est à peine souligné chez Tchekhov, sous l’ ‘‘effet de loupe" va prendre, clans certaines mises en scène, une importance souvent démesurée, parfois même trop explicite. Ainsi, chez Strehler, Lopakhine quitte le plateau en renversant de manière volontaire et avec méthode, les unes après les autres, les deux rangées de chaises mises en place auparavant avec un soin minutieux par Varia, chaises dont Strehler, en se souvenant du texte de Ionesco, avait fait la figure de l’attente. On montre le désir de démolition ... Lopakhine s’y applique avec système. L’intention trop lisible provient de (‘effet de loupe qui convertit l’ambiguïté de ce qui pourrait être un accident, sans en être tout à fait un, en stratégie délibérée. Celle-ci s’imposera plus tard, à la fin, lorsqu’il ordonne que la cerisaie soit abattue ... tandis que la didascalie tchékhovienne, plus p.120 subtilement, ne fait que présumer de la destruction à venir. Pour l’heure, Lopakhine n’en est pas tout à fait conscient. Brook met en scène justement cette incertitude car, malgré lui, son Lopakhine renverse un des paravents qui dessinent le contour de la maison en faisant s’écrouler l’organisation spatiale, par ailleurs assez mobile, de la maison. Brook respecte Tchekhov et préserve ainsi le caractère fortuit de l’incident, tout en ajoutant une dimension supplémentaire : le paravent qui tombe entraîne dans sa chute le nouveau maître et laisse découvrir, comme des spectres, les invités livides, effarés par les débordements de ce Lopakhine débridé. Mais sa victoire s’annonce passagère, car le spectacle intègre déjà la chute future ... En détruisant, le gagnant d’aujourd’hui se détruit. Et de courte durée sera son triomphe. Chez Stein, lorsque Lopakhine ordonne à la musique de jouer plus fort, non seulement l’orchestre juif s’y conforme, mais avec lui l’assistance tout entière. Soumise et vaincue, elle se met à danser sur ordre du nouveau maître. Il ne rencontrera nulle résistance, la bataille de la vente une fois gagnée ... hallucinés, les invités dansent comme des automates, tandis que Lopakhine a déjà quitté la pièce en arrachant, avec violence, une applique. Il n’a plus besoin de se retourner pour s’assurer que son injonction sera respectée ... les musiciens hurlent, et les invités poursuivent au ralenti leur danse. Chez Zadek, dans une ambiance de déchéance et de perturbation extrêmes, les invités jettent les coquilles de noix par terre, Lioubov boit. .. et un groupe d’enfants agités accroche la nappe en renversant les verres. Le chaos est général. Lopakhine sort en titubant et il ne fait que répéter le geste des enfants : il ne se livre pas à un acte de violence caractérisé, il exaspère une décomposition déjà bien amorcée. Il participe à la logique de destruction mise en place avant son arrivée ... p.121 il signe la conclusion d’un processus. S’il arrache une nappe et fait tomber des lampes, Lopakhine n’agit pas délibérément, ni solitairement: l’accident tchékhovien le rattache à un désordre contagieux qui précède son intervention. La chute de la cerisaie n’en sera que le terme final. Dans les spectacles de Braunschweig ou d’Alain Françon, le symbole de destruction sera l’arrachage soit du rideau tout entier, soit d’un simple bout de rideau ... il s’attaque ainsi à la maison- théâtre. Et alors, brusquement, par-delà la fiction de l’œuvre, il est f~lcile d’identifier les agressions contre cet art menacé qu’est le théâtre et dont certains ont fait leur cerisaie intérieure. La cerisaie, notre théâtre. Lioubov écroulée, une fois le récit de la vente fini, Ania, comme autrefois à Paris, renverse les rÔles et se charge du soutien de la mère défaite. Solution antique, un instant retrouvée: la fille conduit le père aveugle. Ici, Lioubov aux yeux embués de larmes prend la place d’Œdipe aux yeux crevés, mais c’est toujours l’enfant qui accompagne vers la vie le parent tragiquement frappé. Inversion appelée par le désastre ... La mère, en acceptant le secours d’Ania, au foncl la réconforte car, comme lorsqu’elle parvenait à la convaincre cie retourner en Russie, la jeune fille éprouve de nouveau un sentiment d’utilité. Ania veut sauver ou servir. Chez Strehler, la mère et la fille, parées cie toilettes similaires, s’enlacent, au point que leurs coi/Tures se confondent et que leurs anglaises s’enrubannent. .. Ania encourage Lioubov en la contaminant par sa jeunesse. Par cette virtuelle relation sororale qu’Ania parvient, iIlusoirement, à retrouver, elle restitue à sa mère un âge définitivement perdu. Alors, pour la dernière fois, elles s’embrassent comme deux "jeunes filles en fleur" ... C’est ce dont la Lioubov de Strehler se sentait spoliée en apprenant la perte du verger blanc. 122 Chez Karge et Langhoff, la musique, à la demande du nouveau maître, braille désagréablement et, au plus fort de ces accords criards, Ania hurle ses mots de faux espoir. L’échec de ces encouragements est flagrant: on ne peut rien dire, aucune vérité ne se formule et tout prend l’allure d’un faux-semblant. Ania, investie par le discours de Pétia, ne fait que répéter les clichés ... langue de bois d’une utopie prête à porter. Deux étrangères, prochainement séparées, voilà ce que sont devenues la mère et la fille. Chez Serban, au-delà des mots fourvoyés, les ‘corps des deux femmes entretiennent l’espoir d’une sauvegarde commune. Ici il n’y a plus d’encouragement à sens unique, mais au contraire communication à double voie. Ania ouvre ses bras et rejoint les bras également écartés de Lioubov ... Alors en se touchant les paumes elles forment une sorte d’être bicéphale animé par le souft1e de leurs respirations synchrones. La mère et la fille partagent la même colonne d’air et, ensemble, survivent après le terrible constat d’échec. Belle métaphore que ce bouche-à-bouche oÙ Ania réanime, désespérément, sa mère. Et c’est ensemble, monstre hybride à deux têtes et quatre bras, qu’elles quittent la scène en faisant entendre, pardelà les mots, la fusion de leur souft1e. Respiration commune, double. Chez Zadek, Lioubov est une mangeuse d’hommes, elle les touche, les attire, mais après la vente tout appétit érotique s’éteint, comme si le désir désormais avait été entièrement mortifié. Elle est sevrée d’amour. Faut-il tout montrer ou, plus exactement, faut-il apporter la preuve littérale des changements à venir? Stein fait apparaître au loin, tel un fantôme, la ville qui se voit "par temps clair", comme l’indiquait 123 Tchekhov dans sa didascalie. C’est la source des angoisses et des peurs qui agitent les maîtres ... Cette ville industrielle scelle le destin du verger. Elle annonce l’ère ~l venir, menace qui se profile à l’horizon. Serban, plus encore, va faire paraître, lors des discours exaltés de Pétia, l’image géal~te de l’usine qui va engendrer le prolétariat voué à détruire ce monde. N’insère-t-on pas abusivement le discours d’une autre époque, l’utopie et son échec? Cette intervention massive de la ville trouble l’équilibre d’une œuvre qui parle de la chute d’une citadelle plus que des adversaires qui l’assiègent. Chez Stéphane Braunschweig, lorsque Lopakhine raconte la vente en se mettant, physiquement, sous le joug de la propriété fraîchement acquise, Ania porte sur l’épaule une branche de cerisier en fleur. Elle affirme son appartenance au verger qui l’a pleinement investie: Ania l’a fait sien davantage que sa mère éplorée. Et son identité se révèle en être indissociable ... la branche devient métaphore littérale de cette réalité qui la tient el la marque. Branche arrachée au verger et posée sur l’épaule de la jeune fille qui, justement, invite ses proches à s’affranchir de l’emprise que la cerisaie exerce sur eux ... Sa liberté n’est qu’un leurre car, en elle, le verger perdure. La branche de cerisier ne cesse pas de le rappeler. Les mots ne suffisent pas; on ne surmonte pas un complexe avec l’aisance d’un engagement utopique et, déposé en soi, il résiste ... Sous la doctrine inséminée par Pétia et qu’Ania ne fait que citer, voire même "réciter", persistent les résidus du verger jamais tout à fait enterré. La branche dénonce les illusions du discours de la jeune fille. Pétia n’a pas vaincu le complexe du verger. En même temps, la branche s’apparente à une aile d’ange. Second sens de cette métaphore littérale. Oui, en perdant la cerisaie, Lioubov perd son paradis ... chassée de là, elle pleure par terre, p.124 enveloppée dans les plis du rideau rouge, rideau qui, tout au long du spectacle, assimile le théâtre de la mémoire heureuse, lui aussi menacé, au verger mythique. Lioubov, comme une de ces stars dont elle emprunte le comportement excessif et la désinvolture ludique, Sarah Bernhardt ou Isadora Duncan, est emmaillotée par les langes de velours sang ... enfant ployée sur elle-même, interdite d’espoir, vouée à l’errance. Alors l’ange s’approche pour la réconforter. Mais de qui est-il le messager ? De quel "ciel verrouillé" arrive-t-il ? Ange du temps, intermédiaire entre l’Ancien et Je Nouveau, Ania enlace la femme exclue de son paradis ... et en même temps, par-delà des mots appris, la jeune fille s’érige en héritière de l’éden auquel sa mère n’a plus accès. L’aile-cerisier reste le sceau définitivement apposé sur ses épaules. p.125 Le courage du quatrième acte, Tchekhov l’a toujours eu, mais ici il est plus que jamais assumé. La pièce est achevée, le destin s’est accompli ... et pourtant il ose cette coda. Après la vente, après la chute ... Au premier et au quatrième acte, le temps est chaque fois qualifié d’exceptionnel pour la saison. Il "est sorti de ses gonds". Et de surcroît, comme dans une pièce de Beckett, la circularité règne: la températli’re ne varie guère, toujours moins trois degrés. Les maîtres ont trahi. Ici ce n’est pas sous l’effet d’une intransigeance de classe qu’ils s’écroulent. Bien au contraire, ils se sont adaptés, Gaev a fait siens les idéaux progressistes et Lioubov a pris pour mari un avocat au grand dam de la famille et surtout de la tante qui, elle, par contre, se refuse à ouvrir la moindre brèche dans le système parental hérité. Le frère et la sœur ne sont pas des gardiens incorruptibles des normes anciennes, mais des êtres de transition, à l’écoute des désirs, soucieux du progrès, opposés à la stagnation aristocratique. La Lioubov de Zadek, plus que toute autre, se comporte en maîtresse nullement distante : elle touche les hommes, se déshabille, affiche une désinvolture de femme indifférente à toute réserve. Parce que captive du corps, elle se rend expugnable, rejetable ... elle ne craint pas de se compromettre, elle se "livre" dans tous les sens du terme. Gaev, à son tour, ne se replie guère sur un discours archaïque. Ils ne s’opposent pas à l’histoire, ils pactisent avec elle jusqu’à l’instant où celle-ci s’accélère et les emporte’: La tante, figure tutélaire haïe, refuse toute alliance avec les temps nouveaux: elle résiste. Sa propriété ne sera pas déchiquetée par les coups de hache ... elle qui a dressé des barrages et écarté p.128 tout compromis, ne tombera que plus tard, sous les coups de butoir de la terreur révolutionnaire. Du côté des capitalistes, Lopakhine s’affirme, lui aussi, comme un être de transition puisque, à son tour, il se montre écartelé par des contradictions irrésolues. L’entente avec les anciens maîtres se fonde sur cette incertitude qui allie fascination et ressentiment. L’équivalent antinomique de la tante, personnage tout aussi détesté, c’est "le richard" Dériganov. Lopakhine entretient avec un de ses pairs la même hostilité qui régit les rapports des maîtres ayant essayé d’intégrer la modernité et de la tante inexpugnable. Ni elle ni Dériganov n’admettraient nulle intimité, nulle rencontre, cela est le lot des impurs ... de Lioubov et de Lopakhine. Et le retournement historique va s’opérer justement entre des êtres proches, et non pas distants, comme la tante et le banquier ... Là où les conflits ne s’exaspèrent pas, où il y a proximité et séduction, où les contraires se tiennent et où les mains s’effleurent. Cela procure sans doute cette douleur partagée et ce sentiment de victoire incomplète. Une seconde, par le jeu subversif d’une communauté indifférente aux affrontements de classe explicites, Lioubov, Gaev, Lopakhine ont cru pouvoir tromper l’histoire. Illusion, car ici, selon l’habitude, ce sont les êtres qui perdent, tandis que l’histoire, comme la mort, elle, gagne toujours. Destin qui scelle le complexe du verger. Tchekhov insistait sur le caractère "increvable" de Ranevskaïa ... elle a des "envies débridées" , et cette pulsion de vie se régénère constamment grâce à l’exercice de la dépense qui lui est constitutif. La dépense, chez Lioubov, prend le sens d’une liqueur de jouvence. Plus tard, les roubles dérobés à la tante seront dilapidés pour se consoler de la déposition vécue et résister en se refusant toute restriction sécuritaire. Lioubov p.129 confirme le fonctionnement ambivalent de la "notion de dépense". La fin ne résout pas le complexe du verger, elle l’ampute seulement et annonce des malheurs futurs en raison du règne de l’économique qui s’instaure. De ce règne, même Lopakhine ne se présente pas comme le pur défenseur car s’il combat Dériganov "le richard", c’est justement parce qu’il reconnaît en lui le partisan indéfectible de la pulsion économique. Parce que follement épris de la cerisaie, Lopakhine contrarie l’appétit de son adversaire et achète le verger, mais aussi parce qu’il reste prisonnier de sa propre logique, il le détruira. Passion dostoïevskienne, passion assassine ... Lopakhine est un nœud, un entredeux. Par cette incertitude, il se rattache au complexe du verger dont l’irrésolution, c’est certain, va int1échir son destin. Le départ de Lioubov engendre du refoulé et celui-ci sans doute reviendra un jour pour troubler, voire briser, ce Bolingbroke épris de la reine qu’il dépose. Lioubov, Gaev ont éprouvé le poids inéluctable d’une question sans réponse, d’une crise à l’opacité absolue. Mur infranchissable, l’imminence de la vente prend l’allure d’une inévitable fin, d’une incontournable chute. Ils dansent, parlent, s’abandonnent, mais toujours avec les yeux rivés sur cette ligne de fuite au-delà de laquelle se devine le deuil de la cerisaie mythique. Et avec celui-ci, le leur aussi. La vente les soumet à l’épreuve terrible du détachement. Cela libère et en même temps produit le vertige d’une absence, ravin où l’on peut se précipiter pour "faire une bêtise". Désormais nul point d’attache, nulle amarre, seul l’attrait du vicie qui s’ouvre. p.130 Le premier acte affirme la force centripète du verger, convertie au terme du quatrième acte en force centrifuge. La cerisaie ornementale attire, la cerisaie que l’on abat expulse. Au début, selon la fameuse lettre de Tchekhov dont Strehler s’est inspiré, des femmes vêtues de blanc disparaissent dans le blanc du verger. L’accord est parfait, la fusion absolue. Et, justement, là où une pareille union s’affirme, Lopakhine propose que l’on débite ce monde, que l’on lotisse l’astre blanc, que l’on désintègre cette unité qui à elle seule dit le bonheur. La parcellisation du verger, conseille-t-il, mais une telle issue implique l’effritement inacceptable, le sacrifice de la communion qui règne, perte de l’unité, bref, impossible désaveu de la force centripète exercée par la cerisaie. Et pourtant la catastrophe, une autre, pas celle dont parle Firs, arrivera. Ici, pour la première fois, Tchekhov montre des personnages qui ne veulent pas quitter le domaine comme partout dans sa tétralogie, et qui, constat inévitable de la fin, se voient tous éjectés vers un extérieur disloqué ... Personne n’emprunte la même direction. Les éclats de l’unité de jadis se projettent dans tous les sens. Cette année, comme le dit Irina des Trois sœurs, "père est mort". Rentré précipitamment, le froid m’a envahi: le froid de l’extérieur se confondait avec un autre, plus profond, immobilité glacée du deuil. Ni frisson ni fièvre, ce froid-là produit une sorte de clarté fixe, de luminosité lucide, suspension de l’instant au profit d’une durée arrêtée. Froid de l’hiver intérieur. C’est le même froid qui gagne La Cerisaie à la fin ... Brook, en faisant retirer les tapis moelleux qui ont recouvert la scène trois actes durant, refuge pour ces enfants attardés, place le quatrième acte, comme Tchekhov le souhaite, sous le signe p.131 du froid ... Au froid météorologique du début répond maintenant le froid intérieur qui fige le sang et glace les os. Ce froid procure une clarté hivernale. Drogue de la défaite. L’agonie s’achève, l’extinction s’annonce. La Cerisaie ou l’expérience de la mort. Depuis des mois tous sont réunis autour d’un moribond qu’aucun remède partiel ne peut arracher à son état ... Il faut penser à un nouveau cycle. Il entraîne l’expérience de la mort dans la mesure où, la cerisaie précipitamment décapitée par un Lopakhine soumis au chronomètre, personne ne la verra plus ... Il y a dispersion là où il y a disparition. La foule des arbres et la splendeur des Heurs les tenaient ensemble ... eux sacrifiés, le verger bascule du côté de la mémoire. Mémoire qui persiste tant que les témoins survivent. .. comme un spectacle de théâtre. La cerisaie devient intérieure. Etre chassé de... grand motif biblique, indissociable du scénario fondateur. Si les trois sœurs subissent l’onde de choc d’une pareille expulsion - Moscou, c’est leur paradis! -, dans La Cerisaie Lopakhine expulse sous nos yeux les maîtres qui d’emblée, dès la première rencontre, assimilent la cerisaie à un paradis qu’ils s’avouent incapables et de quitter et de voir disparaître. Et pourtant ils devront partir. .. et ce qui leur reste à vivre portera l’empreinte indélébile de cette appartenance à un univers oublieux du réel. Ces rescapés de la chute vont découvrir la perte de l’unité et rencontrer l’histoire comme figure du destin qui les frappe. Chassés, ils s’enfoncent dans la solitude. Sans pour autant retrouver le monde. Ils survivront à la dérive. p.132 Pour Lioubov, suivant la cohérence de son être et de son système de valeurs, il n’y a pas de véritable solution de repli. Réfractaire à la trahison, elle ne peut que poursuivre son chemin, sans intégrer aucune leçon de son expérience marquée d’échecs. Mère Courage de l’aristocratie. Une Mère Courage à l’envers, car si la mère brechtienne s’agite, Lioubov reste immobile. Mais ni l’une ni l’autre ne sont atteintes de cécité, comme Brecht le disait: les issues ne diffèrent pas là où il n’y a pas de réponse. Remarque de spécialiste: les cerisiers se distinguent des oliviers qui n’exigent aucun soin particulier. Une cerisaie, pour vivre, demande qu’on la travaille en abattant des arbres, en replantant. Ici, par contre, la cerisaie est embaumée ... et Lopakhine la détruit. Deux extrêmes. Pirs immobile s’attache à la propriété, Yacha mobile ne rêve que de retour à Paris... l’enracinement et le déracinement. Yacha est le double renversé de Firs. Toujours deux mondes. Yacha, à l’arrivée, empruntait les postures de Gaev ; à la fin, préoccupé comme Lopakhine par l’imminence du départ, il ne cesse pas de regarder sa montre. Lui, plus que tout autre, ne souhaite pas rater le train. Chez Tchekhov, il y a une catégorie de gens qui demandent que l’on abatte quelque chose. Medvedenko, exaspéré par les claquements sinistres du théâtre de Kostia, suggère qu’on l’abatte; Natacha, une fois la mainmise sur la maison des sœurs achevée, propose que l’on abatte les arbres autour et, enfin, presque par p.133 une progression dramatique, Lopakhine non seulement réclame mais amorce aussi l’abattage du verger. Y a-t-il une parenté entre ces personnages ? Appartiennent-ils à une même famille ? Lopakhine, l’homme aux prises avec l’instant, n’a que mépris pour l’indéterminisme utopique de Pétia. Deux rapports à la durée névrotiquement personnalisés. Pétia, l’homme qui ne parle que de l’avenir inhumainement éloigné - cent ans, le même chiffre qu’honorait Gaev pour l’armoire -, c’est aussi celui qui vieillit le plus vite. Tchekhov joue de ce contraste auquel sera sensible Lopakhine qui l’invite à ne pas dresser trop orgueilleusement le menton car, entretemps, dit-il, la vie passe. Tchekhov fait aussi intervenir l’opposition entre l’amélioration du monde envisagée par Pétia clans un avenir éloigné et l’état actuel de ses caoutchoucs. Ses discours soumis à l’épreuve la plus chère à Tchekhov, l’épreuve du quotidien, ne résistent pas ... l’étudiant manque à la morale de l’immédiat, ~l l’efficacité concrète des actes au présent. Pour Tchekhov, la tâche consistait à s’y donner avant toute chose, première étape vers une amélioration qui ne pouvait s’accomplir que "pas à pas". Les traductions qu’il fait servent à Pétia de moyen de survie: il sait les langues, il ne les a pas oubliées, comme Trina. Il les exerce encore. Mais que traduit-il? Silence. De quelle langue? Silence aussi, mais tout de même on reconnaît en lui un connaisseur de l’Occident capable d’en donner une image moins caricaturale que celle que fournissent les commentaires de Dachenka, la fille de Pichtchik, ou les propos déroutants d’Epikhodov. p.134 Lopakhine a raté deux fois le train: à l’arrivée des maîtres et après la vente. De là sa préoccupation obsessionnelle pour les vingt minutes qui précèdent le départ définitif. Celui-là, il ne peut pas se permettre de le manquer. Dans l’invitation faite par Lioubov à Lopakhine de demander sa main à Varia, il est possible d’imaginer que les spectateurs de l’époque reconnaissaient les résidus de la vieille coutume des maîtres qui se chargeaient de marier les serfs avant leur libération. (De l’importance, parfois, de la lecture historique des textes !) L’ancienne maîtresse veut comme jadis sceller une alliance, mais l’opération échoue ... le monde a tourné et les habitudes d’autrefois n’ont plus cours. L’insuccès de la demande en mariage est annoncé bien avant par la citation boiteuse d’Hamlet que fait Lopakhine, à meilleur escient qu’on ne pourrait le penser: "Va au monastère, Ophrélie." L’erreur onomastique sert d’écran trompeur, car, en réalité, la réplique ironiquement récitée recouvre parfaitement les intentions du fiancé qui ne se déclare pas et qui, par ailleurs, confirme la compréhension correcte des relations entre le prince danois et Ophélie. Il reconnaît chez Varia le désir de couvent de même que chez lui le non-désir de mariage. Mais personne ne déchiffre ce message codé. Peut-être en raison de la méfiance à l’égard des aptitudes culturelles de Lopakhine. Erreur de maîtres ... Ils oublient que Lopakhine n’est ni Epikhodov ni Pichtchik, qui entretiennent avec la culture une relation burlesque, brouillonne et incertaine. Les citations, de Shakespeare et de Lermontov, qu’il emploie à deux reprises, se distinguent par leur égale pertinence. Non, lui n’a rien d’un bouffon de la culture. p.135 Ici on parle beaucoup de mariage, mais son manque de réussite semble être généralisé. Rien pour le sauver ... Lioubov enfreint les interdits de classe et, en épousant un avocat, se coupe de son monde sans que sa rébellion soit pour autant récompensée. Le mariage d’amour coule dans les vapeurs du champagne qui emportent l’époux alcoolique ... Gaev, à l’opposé, envisage comme solution aux insolubles difficultés financières de la famille un "mariage arrangé" pour Ania, sacrifiée sur l’autel de la cerisaie. Peine perdue. Lioubov, à son tour, ne parvient pas à faire épouser Varia par Lopakhine ... et Epikhodov qui avait déjà demandé la main de Douniacha voit son intention contrariée par l’arrivée brutale de Yacha, l’heureux rival. Maintiendra-t-il encore sa demande en mariage après le départ de l’amant ? L’expérience du mariage autant que les projets, bien nombreux, échouent. Comme si dans ce monde la cellule familiale ne pouvait plus ni résister, ni se constituer. Signe subtil de destruction. Ici aucun contrat ne se noue. Sauf celui de la vente. Chacun finit seul. Dans son spectacle rapide, la scène de la demande ratée, Brook la met en scène comme une danse lente à distance. Danse du désaccord implicite, car lorsqu’un des partenaires se déplace, l’autre s’immobilise et ainsi de suite. Lorsqu’ils se rejoignent enfin, une longue attente commence ... attente muette. Après, Varia s’écroule et Lopakhine libéré se précipite vers l’extérieur. La vitesse reprend ses droits. Zadek dit : "La cerisaie est, pour eux, comme la femme après un mariage cie quarante ans. On p.136 ne peut plus s’en séparer. Il est désormais impossible de vivre sans son passé." Au quatrième acte, on refuse tout ce que le vainqueur propose, et le champagne, et l’argent. Par contre on lui livre une femme, mais cette fois-ci, c’est lui qui décline l’offre. Tout échange est suspendu. Chaque acte possède un "numéro comique" : au premier, l’oubli de Lopakhine, au deuxième les ébats amoureux des jeunes serviteurs sur fond de jalousie "suicidaire" d’Epikhodov, au troisième les tours de passe-passe de Charlotte, au quatrième la bouteille de faux champagne sifl1ée par Yacha. Le comique est toujours l’affaire des serviteurs, des intendants et des gouvernantes. La Russie et l’Europe: l’éducation allemande, l’industrie anglaise, la mode française. Le refus du champagne offert par Lopakhine. Les maîtres refusent, implicitement, de participer ~l la corruption de leurs coutumes à laquelle, pour une fois, mimétiquement, Lopakhine les convie. Cette victoire-là, ils la lui contestent. Une manière cie ne pas capituler totalement. Les maîtres sont distraits, condition d’une classe déclinante; Lopakhine, lui, se montre constamment concentré, symptôme d’une classe montante. Les Estivants cie Gorki - preuve de la faillite du projet de Lopakhine et confirmation des craintes de Lioubov ou de Gaev : la beauté évanouie, la vulgarité agressive s’installe, l’unité perdue, la p.137 fragmentation détraque tout. C’est l’écrivain prolétarien qui conforte les appréhensions des maîtres. L’histoire ne pouvait s’immobiliser mais Gorki leur donne raison d’avoir refusé d’y collaborer. Justice après la défaite. Souvent à l’Est, dans les salles de théâtre déficitaires, on a installé des bars, des salles de jeu, mais les entrepreneurs en produisant de l’argent n’ont pas sauvé le théâtre, ils ont seulement permis aux comédiens cie survivre ... Les maîtres, par le rejet de la solution de Lopakhine, ont résisté justement à ces palliatifs qui entraînent la déchéance du lieu au nom d’un rachat financier des habitants. A Bucarest, cas typique, un important homme d’afJaires consacre cie l’argent au théâtre, bit des spots publicitaires, produit un phénomène médiatique ... mais les artistes, tout en acceptant, pour des raisons matérielles, ce marketing agressif, admettent en secret que leur art n’est pas ainsi sauvé. La logique de Lopakhine bute toujours sur l’énigme du verger. .. Construction littéraire reprise par la mise en scène cie Zadek : Douniacha, au premier acte, serrée par surprise dans les bras de son futur amant, casse une soucoupe, indique Tchekhov. Au quatrième acte, lors du départ pour l’étranger de Yacha, elle brise, cette fois-ci délibérément, une coupe ... De tels échos tressent le spectacle comme une maille discrète. Douniacha simule la "sensibilité" des maîtres - migraines, évanouissements - tout au long des trois premiers actes. Au quatrième acte, elle pourrait se sentir mal pour de vrai, avoir les symptômes d’une femme enceinte. Ici où Gricha est mort, le seul enfant serait alors celui des serviteurs, p.138 mais si le premier avait perdu un père trop épris de champagne, le second sera abandonné par un père volage que Paris attire. Pourquoi ne pense-t-on pas à mettre en scène la paternité de Yacha ? Il fuit sa mère autant que son enfant. Au quatrième acte : "YACHA. C’est la dernière fois qu’on nous verra. (. .. ) LIOUBOV. Je reviendrai, mon trésor." Le serviteur dit vrai et dénonce, implicitement, la dérobade mensongère de la maîtresse. Pour elle, encore plus que pour lui, il est certain que de retour il n’yen aura pas. Yacha reste entièrement indifférent aux destins des maîtres. Son seul souci: regagner Paris. Le vrai cosmopolite, c’est lui. A Téhéran, un cinéaste vient de se voir interdire son film. Je l’apprends lors d’un dîner et, sensible à la censure à laquelle le passé m’avait habitué, je l’approche. Il a l’air résigné sans être entièrement vaincu: "Des temps meilleurs vien(hont et le film sortira." Optimisme nécessaire là Ol1 l’arbitraire fait la loi. - De quoi parle-t-il ? - D’une banou. - D’une banou ? - Oui, cela signifie "grande dame" en persan. Le film la montre sur un quai de gare, elle a tout perdu et elle doit partir. A cet instant tous les souvenirs remontent. Je lui parle de La Cerisaie qu’il semble ignorer, mais, alors, je comprends que la parabole tchékhovienne surgit toujours là où il y a perturbation historique, où la roue de l’histoire tourne en emportant des êtres et en brisant des destins. p.139 Par une curieuse coïncidence, les metteurs en scène bulgares Mladenova et Dobtchev ont adopté le même scénario : au début du spectacle, sur un quai de gare, le monde chassé de la citadelle prise se rappelle ... Le train comme source de réactivation mnémonique ! Le départ ou la "petite mort", préambule à l’autre, "la grande", éveille le passé lié à jamais aux arbres que l’on fracasse et à la maison que l’on démolit. Le regard circulaire sur la maison de Lioubov et de Gaev restés seuls ... comme le regard de mon grandpère, habité par la certitude du non-retour, sur la maison qu’il quittait. Tchekhov réunit ici tous les signes de la mort. Chez Tchekhov, partout ailleurs les personnages rêvent de quitter les lieux, convaincus que "la vie est ailleurs", et pourtant ils n’y parviennent jamais: Kostia, les trois sœurs, Vania. Ici seulement personne ne formule de vœux de départ. .. départ qui, cette fois-ci, sera imposé et vécu comme expulsion, comme arrachage, comme décollement de la terre d’origine. Le tragique provient du fait que, pour une fois, l’extérieur n’est investi par aucun pouvoir régénérateur, il n’est qu’espace de fuite, territoire sans repères, étendue indéfinie. Seule Ania, parmi les indigènes, formule un espoir, mais tout dénonce l’illusion de ses propos. Le départ est général et il ne reste que Firs, plus que jamais assimilé au verger. Le lieu comme un fantôme vengeur s’accroche à ses épaules et lui interdit de le quitter. Firs coule avec la cerisaie-fantôme. Pour Lioubov, il y a deux départs: le premier est une fuite, le second une expulsion. Différence énorme. Paris ... les gares ... les trains ... chaque fois elle les regarde et les vit autrement. p.141 S’imaginer Lioubov revenue à Paris. Le retour après la déposition. Un immense état d’épuisement. Réveils tardifs, volets fermés, une lassitude absolue ... fatigue. Elle n’est que fatigue. Lioubov n’est pas Arkadina : elle théâtralise son existence, mais ne peut se sauver en montant sur un plateau. La cerisaie fonctionnait comme substitut de l’art pour cette femme dépensière et interdite cie création. Il n’y a ni repli, ni refuge pour elle. La mise en scène cie Tchekhov exige de traiter aussi ses stratégies dissimulées, ses procédés de camouflage, ses techniques de détournement car il est tout sauf un écrivain direct. Ce qui pourrait prendre le sens d’une profession de foi, d’un credo, voire même d’un aveu testamentaire, il appartient de le formuler non pas aux protagonistes, mais à des personnages plutôt décentrés, a priori inaptes à de pareilles réflexions. Chez Ibsen, c’est toujours le héros qui les prend en charge, chez Tchekhov c’est tantôt un oncle gâteux - Sorine dans La Mouette qui dit: "On ne peut se passer de théâtre" -, tantôt un personnage imprévisible comme Pichtchik ici qui conclut sur un constat bonhomme: "Tout a une fin dans ce mancie." Tchekhov cultive le défi de cette ambiguïté produite par le rapport imprévisible entre la portée de la réplique et le statut clu personnage. Ainsi tempère-t-il la mélancolie et modère-t-il la rhétorique de la finitude. Pratique tchékhovienne. Il revient au metteur en scène de la travailler afin de faire entendre un aphorisme sans sacrifier les choix d’écriture. Le reproche habituel formulé à l’égard de Pétia : il se contente de parler. Mais, pour lui, parler n’est pas synonyme d’oisiveté ni d’inefficacité. Pétia p.142 entretient et cultive un sentiment de culpabilité, il trouble les personnages de la cerisaie et, au terme de l’été, il entraîne avec lui Ania, future militante endoctrinée. Pour tout mouvement terroriste, chaque cooptation est essentielle et peut-être Pétia accomplit-il ainsi un acte dont on ne mesure pas l’importance. Quand Baader a rallié à sa mouvance Ulrike Meinhof, qu’a-t-il fait d’autre ? N’oublions pas Les Justes de Camus ni Les Possédés de Dostoïevski pour comprendre la portée de chaque affiliation au petit cercle de ces guerriers urbains qui se sont attaqués au pouvoir en place. Cette hypothèse mérite d’être prise en compte avant de qualifier trop rapidement Pétia de rhéteur bavard. Chez Lassalle, les machinistes, après avoir emporté les objets et les accessoires de l’acte précédent, viennent barricader eux-mêmes les fenêtres de la maison. Et cela juste au terme du troisième acte, pendant le monologue rassurant d’Ania qui parle d’un bonheur à venir: le travail de la scène le dément. Non, les meubles s’en vont, les fenêtres deviennent aveugles, il n’y a plus de lieu pour espérer ... De cette leçon de lucidité, la mise en scène charge ces prolétaires de la scène que sont les machinistes Mais, au-delà de l’histoire, il y a plus fort qu’elle, la mort, "toujours vainqueur", comme l’admettait même Staline. C’est alors que le cyclo se lève, pour laisser Firs seul dans l’espace vide, désert nocturne où il s’évanouit doucement. Le réalisme en lambeaux du spectacle touche ~l sa fin à l’heure même où la mort l’emporte sur la vie. Ici tout meurt et personne ne naît. Par contre l’enfance les tient tous, des maîtres à Lopakhine et à Firs, de Charlotte à Ania. Avec la cerisaie disparue, cette enfance généralisée s’évanouit. Le seul p.143 enfant qui reste est celui imité par les sons grimaçants de Charlotte la ventriloque. Ou, peutêtre, celui non désiré, probable, de Yacha et de Douniacha ... A l’heure du départ, pendant le monologue de Lioubov, Zadek fait essayer les clefs à Lopakhine qui, de surcroît, marche sur une noix, reste de la fête des maîtres désargentés. De nouveau, un écho. Jeune lecteur, le cynisme de Yacha à l’égard de Firs m’exaspérait. Aujourd’hui je me demande si Yacha ne dit pas tout haut ce que les autres pensent tout bas. Firs a un âge "préhistorique" et par rapport à cette longévité hors pair, Yacha se fait le porte-parole explicite de la communauté lâchement silencieuse. Un metteur en scène pourrait dire: "Firs, jadis je l’ai mis en scène avec un soin particulier. Je l’aimais ... Maintenant l’invasion touristique des vieillards, l’enjeu économique et politique qu’ils repré~ sentent produisent parfois de l’aversion. Et je n’y reste pas étranger. Aujourd’hui si je remonte La Cerisaie, c’est pour dire cela aussi : la mort de Firs prendra le sens d’une libération, car, moi aussi, je crois qu’il n’est plus «réparable». C’est peut-être aussi parce que j’ai vieilli: en vieillissant on n’aime plus les vieux. Ils nous renvoient trop à notre avenir." Lopakhine parle de la cerisaie de la même façon que Yacha de Firs et ainsi, subtilement, Tchekhov redouble les discours de la jeune génération à l’égard du "vieux monde". Tout est voué à la mort. "Il y a un temps pour tout, un temps pour tou tes choses sous les cieux: un temps pour planter, et p.144 un temps pour arracher ce qui a été planté." (L’Ecclésiaste .) Chez Braunschweig, Firs est assimilé à une marionnette de bunraku. Une difficulté de distribution l’équipe était jeune - se convertit ainsi en réponse légitime inspirée par la rigidité d’un corps âgé et sa motricité réduite. Firs est un automate qui continue à fonctionner avec des pannes et des ratés en raison d’un programme depuis longtemps établi. Il a perdu tout rapport avec le contexte et poursuit l’exercice de ses tâches malgré les ficelles qui se détendent et les mouvements qui, de jour en jour, se désarticulent davantage. Firs "n’est plus réparable". C’est la conviction qui, secrètement, explique l’erreur, délibérée ou non, de son oubli. Firs est appelé à disparaître comme la cerisaie ... Si celle-ci subit l’agression des haches, lui peut s’éteindre légèrement, sans convulsions, en accord avec cette fin discrète que Tchekhova su ménager pour lui-même. Et Strehler se trompe lorsqu’il prolonge indéfiniment la scène pour dire qu’un monde s’effondre ! Trop de pathos. Chez lui, l’armoire centenaire embaume le cadavre de l’enfance qui surgit fantomatiquement à l’heure du retour ... Les boules de Noël et les poupées empoussiérées se déversent au premier acte de ce cercueil qui en regorge tandis que, plus tard, Pirs va s’éteindre dans le creux du linceul qui recouvre l’armoire funéraire. Double mort du temps : de l’enfance et de la vieillesse. La citadelle est vide et les derniers survivants viennent de s’enfuir. Zadek montre Firs avec une valise prête à la main, un retardataire abandonné ... Cela suppose chez le serviteur octogénaire la persistance du désir de vivre. Il avait envisagé, lui aussi, de quitter la cerisaie naufragée. Il n’est plus l’homme oublié, mais l’homme qui n’a pas réussi à fuir. Ailleurs, plus banalement, il paraît en habit de p.145 enfant qui reste est celui imité par les sons grimaçants de Charlotte la ventriloque. Ou, peut-être, celui non désiré, probable, de Yacha et de Douniacha ... A l’heure du départ, pendant le monologue de Lioubov, Zadek fait essayer les clefs à Lopakhine qui, de surcroît, marche sur une noix, reste de la fête des maîtres désargentés. De nouveau, un écho. Jeune lecteur, le cynisme de Yacha à l’égard de Firs m’exaspérait. Aujourd’hui je me demande si Yacha ne dit pas tout haut ce que les autres pensent tout bas. Firs a un âge "préhistorique" et par rapport à cette longévité hors pair, Yacha se fait le porte-parole explicite de la communauté lâchement silencieuse. Un metteur en scène pourrait dire: "Firs, jadis je l’ai mis en scène avec un soin particulier. Je l’aimais... Maintenant l’invasion touristique des vieillards, l’enjeu économique et politique qu’ils représentent produisent parfois de l’aversion. Et je n’y reste pas étranger. Aujourd’hui si je remonte La Cerisaie, c’est pour dire cela aussi : la mort de Firs prendra le sens d’une libération, car, moi aussi, je crois qu’il n’est plus «réparable". C’est peut-être aussi parce que j’ai vieilli: en vieillissant on n’aime plus les vieux. Ils nous renvoient trop à notre avenir." Lopakhine parle de la cerisaie de la même façon que Yacha de Firs et ainsi, subtilement, Tchekhov redouble les discours de la jeune génération à l’égard du "vieux monde". Tout est voué à la mort. "II y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux; un temps pour planter, et p.144 un temps pour arracher ce qui a été planté." (L’Ecclésiaste .) Chez Braunschweig, Firs est assimilé à une marionnette de bunraku. Une difficulté de distribution l’équipe était jeune - se convertit ainsi en réponse légitime inspirée par la rigidité d’un corps âgé et sa motricité réduite. Firs est un automate qui continue à fonctionner avec des pannes et des ratés en raison d’un programme depuis longtemps établi. Il a perdu tout rapport avec le contexte et poursuit l’exercice de ses tâches malgré les ficelles qui se détendent et les mouvements qui, de jour en jour, se désarticulent davantage. Firs "n’est plus réparable". C’est la conviction qui, secrètement, explique l’erreur, délibérée ou non, de son oubli. Firs est appelé à disparaître comme la cerisaie ... Si celle-ci subit l’agression des haches, lui peut s’éteindre légèrement, sans convulsions, en accord avec cette fin discrète que Tchekhov a su ménager pour lui-même. Et Strehler se . trompe lorsqu’il prolonge indéfiniment la scène pour dire qu’un monde s’effondre! Trop de pathos. Chez lui, l’armoire centenaire embaume le cadavre de l’enfance qui surgit fantomatiquement à l’heure du retour ... Les boules de Noël et les poupées empoussiérées se déversent au premier acte de ce cercueil qui en regorge tandis que, plus tard, Firs va s’éteindre dans le creux du linceul qui recouvre l’armoire funéraire. Double mort du temps: de l’enfance et de la vieillesse. La citadelle est vide et les derniers survivants viennent de s’enfuir. Zadek montre Firs avec une valise prête à la main, un retardataire abandonné ... Cela suppose chez le serviteur octogénaire la persistance du désir de vivre. Il avait envisagé, lui aussi, de quitter la cerisaie naufragée. Il n’est plus l’homme oublié, mais l’homme qui n’a pas réussi à fuir. Ailleurs, plus banalement, il paraît en habit de p.145 soirée ou en chemise de nuit, un exclu de l’exode général. Alors, il se laisse envahir par l’épuisement et tourne le visage contre le mur pour se laisser mourir. De même que dans Trois sœurs personne ne dit adieu à Tcheboutykine, ici personne non plus ne pense à embrasser Firs avant son départ supposé à l’hôpital. Oubli qui prend le sens d’un assentiment tacite ... Yacha l’avait compris. Dernière image dans le spectacle d’Alain Françon : Firs, dans son habit, allongé par terre ramasse la bouteille de champagne et les verres. Françon dit qu’il voulait ainsi mettre en scène la réplique "Bon à rien", discours sur la servitude comme condition définitive, indépassable même avant le dernier souffle. Yacha, Douniacha peuvent s’affranchir, pas Firs. Mais, par une association d’idées, on peut reconnaître aussi un rappel de la dernière coupe de champagne réclamée par Tchekhov avant de dire "ich sterbe", "je meurs". Toute construction réclame un sacrifice et les rites, surtout balkaniques, sont unanimes: l’édifice tient si le bâtisseur emmure un être vivant. Firs s’éteint-il comme victime symbolique à même de fonder le projet de Lopakhine ? Peut-être, mais toujours· est-il que les rites réclament un être jeune apte à communiquer son énergie, et non pas un être fini ... La mort de Firs ne présage pas une rédemption, elle clôt un cycle. Mort stérile, inféconde. Au printemps, Lopakhine devra affronter l’odeur dont la maison sera infestée par le cadavre du serviteur oublié. Ne peut-on pas lire cette fin plutôt comme prémonition d’un échec ? L’orage arrive le soir où un ami me convie pour fêter ses cinquante ans. Réticent à l’idée du refuge précipité dans le petit château familial où p.146 les invités se trouvent déjà réunis, je m’attarde sur la terrasse en pensant à mon anniversaire récent, d’autres à venir. .. des décades, des demi-décades. Le paysage semble être ancien, il évoque Le Lys dans la vallée ... je retarde le moment où je vais rejoindre l’assemblée pour profiter seul du parc et de son érable flamboyant sous la lumière des éclairs qui zèbrent le ciel. Alors, comme dans un ralenti onirique, l’arbre séculaire bouge, se: penche lentement et se couche en douceur. Muet, j’assiste en témoin ébloui à sa fin et je me souviens de Firs qui, chez Stein, s’allongeait par terre tandis qu’un arbre géant venait se ployer sur le plateau. L’érable dont j’avais vu le déracinement serein ressuscitait l’émotion déjà vécue à la Schaubühne. Dans le tronc légendaire j’ai reconnu Firs qui disait adieu aux danseurs de la fête perturbée par l’orage. Strehler fait de cette œuvre ultime l’objet d’une disparition théâtralement somptuaire en mettant son spectacle sous le signe de la blancheur qui, dit Melville, "frappe l’esprit d’une terreur plus grande que le pourpre du sang ... Ce qui épouvante le plus à la vue d’un mort, c’est sa marmoréenne blancheur, elle semble trahir l’effroi de se trouver dans l’autre monde ... La blancheur conserve aux ruines de Lima une éternelle jeunesse, refuse la joyeuse verdure d’un déclin consenti et étend sur ses remparts la rigide pâleur convulsée d’une mort foudroyante." La cerisaie a été la baleine blanche de Lopakhine. La Cerisaie- œuvre ultime écrite....les yeux rivés sur la fin - fut mise en scène en Roumanie par György Harag de son lit de malade incurable d’où il dirigeait les comédiens qui se rendaient chez lui. Si Tchekhov exténué a pu tout de même assister en 1904 à la première de sa pièce, p.147 Harag s’est éteint avant le premier spectacle en empruntant le couloir du temps dont il avait fait le principal élément scénographique. Un tunnel qui absorbe le monde de la cerisaie, métaphore théâtrale de ces récits des moribonds qui retournent à la vie. Il permettait aux personnages de s’éloigner ou de se rapprocher, d’être vus comme à travers des jumelles qui, toujours, perturbent les distances, les rendent irréelles. Après le départ, les cordes lâchaient la structure et, à terre, elle dévoilait le théâtre nu où Firs expirait. Ainsi nous lisions le testament de Harag qui mettait en scène la mort de son théâtre en même temps que l’autre, la mort de l’être seul au monde à l’heure de la fin. Spectacle ultime. Un ami italien s’approche de moi après une conférence que je viens de donner sur plusieurs Cerisaie. "Au fond tu t’interroges sur la meilleure manière de disparaître", me dit-il. Quelques semaines plus tard, il se laissait emporter par une rivière qui l’engloutissait. Une autre réponse. Jamais commentaire n’a apposé une cicatrice plus définitive. Dernière image sur l’aéroport de Bucarest ... "père" mort, je regarde à travers le hublot la tempête de neige qui risque de reporter le départ. Le froid du dehors répond à celui du dedans. Fixation du drame. Un long hiver commence ... hors scène. C’est dans la chaleur tiède de Yalta que Je malade en sursis qu’était Tchekhov a éprouvé la montée du grand froid. Il rêvait d’en parler dans sa dernière pièce, celle par quoi il voulait tout recommencer. .. "Partout la neige, ]a vie est muette ici. Rien ne pousse et ne croît plus ici." (Nietzsche.) p.148 Je rencontre un homme fier de son arbre exotique dont la floraison annuelle éblouit ce village de l’Est qui ignore pareil épanouissement. Mon admiration le réjouit! et, réjoui, . il me raconte l’histoire de son arbre qui devient l’objet de nos dialogues périodiques jusqu’à cet hiver rigoureux qui brûle, en le défigurant, le bel ornement venu d’ailleurs. Son propriétaire mourra quelques mois plus tard. Il n’a pas survécu à son arbre. Et les maîtres ? Sur le papier calligraphié par un moine zen, je lis ce poème: "Chose éphémère, cerisier d’hiver / qui a l’air froid / se reflète au fond du cœur / telle la neige blanche." Car les fleurs blanches se convertissent en fleurs de glace. Le son final, technique privilégiée de Tchekhov: un coup de fusil dans La Mouette, la musique militaire dans Trois sœurs, un 1 son de cloche dans Oncle Vania ... la hache d’abord et la corde ensuite dans La Cerisaie ... concentration acoustique d’un univers qui se résume ainsi. Les maîtres, à leur arrivée, avant de les voir, on les entend ... une fois partis, un son vibre encore. Echo qui se meurt du bruit, supposé heureux, qui les avait précédés. La fin est dispersion. Je regarde le livre que j’ai sous les yeux, lève les yeux sur la bibliothèque où, comme disait quelqu’un, "se trouvent mes meilleurs amis". Après ce bref détour je retourne à la page ... avec le sentiment que tout ce monde-là vit sous la menace, qu’il sera bientôt anéanti sur l’autel des dieux informatiques. Et, malgré tout, conscient p.149 de l’évident repli réactionnaire dont pareille crainte peut être qualifiée, je ne parviens pas, comme Lioubov, à me résigner aux stratégies de sauvegarde avancées par Lopakhine qui, toutes, impliquent le sacrifice du livre au profit de l’écran et le démantèlement de cette "cerisaie" des intellectuels qu’est une bibliothèque. Quand les expériences de la fiction parviennent à un tel degré de proximité, on se projette dans les personnages et on en adopte les répliques. Et face à l’évanouissement annoncé du livre, comme devant le recul confirmé du théâtre, peu importe le sourire narquois qu’elles suscitent, je fais miennes les phrases de Lioubov et de Gaev. Rien ne permet plus de les juger de la hauteur d’un grand discours idéologique à même de surplomber leur dérisoire résistance. Comme eux, encore plus qu’eux, je reconnais la perspective de la défaite, mais défaite accompagnée d’aucune trahison. Et ceci au prix d’une victoire donnée pour sûre par les Lopakhines de l’avenir technologique. Il y a un attrait secret de la perte et nous sommes encore quelques-uns à nous réclamer du parti des vaincus. En raison du scepticisme qui est le nôtre à l’égard des victoires trop orgueilleusement annoncées : le siècle n’a fait qu’infirmer tous les pronostics. Phrase d’Anatoli Vassiliev pour La Cerisaie: "Pourrir, parfois, c’est beau." Séduction d’un monde qui se désagrège, sur lequel on ne peut intervenir et dont on est le témoin impuissant sans prise sur les choses. La maison de ma famille française aura cent ans cette année, dit le chiffre taillé dans la pierre comme l’autre, gravé au feu, dans l’armoire dont Gaev honore le centenaire. La bachellerie, 1899. Au fond du pré bordé par des sapins crie un p.150 paon tandis que, au loin, s’agitent des pintades parmi les meules dorées posées sur la prairie tels des dolmens estivaux. C’est la dernière fois ... l’année prochaine une autoroute sabrera le champ et, sans que personne ne s’arrête, le vrombissement des voitures pressées va achever le silence d’aujourd’hui. Une "cerisaie" de plus engloutie. Je regarde la photo prise par un ami dans une rue de Bucarest et je m’imagine la propriété des maîtres, elle aussi également délabrée, à la dérive, en décomposition. La maison de la photo renvoie à une beauté ancienne aujourd’hui anéantie et, face à ce naufrage, l’on s’interroge : faut-il laisser couler les choses, les vouer à ce qui semble être leur cours ou les sauver en leur procurant une beauté nouvelle, trafiquée, maquillage qui ne pourra pas dissimuler les cicatrices du souvenir dans la mémoire des témoins ? Zadek, pour désigner l’état. de la maison, construit son décor avec ce qui semble être du matériel de récupération emprunté aux magasins du théâtre: portes de dimensions différentes, chaises disparates, vaisselle de bric et de broc ... Le délabrement de la propriété fait écho au délabrement des résidus théâtraux agglutinés ici. Dans une Cerisaie récente, de Vlad Mugur, le plâtre s’effritait, le papier peint se décollait, les murs s’écroulaient ... tout n’était que ruine ! Métaphore d’un passé qui, sous nos yeux, se délite. Beckett ante portas. Tout rappelle ici la photo de mon ami. Beckettisation de la vie et de Tchekhov: destin du siècle. p.151 Ne jamais oublier qu’ils n’ont pas été heureux ici. Ils construisent, en s’appuyant sur l’enfance, un bonheur imaginaire ... mais le récit biographique reconstitué atteste l’échec de la vie adulte qui débouche sur la mort, la noyade, la fuite. Leur mémoire est menteuse. Suspect en raison de nombreux commentaires littéraires suscités par sa peinture et d’une excessive utilisation médiatique, René Magritte fait partie des artistes déconsidérés aujourd’hui. Et pourtant certaines toiles parlent encore. Une en particulier. .. elle évoque La Cerisaie. Un immense arbre aux proportions démesurées bouche l’horizon tandis q\.1e dans le tronc on peut apercevoir, placés dans deux caissons, une maison bourgeoise éclairée et un œuf énigmatique. L’univers de La Cerisaie se concentre dans La Voix du sang. "Nous dressons fièrement le menton et la vie passe", dit Lopakhine, l’homme habité par le temps. Plus tard, à son inquiétude Firs apporte la confirmation : "La vie est passée comme un éclair." Seul le nouveau maître le savait. La vie, dit un poème chinois, dure autant que le saut d’un cheval blanc entre deux rochers ... vitesse et éblouissement. Après les recherches sur Je temps tchékhovien de ces dernières années, Je tempo juste de La Cerisaie semble être allegro ma non troppo. Sur ma table, un arbre en bronze argenté aux branches décorées de médaillons dont j’ignorais l’usage à l’heure de l’achat; plus tard seulement j’ai appris que je devais y placer des photos pour p.152 constituer mon arbre généalogique. Aujourd’hui il m’apparaît comme figure de cette cerisaie OlI les arbres accueillent les âmes défuntes, Lioubov y reconnaît sa mère, Pétia identifie la masse des serfs et parvient à communiquer à Ania sa funèbre vision. En regardant l’arbre en bronze argenté, je me souviens des troubles de la maîtresse qui rentre et de l’étudiant qui endoctrine et alors je me refuse à remplir les médaillons. Afin de ne pas investir l’arbre de mes fantômes. Le froid de La Cerisaie annonce le projet de la pièce que Tchekhov semblait envisager ensuite... une pièce sur la glaciation généralisée. C’est finalement Nabokov qui l’a écrite et Grüber qui l’a mise en scène: Pôle. Beckett, en paraphrasant le cycle de Schubert Voyage d’hiver, parlait d’un hiver sans voyage. Le domaine abandonné s’y enfonce. La Cerisaie s’achève lorsque l’hiver commence. p.154 ANNEXE LE THÉÂTRE ET LE VERGER, UNE PARABOLE DE LA CRISE La Cerisaie, œuvre ultime de Tchekhov avec laquelle le XXe siècle commence, est une parabole de la crise. Mais cette crise, on peut la déplacer dans le domaine du théâtre. Elle débute presque à la même époque, lorsque le théâtre de loisir, théâtre qui drainait les foules et en même temps séduisait les aristocrates, a été remplacé progressivement par le théâtre d’art. La mutation s’est produite sous la pression de l’émergence de cet extraordinaire loisir inconnu auparavant que fut le cinéma et qui obligea le théâtre à abandonner une partie de son terrain de jadis, le divertissement, pour se constituer en art ~t part entière. Cela va entraîner la perte de son ancien statut majoritaire car il subit, sous la pression du cinéma dont la diffusion est énorme, le même changement que la cerisaie menacée par l’avènement du train qui l’ouvre à la démocratisation des vacances estivales. Le train et le cinéma - facteurs de la civilisation moderne qui placent le verger aussi bien que le théâtre sous le signe de la crise. Gaev, au terme de l’acte premier, reconnaît la gravité de la situation et il propose plusieurs remèdes faute de pouvoir en trouver un seul, véritablement efficace. Fort de l’expérience médicale de Tchekhov, le frère reconnaît que par sa stratégie il ne peut qu’atténuer la crise, mais pas en sortir. Lopakhine, au contraire, av,clnce obstinément un seul argument, convaincu qu’il n’y a pas d’autre hypothèse: abattre la cerisaie pour sauver économiquement les maîtres. Face au danger, voilà l’alternative. Une parabole permet de s’appuyer sur le premier niveau, concret, du récit pour accéder à un autre niveau, proche de l’expérience du lecteur ou du public. Elle p.159 rappelle aujourd’hui la situation du théâtre ou du livre face à l’expansion des technologies modernes. Cent ans après le début de la crise du théâtre, nous vivons actuellement en pleine crise du livre et les défenseurs d’Internet parlent avec l’assurance des nouveaux Lopakhines. De même que le théâtre fut attaqué, le livre subit aujourd’hui une pression similaire: ces deux supports de la culture, la scène et la page, semblent être tout aussi voués à la disparition que le splendide verger tchékhovien. La perte de leur ancienne centralité se justifie par des arguments qui reprennent terme à terme le procès instruit au verger par Lopakhine. Limitons-nous au domaine du théâtre dans sa relation au verger. Cette assimilation, en rien arbitraire, confirme la dimension parabolique de l’œuvre, à la fois enracinée dans une expérience concrète et ouverte à une lecture actuelle. Il est intéressant de relever aussi bien les arguments de l’accusation que ceux de la défense, à partir de l’œuvre et de l’expérience du siècle qui s’achève. LE PROCÈS : LES ARGUMENTS DE L’ACCUSATION Quels sont les principaux arguments invoqués pour justifier la radicalité de Lopakhine ? La faiblesse économique Firs évoque une recette oubliée pour la préparation des cerises, ce qui désormais rend le verger entièrement improductif. TI n’a plus pour lui que la beauté décorative quine peut guère intervenir comme argument dans une logique fondée sur l’efficacité capitaliste. Et le théâtre n’est-il pas l’objet des mêmes réserves? N’est-il pas mis en cause pour son f~tible pouvoir économique ? N’a-t-il pas perdu lui aussi "la recette" du loisir qui drainait jadis un public aujourd’hui séduit par d’autres pratiques? N’a-t-il pas cessé, comme la cerisaie, d’être source de profits en se révélant médiocre sur le plan des performances financières? L’accélération des rythmes Le train rend la cerisaie accessible et la distance qui la sépare de la ville se fi’anchit autrement plus vite que p.160 par le passé. Nous entrons dans ce que l’on appelle aujourd’hui le "circuit court", à savoir le circuit qui permet au désir de s’accomplir avec une rapidité inconnue auparavant. Le verger intéresse les estivants parce qu’il est devenu facile d’accès. Lopakhine, le premier, a compris cette mutation et il l’invoque lorsqu’il envisage la destruction de la cerisaie au profit du lotissement présenté comme "démocratique". Le théâtre, lui aussi, fut soumis au même changement en raison de cette accélération dont le cinéma et ensuite la télévision ont profité : l’un comme l’autre peuvent être diffusés avec une vitesse qui lui restera à jamais étrangère. Le théâtre sauvegarde les vertus de la lenteur. Le cinéma et surtout la télévision instaurent le "circuit court" aux dépens du "circuit long" auquel le théâtre continue à être encore affilié car il est inapte à pénétrer le monde avec la précipitation de ses compétiteurs. Il ressemble à la cerisaie d’avant l’arrivée du chemin de fer, espace-îlot qui exige de l’effort pour y accéder. La démocratisation La cerisaie, selon le programme de Lopakhine, cessera d’être un domaine réservé pour s’ouvrir aux estivants : elle entre dans le domaine du pluriel. Au cercle restreint des maîtres et de leurs proches succédera le cercle élargi des nouveaux riches épris des plaisirs de la campagne. Les données numériques de l’occupation du terrain changent radicalement. Quantitativement, le théâtre, même lors de ses plus retentissants succès, n’est qu’une misère par rapport au nombre de spectateurs touchés par les nouveaux médias. Il ne dispose pas des ressources indispensables à un pareil élargissement du public, il ne peut pas participer à cette compétition, il reste voué aux données d’un public "familial", comme le verger qui suscite les convoitises des "nouveaux maîtres". Et, inapte à accueillir les masses, il ne peut engendrer que des mises en cause apparentées à celles formulées par Lopakhine. Il tient du "cercle restreint" qui le rattache aux minorités. C’est pourquoi le théâtre nous apparaît aujourd’hui comme une cerisaie assiégée. p.161 LE PROCÈS: LES ARGUMENTS DE LA DÉFENSE Aux arguments de l’accusation, nous pouvons opposer les arguments de la défense, empruntés, eux aussi, au texte de Tchekhov. Le prestige culturel Gaev, lorsque l’hypothèse de la destruction du verger, émise par Lopakhine, le surprend, invoque un argument d’autorité: la cerisaie est citée même dans le Dictionnaire encyclopédique. Le plus souvent, cet argument suscite le sourire supérieur des spectateurs d’aujourd’hui. Ils ignorent la portée culturelle de cet ouvrage fondateur pour la Russie, véritable équivalent de l’Encyclopédie dans la France du XVIIIe siècle. La référence invoquée par Gaev s’appuie sur le prestige du livre qui a intégré, preuve indiscutable de son importance, un article consacré au verger. Il appartient au patrimoine national dont le Dictionnaire dresse l’inventaire. Et le théâtre, ne le défendons-nous pas avec des arguments d’une même nature? Arguments qui ont à voir avec un prestige culturel que certains de ses adversaires considèrent comme étant tout aussi dérisoire que celui invoqué par Gaev : il est cité dans les livres, il remonte à l’Antiquité, il appartient à la mémoire d’une civilisation que les dictionnaires citent dans leurs pages. Le théâtre, pareil à la cerisaie, y trouve toujours sa place. Le rôle d’identification Gaev, de nouveau lui, formule, en guise d’opposition aux plans de Lopakhine, une autre réserve en avançant le Llit que la cerisaie "est la seule chose remarquable de notre région". Tout d’ailleurs le confirme et cela n’a rien d’une vantardise: le verger représente le pôle d’identification du territoire. Le territoire se distingue de l’étendue par la présence de repères qui le délimitent et le personnalisent. Gaev précise que la cerisaie réalise cette fonction et que sa disparition provoquera, par voie de conséquence, la chute de la région dans l’anonymat. Cette perte de tout élément identitaire va la réduire à un espace vaste, démesuré, espace sans repères, non identifiable. p.162 Le théâtre, dans la mesure où il sauvegarde les particularismes des langues, ne représente-t-il pas aussi cette "chose remarquable" qui empêche une culture nationale de se dissoudre dans "l’étendue" de la mondialisation dont le cinéma et encore plus la télévision sont les artisans infatigables? N’est-il pas cette "cerisaie" locale qui permet aux gens de continuer à entendre encore les mots de leur origine et ainsi de ne pas brocarder l’appartenance au territoire de leur culture? Et même, spatialement parlant, l’édifice théâtral n’a-t-il pas servi de repère pour articuler l’organisation d’une ville? Il s’est constitué en référence topographique, de même que la cerisaie. Le fait de les détruire, le verger comme le théâtre, entraîne l’effacement des points d’orientation qui fondent le sentiment d’appartenance à un espace. Les indigènes ne s’égarent jamais parce que leur territoire est parsemé de repères. La beauté éphémère Le verger légitime sa raison d’être par la splendeur éphémère des cerisiers en fleur. Elle envahit le regard et comble l’âme pour quelques jours seulement : cette beauté-là fascine parce qu’elle est fugitive. Il faut la saisir et en garder le souvenir. Et le théâtre aujourd’hui ne fonde-t-il pas son identité sur cet éphémère qui explique l’attrait qu’il exerce encore, éphémère par ailleurs assimilé à une faiblesse à l’heure où se développe le goût pour la mémoire mécanique, enregistreuse ? Celle-ci préserve, archive, sans jamais pouvoir retenir l’éblouissement de j’expérience théâtrale qui se trouvera toujours à la source de l’autre mémoire, la mémoire vivante. Voir un beau spectacle est synonyme de voir la cerisaie en fleur. Le temps d’un’ souffle. Mais le souvenir peut marquer une vie. Voilà les arguments qui nous permettent d’assimiler le théâtre à la cerisaie. Cette parabole ne peut qu’intéresser ces inquiets que nous sommes. Quoi faire ? L’ÉNIGME DU VERGER La Cerisaie nous confronte à une interrogation insoluble. Sa force vient de là aussi. Gaev, on l’a dit, p.163 annonce lui-même sa défaite imminente lorsqu’il énumère les remèdes envisagés faute d’en proposer un seul. Mais Lopakhine a-t-il pour de vrai, comme il le prétend, une réponse? Rien n’est moins sûr. L’ana- lyse de son programme révèle que la proposition avancée implique le sacrifice de la cerisaie - il faut la raser ! - pour sauver les maîtres. Voilà les données que Lopakhine expose avec fougue. Que veut-il dire? Il aime les maîtres de même que la cerisaie-théâtre, mais il avance une solution qui s’inscrit dans la cohérence de sa logique, solution que les maîtres, à leur tour, n’ont pas admise au nom de leur propre logique. Restent-ils insensibles à ses arguments, comme on le pense souvent, uniquement par indolence et manque de responsabilité ? Pas vraiment. Le pacte proposé, ils le comprennent, envisage le sacrifice des valeurs symboliques au profit des valeurs économiques, et à cette défaite-là ils ne sont pas près de collaborer. Et, sans prendre de décision, ils résistent par défaut. .. Parce qu’au fond ils le savent, de solution il n’yen a pas. Comme ils reconnaissent que, sans la cerisaie et ce qu’elle représente comme charge fantasmatique et dépôt symbolique, il leur est impossible de survivre, la solution économique ne peut pas les satisfaire. Et, implicitement, ils l’admettent. Mais le théâtre, surtout dans les anciens pays de l’Est, n’a-t-il pas connu des phénomènes similaires? Lorsque les salles se sont vidées, à la suite de l’invasion des films à grand spectacle et d’une télévision mondialiste, n’a+on pas fait appel à des’ solutions économiques? Tantôt l’on a installé des restaurants et des casinos, tantôt l’on a fait appel aux nouveaux maîtres de la finance suspecte, bref, mutatis mutandis, l’on a’ adopté les propositions formulées par Lopakhine. Mais, assez vite, s’imposa avec évidence le constat qu’ainsi 011 pouvait sauver seulement les artistes, mais pas le théâtre: L’on découvrait alors le désastre qu’entraîne le recours à la seule pensée économique. La survie financière se paie au prix du symbolique et à cet arrangement les maîtres, de même que certaines gens de théâtre, n’ont pas consenti. Peuton le leur reprocher? Sans doute que non, mais, en même temps, il serait erroné d’assimiler Lopakhine à un adversaire. A ·la question de la cerisaie, il n’y a p.164 pas de réponse satisfaisante pour les deux parties en présence. Sans que le théâtre puisse être concrètement racheté, sa situation s’apparente à l’énigme du verger. Et nous ne sommes pas des Œdipes à même de la résoudre. Certes, il n’y aura pas de vente du théâtre, mais son inéluctable éloignement du centre de l’actuelle civilisation des loisirs devient flagrant, et sa poussée vers les marges des pratiques minoritaires le rapproche du destin de la cerisaie. Quoi faire lorsque, pareils à Lioubov qui dit: "Ma vie n’a pas de sens sans la cerisaie", nous disons: "Notre vie n’a pas de sens sans le théâtre" ? Naviguer entre l’inefficacité de Gaev et l’efficacité de Lopakhine, entre le symbolique et l’économique ... sans jamais trouver de réponse. La lucidité consiste à l’admettre et surtout à ne pas se fier à l’optimisme du "nœud gordien" qu’un jeune homme tranche par le violent coup de son sabre ravageur. Lopakhine agit en Alexandre et il se trompe. Les maîtres aussi ... Faute de parvenir à la réponse, nous devons continuer à la chercher au nom de cette "cerisaie intérieure" qu’est devenu "notre théâtre". CRÉDITS PHOTOGRAPHIQUES Harlingue-Viollet: p. 10 Luigi Ciminaghi : p. 34, 74 Bernd Uhlig : p. 46-47 A. Sternin : p. 51 Alexandra Serban : p. 57 François Darras : p. 80-81 Roswitha Hecke : p. 88, 96-97 Marc Enguerand : p. 114 Wilfried B()ing : p. 140 Espen TolleL<;en : p. 153 Brigitte Enguerand : p. 155 DR: p. 126-127, 165 MT comment : Comment Georges Banu se raconte à travers La Cerisaie. Commentaires prétextes à une autobiographie. Il voit des cerisaies partout : foyer d’un théâtre, espace de transition, Yougoslavie « On a tous en soi quelque chose d’une cerisaie… » pour pasticher un chanteur populaire français JeanPhilippe Smedt (= Johnny Halliday) Banu : Verger = fantôme collectif. P.28 Dans l’intimité des souvenirs / enfance / Gaev-Lioubov Intime du temps / dans l’intimité du temps