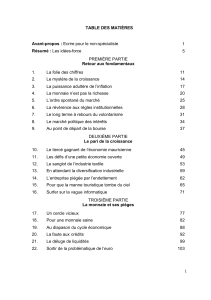Chap. 1

Chap. 1 : l’équilibre en économie fermée
Le modèle IS-LM
Vision du modèle keynésien simplifiée :
- il existe un seul marché, celui des biens et services avec des consommateurs,
l’Etat et les entreprises.
- l’investissement des entreprises est exogène.
- pas de prise en compte de l’impact des anticipation des agents.
Par rapport à la 1ère année :
- l’investissement devient dépendant du taux d’intérêt.
- le taux d’intérêt devient endogène.
- existence d’un 2ème marché, celui de la monnaie.
le modèle IS – LM fût construit par Hicks en 1937.
I) Les principes du modèle IS – LM
L’économie est fermée et il existe 3 types de marchés, celui des biens et services, celui de la
monnaie et celui des titres. Ces 3 marchés interagissent les uns avec les autres, ils déterminent
l’équilibre de l’économie.
Loi de Walras : si 2 marchés sur 3 sont en équilibre, alors le 3ème est en équilibre. Donc on
s’intéressera qu’au marché des biens et services et à celui de la monnaie.
les prix sont fixes et les entreprises sont contraintes par la demande.
chômage keynésien : excès d’offre sur le marché des biens et services, et donc excès
d’offre sur celui du travail.
A/ Le marché des biens et services
Equilibre du marché : offre = demande.
La demande est formée de la consommation, de l’investissement des firmes et des dépenses
publiques : D = C + I + G
L’offre est égale au revenu distribué dans l’économie, c'est-à-dire au niveau de production
noté Y.
L’équilibre sur le marché des biens et services est tel que : D = Y.
1- la consommation
C = c ( Y – T ) + Co,
Où T représente les impôts payés par les ménages, Co la consommation autonome, et c є [0;1[
est la propension marginale à consommer.
Les taxes et la consommation autonome sont exogènes, c'est-à-dire fixes.

2- l’investissement
L’investissement I est influencé négativement par le taux d’intérêt i : pour acquérir des
machines, les firmes doivent emprunter, soit auprès d’une banque, soit sur les marchés
financiers.
I = I(i) = Io – a*i, où a est la sensibilité de l’investissement au taux d’intérêt.
3- l’équilibre offre/demande : la courbe IS
L’offre se détermine au niveau de la demande effective dans l’économie, de sorte que,
l’équilibre sur le marché des biens et services est caractérisé par :
Y = C + I + G = c ( Y – T ) + Co + Io – ai + G
relation IS : « investment saving ».
En effet, l’équilibre sur le marché des biens et services, entre la production et la demande de
biens correspond aussi à l’équilibre entre investissement et services.
- le revenu est déterminé par la demande :
Y = C + I + G
- la distribution du revenu pour payer l’impôt, la consommation et épargner :
Y = T + C + E
=> équilibre comptable de l’économie :
I = E + ( T – G )
La relation IS, l’équilibre sur le marché des biens et services, se définit par une relation entre
le revenu et le taux d’intérêt pour laquelle l’équilibre est réalisé sur le marché des biens et
services.
On représentera l’équilibre sur le marché des biens et services par une courbe décroissante
dans un repère (Y ;i).
Lorsque le taux d’intérêt varie, on se déplace sur la courbe IS. Lorsque les variables exogènes
changent de valeur, il y a déplacement de IS. Plus généralement, tout facteur qui pour un taux
d’intérêt donné, réduit le niveau de production, entraîne un déplacement de la courbe IS vers
la gauche.
B/ Marché financier
1- arbitrage monnaie/titre
Dans les économies modernes, les agents ont le choix de détenir leur richesses sous
différentes formes d’actifs financiers : monnaie, obligations, actions, fonds de pension…
Nous allons supposer, pour simplifier, qu’il n’existe que 2 types d’actifs financiers :
- la monnaie (utilisable pour les transactions, ne produisant pas d’intérêts)
- les obligations ou titres (non utilisables pour les transactions, produisant un
intérêt nominal noté i. La particularité de ces titres est la relation inverse entre
leur prix et le taux d’intérêt)
En supposant aussi que la richesse financière des agents provient de l’épargne (et des intérêts
de cette épargne), chaque agent a 1 seul choix financier :
RICHESSE => monnaie -> demander de la monnaie

=> titres -> demander des titres
2- la demande de monnaie
Si on note R la richesse, Md la demande de monnaie et Od la demande d’obligations, d’après
ce que nous venons de voir, ce qui est demandé sous forme de monnaie et ce qui est demandé
sous forme d’obligations = la richesse. Md + Od = R
Comment partager sa richesse entre la monnaie et les titres ?
Le partage dépend de 2 variables principales :
- le niveau de transaction (il faut suffisamment de monnaie pour réaliser ses achats)
- le taux d’intérêt ( + le taux des titres est élevé, + on est incité à détenir des titres plutôt que
de la monnaie)
=> Donc la demande de monnaie dépend positivement du niveau de revenu dans l’économie
et négativement du taux d’intérêt : Md = f ( Y+ , i- )
Où f est une fonction mathématique.
3- la demande de titres
Comme Md + Od = R et Md = f ( Y+ , i- )
la demande de titre s’écrit : Od = R – f ( Y+ , i- )
La demande de titres est une fonction décroissante du revenu et croissante du taux d’intérêt.
4- l’offre de monnaie
Les banques commerciales, en octroyant des crédits, sont à l’origine de la création monétaire.
Mais cette création monétaire de la part des banques est soumise à des contraintes : réserves
auprès de la Banque Centrale. Donc la masse monétaire dans l’économie dépend de la base
monétaire (monnaie détenue par les agents et réserves des banques).
Comme cette monnaie banque centrale est déterminée par la banque centrale…
… c’est la banque centrale qui détermine la masse monétaire dans l’économie.
Pour simplifier, nous supposons qu’elle offre une quantité exogène de monnaie :
Mo = M
La banque centrale modifie l’offre de monnaie par des opérations d’open-market : elle achète
ou vend des titres sur le marché des titres.
5- l’équilibre des marchés financiers
L’offre des titres (noté Ō) est supposée exogène. Les offres de monnaie et de titres constituent
les stocks de monnaie et de titres disponibles dans l’économie. La richesse financière de
l’économie est donc égale à la somme de ces 2 offres :
R = M + Ō et R = Md + Od
Donc Md + Od = M + Ō
Si on a l’équilibre sur le marché de la monnaie Md = M, on a l’équilibre sur le marché des
titres Ō = Od, et donc équilibre des marchés financiers.
6- l’équilibre du marché de la monnaie : la courbe LM

Offre de monnaie = Demande de monnaie
LM représente l’ensemble des combinaisons Y,i pour lesquelles l’offre de monnaie égale la
demande de monnaie. Un accroissement de l’offre de monnaie fait déplacer la courbe LM
vers la droite.
Existence d’une relation inverse entre le prix des titres et le taux d’intérêt
Comment la BC augmente l’offre de monnaie ?
en augmentant sa demande de titres.
Si la BC décide d’accroître la quantité de monnaie en circulation M, elle va acheter
(demander) des titres sur le marché des titres, ce qui provoque une augmentation du prix des
titres (demande>offre). Graphiquement, si le taux d’intérêt n’est pas modifié, plus de monnaie
dans l’économie signifie un déplacement de la verticale vers la droite. Cela se traduit par une
baisse du taux d’intérêt qui équilibre le marché de la monnaie.
Comment comprendre cette baisse ?
Le taux de rendement des titres est i = ( 100 – PB ) / PB avec PB=prix des obligations
Si PB est égal à 95, alors ce que vous rapporte le titre égal 5,3%. Si le prix égal 90, alors le
titre rapporte 11,1%. Il apparaît ainsi qu’à un prix des titres + faibles, correspond 1 taux +
élevé.
Le prix d’un titre est égal à ce qu’il sera payé à échéance divisé par 1 + le taux d’intérêt.
La logique reste la même si on envisage le cas où le taux d’intérêt est donné. On peut alors
obtenir la valeur d’un titre : PB = 100 / ( 1 + i ).
C/ L’équilibre global de l’économie
L’équilibre dans l’économie = équilibre simultané sur le marché des biens et services et sur le
marché de la monnaie. Y = c ( Y – T ) + I ( i- ) + G
M = Md = f ( Y+ , i- )
- Variables exogènes (fixes) :
les taxes T
les dépenses publiques G
l’offre de monnaie M
- Variables endogènes :
revenu Y qui détermine la consommation C
le taux d’intérêt i qui détermine l’investissement I
Graphiquement, on a l’intersection entre la courbe IS et la courbe LM. Cette intersection
définit simultanément le revenu et le taux d’intérêt dans l’économie.
II) Les politiques économiques
Nous pouvons examiner 3 types de politiques :
politique budgétaire -> évolution de G
politique fiscale -> évolution de T
politique monétaire -> évolution de M
Pour répondre à toute question concernant l’effet d’une politique économique : il faut suivre
les 3 étapes suivantes :

[1]-se demander si la politique adaptée à des effets sur l’équilibre du marché des biens et
services et/ou sur l’équilibre des marchés financiers. En somme, comment se déplacent les
courbes IS et/ou LM ?
[2]-caractériser les effets de ces changements sur l’équilibre de l’économie.
[3]-expliquer littéralement les effets.
A/ La politique budgétaire
Hypothèse : politique budgétaire expansionniste = évolution positive de G
Quel est l’impact de cette politique budgétaire expansionniste ?
[1]-Graphiquement :
G apparaît dans l’équation IS, et comme G est une variable exogène, la courbe IS se déplace.
G n’apparaît pas dans l’équation LM, la courbe LM ne bouge donc pas.
[2]-Dans quel sens se fait le déplacement ? Quel est le nouvel équilibre ?
La courbe IS se déplace vers la droite. Le nouvel équilibre se situe à l’intersection entre la
nouvelle courbe IS et la courbe LM.-> nouvel équilibre E2 avec Y2>Y1 et i2>i1.
Il y a donc augmentation du revenu et augmentation du taux d’intérêt suite à la politique
budgétaire expansionniste.
[3]-Expliquer avec des mots ce qui s’est passé dans l’économie :
1- sur le marché des biens et services
L’accroissement des dépenses publiques augmente la demande dans l’économie. Comme
l’offre se fixe à la demande, l’offre augmente et par suite les revenus distribués dans
l’économie. Comme les taxes sont exogènes, il y a accroissement du revenu disponible et par
suite un accroissement de la consommation. Mais la consommation est aussi une composante
de la demande donc :
… un accroissement de la demande qui entraîne un accroissement du revenu…
Nous retrouvons l’effet multiplicateur keynésien simple.
A l’inverse le modèle keynésien simple, nous avons introduit le marché de la monnaie, et
l’équilibre du marché de la monnaie dépend du niveau d’activité dans l’économie, au travers
de la demande de monnaie.
2- sur le marché de la monnaie et des titres
L’accroissement de l’activité implique un accroissement de la demande de monnaie pour le
motif de transaction. Md > M …-> déséquilibre.
Sur le marché des titres, mise en vente des titres d’Etat pour financer la politique budgétaire.
L’offre de titre devient > à la demande, le prix des titres chute, ce qui provoque une hausse du
taux d’intérêt.
Les agents réduisent leur demande de monnaie spéculaire -> évolution négative de la
demande de monnaie. -> rééquilibre.
Le taux d’intérêt augmente jusqu’à ce que la demande de monnaie soit revenue au même
niveau que l’offre (équilibre du marché de la monnaie).
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%