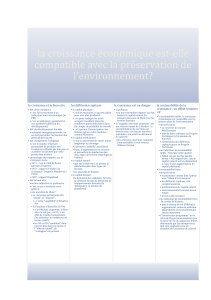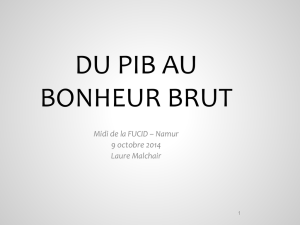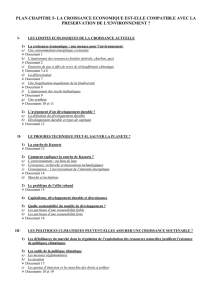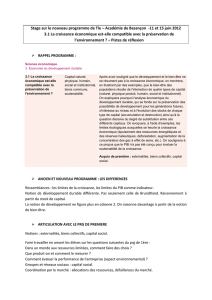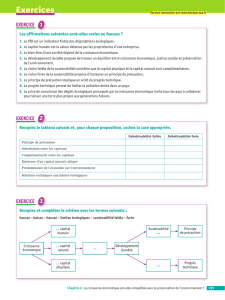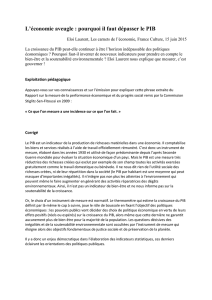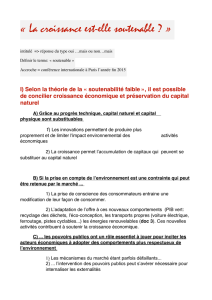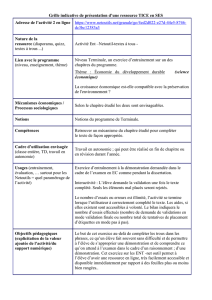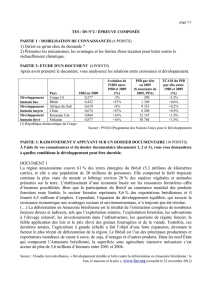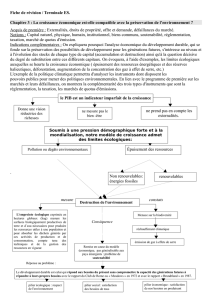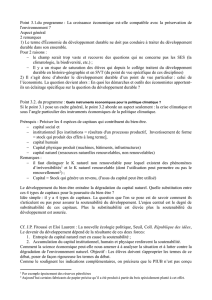Chapitre 6 : COMMENT REPRESENTER L`ECONOMIE

Thème 2 : Economie du développement durable
Chapitre 3 : La croissance économique est-elle compatible avec la
préservation de l’environnement ?
I – Comment obtenir plus de bien-être ?
1 – Distinguer croissance et développement
2 – La notion de bien-être
3 – Quels sont les origines du bien-être ?
II – Les limites écologiques à la croissance
1 – Les menaces pesant sur notre environnement
2 – Une vision optimiste de l’avenir : la croissance est soutenable
3 – Une vision pessimiste
III – Quels instruments de mesure pour le développement durable ?
1 – Le PIB et l’IDH ne sont pas des indicateurs de développement durable
2 – Quelques trouvailles des économistes
Vocabulaire : Capital naturel, physique, humain, social et institutionnel, biens communs, soutenabilité
Vocabulaire de 1ère : Externalités, biens collectifs, capital social

Thème 2 : Economie du développement durable
Chapitre 3 : La croissance économique est-elle compatible avec la
préservation de l’environnement ?
Notions de terminale
Acquis de 1ère
IC
Capital naturel, physique, humain,
social et institutionnel, biens
communs, soutenabilité
Externalités, biens collectifs, capital
social
Le bien-être des populations résulte
de l'interaction de quatre types de
capital (naturel, physique produit,
humain, social et institutionnel).
Les limites écologiques auxquelles se
heurte la croissance économique.
Le PIB n'a pas été conçu pour évaluer
la soutenabilité de la croissance.
Il y a un site du pnud où l’on fait de beaux graphiques ! « Construisez votre propre indice »
http://hdr.undp.org/fr/donnees/construire/
Prise de représentation : Activité avec les dessins de Plantu (travail sur les notions de croissance et
développement).
L’objectif est de revenir sur la notion de développement, en montrant que le terme développement durable
est lié à cette notion.
Ou alors :
Prise de représentation : « Qu’en pensez-vous ? «
Dennis L.Meadows : « L’humanité a perdu trente ans. Si nous avions commencé dans les années 1970 à
construire des alternatives à la croissance matérielle, nous pourrions regarder l’avenir de façon plus
détendue ».
Larry Summers : « Les pays sous-peuplés d’Afrique sont largement sous-pollués. La qualité de l’air y est
d’un niveau inutilement élevé par rapport à Los Angeles ou Mexico (…). Il faut encourager une émigration
plus importante des industries polluantes vers les pays les moins avancés. »
I – Comment obtenir plus de bien-être ?
1 – Distinguer croissance et développement
- La croissance correspond à une augmentation de la production. Son instrument de mesure est le PIB qui a
des 3 limites (voir le chapitre 1). Il faut rajouter que le PIB/habitant n’est qu’une moyenne, et qu’il ne dit
rien des inégalités de répartition.
- La notion de développement est qualitative.
La notion de développement se rapproche de celle de bien-être. En effet, le développement est l’ensemble
des changements économiques, politiques, culturels et sociaux qui favorisent la croissance. Notion proche du
progrès social. L’instrument de mesure est l’IDH.
Texte 1 p. 22 : L’indicateur de développement humain
Tableau 2 p. 22 : De très fortes disparités entre les pays
L’IDH a trois composantes : l’espérance de vie, la durée de la scolarité et le revenu national brut par
habitant.
[Le RNB s’obtient à partir du PIB en lui ajoutant le solde des échanges de revenus primaires avec le reste du
monde]
Une limite de l’IDH : il prend peu en compte les inégalités.
2 – La notion de bien-être
- La notion de bien-être d’une population n’a pas de définition en économie. Elle ne peut être approchée par
la production (problème de sa répartition), même si son augmentation peut y contribuer.
Le lien entre production et bien-être n’est pas automatique.

Pourquoi ? Débat avec la classe.
Autre explication : le paradoxe d’Easterlin : économiste américain (1926-) a travaillé sur la relation entre
richesse et bonheur. Le paradoxe : la hausse du PIB n’est pas synonyme de hausse du bonheur.
Texte 3 p. 141 : Une première explication au paradoxe d’Easterlin. Q1
- La notion de bien-être peut être appréhendée par la notion de développement durable.
Développement durable : développement qui permet de satisfaire les besoins des générations présentes sans
compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs.
Il y a 2 conceptions du développement durable :
- une conception large : le développement durable englobe le développement + aspects écologiques
- une conception stricte : seulement les aspects écologiques
Alors comment mesurer le bien-être ? en faisant des sondages par exemple.
Graphique 1 p. 142 : La carte mondiale du bonheur
Graphique 1 p. 140 : L’argent fait-il le bonheur ? Q 3
Graphique 2 B p. 140 : Richesse et bonheur : le cas des Etats-Unis
Il existe d’autres instruments de mesure qui ont été inventé :
- L’indicateur de progrès véritable aux Etats-Unis (Hachette, p. 153)
- L’indice d’Osberg (Hachette, p. 154) – Lars Osberg, économiste canadien.
- Le Bonheur National Brut au Bouthan : en 1972, le Bouthan a remplacé le PNB par le BNB. Cet indice
prend en compte 4 dimensions : la croissance et le développement économique responsables, la conservation
et la promotion de la culture bhoutanaise, la sauvegarde de l’environnement, la bonne gouvernance
responsable.
Au final, pour mesurer le bien-être, il faudrait prendre en compte la production et sa répartition, le niveau de
santé, le niveau d’éducation, l’activité personnelle dont le travail, la participation à la vie politique et sociale,
mais aussi les atteintes à l’environnement, les problèmes d’insécurité. Ce sont des recommandations du
rapport de la commission Stiglitz-Sen-Fitoussi sur la mesure des performances économiques et du progrès
social (2009).
3 – Comment obtenir plus de bien-être ?
- Capital physique ou capital technique fixe : capital technique durable utilisé durant plusieurs cycles de
production.
Révisions du chapitre 1 : si le capital technique fixe est plus important, la production augmente. Donc le
bien-être peut augmenter (cf. lien entre production et bien-être).
- Capital naturel : ensemble des ressources naturelles (renouvelables ou non) qui servent à la production.
Texte 4 p. 143 : Le rôle du capital naturel. Q1
Les capitaux naturels sont utilisés dans le processus de production : les matières premières. Plus on en a, plus
la production peut être importante. Cf. les terres rares.
Mais ce capital diminue par l’exploitation.
- Capital humain : ensemble de connaissances, compétences et expériences qui rendent l’individu productif.
Révisions du chapitre 1 (lien capital humain & productivité & croissance)
Texte 3 p. 143 : Le rôle du capital humain. Q1 & 2
- Capital social : Ensemble des relations sociales et des réseaux de connaissances d’un individu.
Il faut trouver un texte intéressant. Hachette p. 155 ?
Document 1 polycopié
- Capital institutionnel : ensemble d’institutions politiques et juridiques. Elles peuvent être formelles ou
informelles.
Révisions du chapitre 1 (le rôle des institutions)
Les aspects politiques : la stabilité politique, les droits de propriété
L’intervention de l’Etat : en matière d’éducation, de santé, d’infrastructures publiques, d’organisation du
marché.

Attention : C’est une approche par stock !
Il faut distinguer stock et flux.
Document 2 polycopié
Synthèse :
- Si l’objectif de toute population est d’augmenter son bien-être, il n’y a pour l’instant en économie pas de
définition précise de ce concept, ni d’instrument de mesure.
- Il ne faut pas confondre : la production de B et S, le développement, le développement durable, et le bien-
être (pour lequel il n’y a pas de définition).
- Essayer de faire un schéma montrant toutes les interactions entre les 4 types de capitaux, qui favorisent la
production et le bien être. Mettre un exemple sur chacune des flèches.
II – Les limites écologiques à la croissance
1 – Les menaces pesant sur notre environnement
« Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. La nature, mutilée, surexploitée, ne parvient plus à se reconstituer, et
nous refusons de l'admettre. L'humanité souffre. Elle souffre de mal-développement, au Nord comme au Sud, et nous
sommes indifférents. La Terre et l'humanité sont en péril, et nous en sommes tous responsables. » Jacques Chirac – 2
septembre 2002
Car maintenant, je cite Jacques Chirac dans mes cours !
Avec une vidéo de l’INA :
http://www.ina.fr/economie-et-societe/environnement-et-urbanisme/video/2090725001027/la-journee-de-
chirac-a-johannesburg.fr.html
Les menaces sont connues :
- épuisement des ressources naturelles,
- pollution, dont émissions de gaz à effet de serre. Les activités humaines génèrent des externalités
négatives.
Externalité : Conséquence positive ou négative de l’action d’un agent sur la situation d’un autre agent sans
accord préalable entre eux. (déjà vu au chap. 1)
Graphique 1 p. 146 : La dégradation de l’environnement : l’évolution sur le long terme
Graphique 2 p. 146 : L’épuisement des ressources naturelles : l’exemple du pétrole
Quel est un des problèmes ?
Texte 3 p. 147 : L’environnement, un bien commun. Q1 & 2
Bien commun : bien pour lequel il est impossible d’empêcher un agent de le consommer, or sa
consommation diminue les quantités disponibles pour les autres.
Un des problèmes est que certains biens n’ont pas de propriétaires désignés (pas de droit de propriété précis).
Cela peut générer de l’épuisement des ressources (poisons dans un lac) ou de la pollution (l’air). Une
solution possible est d’établir des droits de propriété : s’il y a des propriétaires pour le lac, les poisons auront
un prix ; la pollution du lac aussi si les propriétaires portent plainte.
Autres solutions (source : eduscol)
Une autre solution consiste à faire appel à l’Etat qui use de son pouvoir règlementaire (création de réserves et de parcs
naturels par exemple, interdiction de la chasse ou de la cueillette, quotas de pêche, etc.). Elinor Ostrom met l’accent sur
une « troisième voie » : la gestion communautaire ou coopérative des ressources communes. Ses études comparatives
des nombreux exemples de tels modes de gestion montrent l’importance des institutions et de la confiance pour créer les
conditions de l’adoption de comportements coopératifs permettant de gérer ces ressources dans l’intérêt commun (y
compris dans l’intérêt des générations futures).
A ne pas confondre avec :
Bien collectif : bien pouvant être consommé par plusieurs personnes sans que la consommation d’une
personne soit diminuée et sans que l’on puisse exclure une personne qui ne paie pas.
(programme de 1ère)
Exemple : éclairage public, défense nationale, feux d’artifices,…

Rivalité
Non-rivalité
Exclusion
Biens privés
Biens de club ou à péage
Non-exclusion
Biens communs (ou collectifs
impurs)
Biens collectifs (ou publics purs)
2 – Une vision optimiste de l’avenir : la croissance est soutenable
La croissance économique peut favoriser la protection de l’environnement. Cela s’exprime par la courbe
environnementale de Kuznets.
Graphique 1 p. 144 : La courbe environnementale de Kuznets
Explications :
- La préoccupation grandissante des citoyens des pays riches (cf la conception du bien-être)
Texte 2 p. 144 : Enrichissement des nations et protection de l’environnement
- L’augmentation des prix ce qui peut diminuer la consommation ou développer la consommation de biens
substituables.
Texte 3 p. 145 : L’augmentation du prix comme signal
Ce mécanisme repose sur l’hypothèse de soutenabilité faible des néo-classiques. Le volume total de capital
peut être stable et engendrer un bien-être stable, car les différents types de capitaux sont substituables : un
peu moins de capital naturel, mais un peu plus de capital technique, ou de capital humain.
Texte 1 p. 150 : La soutenabilité faible
Soutenabilité : maintien d’une capacité constante de la société à produire du bien-être.
= développement durable
- Le progrès technique : il peut permettre de moins polluer ou de consommer moins d’énergie ou de matière
première pour produire un euro de biens et services.
Cela renforce le mécanisme de soutenabilité.
Cela se concrétise par des décisions au quotidien :
- tri sélectif réalisé par chacun
- les agendas 21 des collectivités locales (texte 3 p. 164 Hachette)
- la responsabilité sociale et environnementale des entreprises (texte 4 p. 165 : exemple du groupe GDF-Suez
– Hachette).
3 – Une vision pessimiste.
Texte 3 p. 151 : Une soutenabilité forte.
Le capital naturel n’est pas substituable par d’autres capitaux.
Actuellement, des dégâts sont irréversibles et il faut s’en inquiéter. Le progrès technique ne peut pas tout.
L’idée serait alors d’aller vers la décroissance.
Graphique 2 p. 148 : Le PIB et l’oubli de la soutenabilité
La courbe environnementale de Kuznets est contestée : la consommation par habitant des pays riches
continue à augmenter. Même, si produire une unité pollue moins, la pollution progresse.
Synthèse.
Il est difficile de répondre à la question posée comme titre du chapitre. En effet, il est très difficile de prévoir
le futur. Les comportements dans les pays occidentaux changent lentement. Les besoins des pays en
développement deviennent énormes.
Or l’environnement est un bien commun mondial. Il faut l’aide de la science politique pour comprendre
pourquoi nous avons tant de mal à signer des accords internationaux de protection de l’environnement.
 6
6
 7
7
1
/
7
100%