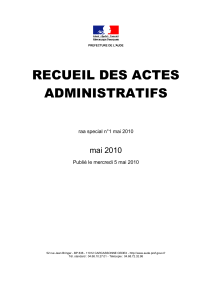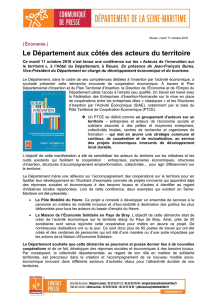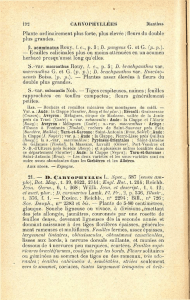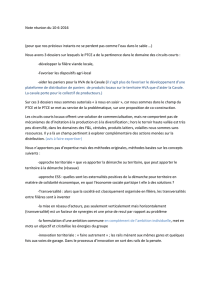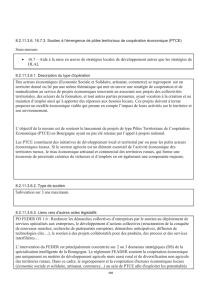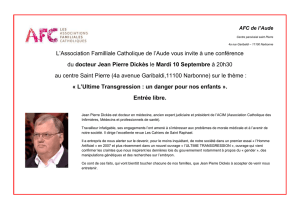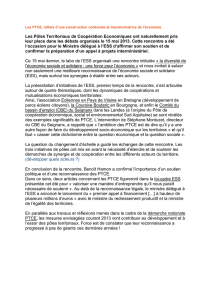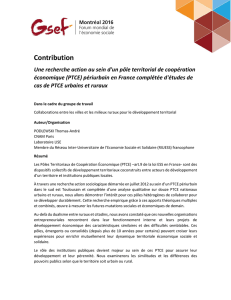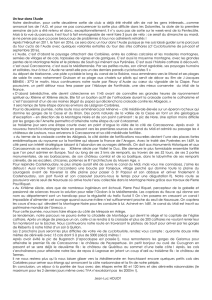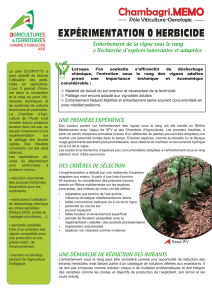Télécharger - Scic Sapie

Le Pôle Territorial de Coopération Economique (PTCE)
de la Haute-Vallée de l’Aude
Dossier de présentation
« la question de l’innovation - qu’elle soit technologique ou sociale - dans les territoires ruraux, est
un levier d’amélioration de la qualité de vie de nos concitoyens, mais aussi de développement
économique. Je sais que les territoires ruraux ne manquent pas d’idées en la matière ! »
Sylvia Pinel, ministre du Logement, de l’Egalité des territoires et de la Ruralité.
Le projet de PTCE de la Haute-Vallée de l’Aude est issu de la volonté des services de l’Etat de
corriger ces inégalités par des mesures d'équité territoriale et d’impulser une dynamique de
revitalisation économique portée par les acteurs du territoire. Il s’agissait donc de fédérer
l’ensemble des acteurs autour d’un projet qui réponde concrètement aux besoins des entreprises
et des populations et qui soit porteur d’une ambition collective : revitaliser en imaginant
collectivement des solutions durables et responsables.
Une stratégie ambitieuse pour développer l’expérimentation de
l’entrepreneuriat en milieu rural
A l’instar de nombreux territoires de montagne, la Haute-Vallée de l’Aude est historiquement
marquée par des pratiques coopératives et des pratiques d’entraide fortes. L’enclavement du
territoire l’a contraint à développer une économie sociale et solidaire avant la lettre, dans les
relations entre voisins, entre agriculteurs, entre membres de mêmes communautés villageoises.
Paradoxalement, ces pratiques très développées ne se sont que marginalement traduites dans la
constitution de projets économiques coopératifs ou associatifs ; c’est principalement le secteur
agricole qui s’est approprié depuis longtemps les avantages de ces pratiques de mutualisation ou de
cofinancement.
Aujourd’hui, l’enjeu territorial est en grande partie lié à la transformation de ces dynamiques
locales sous la forme de projets économiques créateurs d’emplois. De nombreux freins
économiques (accès au financement, accès à des bassins de consommation, contraintes logistiques
et techniques de l’environnement montagnard, etc.) ou culturels (manque de formation des
ressources, éloignement des nouveaux outils numériques, craintes vis-à-vis du monde
économique…) ont été identifiés par les acteurs du territoire.
Aussi, et dans une démarche volontariste impulsée par la sous préfète de l’arrondissement, un
collectif d’acteurs s’est constitué pour construire un écosystème de l’expérimentation de
l’entrepreneuriat en milieu rural.
Les partis-pris de la démarche
La problématique du PTCE a rapidement rejoint la problématique d’un territoire marqué par un
grand nombre de fractures territoriales : de par son enclavement, la Haute-Vallée de l’Aude se
heurte encore à de nombreuses difficultés d’accès à de nombreux leviers de développement (accès
aux services publics, accès au numérique, accès à l’emploi, accès aux autres territoires, accès à la

mobilité…). C’est donc dans une approche inclusive du projet de territoire que le PTCE a été
construit et non comme un outil déconnecté de cette réalité territoriale ; cette approche s’est
appuyée sur les partis-pris suivants pour construire le sens de la démarche.
Construire un projet, avec et pour le territoire
La démarche mise en œuvre a reposé sur une posture de l’action publique : s’appuyer sur l’expertise
d’usage des acteurs du territoire pour susciter un projet économiquement viable parce
qu’économiquement utile.
De cette posture est née la volonté d’associer l’ensemble des forces de la Haute-Vallée de l’Aude, et
en premier lieu les acteurs qui ne sont que trop rarement mobilisés, les femmes et les jeunes, avant
d’élargir la concertation aux acteurs économiques.
Les différents partenaires ont été associés au travers de réunions collectives ou de groupes de
réflexion, pour générer des idées, des projets, des rencontres et des coopérations.
Innover pour faire projet
Dans un petit territoire où les modalités de fonctionnement sont ancrées sur des temps longs, la
démarche a voulu bousculer le jeu de contraintes pour faciliter l’émergence d’idées et d’initiatives.
Ainsi, c’est en favorisant le contact direct, la convivialité, l’expression libre et non censurée que la
parole a été donnée aux différents collèges d’acteurs par la sous préfète Sylvie Siffermann , tiers de
confiance et facilitatrice.
De même, la mobilisation officielle des acteurs institutionnels n’a été engagée que dans un second
temps afin de ne pas brider les débats avec des a prioris politiques.
Organiser la transversalité
Afin de diffuser largement une innovation dans les modes de fonctionnement, une démarche
transversale a été préférée à une démarche par secteurs d’activité ou par filière.
Ainsi, l’innovation (et en particulier l’innovation numérique comme facteur d ’innovation sociale) a
été retenue comme « le fil rouge » des débats, permettant de requestionner les modes de
fonctionnement traditionnels et d’identifier de nouvelles modes de coopération.
Assurer la pérennité de la dynamique territoriale
Processus de transformation d’un territoire rural, l’accent a été mis dans un premier temps sur la
dynamique économique et dans la perspective du second appel à projet 2015 pour la labellisation
des PTCE.
Ceci étant, ce projet est construit en cohérence ou en complémentarité avec d’autres démarches
susceptibles d’accompagner cette dynamique territoriale. Ainsi :
- Le contrat de ville de Limoux(centré sur le quartier Aude et signé le 13 février 2015)engage
la démarche sur une dimension urbaine. Nouvel entrant dans la géographie prioritaire de la
politique de la ville, Limoux a son seul quartier prioritaire situé en partie en centre-ville et
associant des éléments de ville datant du XVIIIème siècle, des extensions urbaines des années
1950 et 1960, des friches industrielles et le quartier Saint-Antoine. Poumon économique
local, Limoux se découvre ainsi des problématiques de pauvreté et de précarité qui la
rapproche de certaines des difficultés de la Haute-Vallée de l’Aude ; dans ce cadre, le projet
de PTCE est envisagé comme générateur de coopérations économiques et sociales entre
espaces urbains et espaces ruraux ;
Devenir un territoire d’expérimentation
Le projet du PTCE est envisagé également comme un espace d’expérimentation, un écosystème
territorial d’innovation : expérimentation de nouveaux concepts, expérimentations de nouveaux
modèles économiques, expérimentations d’usage.
Si le territoire de la Haute-Vallée de l’Aude n’est pas le premier lieu de l’innovation technologique,
il peut être un lieu d’innovation sociale et d’innovation par les usages, comme l’atteste le caractère
innovant de son tiers-lieux numérique porté par une SCIC, développé en milieu rural et autour
duquel se greffe une dynamique de projets.
Poser les bases d’une économie circulaire
Productrice de matières premières agricoles et sylvicoles, la Haute-Vallée de l’Aude dispose d’un
potentiel de valorisation important de ses coproduits ; ce gisement suggère de s’inscrire dans les

logiques de l’économie circulaire.
Le périmètre retenu pour le PTCE : la Haute-Vallée de l’Aude
Le périmètre de projet visait initialement les
plateaux du Pays de Sault, qui constituent une
unité géographique naturelle au sud-est de
Quillan, dans l’Aude, qui portent une culture
locale historiquement marquée par le catharisme
et par un enclavement qui reste important.
Ce territoire très rural était en effet emblématique
des nombreuses problématiques (fractures, mais
également potentialités) de la Haute-Vallée de
l’Aude : enclavement, faible densité, faible
attractivité…
Il disposait par ailleurs de leviers propres pour
assurer sa revitalisation (développement de
nouvelles formes d’agriculture, de nouvelles
formes de tourisme…).
Une dynamique territoriale co-construite
La mise en œuvre de cette démarche de mobilisation s’est appuyée sur les jalons suivants, organisés
par collège d’acteurs :
Jalons
Date
Objectif
Réunion des Femmes
dirigeantes
8 octobre
2014
Ecouter la parole des femmes du territoire (chefs
d’entreprise, présidentes d’association, élues,
agricultrices…) sur les potentiels de création
d’activités en lien avec un projet de PTCE
Réunion des Jeunes et
Etudiants
27
novembre
2014
Présenter les technologies d’impression 3D et
questionner leurs apports pour le territoire
Ecouter la parole des jeunes du territoire sur les
opportunités de développement économique
Réunion des Entreprises
(62 acteurs économiques
présents)
28 janvier
2015
Générer des projets de coopération économique ou
identifier des coopérations économiques
Mobilisation des Elus
locaux (conseil
communautaire)
12 février
2015
Informer et associer les 89 conseillers
communautaires de la communauté de communes
des Pyrénées audoises de la dynamique et de la
démarche engagée
Réunion n°2 des
Femmes dirigeantes
24 février
2015
Partager l’avancée du projet ainsi que les premiers
enseignements de la démarche
Réunion du Monde
anglo-saxon et d’Europe
du Nord
Mars 2015
Identifier et s’associer à de nouvelles dynamiques
pour redynamiser la Haute-Vallée de l’Aude
Réunion de Mobilisation
des seniors
13 mars
2015
Mobiliser les acteurs de la communauté anglo-
saxonne dans la dynamique de projet
GT Economie circulaire
7 avril
2015
Rechercher, entre acteurs économiques des pistes de
coopération, sur la thématique de la valorisation des
déchets

Jalons
Date
Objectif
Cellule économique
9 avril
2015
Présenter le projet start-up est dans le pré
Réunion des acteurs de
la formation et de la
recherche
28 avril
2015
Renforcer le lien entre acteurs économiques et
acteurs des sphères de l’éducation et de la recherche
(publique ou privée)
o Identifier des potentiels de coopération
La démarche engagée s’est appuyée sur une approche très participative mêlant ateliers, réunions
publiques, entretiens ; elle a permis d’identifier 10 thématiques pour lesquelles le territoire dispose
d’atouts importants pour la définition de nouvelles coopérations économiques
Au travers des débats, différents enjeux sont revenus de manière récurrente ; ils sont synthétisés ci-
après.
Enjeu n°1 : Construire des coopérations économiques entre acteurs
Au travers des différentes réunions qui ont structuré la démarche d’émergence du PTCE de la
Haute-Vallée de l’Aude et qui ont systématiquement rencontré un vif succès, de nouvelles
dynamiques se sont créées autour d’un même constat : le manque d’instances et de lieux de
concertation entre les acteurs du territoire.
Ainsi, le territoire est une terre d’accueil de nouvelles populations, fréquemment étrangères. La
réappropriation de la ruralité par des acteurs exogènesconstitue alors un potentiel important de
coopérations économiques pour le territoire ; éventuellement portés par des valeurs qui tentent de
concilier une certaine forme de développement économique et de respect du territoire, les nouveaux
venus génèrent des besoins en termes de services ou de construction par exemple. Par ailleurs, ils
sont en attente de lien social et d’occasions de développer de nouvelles activités ou de transmettre
leurs savoir-faire et leur expérience.

Enjeu n°2 : Ancrer localement la valeur
La Haute-Vallée de l’Aude est un territoire dont le caractère est marqué par une géographie qui
façonne les relations économiques et sociales (entre enclavement et solidarité) et une histoire forte ;
son potentiel touristique repose sur de nombreux atouts, mais la vallée ne sait pas encore capter et
ancrer la plus-value économique générée par ses paysages et ses nombreuses activités ludiques et
sportives.
Aussi, et pour construire une dynamique sur le sentiment d’appartenance territorial, il a été proposé
de mettre en œuvre une monnaie complémentaire locale (le denier cathare). Cette monnaie ne
pouvant être dépensée que localement, elle pourrait permettre de fixer la richesse apportée en
particulier par les touristes.
Enjeu n°3 : Renouveler les activités traditionnelles
Dans un environnement général qui reste très traditionnel, l’exploitation des nouvelles
fonctionnalités conférées par le numérique pourrait être un outil de redynamisation des activités
traditionnelles. Il en est ainsi des entreprises qui se sont positionnées dans la vente à distance et qui
trouve là de nouveaux canaux de commercialisation qui s’affranchissent des contraintes
géographiques.
Le développement durable est également un puissant levier de changement des industries
traditionnelles.
Enjeu n°4 : Encourager l’entrepreneuriat et réduire l’isolement des entrepreneurs
Dans un environnement peu dense en termes de services à l’entreprise, la démarche de création
d’entreprise n’est pas facilitée ; elle est même d’autant moins naturelle sur un territoire qui a été
marqué par d’importantes (et relativement récentes) faillites industrielles. Le territoire ne dispose
pas par ailleurs de l’attractivité qui lui permettrait d’engager son développement économique sur
des apports exogènes ; il doit donc se concentrer sur l’endogène, sur ses forces vives, pour
construire de l’économie et de l’emploi.
Dans ce sens, les initiatives visant à accompagner l’entrepreneur au travers de son parcours de
création et de développement de l’entreprise, mais également visant à constituer une communauté
d’acteurs économiques partageant des espaces de rencontre et éventuellement d’affaires,
soutiennent favorablement le développement du territoire.La pépinière d’entreprise ERECO et le
Tiers Lieux de Limoux constituent à cet égard un atout ; les événements la start-up est dans le pré
sont une opportunité de développement économique.Un réseau de cafés culturels, de repair-cafés
peuvent accompagner une logique d’organisation d’événements à finalité économique.
Enjeu n°5 : Améliorer l’employabilité et l’efficacité professionnelle
Les réunions successives avec les étudiants (au Lycée technologique de Quillan ou Lycée
enseignement général de Limoux) et avec les acteurs économiques ont mis en exergue la difficulté
de construire des parcours de formation, la difficulté de disposer d’une ressource qualifiée et
professionnelle pour les autres.
Enjeu n°6 : Développer de nouvelles offres de service
La Haute-Vallée de l’Aude est menacée par des mouvements de vieillissement naturel de sa
population et de désertification de ses espaces les plus ruraux. Inversement, avec un acteur des
services à la personne de premier plan sur le territoire et des formations dédiées aux soins et au
service à la personne, elle dispose également d’un potentiel pour adresser les nouveaux marchés
économiques liés au vieillissement. Ayant accès à certaines nouvelles technologies (télémédecine),
elle pourrait constituer un lieu d’expérimentation de nouvelles pratiques.(silver economie)
Enjeu n°7 : Développer l’itinérance
L’itinérance peut permettre de pallier les difficultés liées à la faible densité démographique et la
dévitalisation des zones rurales. Ainsi, l’école numérique, si elle est itinérante, peut être couplée
aux manifestations culturelles… dont elle serait un volet. Une logique d’université populaire
itinérante pourrait également être associée, par exemple autour du thème de la ruralité pour un
premier cycle (qui passerait par une association des habitants à la construction d’une nouvelle
ruralité choisie et non subie) et qui pourrait s’appuyer sur les MOOC.
 6
6
1
/
6
100%