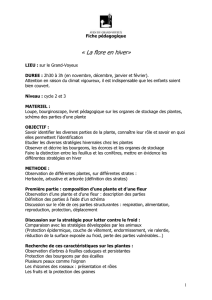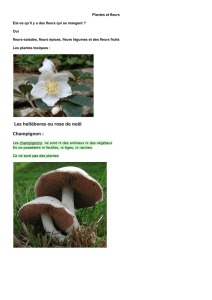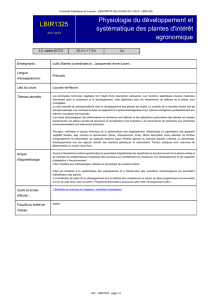Introduction - E

Chapitre 1 : Généralités
Physiologie Végétale - 1 -
Chapitre 1 : Généralités
I. Introduction
I.1. Caractères généraux des végétaux
♣
faculté de synthèse
Les animaux ont besoin pour se nourrir de manger des végétaux ou d’autres
animaux, les végétaux eux utilisent directement les sels minéraux du sol et le
carbone de l’air. Ils sont donc autotrophes . Ces autotrophes sont capables
notamment de fabriquer des glucides grâce à l’énergie solaire c'est-à-dire
d’élaborer leur propre matière, on dit que se sont des producteurs.
En fixant l’énergie solaire et en transformant cette énergie en énergie chimique
les végétaux élèvent ainsi le niveau d’énergie des écosystèmes (s’il n’y avait pas
de végétaux sur la planète, les écosystèmes ne pourraient pas fonctionner
puisque leur niveau énergétique chuterait) et qui permet ainsi leur
fonctionnement. Toute vie sur la planète dépend de ce niveau de producteurs. Les
végétaux constituent donc le support de toute vie animale, sans les végétaux les
animaux ne pourraient vivre puisqu’ils sont incapables de fabriquer eux même
toute ou partie de leurs constituants. Cette faculté de synthèse chez les végétaux
se traduit au niveau cellulaire par la présence d’organites particuliers, appelés
des plastes (dont la cellule animale est dépourvue). La captation de l’énergie
solaire lors de la photosynthèse est rendue possible chez les végétaux par la
présence de pigment assimilateur qu’on appelle des photorécepteurs dont entre
autre les chlorophylles responsables de la couleur verte des végétaux.
♣
présence autour de chaque cellule d’une paroi rigide de nature glucidique.
Chez les algues la paroi glucidique est composée de polymère de mannose et de
xylose , chez les autres végétaux c’est la cellulose qui est le constituant majeur
de la paroi. Cette enveloppe rigide de cellulose empêche la cellule végétale de se
déformer et de se mouvoir, il en résulte donc l’immobilité et la fixation au sol de la
plupart des végétaux. Chez les groupes moins évolués c'est-à-dire chez les algues,
les mousses et les fougères les cellules reproductrices capables de se déplacer
dans l’eau grâce à des flagelles sont dépourvues de parois. La plante est donc
prisonnière de son milieu de vie, ce qui oblige son organisme à avoir une plus
grande souplesse, une grande facilité d’adaptation face à des conditions
défavorables. Toute fois la dispersion des organes de dissémination qu’on appelle
des diaspores (n’importe quel forme de dissémination végétale : spores sexuels,
graines, fruits, boutures, etc…) par divers processus se faisant souvent à de
grandes distances permet aux plantes de coloniser des régions étendue ou
éloignées.
De plus lors de la formation d’embryon, on n’observe pas chez les végétaux de
déplacement, de mouvements cellulaires caractéristiques de l’embryogénèse
animale.

Chapitre 1 : Généralités
Physiologie Végétale - 2 -
Les végétaux constituent des organismes peu différenciés. On distingue chez les
végétaux certains organes (racines, tige, feuilles, fleurs) mais aucune appareil ni
nerveux, ni respiratoire, ni circulatoire. Au maximum, on observera chez les
espèces de plantes les plus évoluées un système conducteur de sève ou par
exemple des organes de réserves. Cette faible différenciation des végétaux est à
mettre en relation avec une grande plasticité de la plante à son environnement et
avec une grande facilité de régénération.
♣
La plasticité des végétaux
Elle vient du fait que l’individu se réalise par une construction continue d’éléments
nouveaux (racine, tige, feuilles, fleurs) au type limité. Ces éléments nouveaux ont
des structures voisines par exemple les feuilles ont des structures de tiges
aplaties. Et la forme et le rôle de ces structures sont sans cesse accommodés aux
conditions extérieures. La facilité de régénération se traduit par le fait qu’un
fragment de tige voir de feuilles ou de racine dans certains cas soit capable de
redonner un nouvel individu, on peut dire ainsi que la multiplication végétative est
particulièrement répandu chez les végétaux alors que chez les animaux elle est
exceptionnelle.
Les recherches sur les cultures de cellules végétales isolées ont montré la
totipotence de la cellule végétale (capables dans certaines conditions de
régénérer une plante entière). Cette totipotence cellulaire s’accompagne d’une
possibilité de multiplication indéfinie, c’est le cas des cellules des méristèmes
(zones qui assurent la croissance des plantes). Chez les animaux, ils cessent de
croître une fois adulte et ont une durée de vie limitée (probablement que cette
durée de vie est programmée dans leur génome), au contraire les végétaux ont
une croissance dite indéfinie et se sont souvent les circonstances extérieures
(climatique) qui peuvent mettre fin à leur existence. Cette totipotence cellulaire
explique également qu’il n’y ait pas chez les végétaux de séparation des cellules
sexuelles (alors que chez les animaux on va distinguer une lignée germinale
dès l’embryon les cellules sexuelles sont isolées)
I.2. Signification et importance de la systématique
La systématique est généralement définie comme la science qui s’intéresse
à la diversité des organismes et à son histoire évolutive.
Ceci implique qu’il faille tout d’abord découvrir, décrire, et interpréter la diversité
biologique puis synthétiser les informations sur cette diversité et les présenter
sous forme de système de classification. La systématique est aujourd’hui de plus
en plus évolutive, son objectif fondamental est la découverte de toutes les
ramifications de l’arbre phylogénétique, c'est-à-dire l’étude de toutes les
modifications qui se sont produites au cours de l’évolution dans les différentes
lignées et elle consiste également en la description de toutes les espèces qui
représentent les extrémités de ces ramifications. On peut donc dire que la
biologie évolutive joue un rôle central en systématique. Il faut bien considérer que
l’évolution biologique est intervenue et intervient encore en permanence. Au point
de départ, il y a eu séparation d’une lignée en 2 voir en plusieurs zones, il est donc
admis que des modifications évolutives se sont produites et se produisent encore
dans ces lignes. La reconstruction par le systématicien de l’histoire évolutive des

Chapitre 1 : Généralités
Physiologie Végétale - 3 -
organismes en établit la phylogénie. Met en évidence les relations
phylogénétiques existantes entre les organismes. Les recherches sur la vitesse
d’évolution ainsi que sur l’âge et le mode de diversification des lignées reposent
directement sur la connaissance de leur relation phylogénétique.
Exemple : 3 membres de la famille des rosacées
Framboisier, cerisier, ronce
Ronce et framboisier sont toutes les 2 des espèces qui ont de nombreux petits
fruits charnus à noyau polydrupe
Alors que le cerisier à des drupes plus grosses et isolées
A partir du simple caractère fruit nous estimons que la ronce et le framboisier
sont étroitement apparentés alors que le cerisier est plus éloigné
Ronce et framboisier sont des groupes frères
On obtient le même arbre si on s’appui sur d’autres caractères des rosacées tels
que des caractères structuraux, sur la composition chimique et sur la
comparaison des séquences ADN
La classification et l’identification (ou détermination) sont deux activités
importantes des systématiciens.
♣
La classification consiste à placer une entité biologique dans un système
de relation logiquement organisé et hierarchisé.
Exemple : quel est la place du hêtre dans un système de classification hiérarchisé
Ronce
Framboisier
Cerisier
Règne des plantes vertes
Trachéophytes (plantes vasculaires)
Non vasculaire
Plantes à fleurs
Plantes diverses dépourvues de fleurs
Fagacées
Autres familles
Fagus
Autres genre
sylvatica
autres espèces

Chapitre 1 : Généralités
Physiologie Végétale - 4 -
Il appartient aux plantes vasculaires (trachéophytes), aux plantes à fleurs,…
La classification peut être également utilisée de manière prédictive.
Exemple : igname
Chez certaines espèces d’igname on a trouvé des précurseurs biochimiques de la
cortisone, ce qui à entraîné la recherche dans toutes les espèces du genre puis la
découverte de cette substance chez d’autres espèces.
Une classification est d’autan plus prédictive qu’elle représente bien la phylogénie
♣
L’identification consiste à déterminer si une plante inconnue appartient à
un groupe de plantes connues et nommées. Il existe 3 moyens principaux
de déterminer une plante :
-
interroger un botaniste qui connaît les plantes de la région
-
consulter des livres qui permettent d’identifier des plantes
les flores
-
consulter un herbier de référence (= installation destinée à
conserver les collections scientifiques de plantes séchées)
ainsi on peut comparer notre plante à identifier à un spécimen
déterminé se trouvant dans l’herbier
La systématique regroupe un grand nombre de discipline
Nous dépendons de nombreuses espèces de plantes, tout d’abord pour
notre nourriture, pour notre protection (vêtement, construction, …), pour les fibres
nécessaires aux vêtements et au du papier, pour les médicaments, pour les outils,
pour les colorants et de multiples d’autres usages.
C’est en parti grâce à notre connaissance systématique des végétaux que nous
pouvons utiliser des espèces
La connaissance de la systématique oriente par exemple la recherche de plante
pouvant potentiellement avoir une importance industrielle.
Botanique
(Science des
plantes)
Morphologie
Phytochimie
Biologie
moléculaire
Physiologie
Biologie
évolutive
Ecologie
Systématique

Chapitre 1 : Généralités
Physiologie Végétale - 5 -
Exemple : dans les années 1960, au cours de ses études des plantes des Andes au
Pérou, le botaniste Dioscoride à découvert et récolter une espèce sauvage de
tomate importation de nouveau gènes croisement amélioration du goût
des tomates
De tels progrès ont amélioré la productivité, la résistance aux maladies et
d’autres caractères utiles chez les plantes cultivées.
De plus la systématique est essentielle et indispensable pour les sciences
biologiques qui s’intéressent à la diversité comme l’écologie, la biologie de la
conservation
I.3. Place des grands groupes végétaux
Traditionnellement, le vivant a été divisé en 2 règnes : Animal et végétal, à cette
époque les bactéries et les champignons été considérer comme faisant parti des
végétaux. En s’appuyant sur les séquences de l’ARN ribosomique on distingue
aujourd’hui 6 grands ensembles : Eubactéries, Archebactéries, Protistes,
Champignons (incluant aujourd’hui les lichens), Animaux et Végétaux.
Les Eubactéries et Archebactéries possèdent une cellule procaryote (cellules
réduite à une paroi externe, une membrane plasmique et un ADN circulaire incluse
dans le cytoplasme). Les 4 autres ensembles possèdent des cellules eucaryotes
(membrane plasmique protégée ou non par une paroi externe, cytoplasme
comportant un noyau véritable, cytosquelette, système endomembranaire,
éventuellement des flagelles locomoteurs et dotées d’un ensemble d’organites
résultant d’endosymbiose)
Arbre phylogénétique simplifié du vivant
Lignée des Ochrophytes
p
r
o
c
a
r
y
o
t
e
e
u
c
a
r
y
o
t
e
Eubactéries
Archébactéries
Plantes terrestres
Algues
vertes
Algues rouges
Algues brunes
Champignons
Animaux
Euglénobiontes
Protistes
Lignée verte
Chlorobionte
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
1
/
22
100%