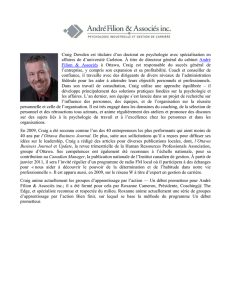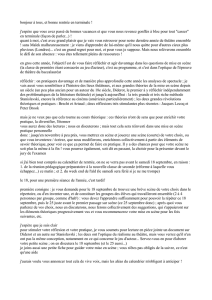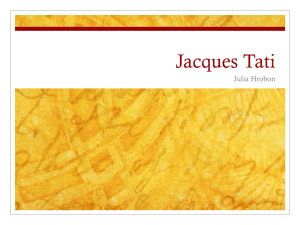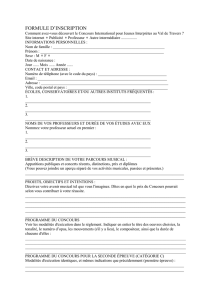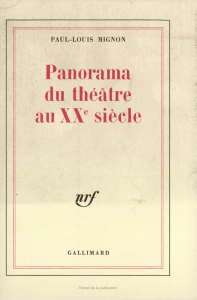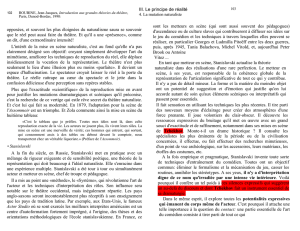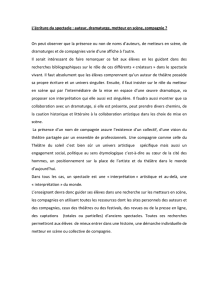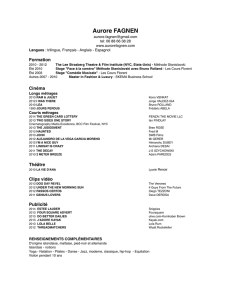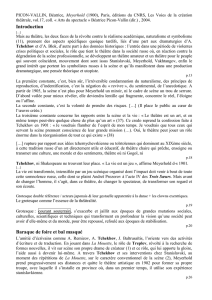Le modèle musical dans les théories de la mise en scène au XXe

1
Muriel Plana (Toulouse II - Le Mirail)
Le modèle musical dans les théories de la mise en scène au XXe siècle
8 juin 2010
Texte de la communication
Travaux de Muriel Plana sur le sujet :
* Les relations théâtre-musique: du désir au modèle, coordonné et présenté par Muriel Plana
et Frédéric Sounac, Colloque international, Université Toulouse le Mirail, 25, 26, 27 octobre
2007, actes à paraître.
* « Puissance et fragilité de la danse dans la relation théâtre-musique : de Meyerhold à la
Needcompany » dans Quel dialogisme dans la relation théâtre-musique-danse ?, Journée
d’études de l’Institut de Recherches Pluridisciplinaires Arts Lettres Langues (IRPALL),
organisée par Elise van Haesebroeck, Floriane Rascle et Herveline Guervilly, Université
Toulouse II-Le Mirail, jeudi 8 avril 2010.
* « Musique et son dans la mise en scène stanislavskienne, entre méfiance et plaisir » dans
Interactions entre musique et théâtre, Journées d’études organisées par Guy Freixe et
Bertrand Porot (CRAIF et CERHIC), 23 octobre 2008 et 13 mai 2009, Université de Reims et
Université d’Amiens, à paraître dans Corridor, CRAIF, Université d’Amiens, 2010.
* « Les songs dans la comédie, jubilation et subversion. L’exemple de la réécriture de
L’Opéra du Gueux (1728) de John Gay par Bertolt Brecht (1928) », dans La Comédie en
mouvement. Avatars du genre comique au XXe siècle, sous la direction de Corinne Flicker,
Publications de l’Université de Provence, 2007.
Liens :
* CV sur le site de l’Université Toulouse-Le Mirail :
http://w3.lla.univ-tlse2.fr/equipe/membres/plana.htm
* La Compagnie du Planisphère, dirigée par Muriel Plana :
http://cdptheatre.free.fr/
***
Pour se définir en tant qu’art autonome (évidemment par rapport au texte dramatique)
et devenir l’art du théâtre
1
, la mise en scène moderne, art jeune né seulement à la fin du XIXe
siècle, a eu besoin de modèles et de références esthétiques. Elle est allée les chercher dans les
autres arts, de préférence des arts qui n’ont rien de littéraire.
Les deux modèles retenus paraissent, au premier abord, antithétiques, mais on constate,
après étude, qu’ils sont le plus souvent étroitement liés chez les grands réformateurs du
théâtre moderne : un modèle visuel et spatial tiré des arts plastiques, de l’architecture ou du
1
De l’art du théâtre est le titre de l’ouvrage fondateur de E. G. Craig (Circé, 1999) qui ne cesse de proclamer
dès 1911 l’autonomie de la mise en scène comme art créateur à part entière : dans sa théorie, le théâtre est mise
en scène, en dehors de tout lien au texte.

2
cinéma, et/ou, plus subtil, parfois dissimulé derrière le premier, un modèle temporel inspiré de
la musique (mais où la danse peut prendre parfois, par exemple chez Meyerhold, une grande
importance
2
).
L’usage des modèles externes s’exprime surtout au début du XXe siècle, car c’est à
cette époque que l’essentiel du travail théorique se fait, mais les modèles plastique et iconique,
ou encore chorégraphique, visiblement dominants sur les scènes d’aujourd’hui, investies en
masse par des plasticiens, des vidéastes et des chorégraphes metteurs en scène au sein du
théâtre actuel scéno-centrique, ou, selon le terme de Hans-Thies Lehmann, post-dramatique,
sont très souvent associés à un modèle musical, plus secret, plus difficile à saisir...
Ainsi un « théâtre d’images » comme celui du Théâtre du Radeau et de François
Tanguy, où la scène est composée comme un tableau abstrait traversé de lignes, de volumes et
de couleurs, et le décor comme une installation plastique jusque dans le choix des matériaux
utilisés, est-il également un théâtre musical : par exemple, la construction scénique des
spectacles Coda et Ricercar, dont les seuls titres se réfèrent à des formes musicales précises,
est transposée, tant au niveau spatial que temporel d’un modèle musical explicite.
On se concentrera cependant ici sur le modèle musical tel qu’il se déploie chez les
fondateurs de la mise en scène occidentale moderne au tournant du XXe siècle que sont
Antoine, Craig, Stanislavski et Meyerhold alors qu’ils tentent de donner à ce nouvel art,
encore peu reconnu et qui n’a que peu d’autonomie face à la littérature, une dignité et des lois
équivalentes à celles qui existent dans les Beaux-arts, dans la danse et dans la musique.
Si nous parlons de modèle, c’est qu’il ne s’agit pas chez ces théoriciens et praticiens de
la mise en scène, d’emprunter à la musique de leur temps. La question n’est pas non plus celle
de la place qu’ils accordent concrètement à la musique dans leurs spectacles, autre aspect
passionnant de la relation théâtre-musique, que j’ai explorée dans d’autres cadres chez
Stanislavski
3
ou chez Brecht
4
, mais que je ne traiterai pas ici.
Il s’agit plutôt, dans notre cas, de cerner l’idée que se font ces artistes théoriciens du
théâtre de l’art dont ils cherchent à s’inspirer, en l’occurrence la musique, de cerner l’idéal
esthétique ou les fantasmes qu’ils projettent en lui, de comprendre comment et pourquoi ils
s’y réfèrent, enfin, de mesurer en quoi le modèle musical a inspiré des réformes essentielles
dans la mise en scène du début du XXe siècle.
On verra que chacun a une conception spécifique de la musique et qu’ils en usent très
diversement, selon qu’ils défendent une esthétique réaliste ou symboliste, selon qu’ils
s’inscrivent dans une approche idéaliste ou pragmatique de la scène, mais qu’ils y puisent tous
des lois, des exemples, un vocabulaire esthétique, qu’elle est pour eux un secours, un recours,
voire un rêve, qu’ils cherchent et parfois trouvent en elle des solutions aux problèmes plus ou
moins concrets que leur posent aussi bien la pratique de la mise en scène elle-même, que la
vie de la troupe, le jeu des acteurs, leur rapport aux textes qu’ils souhaitent monter, la relation
scène/salle.
2
Voir Muriel Plana, « Puissance et fragilité de la danse dans la relation théâtre-musique : de Meyerhold à la
Needcompany » dans Quel dialogisme dans la relation théâtre-musique-danse ?, Journée d’études de l’Institut
de Recherches Pluridisciplinaires Arts Lettres Langues (IRPALL), organisée par Elise van Haesebroeck,
Floriane Rascle et Herveline Guervilly, Université Toulouse II-Le Mirail, jeudi 8 avril 2010.
3
Voir Muriel Plana, « Musique et son dans la mise en scène stanislavskienne, entre méfiance et plaisir » dans
Interactions entre musique et théâtre, Journées d’études organisées par Guy Freixe et Bertrand Porot (CRAIF et
CERHIC), 23 octobre 2008 et 13 mai 2009, Université de Reims et Université d’Amiens, à paraître dans
Corridor, CRAIF, Université d’Amiens, 2010.
4
Voir Muriel Plana, « Les songs dans la comédie, jubilation et subversion. L’exemple de la réécriture de
L’Opéra du Gueux (1728) de John Gay par Bertolt Brecht (1928) », dans La Comédie en mouvement. Avatars du
genre comique au XXe siècle, sous la direction de Corinne Flicker, Publications de l’Université de Provence,
2007.

3
Antoine : la troupe comme « orchestre », le metteur en scène comme « chef »
Chez Antoine, l’inspiration musicale est avant tout pragmatique. Elle lui permet de
penser la fonction, le rôle du metteur en scène, figure nouvelle du théâtre, dont il est une des
premières incarnations en Europe, sans doute la première en France. Bien qu’il ne soit en rien
musicien et qu’il l’investisse dans le cadre limité d’une esthétique naturaliste, on s’apercevra
que le modèle musical est utilisé plus largement qu’on ne l’imagine par celui qui est considéré
comme l’inventeur de la mise en scène moderne.
Sensible au travail sur les ensembles, acteurs et figurants harmonieusement disposés
sur scène, de la troupe allemande des Meininger, qui applique comme lui les principes d’un
théâtre réaliste, Antoine comprend vite que l’harmonie d’un tableau théâtral repose sur la
composition et la maîtrise de l’image scénique dans sa totalité :
Je ne connais rien en musique ; mais on m’a dit que Wagner avait, dans certains opéras, des chœurs à
multiples parties et que chaque série de choristes personnifiait un élément distinct de la foule, se fondant
dans un ensemble parfait. Pourquoi, dans le théâtre parlé, ne ferions-nous pas ça ? M. Emile Zola le
voulait pour Germinal et ne l’a pas pu pour des motifs budgétaires que faisaient valoir les directeurs. Son
dessein était de faire répéter longtemps les ensembles sous la conduite de comédiens figurants. Vous
voyez, c’était le procédé des Meininger
5
.
Antoine emprunte donc aux Allemands, à Wagner et aux Meininger, l’idée de la mise en jeu
de l’ensemble des personnages sur scène. En bon naturaliste, théoricien du milieu, il considère
en effet le décor comme un personnage et comme une force dramatique ; on se souvient du
reste de sa fameuse définition de la mise en scène qui serait au théâtre ce que la description
est au roman. Dès lors, l’image scénique (jeu, scénographie, chorégraphie) doit être
« composée » par le metteur en scène.
La mise en scène n’est pas encore pour lui, comme elle le sera pour Craig, un art de
création à part entière ; elle demeure (comme d’ailleurs pour Appia, Lugné-Poe ou
Stanislavski) un art de l’interprétation au service d’un texte (d’une partition) mais ce doit être
une interprétation visuelle porteuse de sens, d’ordre et d’unité : « La mise en scène doit servir
le texte dans toutes ses parties », écrit-il ailleurs.
Le metteur en scène est donc bel et bien le garant de l’interprétation générale, il fait le
lien entre la troupe pensée comme un orchestre et l’auteur considéré comme un compositeur,
il est le premier lecteur et interprète du texte désormais traité comme une partition. Il est celui
qui maîtrise l’ensemble parce qu’il s’exclut lui-même de l’exécution instrumentale afin de
mieux la diriger.
De cette conception du metteur en scène comme chef d’orchestre, Antoine tire l’idée
de la démolition du « système des étoiles », où les vedettes s’exprimaient individuellement et
en dehors de tout contrôle extérieur qui tendrait à instaurer de l’unité dans le spectacle, au
service de la partition écrite dans sa totalité. La mise en scène est bien, pour Antoine comme
pour son contemporain Louis Becq de Fouquières, premier esthéticien français de la mise en
scène, un art de la synthèse
6
. Il critique également le fait que les acteurs de son temps ne
savent pas lire une pièce dans son intégralité, se contentant de leur partie, un peu comme des
musiciens d’orchestre. Le metteur en scène est donc celui qui lit et maîtrise l’ensemble de
l’œuvre, en fixe l’interprétation globale, le tempo et le rythme, les grandes lignes de sens, et
en garantit l’homogénéité:
5
Jean Pierre Sarrazac et Philippe Marcerou, Antoine, l’invention de la mise en scène, Anthologie de textes
d’Antoine, « Parcours de théâtre », Actes Sud Papiers, 1999. « Lettre à Francisque Sarcey (6 juillet 1888) »,
p. 58-59.
6
Voir Louis Becq de Fouquières, L’Art de la mise en scène, Editions entre/vues, 1998.

4
Alors que l’interprétation d’un ouvrage exige avant tout une qualité tellement essentielle qu’elle
dispense des autres, l’ensemble, condition sans laquelle une œuvre littéraire est défigurée et massacrée
comme le serait une œuvre musicale dont les exécutants ne joueraient pas en mesure, les directeurs,
substituant au système de l’ensemble le système des étoiles, mettent en vedette un ou deux noms connus
et cotés, purs-sangs dont ils paient à prix d’or la course plus ou moins brillante, et entourent ces grands
favoris souvent fatigués mais tenant toujours la corde, de malheureux acteurs recrutés au hasard pour
servir de repoussoirs aux têtes d’affiches. De cette interprétation hétéroclite résulte une absolue
déformation de l’œuvre, d’où nouvelle et irrémédiable cause de répulsion pour le public indigent
7
.
Chez Antoine, le modèle musical va également s’appliquer à l’acteur quand il sera
question de sa position - juste ou fausse - face au texte :
L’idéal absolu de l’acteur doit être de devenir un clavier, un instrument merveilleusement accordé, dont
l’auteur jouera à son gré. Il suffit qu’une éducation technique toute matérielle ait assoupli physiquement
son corps, son visage, sa voix et qu’une éducation intellectuelle convenable l’ait mis à même de
comprendre simplement ce que l’auteur le charge d’exprimer
8
.
Le comédien doit donc se faire servile ; il faut briser son ego, son individualisme et son
indépendance artistique, qui le confine, selon Antoine, au cabotinage et à la virtuosité
gratuite
9
; il doit désormais se considérer comme l’instrument (objet et moyen) de l’auteur (du
texte, donc), ce qui exige de lui qu’il soit techniquement parfait (juste physiquement et
vocalement), artistiquement souple (capable de composer n’importe quel personnage
10
) ; il
faut, écrit Antoine, qu’il soit précisément un « clavier » - soit un instrument à large
« tessiture », à la fois mélodique, rythmique et harmonique, susceptible de jouer en solo, mais
aussi capable de se fondre dans la masse orchestrale ou de soutenir le solo d’un autre
instrument. C’est ainsi qu’on peut voir que la troupe, chez Antoine, est véritablement pensée
comme un orchestre, dont le metteur en scène serait le chef puissant et vigilant.
Dans ce programme, présenté comme une recette de cuisine dans Causerie sur la mise
en scène (avril 1903), Antoine use largement de la métaphore musicale pour définir la mise en
scène : Saisir nettement dans un manuscrit l’idée de l’auteur, l’indiquer avec patience, avec précision, aux
comédiens hésitants, voir de minute en minute la pièce surgir, prendre corps. En surveiller l’exécution
dans ses moindres détails, dans ses jeux de scène, jusque dans ses silences, aussi éloquents parfois que
le texte écrit. Placer les figurants hébétés ou maladroits à l’endroit qu’il faut, les styler, fondre ensemble
les petits acteurs et les grands. Mettez d’accord toutes ces voix, tous ces gestes, tous ces mouvements
divers, toutes ces choses disparates, afin d’obtenir la bonne interprétation de l’œuvre qui vous est
confiée
11
.
En cette fin du XIXe siècle, il y a non seulement à lutter contre les acteurs vedettes mais aussi
contre les autres artistes du plateau (décorateurs, éclairagistes, costumiers) et contre les
directeurs administrateurs. Ce modèle « orchestral », à l’intérieur du modèle musical général,
7
André Antoine, « Causes de la crise actuelle » dans Le Théâtre Libre, mai 1890, pp. 23-27. Texte cité dans Du
théâtre d’art à l’art du théâtre, anthologie des textes fondateurs, « André Antoine : Le Théâtre Libre », textes
réunis et présentés par Jean-François Dusigne, Éditions théâtrales, 1997.
8
Antoine, l’invention de la mise en scène, « Lettre à Charles le Bargy (24 octobre 1893) », op. cit., p. 93.
9
Ibid., pp. 136, 137 : « Il faudra que les comédiens modernes renoncent à leur voix, leur seule ressource d’à
présent, qu’ils cultivent comme des chanteurs […]. Enfin qu’ils vivent leur personnage au lieu de réciter leur rôle
avec plus ou moins de virtuosité ».
10
Ibid., p. 77 : « À ces ouvrages tout d’observation et d’étude, il faudra des interprètes, des comédiens
primesautiers et vrais, imprégnés de réalité » ; « assortis à tous les emplois » ; recrutés non plus sur des « qualités
physiques », des « dons naturels » mais qui vivront « de vérité, d’observation, d’étude directe de la nature ».
11
Antoine, l’invention de la mise en scène, op. cit., p. 107. Je souligne.

5
est celui auquel s’attachent tous les penseurs de la prise du pouvoir du metteur en scène non
seulement sur l’œuvre - il en est désormais le premier lecteur et celui qui donne la ligne
générale de son interprétation aux exécutants - mais aussi sur les différents travailleurs de
l’entreprise théâtrale, qui, non contents de créer chacun de leur côté, dans leur partie, passent
leur temps à s’entredéchirer ou à tirer le couverture à soi et compromettent l’élaboration et
l’unité finale du spectacle
12
. La mise en scène est, pour Antoine, un art harmonique : il s’agit
bien de « fondre » dans un « accord » le « disparate » (créant de la dissonance malheureuse)
des réalisations individuelles.
Avec Antoine, le théâtre commence donc à être pensé comme un art synthétique
mettant certes en œuvre plusieurs éléments et compétences artistiques ou techniques mais
sous l’autorité du seul art théâtral (et non de chacun des arts qui interviennent en lui, comme
le jeu, la décoration, la peinture, la musique…), lequel devient ainsi un art autonome et un art
spécifique, qui ne peut plus se laisser asservir notamment, comme le dénonceront avec force
Craig ou Appia, à l’art des peintres décorateurs
13
.
Antoine conçoit également la mise en scène comme un art du temps dans au moins
deux sens du terme : le temps comme durée et le temps comme rythme. Tel un architecte ou
un chef de chantier, le metteur en scène guide et surveille le processus de création, la
construction progressive du spectacle (« voir de minute en minute la pièce surgir, prendre
corps »). Or, musique et théâtre ont en commun de procéder à ce qu’on appelle des
« répétitions ». À partir de l’avènement du metteur en scène et du Théâtre d’Art, celles-ci vont
prendre de plus en plus d’importance, si bien qu’on ne concevra plus (sauf peut-être
aujourd’hui dans les matches d’improvisation ou le « théâtre d’acteur » des T. G. Stan) de
s’en passer ou de les négliger comme système de travail indispensable à la création théâtrale.
Chez Antoine, le metteur en scène devient le maître incontesté de ces répétitions -
devenues nécessaires - comme le chef d’orchestre l’est de celles de ses musiciens. Son travail
se situe donc dans une temporalité distincte - celle de la durée - de celle de l’acteur – qui, lui,
reste divisé entre la durée lorsqu’il est en répétition et l’instant au moment de la
représentation. Le régisseur travaille en amont de celle-ci, et là apparaît une différence avec le
chef d’orchestre, doit s’effacer au moment de la première
14
.
Enfin, la mise en scène est, à l’image de la musique, un art du temps dans la mesure où
le metteur en scène impose et surveille le rythme de la représentation sur le plan visuel des
actions scéniques (« les jeux de scène ») mais aussi sonore : il contrôle l’alternance entre le
verbe et le silence (« jusque dans ses silences » précise Antoine) dont la valeur d’expressivité
et de construction lui apparaît clairement.
L’idée ultérieurement défendue par Meyerhold que le metteur en scène est avant tout
le maître du rythme du spectacle est donc déjà présente chez Antoine. Mais si, chez le metteur
en scène naturaliste, le modèle a un effet limité, essentiellement pragmatique et politique,
puisqu’il lui permet avant tout de penser la fonction et le pouvoir du metteur en scène face
12
Voir dans « De certaines fâcheuses tendances du théâtre moderne », (E. G. Craig, De l’Art du théâtre, Circé,
1999, pp. 107 à 118) la satire amusante que Craig fait, de son côté, de l’état de l’entreprise théâtrale en cette fin
de siècle.
13
Dans ses mises en scène symbolistes au Théâtre de l’œuvre, Lugné-Poe, contemporain d’Antoine, ne résistera
pas toujours au pouvoir des peintres, transformant quelquefois la scène en lieu d’exposition pour ses amis
peintres Nabis.
14
Notons que c’est Kantor qui ira le plus loin dans cette logique en poussant l’imitation du modèle orchestral
jusqu’à rester sur scène, donnant en direct le rythme, ajustant des éléments de décor, au moment de la
représentation. En effet, l’idée que l’art est un processus et qu’il ne peut jamais être « fini » implique la présence
du créateur au moment du partage de l’œuvre (du processus) avec le public, créateur toujours en action lors de ce
qui n’est qu’une répétition publique (et non un spectacle achevé). Les « spectacles » de Kantor sont donc des
sortes de « concerts », événements (happenings) plus que représentations.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
1
/
17
100%