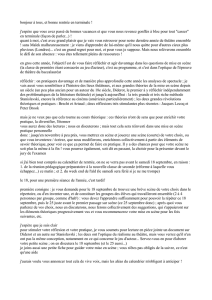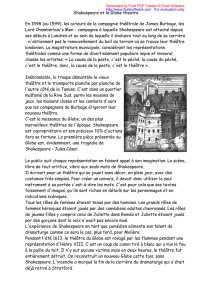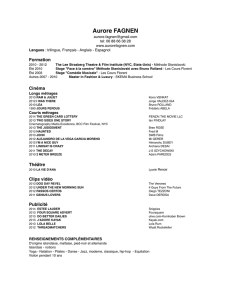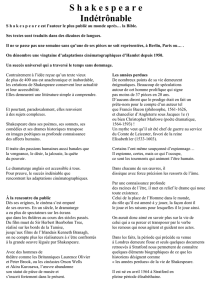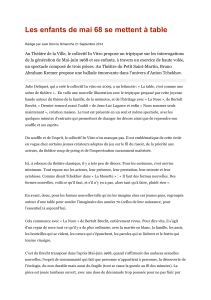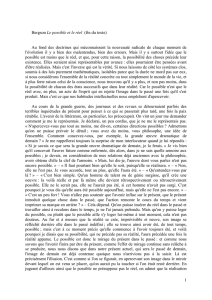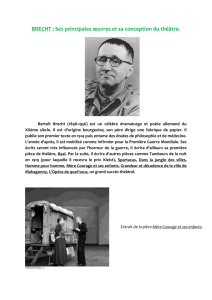102 - Fi-Théâtre

102
ROUBINE, Jean-Jacques, Introduction aux grandes théories du théâtre,
Paris, Dunod-Bordas, 1990:
III. Le principe de réalité
4. La mutation naturaliste
103
opposées, et souvent les plus éloignées du naturalisme saura se souvenir
que le réel peut aussi faire du théâtre. Et qu'il a une «présence», comme
on dit, d'une extraordinaire intensité!
L'intérêt de la mise en scène naturaliste, c'est au fond qu'elle n'a pas
clairement désigné son objectif: croyant simplement développer l'art du
mimétisme, améliorer les techniques de reproduction du réel, elle déplace
insidieusement la vocation de la représentation. Le théâtre n'est plus
seulement le lieu d'une illusion plus ou moins «parfaite». Il devient un
espace d'hallucination. Le spectateur croyait laisser le réel à la porte du
théâtre. Le réelle rattrape au cœur du spectacle et le jette dans la
confusion délicieuse d'une perception sans repères stables.
Plus que l'exactitude «scientifique» de la reproduction mise en avant
pour justifier les mutations dramaturgiques et scéniques qu'il préconise,
c'est la recherche de ce vertige qui estle rêve secret du théâtre naturaliste.
Et c'est lui qui fait sa modernité. En 1879, l'adaptation pour la scène de
l'Assommoir est un triomphe. Et Zola commente ainsi la mise en scène du
huitième tableau:
«C'est le tableau que je préfère. Toutes mes idées sont là, dans celte
reproduction exacte de la vie. Les acteurs ne jouent plus, ils vivent leurs rôles. La
mise en scène est une merveille de vérité; ces hommes qui entrent, qui sortent,
qui consomment assis à des tables ou debout devant le comptoir, nous
transportent chez un véritable liquoriste.» (Préface de l'Assommoir).
• Stanislavski
A la fin du siècle, en Russie, Stanislavski met en pratique avec un
mélange de rigueur exigeante et de sensibilité poétique, une théorie de la
représentation qui doit beaucoup à l'idéal naturaliste. Elle s'enracine dans
une expérience multiple. Stanislavski a été tour
à
tour ou simultanément
acteur et metteur en scène, chef de troupe et pédagogue.
Il a mis au point une «méthode», le «Système», qui révolutionne l'art de
l'acteur et les techniques d'interprétation des rôles. Son influence sera
notable sur le théâtre occidental, mais inégalement répartie. Les pays
anglo-saxons seront incontestablement plus réceptifs à son enseignement
que les pays de tradition latine. Par exemple, aux Etats-Unis, le fameux
Actor Studio où se sont exercés les meilleurs interprètes américains est un
centre d'autoformation fortement imprégné,
à
l'origine, des thèses et des
orientations méthodologiques de l'école stanislavskienne. En France, ce
sont les metteurs en scène (qui sont aussi souvent des pédagogues)
d'ascendance ou de culture slaves qui contribueront à diffuser ses idées sur
le jeu du comédien et les techniques à travers lesquelles elles peuvent se
réaliser, en particulier Georges et Ludmilla Pitoëff entre les deux guerres,
puis, après 1945, Tania Balachova, Michel Vitold, et, aujourd'hui Peter
Brook ou Antoine
Vitez ...
En tant que metteur en scène, Stanislavski actualise la théorie
naturaliste dans des réalisations d'une rare perfection. Le metteur en
scène, à ses yeux, est responsable de la cohérence globale de la
représentation de l'articulation significative de tout ce qui y contribue.
Il n'y a pas de détail mineur. La forme et la matière du moindre objet
ont un potentiel de suggestion et d'émotion qui justifie qu'on lui
accorde autant de soin qu'aux éléments scéniques ou interprétatifs qui
passent pour essentiels.
Il fait sensation en utilisant les techniques les plus récentes. Il tire parti
des nouveaux moyens d'éclairage pour créer des atmosphères d'une
force prenante. Il joue volontiers du clair-obscur. Il découvre les
ressources expressives du bruitage qu'il met en œuvre avec un grand
souci d'exactitude et de raffinement, notamment dans ses mises en scène
de Tchekhov. Monte-t-il un drame historique ? Il consulte les
spécialistes les plus éminents de la période ou de la civilisation
concernées, il effectue, ou fait effectuer des recherches minutieuses,
d'un point de vue archéologique, sur les accessoires, leurs matériaux, les
étoffes des costumes, etc.
A la fois empirique et pragmatique, Stanislavski invente toute sorte
de techniques d'entraînement du comédien. Toutes ont un objectif
commun: éliminer le formalisme et la mécanisation du jeu, casser les
routines, annihiler les stéréotypes. A ses yeux, il n'y a d'interprétation
digne de ce nom qu'irradiée par une intense vie intérieure. Voilà
pourquoi il confère un tel poids à ces silences expressifs qui suggèrent
un au-delà du discours et dont Tchekhov fait un instrument essentiel de
sa dramaturgie.
Dans le même esprit, il explore toutes les potentialités expressives
qui émanent du corps même de l'acteur. C'est pourquoi il attache une
telle importance à la question du contact: une partie essentielle de l'art
du comédien consiste à tirer parti de tout ce qui

104
Ifllrodllt:I;Ofl IIILI' grll1l1/,',I'
1111'111"',1'
tllllllt!âlre
lOS
LI:
l'riflt:;l/(; dl: n<a/lll<
peut suggérer la relation du personnage
à
son environnement, sa
façon de regarder, d'écouter, d'évoluer dans un espace donné, d'utiliser
un objet familier, de se rapprocher ou de s'éloigner d'autrui, etc.
Il n'y a pas non plus, dans la conception stanislavskienne,
d'incarnation vivante si elle ne se charge d'un double «vécu» que l'acteur
doit s'efforcer de mettre en coïncidence : le «vécu» imaginaire du
personnage et le «vécu» réel de l'interprète. Pour ce faire, Stanislavski
n'hésite pas à doter protagonistes, comparses et figurants de
«biographies» doublement fictives puisqu'elles sont une construction
imaginaire appliquée à des figures qui ne le sont pas moins ! Quant au
«vécu» réel de l'acteur, il est mobilisé pour assurer la singularité vivante
de l'interprétation. La difficulté majeure, dans le travail du comédien, dit
Stanislavski, est qu'il doit se battre chaque soir contre tout ce qui
menace la fraîcheur, le jaillissement de son interprétation, contre tout ce
qui en fait une chose morte : la routine, l'automatisme, l'insincérité, etc.
En l'occurrence, le problème se complique du fait que l'acteur doit à la
fois faire déferler en lui une émotion qui transfigurera son incarnation et
qui plongera ses racines dans sa «mémoire affective», et rendre cette
émotion perceptible et compréhensible au spectateur. Ce qui suppose un
travail de formalisation complexe, et un contrôle constant de ses
retentissements, tant sur le public que sur le comédien ou ses
partenaires. Voilà pourquoi Stanislavski exige de ses acteurs une
autodiscipline approfondie, une maîtrise de toutes les techniques
corporelles et vocales.
Cette maîtrise étant acquise, l'acteur sera en mesure de mettre en
œuvre ce que Stanislavski appelle le revivre. Le revivre, dans sa
terminologie, est l'antithèse du représenter. Le comédien qui
«représente» se borne à utiliser des formes usagées, convenues des
stéréotypes. Le revivre, au contraire, c'est la rencontre d'une situation
dramatique donnée et du passé intime de l'acteur. Celui-ci
s'approprie totalement la situation proposée par l'auteur en
l'articulant à une expérience vécue identique ou homologue. Par
exemple, s'il joue un crime passionnel (Othello), il cherchera à
retrouver, en lui, la mémoire d'une souffrance passionnelle suraiguë ...
Par là, l'interprétation échappera aux poncifs. Elle acquerra une
singularité, une authenticité qui donneront au spectateur le
sentiment d'une urgence complètement neuve ou si l'on veut, d'un
«naturel» encore jamais atteint. Une fois de plus, le génie de l'homme de
théâtre, c'est de déplacer les frontières entre le «réel» et la «représentation»
et d'élargir le champ de cette dernière.
La scène naturaliste : bilan et prolongements
Bien sûr, la scène naturaliste prête le flanc à bon nombre de critiques. On
lui reprochera de se perdre dans l'accumulation quasi documentaire ou
pittoresque d'effets de réel qui finissent par se télescoper, s'enchevêtrer et
manquer la fonction qui leur était assignée. Mais son exigence même, dans
ce qu'elle peut avoir, à nos yeux, d'excessivement vétilleux, doit être
replacée, pour être correctement évaluée, dans le contexte de l'époque. Elle
dénonce en effet le manque de rigueur de ces pratiques banales qui
confondent trop facilement convention et facticité, stylisation et stéréotype.
Les approximations en vigueur, les pseudo-trompe-l'œil (miroirs peints qui
ne renvoient aucun reflet, fenêtres qui ne s'ouvrent pas, clair de lune qui
semble sourdre du sol, etc.) tout cela, grâce à l'exigence naturaliste, sera de
moins en moins toléré.
Et le débat fondamental sera clairement posé : le théâtre ne saurait à la
fois prétendre reproduire le monde de façon «véridique» ou «réaliste» et
refuser de s'interroger sur la validité et l'efficacité des techniques mises en
œuvre à cette fin. Affirmer le caractère incontournable de la convention
théâtrale, n'est-ce pas insidieusement justifier la routine de certaines
pratiques?
Le naturalisme aura fourni à la scène de nouveaux instruments.
On a beaucoup ironisé sur le recours à l'objet «vrai». Mais, au-delà de
l'ingénuité mimétique qu'il semble révéler, il offre, transformé en
«accessoire», une théâtralité d'une force imprévue. Brecht saura s'en
souvenir et, après lui, ainsi que l'observait Bernard Dort en 1964, la scène
«s'emplit de matériaux hétéroclites, lambeaux d'étoffes usées, fragments
d'objets quotidiens arrachés à quelque désastre [ ... ] Le monde des choses a
de nouveau accès au théâtre. Ce n'est sans doute plus ces «milieux» trop
bien imités dont Antoine rêvait, mais c'est encore un milieu qui signifie
notre dépendance vis-à-vis de la société, qui nous dit immédiatement

126
In/roduc/iofl III1X
g/'(/fld,'.l'
/Mo"'I',I'
du
tll/':(J/rt~
IV. Les six tentations du théâtre
2. Le théâtre, service du texte
127
Brecht. Evoquer les expériences du Living Theatre, c'est redire le rêve
d'Artaud ...
Une approche strictement «nationale» s'accordait, grosso modo, à la
situation du théâtre des siècles précédents. Et encore! Après tout, les
premières réflexions sur Aristote et l'invention de l'opéra nous venaient
d'Italie. Les théoriciens allemands nourrissent le Romantisme français
... Mais à partir des années 1880, elle devient de plus en plus
inadéquate. Avec le développement des voyages, des tournées, puis des
festivals, le théâtre s'internationalise. On a mentionné le retentissement
de Brecht sur la pratique française des années 1960. Il faudrait aussi
évoquer une influence américaine, au cours de la décennie suivante,
avec le Living Theatre, le Bread and Puppett, Bob Wilson. Ou les
recherches polonaises d'un Grotowski, hier, et aujourd'hui d'un Kantor.
Ou le courant italien avec Strehler, Ronconi. .. Ou la mise en scène
allemande (peter Stein, Klaus-Michael Grüber, Matthias Langhoff,
Peter Zadek ... ) Il est devenu courant qu'un metteur en scène étranger
monte, en France, des spectacles français, c'est-à-dire en langue
française, avec des interprètes français
1.
Et un anglais tel que Peter
Brook s'est fixé à Paris depuis 1974. Avec des comédiens de toute
nationalité, il travaille sur des textes du grand répertoire occidental
(Shakespeare, Jarry, Tchekhov ... ) mais aussi sur des traditions
africaines (Les Iks, L'Os), persanes (La Conférence des oiseaux),
indiennes (Le Mahabharata) ... Il Y a longtemps eu, à Paris, un théâtre
des Nations. Il y a aujourd'hui un Théâtre de l'Europe ... Bref, le
cosmopolitisme est devenu la marque même du théâtre français
contemporain.
Sans se dissimuler ce que l'entreprise peut avoir de hasardeux, pour
baliser ce foisonnement théâtral, on regroupera des tentatives variées en
les référant à une commune option théorique. Tentatives et tentations!
L Quelques exemples récents: Les Italiens Giorgio Strehler et Luca Ronconi
montent à la Comédie Française, le premier la Trilogie de la Villégiature de
Goldoni (1978), le second Le Marchand de Venise (1987). L'Allemand K.M.
GrÜber présente, dans le même théâtre, la Bérénice de Racine (1985) et ailleurs
avec Jeanne Moreau, Le Récit de la Servante ZerIine (1986). Strehler inaugure
son mandat de directeur du Théâtre de l'Europe avec une mise en scène de
l'Illusion [comique] de Corneille (1984). Et l'Américain Bob Wilson s'attaque au
Martyre de Saint-Sébastien de d'Annunzio et Debussy (1988) ... Ajoutons que les
metteurs en scène français ne sont pas en reste et travaillent, eux aussi à
l'étranger.
Peut-être verra-t-oll sc dessiller un schéma théorique global, une structure
complexe et souple dévoilant1cs po·stulats essentiels du théâtre moderne et
aussi une combinatoire qui témoigne de sa faculté de rebondissement, de
renouvellement créateur. L'image qui devrait venir à l'esprit serait sans doute
celle du kaléidos-
cope ...
2. Le théâtre, service du texte
L'art de la mise en scène dénature-t-il le texte dramatique dont il prétend
rendre compte par les moyens propres de la représentation ? Le débat est sans
doute oiseux. En tout cas, il est aussi vieux que le théâtre ! Au XVIIe siècle,
déjà, Saint-Evremond déplorait que ce qu'on n'appelait pas encore «mise en
scène» permît d’imposer, par l'éblouissement des sens, des livrets d'opéras
ineptes :
«Une sottise chargée de musique, de danses, de. machine~, de décorations est une
sottise magnifique, mais toujours sottise ; c'est un vil~in fonds sous de beaux dehors,
où je pénètre avec beaucoup de désagrément.» (Sur les opéras, 1677).
Au XIXe siècle, la même critique à l'endroit du spectaculaire ne cesse d'être
articulée par les zélateurs du texte. En 1834, Gustave Planche revendique un
théâtre «sans costumes, sans trappes, sans changements à vue, sans décoration,
un théâtre littéraire enfin.» (De la réforme dramatique). Et, on l'a vu (cf.
supra, p. 109), la théorie symboliste s'édifie contre la mise en scène, contre les
décors et costumes, contre les accessoires, contre les comédiens ...
Du répertoire
Cette arrière-plan explique la position des metteurs en scène français de la
première moitié du siècle qui, derrière Copeau, s'emploient à rénover l'art de
la représentation tout en proclamant l'éminente supériorité du texte sur toutes
les autres composantes du théâtre.
Un trait commun les unit: tous visent à se confronter aux textes majeurs du
répertoire. Et tous rêvent de découvrir et de révéler de, grands textes
modernes. Au théâtre du Vieux-Colombier, Copeau présente Barberine de
Musset, en 1913, et, 1’année suivante,

128
IlIIroduc/;o" tl/LX 1-:rll/lIl/'.\'
tlufo,{r,l'
dll /!lNurc
Lc.l' .l'Ix
//:"/(///0/1,1'
tlu
/!lNJ/n:
129
l'Echange de Claudel. Il montera aussi Shakespeare (La Nuit des rois,
Comme il vous plaira), Baty se lance dans des adaptations pour la
scène des plus grands romans (Crime et châtiment, 1933 ; Madame
Bovary, 1936). Il monte Shakespeare, Molière, Racine, Musset ... Et si
les contemporains qu'il choisit de mettre en scène (Gantillon, Pellerin,
Lenormand, Jean-Jacques Bernard ... ) ne se sont pas imposés
à
la
postérité, du moins témoignent-ils de l'importance que Baty attachait
à
la découverte d'un répertoire nouveau.
On peut en dire autant de Pitoëff et Dullin. Le premier monte
plusieurs Shakespeare et fait découvrir au public français Tchekhov et
Pirandello, Gorki et O'Neill, Claudel et Cocteau, voire le jeune Anouilh.
Le répertoire du second passe par Aristophane, Shakespeare, Corneille,
Molière pour aboutir, en 1943, à la parabole d'un jeune philosophe qui
s'essayait au théâtre (Sartre, Les Mouches). Les Molière de Jouvet (Dom
Juan, Tartuffe, L'Ecole des femmes) sont restés fameux. Mais c'est le
même Jouvet qui fait découvrir l'essentiel du théâtre de Giraudoux et
n'hésite pas à offusquer son public en commandant une pièce à un jeune
et sulfureux taulard qui, affirment alors Cocteau et Sartre, est aussi un
grand romancier (Genet, Les Bonnes, 1947).
Le flambeau sera repris, au tournant des années 1950, par Barrault
qui montera Shakespeare et Kafka, Claudel et Marivaux, Beckett et
Marguerite Duras, et par Vilar qui offrira à son public d'A vignon et du
T.N.P., Corneille et Molière, Marivaux et Musset, Sophocle et
Shakespeare, Kleist et Büchner (cf. supra, p. 121). Et, s'il déplorait de
ne pas trouver d'œuvres contemporaines à la mesure de l'immense
plateau de Chaillot, il n'en révèle pas moins Brecht (Mère Courage,
Arturo Ui), Eliot (Meurtre dans la cathédrale), voire Pichette avec
l'échec courageux de Nuclea. Bref, tous ces metteurs en scène qui
appartiennent à des générations différentes, qui font des choix
esthétiques divers, affirment, par leur pratique, un lien fondamental,
créateur, entre la représentation et le texte de iliéâtre. Tous témoignent
d'une commune exigence intellectuelle, d'un commun refus de la
médiocrité boulevardière.
Le culte du texte
Au fond de cette valorisation du texte, on retrouve sans doute la
trace d'un spiritualisme hérité des Symbolistes. Par exemple,
Copeau reprend à son compte la vision mallarméenne transmise par Gide
avec qui il entretient des liens étroits. Paradoxe d'un homme de théâtre qui en
vient
à
récuser la matérialité même de la représentation !
«A ce qui a trait aux décors et aux accessoires nous ne voulons par accorder
d'importance.» (<<Un essai de rénovation dramatique», in Critiques d'un autre temps,
1923).
Ainsi conçue, la mise en scène doit être une confrontation directe et épurée
entre les trois instances cardinales de la représentation : le texte, le metteur en
scène, les acteurs. La scène n'est jamais que l'espace aménagé de cette
confrontation:
«Que les autres prestiges s'évanouissent et pour l'œuvre nouvelle qu'on nous laisse
un tréteau nu !» (Ibid).
La formule pourrait convenir à tous. Dans son évocation de l'œuvre de
Pitoëff, Jacqueline de Jomaron peut observer:
«Malgré l'importance extrême qu'il attachait à l'autonomie du metteur en scène, la
mise en scène n'en restait pas moins pour lui un moyen au service du «texte»
(Georges Pitoëff, metteur en scène, 1979).
Sans doute Baty brandira-t-il l'étendard de la révolte contre la tyrannie du
verbe :
«En cinq ans, d'un bout à l'autre de l'Europe, une révolution renverse Sire le Mot.»
(Le Masque et l'encensoir, 1926).
Mais, en 1922, comme Copeau, il adhère
à
cette hiérarchisation qui définit
le texte comme le cœur vivant de la mise en scène. C'est lui qui la
surdétermine. Qui lui confère nécessité et cohérence :
«Le texte est la partie essentielle du drame. Il est au drame ce que le noyau est au
fruit, le centre solide autour duquel viennent s'ordonner les autres éléments.» (Bulletin
de la Chimère, VI, octobre 1922).
Et Jouvet ne dira pas autre chose:
«C'est l'enseignement du texte seul qui guide, c'est ce texte seul qui conduit une
représentation.» (Témoignages sur le théâtre, 1952).
Mettre en scène, c'est avant tout se mettre à l'écoute du texte. La
représentation n'est pas une fin en soi. Elle est au fond un art de
l'illumination. Elle doit être capable de faire chatoyer toutes les facettes du
texte sans s'imposer
à
lui. Elle doit aussi être un médium qui établit entre le
texte et le spectateur une nécessaire déflagration amoureuse:

176
IIItroduc/ioll
il/t"
g"(/f/fl,t,~
tMIlI'/':,I'
rJllthNJ/rc:
IV. Les six tentations du théâtre
7. Croisements et métissages
177
Le texte, dénoncé, violé et ... perpétué
Le modèle artaudien excommunie le texte. Pourtant, il faut bien avouer
que, dans ses projets et dans ses trop rares réalisations, Artaud n'a guère
fait autre chose que de se confronter à des textes. Quitte à les violenter
plus ou moins rudement ! N'annonce-t-il pas que le théâtre de la Cruauté
mettra en scène «sans tenir compte du texte» ... toute une série de textes
illustres ou marginaux (Arden of Feversham, un extrait du Zohar,
l'histoire de Barbe Bleue, un conte du Marquis de Sade, des
mélodrames, le Woyzeck de Büchner ... ) ? Sans doute souligne-t-il
clairement que ces textes seront «adaptés», «transposés», «habillés».
Que «du théâtre élizabéthain
[…]
on ne gardera que l'accoutrement
d'époque, les situations, les personnages et l'action» (Le Théâtre et son
Double, «Le Théâtre de la Cruauté», Premier Manifeste, 1932).
Et le même Artaud, curieusement, spécifie que, s'il se propose de
monter Woyzeck, c'est «par esprit de réaction contre nos principes, et à
titre d'exemple de ce que l'on peut tirer scéniquement d'un texte
précis.» (Ibid).
Ironie d'intellectuel
à
l'égard du modèle qu'il est en train d'élaborer ?
Ou souci de construire une théorie «ouverte», de dire qu'un modèle
n'est pas un dogme ?
Les héritiers d'Artaud se donneront la même liberté de répudier le
texte sans jamais cesser d'y revenir! Le Living Theatre proposera «sa»
version d'Antigone. Celle de Sophocle, mais déjà réécrite par Brecht
qui avait fortement affirmé, - paradoxe pour un auteur! - son total
irrespect de la lettre et du caractère prétendument intouchable des
grandes œuvres du répertoire
1.
La pratique et l'évolution du Théâtre du Soleil sont encore plus
suggestives. D'abord il refuse l'intervention même du dramaturge au
profit de la création dite collective (orientée et structurée, il est vrai, par
Ariane Mnouchkine). Cela donne les deux spectacles sur la Révolution,
1789 et 1793, puis l'Age d'or. Ensuite, retour
1. Brecht a réécrit, souvent en en bouleversant de fond en comble la signification,
outre Antigone, l'Edouard II de Marlowe, le Coriolan de Shakespeare, le Dom Juan
de Molière ... Il est juste d'ajouter qu'il recommandait d'user de la même liberté avec
ses propres œuvres, de les transformer, voire de les réécrire en fonction d'un public
donné, de sa mémoire, de sa culture et de sa re1ation à une actualité spécifique.
oblique à la pratique du texle : Ariane Mnouchkine adapte, pour son théâtre,
le roman de Klaus Mann, Mephisto (1979). Un peu plus tard encore, ce
retour au texte est affiché et triomphal (les Shakespeare). Aujourd'hui,
enfin, un équilibre paraît s'être établi. Dramaturgie, mise en scène et écriture
se fondent en un travail commun. Hélène Cixous écrit de véritable pièces
(Norodom Sihanouk, l'Indiade) mais au plus près des recherches théâtrales
d'Ariane Mnouchkine et du Théâtre du Soleil.
En somme, le modèle contemporain se caractérise par une approche
beaucoup moins dogmatique de la question du texte. Sans doute est-ce
qu'aujourd'hui l'impérialisme de l'auteur n'est plus guère à l'ordre du
jour. Tout peut faire texte, et l'essentiel est qu'un lien de nécessité
profondément ressentie s'établisse entre le metteur en scène, ses
comédiens, d'un côté et le texte de l'autre.
Tout se passe comme si désormais le théâtre refusait de s'enfermer
dans des définitions-carcans, de s'imposer des contraintes au nom de
tel ou tel a priori théorique. A cet égard, un Peter Brook donne l'exemple
d'une liberté souveraine. Sans proclamation fracassante, il utilise
l'admirable ruine des Bouffes du Nord pour y monter tantôt des œuvres
canoniques du répertoire international :
Timon d'Athènes de Shakespeare (1974), l'Ubu de Jarry (1977), la Cerisaie
de Tchekhov (1981), tantôt des spectacles dont les sources d'inspiration
sont extrêmement variées, les Iks d'après un ouvrage d'ethnologie (1975), la
Conférence des oiseaux d'après un conte persan (1979) ou le récent
Mahabharata d'après l'un des textes essentiels de la cosmogonie indienne
(1985). L'auteur, en l'occurrence Jean-Claude Carrière, travaille alors en
symbiose étroite avec Brook et ses acteurs, voire avec le lieu qui servira de
cadre à la représentation. Autre exemple caractéristique de ce refus des
frontières et des interdits, la Tragédie de Carmen (1981). Le «texte», en
l'occurrence, c'est l'une des œuvres emblématiques du répertoire lyrique
français. Peter Brook, avec l'aide de JeanClaude Carrière et du compositeur
Marius Constant n'hésite pas à le bouleverser. Il rapproche le livret de la
nouvelle originale de Mérimée. A l'orchestre chatoyant de Bizet, il substitue
quelques instrumentistes ... Le titre affiche d'ailleurs la différence: non pas
Carmen, mais la Tragédie de Carmen. Le spectacle est admirable, mais les
puristes s'indignent qu'on ait osé «porter la main» sur Carmen. Or là est
précisément l'une des caractéristiques du théâtre
1
/
5
100%