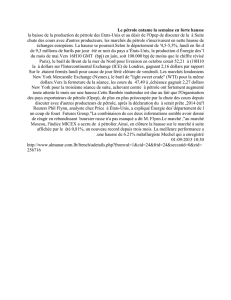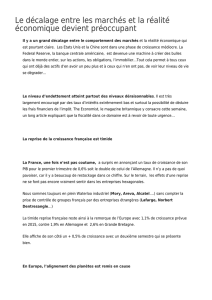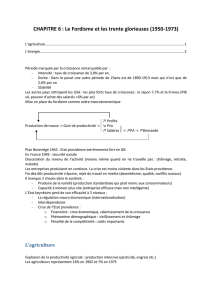Des énergies : Pétrole, Gaz , Charbon

Des énergies : Pétrole, Gaz , Charbon
Plate-forme de forage
John Mead/Photo Researchers, Inc.
A gauche et si dessus nous pouvons voir des puits de
forage destiné à pomper du pétrole .

Le pétrole :
En fait, notre civilisation industrielle moderne dépend du pétrole et de ses dérivés; la structure physique et le mode de vie
des communautés suburbaines qui entourent les grandes villes sont le résultat d'un approvisionnement en pétrole à
grande échelle et peu coûteux. Toutefois, ces dernières années ont montré que cette disponibilité au plan mondial n'a
cessé de décroître et que son coût relatif a augmenté.
Formation
Le pétrole s'est formé sous la surface de la terre, par suite de la décomposition d'organismes marins. Les restes de
minuscules organismes vivant dans la mer et, dans une moindre mesure, ceux des organismes terrestres qui sont
entraînés vers la mer par les rivières et des plantes qui poussent sur le fond des océans, sont mélangés aux sables fins et
aux sédiments qui se déposent sur le fond des bassins marins. Ces dépôts, riches en matières organiques, sont les
roches sources de la génération de pétrole brut. Le processus a commencé il y a des millions d'années avec le
développement d'une vie abondante et il se poursuit encore aujourd'hui. Les sédiments s'alourdissent et tombent au fond
de l'eau sous l'effet de leur propre poids. Au fur et à mesure que les dépôts supplémentaires s'empilent, la pression
exercée sur ceux qui se trouvent en dessous augmente plusieurs milliers de fois et la température s'accroît de plusieurs
centaines de degrés. La boue et le sable durcissent pour former des schistes argileux et du grès!; le carbone est précipité
et les coquilles de squelettes durcissent et se transforment en calcaire!; les restes des organismes morts sont ainsi
transformés en pétrole brut et en gaz naturel.
Une fois formé, le pétrole remonte vers la croûte terrestre car sa densité est inférieure à celles des saumures qui saturent
les interstices des schistes, des sables et des roches carbonifères qui forment la croûte terrestre. Le pétrole brut et le gaz
naturel remontent dans les pores microscopiques des sédiments plus gros qui se trouvent au-dessus d'eux. Il arrive
fréquemment que le matériau qui remonte rencontre un schiste imperméable ou une couche de rocher dense qui
l'empêche de remonter plus haut!; le pétrole est alors emprisonné et un gisement de pétrole se forme. Toutefois, la
majeure partie du pétrole ne rencontre aucun rocher imperméable et remonte librement à la surface de la terre ou sur le
fond des océans. Les dépôts de surface comprennent également les lacs bitumineux et les émanations de gaz naturel.
Développement historique
Ces dépôts de surface de pétrole brut sont connus depuis des milliers d'années. Dans les régions où ils sont apparus, ils
furent longtemps utilisés à des fins aussi limitées que le calfatage des bateaux, l'imperméabilisation des vêtements et
l'allumage des torches. À la Renaissance, certains dépôts de surface étaient distillés en vue d'obtenir des lubrifiants et des
produits médicinaux, mais la véritable exploitation du pétrole brut ne commença pas avant le XIXe siècle. La révolution
industrielle entraîna la recherche de nouveaux combustibles et les bouleversements sociaux qu'elle occasionna créèrent
un besoin d'un pétrole peu onéreux et de bonne qualité pour les lampes!; les gens souhaitaient pouvoir travailler et lire une
fois la nuit tombée. Toutefois, l'huile de baleine n'était accessible qu'aux riches, les bougies de suif avaient une odeur
désagréable et les becs de gaz n'existaient que dans les maisons et appartements modernes des zones urbaines.
La recherche d'un meilleur combustible de lampe entraîna une forte demande d'«!huile de roche!» — c'est-à-dire de
pétrole brut — et, vers le milieu du siècle dernier, de nombreux scientifiques développèrent des procédés permettant d'en
faire un usage commercial. C'est ainsi que James Young, parmi d'autres en Angleterre, commença à fabriquer différents
produits à partir de pétrole brut, mais il s'orienta par la suite vers la distillation du charbon et l'exploitation des schistes
bitumeux. Le physicien et géologue canadien Abraham Gessner déposa en 1852 un brevet pour obtenir, à partir du pétrole
brut, un combustible pour lampe peu onéreux, brûlant sans résidu, appelé pétrole lampant!; en 1855, un chimiste
américain, Benjamin Silliman, publia un rapport indiquant la gamme de produits utiles pouvant être obtenus par distillation
du pétrole.
C'est ainsi que débuta la recherche de plus grosses sources d'approvisionnement en pétrole brut. Le fait que les puits
creusés pour l'eau et le sel présentent parfois des infiltrations de pétrole était bien connu. L'idée de forages pétroliers fit
donc naturellement son chemin. Les premiers puits furent forés en Allemagne en 1857-1859. L'initiative qui rencontra le
plus grand retentissement fut cependant celle d'Edwin L. Drake en 1859, près d'Oil Creek, en Pennsylvanie. Drake, qui
travaillait sous contrat pour l'industriel américain George H. Bissell, procéda à des forages pour trouver la «!nappe mère!»,
origine des affleurements de pétrole de Pennsylvanie occidentale. Si Drake extraya un pétrole de type paraffine,
d'écoulement aisé et facile à distiller et si le puit était peu profond, sa réussite n'en marquait pas moins le début de
l'industrie pétrolière moderne. Le pétrole fit rapidement l'objet de toute l'attention de la communauté scientifique, et des
hypothèses cohérentes furent émises quant à sa formation, sa remontée à travers les couches terrestres et son
emprisonnement. Avec l'invention de l'automobile et les besoins en énergie issus de la Première Guerre mondiale,
l'industrie du pétrole devint l'un des fondements de la société industrielle.

Exploration
Pour chercher le pétrole brut sous la surface de la terre, les géologues doivent rechercher un bassin de sédimentation
dans lequel des schistes riches en matière organique ont été enfouis suffisamment longtemps pour que le pétrole ait pu se
former. Celui-ci doit également avoir la possibilité de migrer à travers des porosités capables de retenir de grandes
quantités de liquide. L'apparition du pétrole brut dans la croûte terrestre est limitée par ces deux conditions, qui doivent
être remplies simultanément, en plus des dizaines de millions, à une centaine de millions, d'années nécessaires à sa
formation. Toutefois, les géologues et les géophysiciens ont plusieurs outils à leur disposition pour identifier les zones
potentielles de forage. Ainsi, la cartographie de surface des affleurements de lits sédimentaires rend possible
l'interprétation des caractéristiques de sous surface. Cette première approche est complétée par des informations
obtenues par le forage de la croûte et par le prélèvement d'échantillons ou de carottes des couches de rochers
rencontrées. De plus, des techniques sismiques de plus en plus sophistiquées (comme la réflexion et la réfraction des
ondes sonores propagées à travers la terre) révèlent des détails de la structure et de l'interrelation de différentes couches
de sous surface. En dernier recours, la seule manière de prouver que du pétrole se trouve sous la surface n'en reste pas
moins le forage d'un puits. En fait, la plupart des régions pétrolifères dans le monde ont, au préalable, été identifiées par la
présence d'affleurements de surface, et la majorité des réserves effectives ont été découvertes lors de forages sauvages,
probablement fondés aussi bien sur une certaine intuition que sur une approche plus scientifique.
Un champ pétrolifère, une fois découvert, peut comprendre plusieurs bassins, c'est-à-dire plusieurs accumulations de
pétrole continues et limitées. En fait, plusieurs bassins peuvent être empilés et isolés par des schistes stériles et par des
couches de roches imperméables. La taille de ces bassins peut aller de quelques dizaines d'hectares à des dizaines de
kilomètres carrés et de quelques mètres d'épaisseur à plusieurs centaines, voire plus. La plus grande partie du pétrole
découvert et exploité dans le monde l'a été dans des bassins importants relativement peu nombreux.
Forage off-shore
Une autre méthode permettant d'accroître la production des gisements de pétrole a été la construction et la mise en
service de tours de forage en mer. Ces tours sont installées, exploitées et entretenues sur des plates-formes en mer
jusqu'à une profondeur de plusieurs centaines de mètres. Elles peuvent flotter ou reposer sur des piliers plantés sur le
fond de l'océan, et sont capables de résister aux vagues, aux vents et, dans les régions arctiques, aux icebergs.
Comme dans les tours de forage habituels, le derrick est fondamentalement une tour qui permet de suspendre et de faire
tourner une tige de sondage, à l'extrémité de laquelle est fixé le burin minier. Des longueurs supplémentaires de tige sont
ajoutées à la chaîne de forage car le foret pénètre de plus en plus profondément dans la croûte terrestre. La force
nécessaire au forage dans la terre provient du poids de la tige de sondage elle-même. Pour faciliter l'évacuation des
débris, de la boue circule en permanence dans la tige de sondage, sort par des trous pratiqués dans le foret puis remonte
à la surface dans l'espace existant entre la tige de sondage et le forage dans la terre (le diamètre du foret est un peu plus
grand que celui de la tige). Des trous de forage ont ainsi été creusés droit au but, jusqu'à des profondeurs pouvant
atteindre plus de 6,4 Km à partir de la surface de l'océan. Le forage en mer a permis la mise en exploitation de réserves
supplémentaires importantes de pétrole.
Le gaz :
Oléoduc en Alaska
Cet oléoduc de 1 270 Km de long
relie la côte arctique à la côte
occidentale de l'Alaska et transporte
2 millions de barils de pétrole par
jour.
Tom & Pat Leeson/Photo Researchers
Gaz naturel
Une certaine quantité de gaz naturel se présente presque toujours en association avec les gisements de pétrole et est
amenée à la surface en même temps que le pétrole lorsque l'on fore un puits. Ce gaz est appelé gaz de tête de forage.
Cependant, certains puits ne donnent que du gaz naturel.

Le gaz naturel renferme des éléments organiques de valeur qui sont des matières premières importantes pour l'essence
naturelle et les industries chimiques. Avant d'utiliser le gaz naturel comme combustible, on en extrait, en phase liquide,
des hydrocarbures saturés comme le butane ou le propane et de l'essence naturelle. Le gaz résiduel constitue ce qu'on
appelle le gaz sec, distribué ensuite aux consommateurs domestiques et industriels qui l'utilisent comme combustible!; le
gaz sec, donc sans butane ni propane, se trouve aussi à l'état naturel. Composé des hydrocarbures les plus légers,
méthane et éthane, le gaz sec est également utilisé pour la fabrication des matières plastiques ou colorantes et des
produits pharmaceutiques.
Le Charbon :
Foreuse à charbon
Dans cette mine de charbon à ciel ouvert, une
énorme foreuse accède au gisement en
perçant dans les parois des trous pouvant
atteindre 30 m de profondeur.
Formation
À des époques géologiques reculées, et surtout pendant l'époque carbonifère, il y a 250 à 300 millions d'années, une grande
partie du monde fut couverte d'une végétation luxuriante qui poussa dans les marais. Nombre de ces plantes étaient des
sortes de fougères, certaines aussi hautes que les arbres. Cette végétation mourut et se retrouva sous l'eau, où elle se
décomposa progressivement. Lors du processus de décomposition, la matière végétale perdit des atomes d'oxygène et
d'hydrogène, laissant un dépôt à forte teneur en carbone. C'est ainsi que se formèrent des tourbières. Avec le temps, des
couches de sable et de boue en suspension dans l'eau sédimentèrent sur certains des dépôts de tourbe. La pression de ces
couches sous-jacentes, mais aussi les mouvements de la croûte terrestre et parfois la chaleur des volcans agirent pour
comprimer et durcir les dépôts, produisant ainsi du charbon.
Utilisations
Toutes les classes de charbon ont de la valeur et un usage. Depuis des siècles, on alimente les feux de cheminée avec de
la tourbe et plus récemment avec des briquettes de tourbe et de lignite que l'on brûle dans des fourneaux. Les centrales
électriques, ainsi que l'industrie tous secteurs confondus, sont les plus gros consommateurs de charbon. Les producteurs
d'acier utilisent la houille métallurgique, ou coke, combustible obtenu par distillation en vase clos du coaltar, ou goudron de
houille, qui ne contient que très peu de matières volatiles, produit à environ 1 000!°C et est composé principalement
d'hydrocarbures aromatiques, de phénols et de quelques composés à base d'azote, de soufre et d'oxygène. Le procédé
de production du coke donne nombre de sous-produits chimiques, qui sont utilisés dans la fabrication de nombreux autres
produits.
Entre l'aube du XIXe siècle et la période de la Seconde Guerre mondiale, le charbon fut également utilisé dans la
production de gaz combustibles, de même que des techniques de liquéfaction de la houille servaient à produire des huiles
minérales. La transformation de la houille en gaz combustibles et autres produits a diminué lorsque l'on a disposé de gaz
naturel en grande quantité. Toutefois, dans les années 1980, les pays industrialisés ont éprouvé un regain d'intérêt pour la
gazéification et les nouvelles technologies de la houille propre. Les besoins de la République d'Afrique du Sud en huiles
minérales sont couverts en totalité par la liquéfaction du charbon.
1
/
4
100%