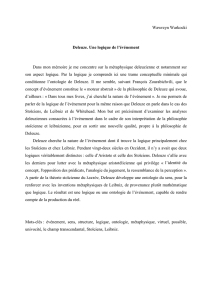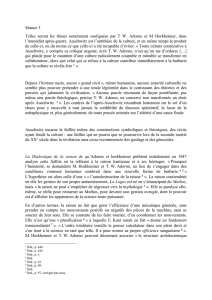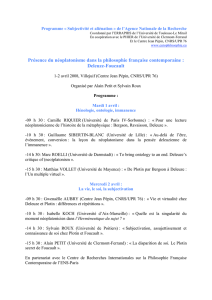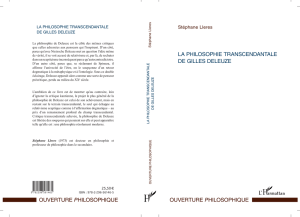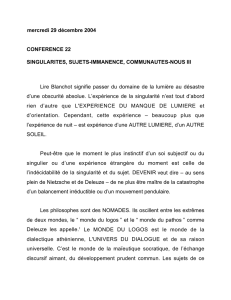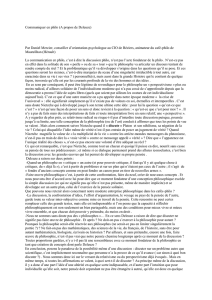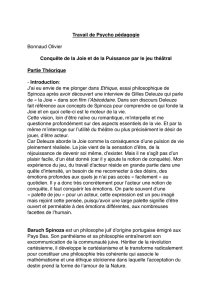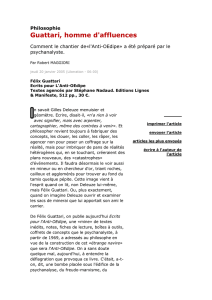Gilles BOUDINET

Expéditeur :
Gilles BOUDINET
62, rue de Paris
95320 SAINT LEU LA FORET
01 39 60 01 73
Approcher une épistémologie, notamment dans le cadre de la recherche en sciences de
l’éducation, renvoie à une question redoutable : comment penser la pensée ? Comment
rechercher sur la recherche que l’on fait ?
Heidegger disait, en se référant à la phrase d’Héraclite, « Ce qui donne le plus à penser est ce
que nous ne pensons pas encore" nous ne pensons pas encore… ce qui est à penser quand on
recherche est toujours à venir…. A sa façon Deleuze disait, « on ne sait jamais d‘avance
comment on va penser ». Propos redoutables, car ceci voudrait dire qu’il ne peut y avoir de
méthode véritable de la pensée, mais juste une intentionnalité dont on ne connait pas le but…
c’est se mettre selon Heidegger sur des chemins qui ne mènent nulle part, l’important n’étant
pas le but, mais le chemin en lui-même, le processus de pensée pris pour lui-même.
Serait-ce à dire, ce que laisse entendre Deleuze, qu’il n’y aurait pas de méthode ? Juste des
chemins….
Ou alors, la méthode, comme le soutient G Devereux servirait simplement à compenser
l’angoisse du chercheur qui ne sait jamais d’avance ce qu’il va penser….
Je vais proposer de démêler ceci à partir de propositions à prendre comme des postulats
Première proposition : Toute démarche de recherche est historiquement située, dans des
cadres de référence, de pensée, dans des contextes. Ainsi prend-elle son sens par rapport à ces
derniers, par rapport aux autres discours et pratiques avec qui elle interfère selon un système
donné ou une épistémè définie à une époque déterminée. A ce titre, elle sera toujours
dépendante d’un environnement symbolique ou politique, marqué par des idéologies qui en
gouverne les « intérêts », pour reprendre ici la terminologie de J. Habermas
1
, au-delà des
typologies entre les niveaux de recherche (théorique, pratique…).
On pourrait par exemple évoquer le débat entre la psychologie génétique de Piaget et celle de
Vigotski. Dans un cas, on a modèle sur l’activité naturelle de l’enfant, qui est ensuite
accommodée à la culture. Dans l’autre l’interaction sociale prime. (exemple du tel) . Au- delà,
rousseau contre marx…
Ainsi, ne va-t-on pas penser ou chercher de même façon dans une épistémè (contexte des
discours scientifiques) marquée par Dieu, par l’aspiration à trouver une théorie générale ou
par l’hétérogénéité et la multiplicité…..
Deuxième proposition Ce cadre de référence historique détermine des postures de recherche,
qui sont souvent inconscientes, on ne peut penser l’éducation au moyen –âge sans concevoir
Dieu vers qui il faut élever les âmes.
1
HABERMAS, J. « Connaissance et intérêts », La technique et la science comme idéologie. trad. J.-R. Ladmiral,
Paris : Denoël, 1984, pp.133-162.

j’insiste sur ce terme de posture de recherche. Chercher, la méthodologie de recherche, c’est
une posture qui produit du sens, une posture de lecture ou d’interprétation du réel…
A chaque fois il s’agit bien d’interpréter –je reviendrai sur ce terme- et on interprète toujours
en fonction d’un schéma, d’un a priori, même les empiristes les plus radicaux qui prétendent
rejeter tout schéma interprétatif qui serait posé d’emblée, qui revendiquent une « mise entre
parenthèses » de toute influence conceptuelle, n’échappent pas à leur inféodation à un schéma
théorique, comme celui de la phénoménologie, qui leur commande un empirisme radical
appliqué à dénier toute théorie de référence préalable, tout en adhérant à la théorie du rejet de
la théorie. Il ya toujours un « inconscient théorique » qui sous-tend la posture.
Ces postures de recherche, ces façons de se positionner peuvent déjà être mises à plat. Elles
retrouvent les trois espèces de philosophes, et j’étends même aux chercheurs en général, que
distingue G Deleuze dans sa Logique du sens.
Dans un premier temps, je propose de mettre à plat ces trois espèces, tant cette catégorisation
peut se prêter à une historicité de la recherche. On regarde les étoiles, dieu, ou une essence
métaphysique, comme la philosophe des profondeurs. Ou encore, on se contente des faits qui
se donnent à la surface… peut-être reconnaîtra-t-on ici la progression des trois états de comte.
L’état théologique, l’état métaphysique, et l’état scientifique. Mais j’ai dit peut-être, car rien
n’est moins certain.
Le premier cas qu’identifie G. Deleuze est celui du philosophe idéaliste, au sens premier du
terme. Ce philosophe « messianique » est sorti de la caverne. Il regarde de ciel, les yeux
tournés vers les Idées célestes, var un au-delà dans le ciel, vers une transcendance… Il pense
le «l’au-delà du là » (lyotard). C’est l’idéaliste qui définit par exemple un modèle à réaliser, et
qui n’est pas encore là. C’est le mystique qui se tourne vers Dieu, le métaphysicien qui se
tourne vers un au-delà du monde physique, le rêveur (sans connotation péjorative) qui pense
un pro-jet du sujet idéal pour une société idéale.
On retrouvera ici, en éducation, la grande tradition qui me semble commencer avec la
République de Platon. Si l’éducation y est très présente, dans ses dimensions intellectuelles,
sensibles, physiques, il s’agit pour Platon de former un citoyen idéal, soucieux du beau (le
beau corps), du bon (le bon jugement) et du vrai, dans une adhésion au monde céleste des
pures Idées et de la sphère théorique, les arts libéraux. L’éducation ici sert le projet de la cité
idéale, un projet somme toute purement politique au sens premier du terme.
On retrouvera ceci avec l’Emile de Rousseau, ou jj rousseau imagine la formation d’un
homme ajusté à sa conception politique, à savoir le sujet du contrat social que d’ailleurs
Rousseau publie en même temps qu’Emile.
Bien évidement, le regard tourné vers une grande transcendance, voulue unique, universelle
(les Idées, Dieu, le citoyen à réaliser) ne peut que relever de l’utopie, ou du moins d’un
modèle idéal.
Tel est le grand débat sur les utopies en éducation.
A m drouin han, l’utopie comme nécessité éducative h hannoun
L’utopie, ou la modélisation comme outil interprétatif. C l s rappelle rousseau.
Mais le regard tourné vers l’absolu du ciel est aussi dogme. L’éducation est la main invisible
de dieu. On peut renvoyer à st augustin

La deuxième espèce de philosophes dont parle Deleuze concerne ceux qui, à l’inverse de
regarder la voûte stellaire, et l’Incérée divin là-haut, ou ses substituts, vont au fond de la
caverne, et prennent leur piolet, pour faire de la philosophie à coups de marteaux selon
l’expression nietzschéeenne. On cherche le fond, l’essence tellurique,
D’une façon positive, cette quête de l’essence, par ce qu’elle vise un en deçà et non un au-
delà, se retrouve dans le travail philosophique par excellence de déconstruction des idées
reçues, appliqué à débusquer le latent caché derrière chaque concept, plus exactement derrière
chaque idée reçue
Et de fait, derrière la doxa, les idées reçues, ce que h hannoun nomme les pré-supposés de
l’éducation, il y a toujours du latent qui se cache….
On pourrait retrouver ici d’une part le criticisme, la philosophie critique cherchant à délimiter
la cohérence d’un système donné, ce qui me semble indissociable d’une quête des fondements
de ce système.
Par exemple, en lecture, faut-il la méthode globale ou syllabique On a effectivement deux
systèmes qui s’opposent, l’un où prime un rapport d’incarnation du sens dans le mot, l’autre
un rapport de médiation par le signifiant sonore, le signe
On se rend compte que ce qui fonde ces systèmes, ce n’est pas dans un parfum de
structuralisme les oppositions entre linguistes et spécialistes de la didactique de la lecture-,
lais des enjeux théologiques qui ont vu le jour à la fin du XViièem siècle, et même avant entre
le catholicisme (le mot est dieu), et le protestantisme, notamment chez calvin : le mot n’est
qu’un signe de dieu…quelle est la limite de chaque système ?
Mais on peut retrouver aussi, dans cette plongée vers un en-deçà, ce qu’on pourrait nommer la
philosophie analytique. Il s’agit de renouer avec les origines d’un concept, ce qui souvent
renvoie à la grèce antique, lieu fondateur de nos concepts.
Par exemple, l’école revoie à la scholè, chez les grecs. Quelle est cette scholè, il s’agit de ce
qu’on, nomme aujourd’hui le loisir, le temps libre. Qu’on ne s’y trompe pas, le temps libre
n’est pas le temps mort. C’est le temps affranchi de toute contrainte utilitariste, affranchi du
travail, des obligations de le matérialité et de la vénalité, obligations qui celles de la classe
des ouvriers et des esclaves, par opposition aux hommes libre. D’ailleurs, ce temps libre, chez
les romains sera nommé l’otium, dont le contraire est le nec-otium… Ce qui signifie que
l’école, la scholè, dans son essence vise la savor pour le savoir, le savoir pur des idées,
totalement désintéressé, non utile, ce quoi permet l’accomplissement du sujet. Ceci signifie
aussi, sur un autre plan, que l’école est d’emblée constituée selon un clivage social entre la
classe des travailleurs, esclaves et des commerçants, et celle de ceux qui sont affranchis des
obligations du travail et qui sont pas soumis aux arts mécaniques, par opposition aux arts
libéraux. On voit ici se profiler, dès ce concept de la scholè, ce qui pourrait fonder la
sociologie des inégalités scolaires… mais on voit aussi du même coup en quoi ce rappel de la
scholè s’oppose aux conceptions de plus en plus utilitariste conférées de nos jours aux
institutions scolaires, même l’université qui est sommé de répondre non plus aux humanités,
mais à la professionnalisation… on retrouve tout le débat souligné lors des Lumières
allemandes par von humbolt sur le différence entre la bildung (formation par les humanités du
sujet) et l’ausbildung,. Ce regard « archéologique » sur l’essence même de la scholè permet
du même coup de se demander si la formation aux humanités est compatible avec l’utilité

d’insertion professionnelle demandée à l’appareil scolaire, alors que les deux sont scandés par
le ministère…
De façon plus problématique, cette quête de l’essence ou d’un fondement se retrouve dans les
aspirations , très fréquentes entre 1850 et 1950, à trouver une théorie générale à partir d’un
fondement unique, universel, indiscutable…
Pour citer des exemples, ce sera là typiquement la démarche de Durkheim qui cherche à
expliquer le social par le saisie d’un grand principe générateur, de façon, universelle, unique.
On se souvient de la méthode de durkheim. Pour lui, il la recherche en sociologie doit être
historique et comparative. Si l’on reconnaît là une perspective qui sera aussi reprise par le
structuralisme, il faut selon durkheim identifier le principe générateur de toute société, de tout
« organisme social » en comparant les différents modèles de société, et en voyant ce qui est en
commun. On retrouve là le suicide.
Mais historique aussi, il faut remonter l’histoire (comme s’il n’y avait qu’une seule histoire,
ce que je vais commenter après) , pour en trouver ce qui la fonde.
Ce sera typiquement le travail de Durkheim sur son histoire de l’éducation, L’Evolution
pédagogique en France ou par ailleurs dans la division du travail social où durkheim reprend
l’histoire du droit, de la pénalité, pour savoir ce qui dans la loi, correspond à la valeur la plus
essentielle. Cette valeur, première chose à laquelle on n’a pas le droit de manquer, première
chose légiférée dès les sociétés antiques, c’est l’être ensemble, l’implication de chacun dans la
communauté. On comprend alors le valeur éducative ;: si les êtres doivent être ensemble pour
faire une société, avec un conscience collective partagée, le problème est que les êtres sont
mortels. Donc il faut transmettre, faire le legs d’une génération à une autre des valeurs
précédentes, fondées sur l’être ensemble, et l’éducation apparaît donc comme l’instance qui
permet à une société de se pérenniser.
Bien évidemment, dans ce contexte archéologique et historique, appliqué à saisir une essence
ou une instance fondatrice qui serait le noyau du comportement humain, il est difficile de ne
pas évoquer la psychanalyse freudienne.
Sous les comportements humains, freud explore l’ics, qui existait bien avant lui, dès leibniz.
Mais au centre du rapport à l’ics, se situe la théorie du refoulement, première fondation
conceptuelle de la psychanalyse. Puis sous le refoulement, intervient le noyau du complexe
d’eodipe.
Le premier problème posé, et ce fut la grande critique adressée à la psychanlyse par Deleuze
et guattari, est le suivant : dès qu’on touche à une clef voulue fondatrice, essentielle, donc
ayant une valeur d’unicité générique et d’universalité, on retourne au dogmatisme
théologique. L’oedipe n’est pas généralisable, et tout ramener à oedipe rencontre une
conception fondée sur une univocité qui finit par retourner au dogme. En quittant le regard
tourné vers Dieu pour chercher l’essence tellurique, on retrouve dieu, ou on fait un dieu dans
le dos….
Le second problème en matière de quête d’un fondement, est que tiut fondement renvoie à
l’infini à un autre fondement plus souterrain, que le monde s’ouvre sans cesse sur d’autres
arrières-mondes. Ainsi, nietzsche disait …

Reste la troisième espèce de philosophes. Deleuze les reconnaît notamment chez le stoïciens,
les pré-socratiques…
Il ne s’agit plus de regarder le ciel et le transcendant, ni de se tourner vers les profondeurs
telluriques, à la quête d’une essence elle-même transcendante, mais de rester au milieu, à la
surface… Il s’agit de se contenter de ce qui se donne, dans les micro-vibrations de la
complexité à la surface, de faire avec elles, sans viser pour autant un principe général d’en
haut, ou d’en bas…Il s’agit de résonner (au sens musical) avec la diversité hétérogène, tout en
se gardant bien de prétendre lui imposer une grande théorisation générale, une grande
unicité…
On reconnaît là , en sciences humaines, en large part les apports, eux-mêmes influencés par la
phénoménologie, de l’anthropologie, où le chercheur s’imprègne au quotidien de son objet,
tout en faisant bien attention à rejeter tout grand système théorique, en évitant de prendre le
court circuit du complexe d’OEdipe face aux élèves qui contestent le maître, mais
simplement, je cite husserl « en accueillant les phénomènes tels qu’ils se donnent à moi ». On
ne passe pas à une analyse précipitée, on ne prend pas parti, on se laisse envbahir par ce qu’on
observe… où l’on est souvent soi-même impliqiué.
On retrouvera ici la démarche entreprise pour le jazz
H becker outsider
Ou, à la suite des travaux de G. Lapassade, ce que fait rémi hess en Se : le diarisme ; noter le
quotidien, trouver une infinité de micro points, de micro vibrations dirait Deleuze…
C’est aussi l‘attachement à travailler des micro-situations en éducation, comme l’étude d’une
leçon de piano de 30 mn qui donne les 300 pages (plus les annexes) de la thèse présentée par
olga tchitchascova sous le direction de jp mialaret…
Le problème ici est celui d’une dispersion dans le micro du micro, ce qui aboutit à une
richesse, mais sans pouvoir inscrire le descriptif dans des synthèses et encore moins des
théorisations… On est dans un empirisme qui finit par perdre tout sens.
Mais ne nous leurrons pas. Derrière ces trois espèces de philosophes, ce qui se passe, ce sont
des enjeux idéologiques. Ce n’est pas un hasard si cette classification en trois postures a été
proposée dans le contexte très soixante-huitard de la pensée deleuzienne. Quelle est cette
idéologie :
Tout ce qui concerne celui qui aspire à trouver une grande unité transcendante, soit là haut
vers dieu, soit en-deçà, vers l’essence fondatrice, n’échappe pas au dogmatisme, du moins à
un risque de dogmatisme. Derrière une autre image : la théorie, issue des Idées platonicienne,
serait une mauvaise chose qui sert à se mettre en position de surplomb, à dominer. C’est le
propre de la raison kantienne –nous y reviendrons- telle que vont la critiquer adorno et max
horkheimer après le drame d’Auschwitz : le raison, la synthèse, est un appareil de domination.
Mais mettre à la poubelle toute synthèse, retrouver une empirie radicale au nom de la lutte
contre la domination ne va pas sans poser de problèmes, et telle sera la pensée de deleuze qui
cherchera à travailler ce que ce philosophe nommait un empirisme transcendental, ce qui est
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
1
/
27
100%