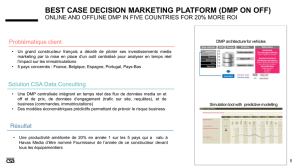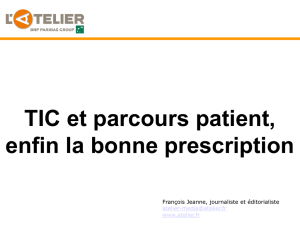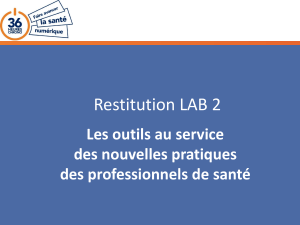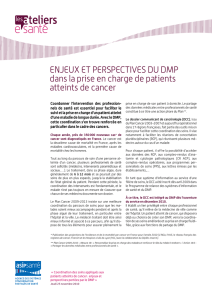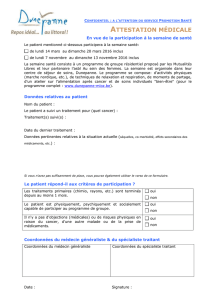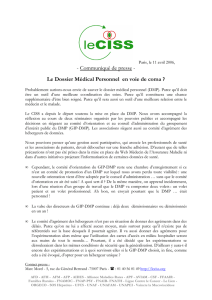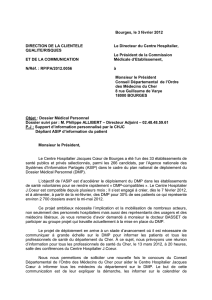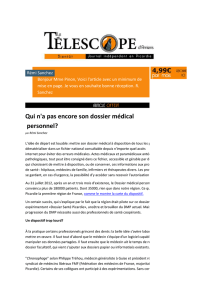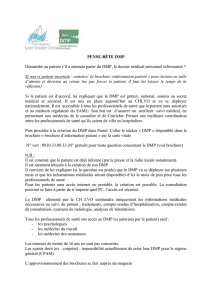Terminale STG GSI

Terminale STG GSI
Épreuve orale de contrôle
Sujet n° 8
Durée : 40 minutes de préparation, 20 minutes d’interrogation
Coefficient : 7
Document autorisé :
- aucun à l’exception des mémentos officiels pour l’épreuve de spécialité GSI
Matériel autorisé :
- calculatrice de poche à fonctionnement autonome sans imprimante et sans aucun moyen de
transmission
- règle à dessiner les symboles de l'informatique
DOSSIER 1 : LES REFORMES DU SYSTEME DE SANTE EN FRANCE
Santé et système d’information
Documents à exploiter
Document 1 : Un secteur en quête de coordination
Document 2 : Entretien avec Emmanuel Briquet, directeur de l’information médicale du centre hospitalier du Havre
Document 3 : Le DMP s’éveille à l’hôpital
Document 4 : Extraits d’un rapport sénatorial
Répondre aux questions suivantes à l’aide du Document 1.
1. Peut-on parler en France d’un Système d’Information de Santé ? Justifier.
2. Quelle fonction du SI devait principalement assurer le carnet de santé ? Justifier. Quelles peuvent être, à votre avis,
les raisons de son échec ?
3. Mettre en évidence des technologies qui devraient accompagner l’évolution future des activités de santé en France.
Répondre à la question suivante à l’aide du Document 2.
4. Expliquer la notion d’interopérabilité. Mettre en évidence son importance dans le domaine médical et sa « traduction »
technique.
Extraits du site www.d-m-p.org :
La loi n°2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie a prévu la création du dossier médical personnel (DMP). À
compter du 1er juillet 2007, la loi prévoit que tout bénéficiaire de l’assurance maladie âgé de plus de 16 ans qui en fait la
demande pourra disposer d’un DMP.
Le secret médical est la pierre angulaire du droit médical. Le DMP appartient au patient. La loi prévoit que l’accès au DMP est
géré par le patient. C’est lui qui détermine les professionnels de santé à qui il permet de consulter son DMP ou de l’enrichir.
L’hébergeur de données de santé à caractère personnel va être chargé de la conservation et de l’intégrité des DMP. Il doit
recevoir l’agrément du ministère de la Santé (six sociétés l’ont reçu à ce jour).
Répondre aux questions suivantes à l’aide des informations précédentes et du Document 3.
5. Qui seront le ou les utilisateur(s), d’une part, et le ou les gestionnaire(s), d’autre part, du DMP ? Justifier.
6. Quels sont les gains attendus, par chaque acteur du système de santé, du DMP ?
7. Expliquer le concept de « SI intégré » et ses avantages. Illustrer à l’aide du Document 3.
8. Expliquer le concept de formalisation de l’information et ses enjeux.

Répondre aux questions suivantes à partir des Documents 1, 2, 3, 4.
9. Recenser les risques et difficultés associés à chacune des parties prenantes du projet DMP en France.
Le parcours de soins
Annexe à exploiter, à compléter et à rendre avec la copie
Annexe 1 : Processus « Parcours de soins »
Tous les bénéficiaires d’une couverture maladie sont invités, à partir de 16 ans, à choisir un médecin traitant qui leur permet de
s’inscrire dans un parcours de soins coordonnés.
À l’issue d’une consultation de premier niveau, le médecin traitant peut, le cas échéant, orienter le patient vers un spécialiste
(sans obligation de choisir celui éventuellement proposé par le médecin).
Toute consultation (de premier niveau ou d’un spécialiste) donne lieu à une feuille de soins électronique directement transmise
à la caisse d’Assurance Maladie du patient afin de permettre un remboursement plus rapide. Toutefois, en cas d’oubli de la
carte Vitale, une feuille de soins papier est délivrée au patient qui aura la charge de demander son remboursement.
Le médecin spécialiste est tenu d’informer le médecin traitant du résultat de ces investigations puisque ce dernier est
également le coordonnateur du DMP (dossier médical personnel) du patient.
La déclaration d’un médecin traitant n’est pas obligatoire, mais permet un meilleur remboursement : le patient doit s’acquitter
d’un ticket modérateur s’il consulte un médecin qui n’est pas son médecin traitant ou un spécialiste sans prescription de son
médecin traitant (sauf exceptions prévues).
Le processus de l’Annexe 1 représente un parcours de soin coordonné dans le cas général ; ainsi, il n’a pas pour objectif de
prendre en compte :
les patients bénéficiaires de la CMU (couverture maladie universelle) : ceux-ci ne paient pas le médecin (et ne sont donc
pas remboursés !) ; c’est la caisse d’assurance maladie qui s’en charge,
l’accès direct à un spécialiste (hors parcours de soins, autorisé pour certaines spécialités : ophtalmologie, gynécologie,
psychiatrie, chirurgie dentaire),
le cas où le patient ne respecterait pas le parcours de soins.
Questions :
1. Qui est le « client » du processus représenté ? Quel est son événement déclencheur ?
2. De quel type de processus s’agit-il (métier, support) ? Justifier.
3. Si on dissociait le sous-processus de remboursement, de quel type serait-il ? Justifier.
4. Enoncer les règles d’émission RE2, RE3 et RE4.
5. Justifier la présence de l’expression de synchronisation ET dans ce schéma de processus.
6. Achever, sur l’Annexe 1, la représentation du processus.
7. À quel(s) stade(s) le processus peut-il se terminer ? Justifier.
Lorsque le médecin traitant est absent (pour cause de vacances par exemple) ou lorsque le patient ne peut pas le consulter
(vacances, déplacement professionnel), ce dernier peut consulter un autre médecin, sans incidence sur les tarifs et le
remboursement. Le médecin consulté cochera une case prévue à cet effet sur la feuille de soins.
8. Ce cas nécessite-t-il l’ajout d’un nouvel acteur au processus ? Justifier.

DOSSIER 2 : SOS DEPANNAGE !
Voici un diagramme Use Case :
Questions :
1. Quel scénario est décrit par ce diagramme ?
2. Quels sont les acteurs qui interviennent dans le scénario ?
3. Quel est le déroulement de ce scénario principal ?

Document 1 : Un secteur en quête de coordination
Quelques chiffres :
1 000 établissements publics de soins, 2 000 privés
2 % des établissements concentrent 58 % des dépenses informatiques
2,7 % du budget des établissements sont consacrés à l’informatique
Le parcours de santé d’un patient n’est pas régulé par des processus clairement identifiés et automatisés. Un médecin qui
détecte une tumeur chez son patient peut aussi bien l’orienter vers un spécialiste que demander l’hospitalisation ou le secours
de l’imagerie médicale. Cette absence de formalisation du parcours clinique se répercute au niveau des systèmes d’information.
Elle s’avère d’autant plus bloquante que le secteur de santé n’est pas régi par un système d’information homogène, mais par
autant de systèmes isolés et différents que le secteur compte de médecins, de laboratoires, de cabinets de radiologie, de
pharmacie, etc. Chacun constitue son dossier patient dans son coin – souvent encore au format papier -, et n’échange avec les
autres corps de métier que lorsqu’il est amené à confier son malade à un collègue. Résultat : quand un patient se casse un bras
au ski, le médecin de famille peine à prendre le relais. Difficile aussi pour l’urgentiste de savoir si l’accidenté qui vient d’arriver
est allergique à la morphine, faute d’information facilement accessibles sur son historique. Le carnet de santé * a complètement
échoué dans ce rôle. Le dossier informatisé du patient, partagé par tous les acteurs du corps médical devrait y remédier.
Toutefois, avant même d’envisager l’alimentation d’un dossier médical personnel (DMP), le secteur de la santé est confronté à
une échéance plus immédiate. À savoir la mise en œuvre de ponts informatiques entre les professionnels de la santé. Le
patient ne doit pas non plus être oublié. « La génération du baby-boom atteint l’âge des maladies chroniques. Or, celles-ci
impliquent un traitement régulier à domicile », souligne l’éditeur d’une plate-forme destinée au partage de l’information entre
professionnels de la santé. « Le nombre de patients suivis chez eux va exploser, poursuit-il. Et cela nécessite des outils pour
les accompagner. Sinon, une partie de l’information sera encore perdue. »
Profitant d’un contexte légal flou, certains hôpitaux ont déjà supprimé le dossier papier au gré de l’informatisation des données
sur le patient. En informatisant, ils centralisent les données. Et cela tout en jetant les bases d’une politique de partage,
indispensable pour améliorer la qualité des soins et optimiser les coûts.
Reste que l’informatisation du dossier du patient va généralement de pair avec une remise à plat des processus, une
formalisation beaucoup plus rigoureuse des marches à suivre… Bref, une discipline informatique à laquelle le corps médical
n’est pas habituée. « Les freins ne sont pas techniques, mais humains. La part d’accompagnement du changement est énorme.
C’est elle qui coûte le plus cher », assure Thierry Durand [directeur de l’information hospitalière du centre de lutte contre le
cancer Léon-Bérard].
Marie Varandat, 01 Informatique n°1869, 25/08/2006
* Le carnet de santé est un document papier personnel que le patient devait présenter à chaque médecin devant lui donner
des soins, y compris en cas d’hospitalisation.

Document 2 : Entretien avec Emmanuel Briquet, directeur de l’information
médicale du centre hospitalier du Havre
Pourquoi avez-vous mis en place un groupe de travail sur les terminologies médicales ?
La santé est régie par des normes dont la plupart s’intéressent plus au contenant qu’au contenu. Résultat : nous avons les
tuyaux (le protocole réseau d’échange HL7), mais pas de standard pour normaliser ce qui se passe dans la plomberie. Le
travail préliminaire de structuration des données n’a pas été fait. Nos autorités de tutelle ne proposent rien. Chaque
établissement lance donc ses propres projets. Si l’on poursuit dans cette voie, nous n’obtiendrons pas l’interopérabilité
sémantique. Or, quand il s’agit de santé, la moindre ambiguïté peut tuer. En l’absence de proposition, l’hôpital du Havre a pris
les devants en initialisant une réflexion sur les terminologies médicales.
01 Informatique n°1869, 25/08/2006
Document 3 : Le DMP s’éveille à l’hôpital
Le dossier médical personnel (DMP) doit être mis en place à partir du printemps prochain. Déjà, dans les établissements de
soins, le compte à rebours a commencé. Mais il leur faut d’abord réunir des données sur le patient éparpillées entre leurs
applications et les documents papier.
La forte mobilité du personnel médical complexifie ce problème de centralisation de l’information sur le patient. Toute
information ou prescription au pied du lit du malade doit être saisie et intégrée au système d’information, si possible en temps
réel. « Pour que les médecins et les infirmières adhèrent, on doit absolument leur éviter les ressaisies », explique Arnaud
Hansske [directeur des systèmes d’information du centre hospitalier d’Arras]. La plupart des logiciels de gestion du patient
proposent des interfaces de saisie de type client léger, qui simplifient le déploiement sur des postes mobiles, reliés à un serveur
central.
Le centre hospitalier d’Arras a ainsi déployé du client lourd sur ses postes fixes, des clients web pour l’accès distant des
patients, ainsi que des Tablet PC dotés de clients légers pour son personnel mobile (infirmières et médecins). Depuis 2000, le
service des urgences de l’hôpital de la Croix-Rousse, à Lyon, a lui aussi instauré une véritable politique de mobilité, fondée sur
des Tablet PC et des solutions RFID [puces à radio-fréquence] pour localiser à tout instant patients et médecins. « Ainsi,
l’information est centralisée et toujours disponible en temps réel dans le service. Gérant des gains de temps considérables »,
précise Thierry Joffre, médecin urgentiste au service médical d’accueil des urgences de l’hôpital.
Pour Pascal Machuron, DSI de l’hospitalisation à domicile de l’Assistance publique Hôpitaux de Paris (AP-HP), « la traçabilité
de l’information et donc sa qualité et sa fiabilité forment les vrais enjeux. Notre objectif apparaît clairement : couvrir toute la
chaîne, de l’hôpital qui nous confie son patient au domicile. Les blocages que rencontrons sont moins techniques
qu’institutionnels », explique Pascal Machuron.
Toutefois, ces efforts pour capter l’information partout afin de la centraliser dans le système d’information se voient pollués par
la masse de documents non structurés circulant dans le secteur médical. Le centre hospitalier d’Arras, entre autres, s’est doté
de Tablet PC et de micros équipés d’une mémoire Flash. Enregistrées au format WAV, les dictées des médecins sont stockées
en l’état dans le dossier du patient. Et cette partie de l’information n’étant ni structurée, ni indexée, l’hôpital rencontre des
difficultés lorsqu’il s’agit d’effectuer des recherches ou d’extraire de l’information. « De manière générale, le secteur de la santé
véhicule plus de documents que de données structurées, estime Thierry Durand. Mais aucune norme ou terminologie n’a été
clairement été arrêtée pour structurer l’information. »
Selon Didier Alain, directeur des systèmes d’information et de l’organisation de l’hôpital Sainte-Camille (Bry-sur-Marne), tout n’a
pas besoin d’être ordonné : « Si l’on structure trop l’information, les outils deviendront trop contraignants pour les médecins. Et
là, nous risquons d’essuyer des rejets. »
Marie Varandat, 01 Informatique n°1869, 25/08/2006
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
1
/
10
100%