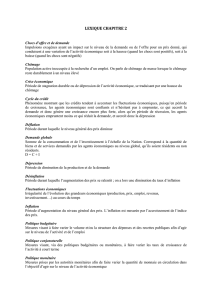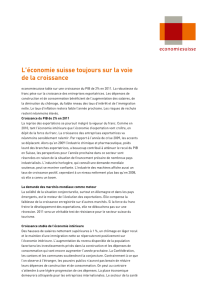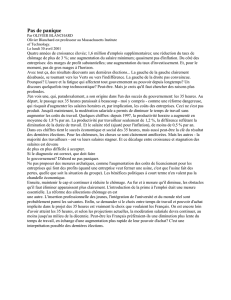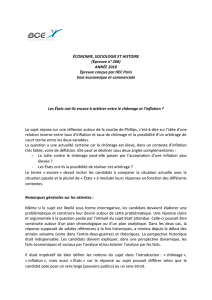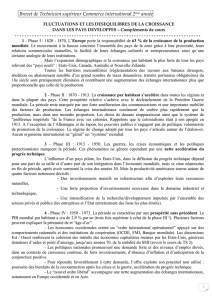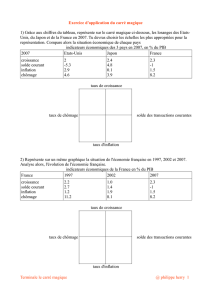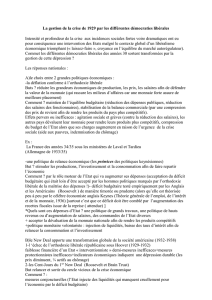le blocage de la croissance pendant l`entre-deux-guerres

LE BLOCAGE DE LA CROISSANCE PENDANT
L’ENTRE-DEUX-GUERRES
La France est en 1918 auréolée du prestige de grande nation, en même temps qu’elle souffre
de déséquilibres économiques (dépression, inflation) qui conduisent rapidement à une perte de
confiance nationale et extérieure. L’économie française, très dynamique au XX° siècle, est
durement touchée par la crise qui y prend des caractères spécifiques et une ampleur excep-
tionnelle (France et Etats-Unis sont encore en crise en 1938) après le retournement de 1930.
Les déséquilibres de l’après-guerre (1918 – 1929)
1. Le bilan de la guerre et le problème des réparations
La France est relativement la plus touchée, humainement (10 % des hommes actifs,
vieillissement, victimes de guerre, disparition d’ingénieurs), matériellement : combats sur son
territoire, destructions d’infrastructures (indemnités = un dixième de la fortune nationale en
1913) et financièrement : la dette augmente, d’autant que les créances extérieures sont
amputées voire répudiées. D’où les exigences françaises : « l’Allemagne paiera » qui culmine
en 1923 avec l’occupation de la Ruhr. La France n’obtient pas le report sur l’Allemagne de sa
dette (rancœurs) mais des réparations de 132 milliards de mark-or (dont 52 % pour elle), soit
2,5 ans de revenu national allemand. L’Allemagne, trop faible économiquement (à cause de la
France entre autres), ne peut pas s’acquitter, d’où son marasme économique. En 24, le plan
Dawes prévoit une réduction et un échelonnement des versements. Mais la France est déçue
(elle n’aura reçu que 10 milliards de F-or, du fait de son refus des prestations en nature) et a
souffert de ses illusions, qui ont repoussé le moment des réformes indispensables.
2. De la crise monétaire à la stabilisation du franc
Les désordres monétaires sont entièrement nouveaux (très peu d’inflation, parités fixes le long
du siècle de stabilité monétaire que fut le XIX°), donc incompréhensibles. Droite et gauche
s’affrontent violemment ; la victoire du Cartel en 1924 empêche l’Etat d’obtenir le crédit à
court terme dont il a besoin. La crise inflationniste devient critique : inflation sans précédent
(* 2 entre 1922 et 26, alors que les prix avaient déjà doublé pendant la guerre) ; dépréciation
extérieure du franc (changes flottants) ; déficit budgétaire permanent et « planche à billets »,
souvent incriminé comme cause de l’inflation par les contemporains. Elle résulte en fait de la
dette de guerre, de la baisse du franc (hausse des prix des M) et de la crise de confiance.
Poincaré (juillet 26) annonce un programme de redressement (± impôt du capital, réduction de
l’impôt sur le revenu, hausse du taux d’escompte, mesures psychologiques). Assez vite, les
prix baissent, les finances publiques se rétablissent malgré la hausse du chômage (plan
Dawes, baisse de la dette grâce à l’inflation). Poincaré stabilise aussi le franc par rapport au $
(20 % d’avant-guerre) ; cette sous-évaluation (+ pour les X) est entérinée par Poincaré en juin
28 : fin des illusions (le retour à la parité de 14) et retour à la normale (franc monnaie solide).
3. Le redressement de l’économie française
La production de 19 a reculé de 45 % par rapport à 13 ; mais ce niveau est retrouvé dès 24 et
dépassé d’un tiers en 29 => retard compensé. La reconstruction a été un succès achevé en 30
et un stimulant de l’économie (avec une relative modernisation). La croissance est rapide et
régulière, poussée par les X, la balance commerciale est excédentaire de 23 à 28 => libéralisa-
tion. La croissance industrielle, fondée sur l’équipement, est la plus forte des PDEM. La

concentration se développe. Le chômage baisse, l’exode rural se maintient (+ immigration) et
la productivité gagne 50 % par heure de travail entre 13 et 29 (25 % par travailleur car RTT).
Mais des disparités géographiques et structurelles s’accentuent (déclin du textile) et la produc-
tion agricole stagne ; si la productivité s’améliore, les coûts de production restent élevés et les
structures inadaptées => dépendance alimentaire. Les titulaires de revenus fixes sont exclus
de la croissance ; la hausse des salaires réels est inférieure à celle du revenu national (au profit
des industriels) : les années 20 n’apparaîtront comme prospères que rétrospectivement.
L’enlisement dans la dépression (1930 – 1935)
Au moment où l’économie semblait enfin se redresser, la France s’enfonce dans un cercle
vicieux de déséquilibre (déficit, baisse des prix, des profits et des investissements) et de baisse
qui concerne tant la production que sa situation relative extérieure. Certes les mesures n’ont
pas été optimales, mais surtout les gouvernants n’ont pas tiré profit des expériences étrangères
et n’ont pas su dépasser les théories économiques dominantes et l’attachement au franc stable.
1. L’entrée dans la dépression
En 1930, la France est un îlot de prospérité alors que le chômage a déjà envahi Allemagne et
GB. Mais la France cesse de percevoir les versements, ses X diminuent et la crise s’installe
peu à peu. La balance commerciale redevient déficitaire malgré le prix relativement faible des
produits français, qui remonte en 31 avec la dévaluation de la livre. Les pays dévaluateurs
amorcent alors leur redressement en « exportant leur chômage » (≠ France et USA). La pro-
duction industrielle chute de 17 % en 7 mois, le chômage démarre. La chute des I est bien
plus prononcée. Du fait de la baisse des prix, l’agriculture peine ce qui compresse la demande.
La timide reprise de 33 est brisée par la dévaluation du dollar => surévaluation des prix.
2. L’inefficacité des politiques
L’instabilité ministérielle s’accroît => pas de véritable politique de crise, sinon de traitement.
L’obsession de l’équilibre budgétaire
Le déficit résulte de la dépression, et non l’inverse. Si Keynes a montré qu’il peut être néfaste,
le dogme de l’équilibre budgétaire domine la vie politique française. On présente des budgets
en équilibre artificiel, on fait des économies de bouts de chandelles (pension des AC !). Le
déficit de 34 sera de 12 milliards ; la France est au bord de la crise de régime.
Les mesures malthusiennes
La surproduction est vue comme cause de la crise, on va donc ajuster l’offre à la demande
quitte à détruire des capacités de production (≠ credo libéral). Face aux récoltes excédentaires,
le gouvernement triche sur les chiffres puis tente d’imposer un prix minimum (=> marché
noir) et interdit les nouvelles plantations viticoles. L’intervention industrielle est limitée mais
on favorise les ententes, l’immigration est réduite (32) comme l’implantation étrangère (Bata).
Les mesures protectionnistes et le refus de dévaluer
En 31 est mise en place une « surtaxe de change » de 15 % contre les dévaluateurs, puis un
système de contingentements qui n’enraye ni le déficit commercial ni la chute des prix, juste
retardée. Les X françaises diminuent plus que le commerce mondial global (franc fort). En 35,
la Belgique dévalue alors que la France s’y refuse toujours (« abomination de la désolation »).
La politique de déflation du gouvernement Laval (juin 35 – janvier 36)
Laval obtient des pouvoirs exceptionnels pour éviter la dévaluation par des mesures (impopu-
laires) : « déflation budgétaire » brutale et autoritaire, « déflation économique » (baisse
imposée de certains prix de référence), baisse des taux d’intérêt déjà appliqués. Malgré une
légère reprise, les prix remontent et le coût de la vie s’accroît. D’où la victoire du Front popu.

3. Premier bilan de la dépression vers 1935
Baisse de l’activité et distorsions structurelles
Les prix de gros baissent de 46 % entre 29 et 35 (60 % pour les actions), la production de 25
%. Même si ce chiffre est surévalué, la France est la seule à voir sa production diminuer après
32, recul qui ne correspond que peu à une baisse de la productivité (perte d’1,8 millions
d’emplois, dont 1 pour l’industrie et baisse des taux d’activité). Le tertiaire est un « secteur
refuge » alors que l’industrie perd durablement des capacités de production. L’augmentation
de la production agricole est compensée par la baisse des prix. Le taux d’ouverture passe de
14,4 à 8,6 %. Un dualisme s’établit entre secteurs « abrité » (public, cartels) et « ravagé ».
La résistance générale des niveaux de consommation
Le minime recul des consommations non alimentaires n’est pas général ; quant aux
alimentaires, elles progressent de 5 % : la valeur réelle du revenu national n’a baissé que de
12 % et s’est redirigée vers la C (aux dépens de l’I et des chances de croissance future…)
Les inégalités devant la crise
Alors même que l’agriculture résiste mieux que l’industrie, les paysans perdent 32 % de leur
revenu réel. Si l’ouvrier employé à temps plein, les professions libérales et le retraité sont
gagnants, il n’en est pas de même des ménages touchés par le chômage ou l’inactivité, ou des
mineurs. Les profits sont laminés au profit des revenus fixes (fonciers) => « revanche du
rentier ». Les inégalités sont nettement perçues dans cette « économie de dérive » (Sauvy).
Des réformes du Front Populaire à la Seconde Guerre mondiale
La gauche comme en 24 et 32 ne dépasse pas deux ans au pouvoir ; l’échec de la CGT fin 38
est la revanche de juin 36. La voie est libre pour Reynaud. Mais en 36, il y a eu un vrai
programme économique de gauche, une nouvelle classe politique et une hardiesse qui
annonce celles de la Libération, sans pour autant faire l’unanimité. D’où l’étude de la période.
1. Le Programme du Rassemblement populaire
L’entente économique des radicaux, SFIO et PC est difficile et se fait sur une politique du
« pouvoir d’achat » socialiste qui évoque Roosevelt, opposée aux pratiques malthusiennes par
un cercle vertueux de la reprise, une « reflation » et une priorité sociale à effets positifs sur
l’économie. Concrètement, grands travaux, indemnisation du chômage et relèvement des prix
s’associent à une réduction du temps de travail (mesure phare) sans baisse de salaire. Les
risques de surcoût pour l’entreprise et de limitation quantitative de la production sont balayés
(étalement des coûts fixes) ou négligés. Ce programme comporte pourtant des manques : peu
de réformes structurelles, pas de nationalisations (opposition des non-socialistes) sauf
industries de guerre et surtout pas de dévaluation (ni contrôle des prix ou des changes) !
2. L’économie française sous le gouvernement Blum (juin 1936 –juin 1937)
L’application du programme de 1936
Au milieu d’imprévus (immense grève qui se conclut avec les accords Matignon) sont votés
dès juin congés payés, conventions collectives (à l’unanimité) et 40 h => + 20 % salaires. La
dévaluation inéluctable d’environ 30 % (fuite des K et inflation) se fait le 26 septembre par un
pacte avec les anglo-saxons (pas de rétorsion), la sous-évaluation permettra d’absorber
l’inflation intérieure. Les 40 h sont peu à peu mises en place (nov / juin), les dérogations
restreintes et la semaine de cinq jours s’impose spontanément par un consensus. Mais elle ne
facilite pas le réemploi ni le maintien de la production, au profit d’une mystique de la paresse.
Les résultats économiques du Front Populaire

Le chômage recule de 20 % (décevant) mais nombre d’emplois sont créés (chômage
« résiduel » d’actifs peu employables). La production reprend (bourse * 2 entre juillet et
janvier) mais reste insuffisante et ne rejoint pas le niveau de 39 ou le rythme extérieur. Elle
est due à la dévaluation et à la politique de pouvoir d’achat ; elle souffre pourtant de la hausse
des coûts de production (+ 50 % de coût du travail en quelques mois), de l’inflation qui
annule la hausse de pouvoir d’achat et surtout de la RTT qui limite les capacités de production
(effet souvent exagéré). La productivité ne suffit pas, notamment dans les mines, métallurgie
et travail des métaux qui freinent les autres branches, et les M augmentent, ce qui annule le
bénéfice de la dévaluation. La guerre a empêché les effets bénéfiques à moyen terme.
3. De la fin du Front Populaire à la guerre de 1939
La récession de 1938
Sous Chautemps, les socialistes protègent les 40 h mais ne peuvent empêcher la redescente du
pouvoir d’achat ouvrier au niveau de 36. Le franc est à nouveau dévalué, mais la reprise se
heurte à nouveau aux capacités bloquées, puis à une nouvelle dépression mondiale.
L’ultime tentative de redressement
Avec Reynaud aux Finances, les heures supplémentaires peu surpayées deviennent la norme
(retour à des mesures classiques) ; devant l’échec de la grève CGT en novembre, le gouverne-
ment va plus loin, abrogeant dans les faits les 40 h, qui persistent en fait (chômage partiel) ;
en 39 s’amorce une reprise « keynésienne » (dans le réarmement d’abord,* 7 entre 36 et 39).
Le déclin économique français à la veille de la Seconde Guerre
mondiale
Les variations, du système productif comme des courants migratoires, sont brutales dans la
période : certaines classes (rentiers) se retrouvent perdants puis gagnants, 1938 préfigure la
« stagflation », l’ensemble reflète une instabilité chronique. Mais le blocage de croissance n’a
pas empêché la modernisation économique ; au contraire, même.
1. Transformation des structures et ralentissement global
L’évolution des structures sectorielles
La France reste très agricole pour un PDEM, mais sa population rurale est tombée à 48 %, les
petites exploitations disparaissent au profit d’une concentration favorable à la modernisation.
La toute petite entreprise artisanale recule, 50 % des salariés secondaires travaillent dans des
établissements de plus de 100 salariés. Les fusions (chimie) et la croissance interne (auto)
permettent la concentration dans les industries récentes et dynamiques (papier !). La part de
PA industrielle textile régresse à leur profit. Les autres premières industries souffrent à partir
de 29. Au total, le tertiaire se développe aux dépens du primaire et du secondaire, qui diminue
par rapport à 1896 (!) en proportion et surtout en effectifs absolus (sous-capacités, remember).
Production, emploi, productivité
En 38, production et revenu restent en-deçà de 29, recul sans précédent et sans égal parmi les
PDEM (20 et 10 % respectivement pour Sauvy, moins pour CDM) alors qu’en 29 la « droite
de trend » avait été rejointe. La PA occupée baisse d’un million entre 13 et 38 (surtout dans
l’industrie) ; comme depuis 1896, les gains de productivité se maintiennent à 2,1 % par an (y
compris dans l’agriculture « attardée ») : concentration, compensation des 40 h, mécanisation,
I de « rationalisation » alors que ceux de capacité ont disparu, modernisation des années 20.
Fortunes et revenus
Les premières ont plus souffert que les seconds (pourtant éprouvés !), la thésaurisation en or
étant seule avantageuse entre 29 et 39 (inflation et chute des dividendes) ; même les place-

ments immobiliers ne sont pas bénéfiques (=> pas d’entretien des immeubles). La fortune
mobilière progresse proportionnellement, les patrimoines sont véritablement amputés. Le
revenu réel par habitant croît de 25 % entre 13 et 38 et les « revenus du travail » passent de 43
à 52 % (salarisation), plus du fait des retraites et pensions que des stricts salaires (40 h) ; les
ouvriers (employés !) sont favorisés à long terme, ainsi que les professions libérales, seuls
indépendants épargnés (≠ paysans). La répartition reste stable en dépit de l’impôt sur le
revenu, l’emploi se dirige vers la C au détriment de l’I (21 % en 29 contre 13 en 38).
2. Les facteurs d’affaiblissement durable
Le vieillissement démographique
La population stagne à 42 millions entre 13 et 38 avec l’achèvement de la transition démogra-
phique, une dénatalité déjà ancienne et l’accroissement de l’espérance de vie. À partir de 35,
les déficits naturels réapparaissent (« classes creuses »), d’où une ébauche de politique
familiale ; la population vieillit (10 % de plus de 65 ans en 36) et la charge des retraites
s’alourdit. Ce vieillissement accroît la rigidité structurelle sans faire baisser la xénophobie.
Repli et fermeture de l’économie française
Alors que la D extérieure avait été un moteur de la croissance au XIX°, la France se cloisonne
fortement avec la dépression, du fait du repli de l’économie mondiale (dislocation des réseaux
d’échange et instabilité monétaire). Les X françaises traditionnelles (luxe) sont très touchées
par la crise en dépit des dévaluations d’ailleurs trop tardives. Le déficit commercial apparaît
dès 31 et se creuse malgré le protectionnisme et les capitaux placés à l’extérieur. La France se
replie donc sur ses colonies, marché protégé (25 à 30 % des échanges commerciaux en 1937)
mais n’atteint pas l’autarcie (dépendance énergétique et alimentaire).
Recul du marché, alourdissement des charges, passivité de l’Etat
L’influence du marché recule aux dépens d’un interventionnisme grandissant (prix minimum
du blé en 33, accords Matignon). La timide politique sociale des années 30 et les 40 h
alourdissent cotisations sociales et coûts de production. La part des dépenses publiques dans
le revenu national passe de 12 à 27,5 % entre 12 et 38 et s’accompagne d’un déficit (et d’une
dette !) croissant. La fiscalité indirecte reste prépondérante et la redistribution sociale des
revenus quasi inexistante. Malgré ses nouveaux pouvoirs, l’Etat n’élabore aucun projet
d’ensemble : peu de dépenses d’éducation, pas de soutien à l’I, nationalisations presque
forcées (chemins de fer en août 37, BDF en 36) contrairement à celles de 45.
Conclusion
La crise de 29 est-elle un prolongement de la Belle Epoque ou une annonce de celle de 73 ?
Ni l’un ni l’autre ? Le passage de la « loi d’airain » au monde productiviste ? Pour Marseille,
la France est entrée en crise dès 28-29 => responsabilités de la France dans la crise, thèse
contestée par la visible consolidation française jusqu’en 30 (hausse de la production et des
salaires, peu de faillites). Pour Marseille, le rôle moteur des X révèle dès 26 la surproduction
française dont on se débarrasse grâce à la dépréciation du franc. Ce qui reste discutable. Pour
Boyer, l’international a révélé les contradictions internes : la crise de 29 serait « un épisode
critique au cours duquel le caractère contradictoire de la reproduction sociale prend
l’apparence d’une surproduction massive », un décalage entre trends de la productivité et des
salaires. Mais CDM n’ont pas constaté l’explosion de la productivité invoquée par Boyer (2,1
contre 5,8 %). Pour eux, la crise serait due à une inadéquation des biens d’équipement à une
D en biens de consommation qui n’évolue pas. À partir de 26, les salaires gagnent sur les
profits, ce qui infirmerait la sous-C comme cause de la crise. On peut donc conserver le
caractère « externe » de la crise française, aggravé par le refus de dévaluer et la contraction du
commerce mondial => « Sedan économique » des années 1930.
1
/
5
100%