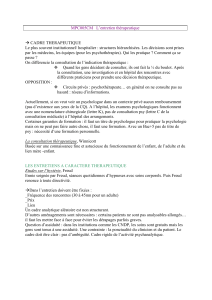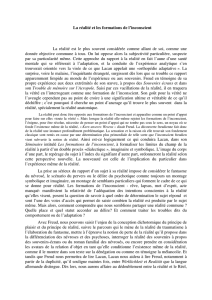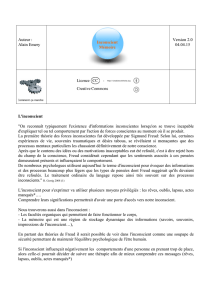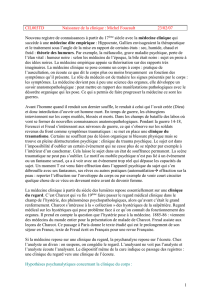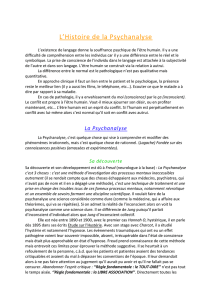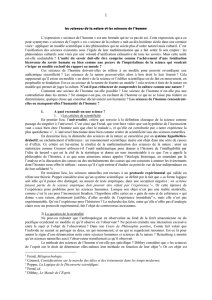131. L`inconscient noumène

GUY LE GAUFEY
L’INCONSCIENT NOUMENE
Que serions-nous sans le secours de ce qui
n'existe pas ? Peu de chose, et nos esprits bien
inoccupés languiraient si les fables, les méprises,
les abstractions, les croyances et les monstres,
les hypothèses et les prétendus problèmes de la
métaphysique ne peuplaient d'images sans objet
nos profondeurs et nos ténèbres naturelles.
Paul Valéry, « Petite lettre sur les mythes »,
Œuvres I, Pléïade, Gallimard, Paris, 1957, p. 966.
Freud aura détesté la philosophie… sans y répugner (Stuart Mill). Il l’aura combattu… en
s’en servant (Brentano). Il l’aura fui… de près (Schopenhauer). Bref, on devrait décerner à
l’ensemble de l’œuvre freudien le grand prix de l’ambivalence à l’égard de la philosophie et
passer outre, une recension sur ce thème
1
nous offrant toute la (mince) matière textuelle
disponible. Pour s’aventurer à nouveau dans ce marais, on ne s’armera ici que d’une
plaisanterie douteuse
2
de Freud, demandant à Paul Häberlin, en présence de Ludwig
Binswanger, si ce que Kant appelait la « chose en soi » n’était pas ce que lui nommait pour sa
part « inconscient ».
Binswanger déclara d’emblée la comparaison « philosophiquement insoutenable », et l’on
ne lui disputera pas ici l’adjectif, vu l’adverbe. Häberlin, dit l’histoire, se contenta d’en rire. Mais
si l’inconscient, au dire de son inventeur, est aussi peu phénoménal que le laisse entendre cette
rapide et malicieuse correspondance, qu’en conclure ? Kant, lui, n’a pas cru nécessaire
d’envisager un « noumène dynamique », ni de prêter à la chose en soi beaucoup de propriétés
positives. Pourquoi diable celui qui n’a eu de cesse d’affirmer que son inconscient était autre
chose que le non conscient a-t-il tenu à le retirer de l’ordre phénoménal ? Si l’on ajoute qu’au
moment de proposer sa « pulsion de mort », il s’est dépêché de la présenter comme une pure
« spéculation », tenons-nous là, sous couvert d’un homme de science et d’expérience, un
faiseur de système prêt à se payer une conscience en dénonçant ses alter ego ?
Le fait de postuler un au-delà ou un en deçà de la représentation est un refrain
épistémique chez Freud : de l’ombilic du rêve au coït des Pankejeff un soir d’été en passant par
1
Paul-Laurent Assoun, Freud, la philosophie et les philosophes, Paris, PUF, 1 976.
2
« une naïveté à moitié feinte », dit Paul-Laurent Assoun, op. cit., p. 174.

L’inconscient noumène, p. 2
le refoulement primaire, le motif secret du fantasme, le meurtre du père totémique ou le premier
Moïse, on ne manque pas de perspectives où l’essentiel est annoncé, pour finir, par-delà toute
enquête mondaine susceptible d’établir la véracité des faits ou le détail historique de
l’événement. Une sorte de priapisme interprétatif vient donner forme et consistance au blanc
proclamé du texte pour faire alors apparaître ce texte lui-même comme le résultat d’une
élaboration tronquée qui oblige à postuler un contenu antérieur, passé aux oubliettes et riche
d’informations. Le schéma qui ordonne L’interprétation du rêve reste à cet égard gros d’une
ontologie que rien ne mettra en doute par la suite. Existe le texte (du rêve, du symptôme, du
délire, etc.), mais celui-ci est méthodologiquement dédoublé : sous le pavé du phénomène
manifeste, le latent fait plage, où s’étalent les premières inscriptions. À l’interprète de les
articuler, non tant comme des vérités cachées, que comme le brouillon compromettant de ce
qui n’aura pu accéder à la manifestation qu’en supportant d’être trituré par la censure. Cet
échafaudage vaut alors preuve pour l’existence d’un inconscient qui, de ce fait, ne sera jamais
appelé à se manifester tel quel, mais comme ce que la censure aura marqué de son empreinte.
Quelle qualité d’existence prêter à cet inconscient qui n’a ici pour l’instant d’autre statut
que celui d’hypothèse heuristique ? Nous avons ici le choix entre Descartes et Newton. Le
premier, dans ses Principes de la philosophie, pousse le bouchon jusqu’à écrire :
Je désire que ce que j’écrirai soit seulement pris pour une hypothèse,
laquelle est peut-être fort éloignée de la vérité ; mais encore que cela fût, je
croirai avoir beaucoup fait si toutes les choses qui en seront déduites sont
entièrement conformes aux expériences : car si cela se trouve, elle ne sera
pas moins utile à la vie que si elle était vraie, parce qu’on s’en pourra servir
en même façon pour disposer les causes naturelles à produire les effets que
l’on désirera
3
.
Et dès le chapitre 45 suivant, il enfonce le clou : « Que même j’en supposerai ici
quelques-unes que je crois fausses », pour titrer son chapitre 47 : « Que leur fausseté
n’empêche point que ce qui en sera dit ne soit vrai ». Bien sûr, dans ce dédale, il peut compter
sur l’opérateur logique de l’implication, qui reste valide lorsque j’infère du faux vers le vrai, la
seule chose interdite étant d’inférer du vrai vers le faux
4
. Il est donc permis de faire des
hypothèses dont la vérité n’est pas en cause, avec cependant cette conséquence fâcheuse :
puisque je ne les suppose pas vraies, je ne peux pas leur prêter un antécédent car si elles sont
fausses, elles ne peuvent procéder que du faux. Et qui voudrait se donner la peine de dérouler
des chaînes de faussetés ? L’hypothèse au sens de Descartes est donc possiblement source
d’intelligibilité, dans la mesure où elle se présentera comme un antécédent logiquement valide
du phénomène, mais elle se comportera comme un cul-de-sac pour toute recherche
hypothético-déductive qui voudrait trouver en amont de quoi elle est elle-même le conséquent.
3
René Descartes, Les principes de la philosophie, Œuvres complètes, Édition Alquié, tome III, Paris,
Garnier-Flammarion, 1973, p. 247.
4
Le vrai vers le vrai, et le faux vers le faux restant éminemment valides.

L’inconscient noumène, p. 3
À cela, Newton répond, dans le General Scholium de la troisième édition de ses
Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica :
Je n’ai pas encore été capable de découvrir la raison de ces propriétés de
gravité à partir des phénomènes, et je ne feins pas d’hypothèses. Car quoi
que ce soit qui n’est pas déduit des phénomènes doit être tenu pour une
hypothèse : et les hypothèses, qu’elles soient métaphysiques ou physiques,
basées sur des qualités occultes ou mécaniques, n’ont pas de place dans la
philosophie expérimentale.
Ce qui existe (phénomènes) provient de ce qui existe, à savoir d’autres phénomènes qu’il
n’est pas toujours possible d’appréhender comme tels mais que, sous certaines conditions, il
est permis de postuler dans l’attente des procédures techniques et/ou conceptuelles qui
pourraient y donner accès. Et une fois portées au phénomène, ces hypothèses pourront alors
être questionnées, susciter d’autres hypothèses en amont d’elles, et ainsi la science
hypothético-déductive pourra-t-elle se développer en consolidant toujours mieux ses bases.
Dans sa fausse révérence à Kant, Freud l’anguille se faufile entre ces deux postures. Il
faut que l’inconscient existe (il est même demandé aux analystes « d’y croire »), mais la voie de
sa manifestation phénoménale le dénature par définition. Donc oui, il y a bien du noumène dans
l’inconscient freudien au sens où sa qualité d’hypothèse heuristique se double d’un fort
coefficient d’existence, même si cette existence se dérobe comme telle.
Cette ambiguïté existentielle est commune aux appellations négatives. Si je place un
préfixe privatif devant un concept quelconque, il adviendra deux choses différentes selon que je
me serai donné ou pas, au préalable, un univers du discours. Dans le premier cas, ma négation
produira le complémentaire de ce concept, désignant ainsi tout ce qui ne relève pas de lui. Ce
n'est rien de bien précis, mais ça a le mérite d'exister. Dans le second cas, si je ne me suis
donné aucun univers discursif de cet ordre, ma négation me laissera le bec dans l'eau,
incapable de savoir si par elle j'obtiens quelque chose ou rien. Pour réduire de façon opératoire
l'immensité qui résulte de l'hypothèse d'un univers
5
dans lequel on effectue une négation, on
adjoint le plus souvent quelques déterminations positives qui circonscrivent dans le
complémentaire ainsi découpé une nouvelle entité en lui conférant une identité, laquelle se
dégage alors du tohu-bohu qu’était ce simple complémentaire du concept obtenu par voie de
négation.
Ainsi « in-conscient » désigne-t-il d’abord tout ce qui échappe à la conscience – ce qui n’a
déjà rien de simple dans la mesure où la conscience peut se diriger vers n’importe quoi dès lors
que ce n’importe quoi-là lui est présenté et soumis. Mais une fois ramené au psychisme sur une
base tout à la fois neuronique, représentationnelle et affective, l’inconscient se voit doté de
propriétés (investissements « non liés », ignorance du temps, association par simultanéité, etc.)
5
En général implicite. Chez Freud, ce sera quelque chose comme « le psychisme » ou « l'appareil
psychique ».

L’inconscient noumène, p. 4
telles que l’on peut croire avoir affaire à une réalité humaine du genre « appareil » (l’appareil
neurovégétatif) ou « système » (le système nerveux central, le système cardio-vasculaire). Et
quand ça se complexifie en topiques (Ics/Pcs/Cs, Ça/Moi/Surmoi), on finit par ne plus douter de
tenir là un composant de l’être humain aussi consistant qu’un foie ou un poumon. « Mon
inconscient… », entend-on dire : cette banalisation linguistique signe l’appropriation positive du
concept négatif, désormais arraisonné, privatisé, et de ce fait même ontologisé par sa prise en
considération comme phénomène naturel.
Or ce n’est pas un phénomène. Donc la difficulté perdure. Et il se passe là quelque chose
qui tient à la consistance singulière du savoir freudien, cette consistance qui retient Freud à
l’extérieur du champ philosophique. Il le dit sans ambages à Eitingon alors que ce dernier
cherchait à lui vanter les mérites de l’œuvre de Chestov :
Vous ne pouvez sans doute pas imaginer à quel point me paraissent
étrangères toutes ces contorsions philosophiques. J'éprouve un profond
sentiment de satisfaction à ne pas prendre part à ces déplorables
gaspillages de la capacité des humains à penser
6
.
L’énergie de ce refus est à chercher dans autre chose que l’idiosyncrasie de Sigmund
Freud : bien plutôt dans l’incapacité constitutive du savoir qu’il invente à propos de l’inconscient
de s'éloigner par trop du cas. L'indubitable plaisir pris à la construction intellectuelle ne doit pas
prendre le pas sur le problème posé par la réalité clinique, même si les détours imposés
paraissent à l'occasion interminables. La grogne trop connue de Freud contre les
Weltanschauungen des philosophes tient à cette injonction d'avoir à répondre à la disparité des
questions posées par une « nature » proliférante. C'est aussi en ce point qu'il fait subir à la
clinique médicale une singulière torsion.
Dans Naissance de la clinique, Michel Foucault a su montrer, dans son détail, le virage
sémiotique par lequel une conception classique du symptôme médical en tant que manifestation
visible d'une maladie invisible a cédé la place au signe clinique en tant que signifiant quasi
transparent d'un signifié qui, articulé à d'autres, fait connaître tout ce qu'il y a à connaître de la
maladie. Celle-ci, dès lors, n'est plus qu'un nom pour rassembler sans perte tous ces signes qui
ne font que se répéter et s'ordonner différemment d'une maladie à l'autre
7
. Sur le principe de
l'analyse mis en lumière par Condillac, se constitue dans le champ médical la conviction selon
laquelle il est possible de décomposer toute maladie en un nombre fini d'éléments diversement
agencés, comme tous les mots d'une langue ne sont jamais que des agencements d'un nombre
6
Cité par Ilse Grubrich-Simitis, dans son article "Wie sieht es mit der Beheizungs- und Beleuchtungsfrage
bei Ihnen aus, Herr Professor ?" - Zum Erscheinen des Freud-Eitingon-Briefwechsels, in Psyche 59,
mars 2005, p. 286. Je dois à Fernand Cambon de m’avoir signalé et traduit ce passage.
7
« Demander ce que c'est que l'essence d'une maladie, "c'est comme si vous demandiez quelle est la
nature de l'essence d'un mot" (Cabanis, Du degré de certitude, Paris, 1819, p. 86). Un homme tousse ; il
crache du sang ; il respire avec difficulté ; son pouls est rapide et dur ; sa température s'élève : autant
d'impressions immédiates, autant de lettres, pour ainsi dire. Toutes réunies, elles forment une maladie, la
pleurésie : "Mais qu'est-ce donc qu'une pleurésie ? C'est le concours de ces accidents qui la constituent.

L’inconscient noumène, p. 5
fini (et restreint) de lettres. Ce principe d'intelligibilité est très puissant, mais porte un coup fatal
à l'être des maladies jusque-là conçues comme des entités morbides prêtes à s'emparer des
corps, et réduites désormais à un certain nombre de dysfonctionnements locaux qui trouvent à
s’exprimer par des combinaisons parfois complexes d’un nombre limité de signes. Le regard
clinique cesse alors de chercher une illusoire profondeur de la maladie pour s'épuiser dans les
effets de surface où elle s’offre à lui au fil de signes sans épaisseur, aussi intriqués soient-ils.
Le symptôme freudien rompt avec ce nouvel et triomphant équilibre de la médecine
clinique du XIXe siècle en ce qu’il résulte d’une « Bildung », d’une formation : formation de
compromis, formation de symptôme, formation substitutive, formation réactionnelle, il semble
bien que ce qui se manifeste comme signe dans ce champ doive toujours être appréhendé
comme terme d’un processus où signifiant et signifié ne s’avèrent plus « coller » aussi bien que
dans la démarche clinique à la Cabanis ou à la Bichat. De fait, la trouvaille initiale de l’« après-
coup », appelée à régir le symptôme freudien, chamboule à elle seule le décor sémiotique de la
nouvelle médecine.
L’exemple princeps qui inaugure cette perspective se trouve dans le deuxième chapitre
de l’Esquisse pour une psychologie scientifique, qu’une tardive mais bienvenue traduction
permet enfin de lire aujourd’hui en français
8
. Emma ne peut aller seule acheter des vêtements.
Freud questionne jusqu’à obtenir un premier souvenir : alors qu’elle avait douze ans, elle s’était
rendue (seule ?) dans un magasin où deux commis – elle se souvient encore de l’un d’eux –
rirent ensemble en la voyant. Saisie d’un affect d’effroi, elle s’enfuit. Elle peut seulement dire
qu’ils avaient dû se moquer de sa robe, et que l’un d’eux lui avait plu. Réaction de Freud : si on
s’en tient là, on ne comprend rien (il est en train de chercher les relations de cette contrainte
avec le refoulement, en faisant depuis le début l’hypothèse qu’il faut rencontrer des
phénomènes de « déliaison sexuelle », seuls à même d’amener dans l’appareil psychique des
excès brutaux de quantité qui, expliquant la douleur, permettraient de comprendre le
refoulement comme fuite inconsciente de cette douleur). Il poursuit donc son interrogatoire,
jusqu’à obtenir un deuxième souvenir. Ici, mieux vaut le suivre à la lettre :
Or une nouvelle recherche met à découvert un second souvenir qu’elle
conteste avoir eu au moment de la scène I. Ça n’est d’ailleurs pas prouvé
9
.
Enfant, à l’âge de huit ans, elle est allée deux fois dans le magasin d’un vieil
épicier pour acheter des friandises. Le patron lui agrippa les organes
génitaux à travers ses vêtements. Malgré cette première expérience, elle s’y
rendit une seconde fois. Après la seconde fois, elle ne s’y montra plus. Elle
Le mot pleurésie ne fait que les retracer d'une manière plus abrégée." (Ibid.) » Michel Foucault,
Naissance de la clinique, Paris, PUF, Quadrige, mars 2000, p. 120.
8
Sigmund Freud, Lettres à Wilhelm Fliess, Paris, PUF, 2006, traduction de Françoise Kahn et François
Robert, p. 651-663.
9
Je ne suis pas ici la récente traduction des PUF qui, pour la phrase « Es ist auch durch nichts
erwiesen. », donne : « Rien ne vient d’ailleurs avérer le souvenir », laissant ainsi croire que le « second
souvenir », celui avec le vieil épicier, serait tenu pour douteux par Freud. Or il semble bien que la seule
chose dont il doute dans ce passage soit le fait qu’Emma se soit rappelée ou pas ce second souvenir lors
de la scène avec les commis qui, elle, n’a jamais quitté sa mémoire. Cf. S. Freud, Lettres…, op. cit.,
p. 658.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
1
/
9
100%