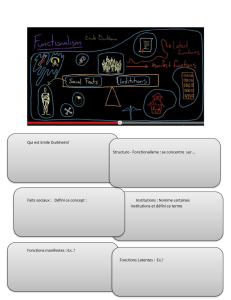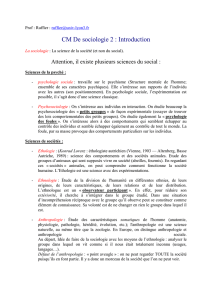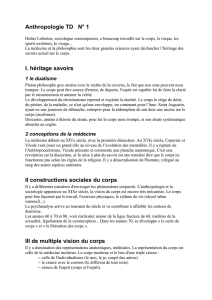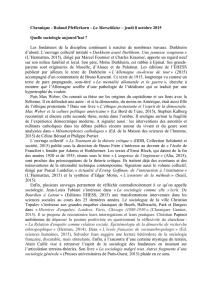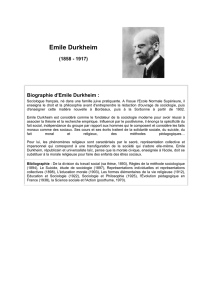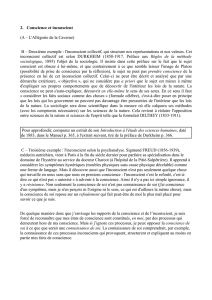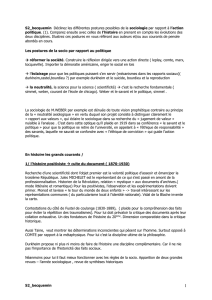Les sciences de la nature et les sciences de l`homme

1
Les sciences de la nature et les sciences de l’homme
L’expression « sciences de l’homme » est une formule qui ne va pas de soi. Cette expression, qui a eu
pour synonymes « sciences de l’esprit » ou « science de la culture » naît au dix-huitième siècle dans une certaine
visée : appliquer un modèle scientifique à des phénomènes qui ne soient plus d’ordre naturel mais culturel. C’est
l’unification des sciences existantes sous l’égide de leur mathématisation qui a fait sentir là son empire : les
phénomènes culturels sont visés par une volonté d’unification exhaustive de tous les savoirs. Mais cette unité
est-elle souhaitable ? L’unité du savoir doit-elle être comprise comme l’achèvement d’une totalisation
bienvenue du savoir humain ou bien comme une preuve de l’impérialisme de la science qui voudrait
s’ériger en modèle exclusif du rapport au monde ?
Ces sciences de l’homme doivent-elles en référer à un modèle pour pouvoir revendiquer une
authentique scientificité ? Les sciences de la nature peuvent-elles alors à bon droit le leur fournir ? Cela
supposerait qu’il existe un modèle « en droit » de la science or l’édifice scientifique est de fait en mouvement, en
perpétuelle re-fondation. Est-ce au science de la nature de fournir un modèle ? cela revient à faire de la nature un
modèle qui permet de juger la culture. N’est-il pas réducteur de comprendre la culture comme une nature ?
Comment une science de l’homme est-elle possible ? Une science de l’homme n’est-elle pas une
contradiction dans les termes ? Ne manque-t-on pas, en excluant de l’homme ce qui ne se laisse pas réduire au
déterminisme, quelque chose qui constitue décisivement son humanité ? Les sciences de l’homme rencontrent-
elles ou manquent-elles l’humanité de l’homme ?
I. A quoi reconnaît-on une science ?
1. ) Les critères de scientificité
En premier lieu, l’universalité, critère qui renvoie à la définition classique de la science comme
passage du singulier à l’universel. C’est ainsi que Freud, qui veut faire valoir que son hypothèse de l’inconscient
vaut « aussi bien chez l’homme sain que chez le malade », et qu’elle est corroborée par « notre expérience la
plus quotidienne »
1
. L’universel fonctionne donc bien comme critère de scientificité issu des sciences naturelles.
En deuxième lieu, la démarche des sciences de la nature se caractérise par un système hypothético-
déductif, un enchaînement d’inférences : un raisonnement scientifique insère son objet dans une série de causes
et d’effets. Ce critère est lui-même le résultat de la mathématisation des sciences de la nature : ainsi un
statisticien comme Cournot utilisera-t-il l’outil mathématique pour donner à l’histoire de l’intelligibilité par
l’idée de hasard « qui est la clef de la statistique et donne un sens incontestable à ce que l’on a appelé la
philosophie de l’histoire, à ce que nous aimerions mieux appeler l’étiologie historique, en entendant par là
l’analyse et la discussion des causes ou des enchaînements des causes qui ont concouru à amener les événements
dont l’histoire nous offre le tableau : causes qu’il s’agit surtout d’étudier au point de vue de leur indépendance ou
de leur solidarité
2
»
En troisième lieu, les sciences naturelles ont recours à un protocole expérimental qui valide ou
réfute une théorie. Popper considère ainsi qu’un système scientifique se définit par le fait que « sa forme logique
soit telle qu’il puisse être distingué, au moyen de tests empiriques, dans une acception négative : un système
faisant partie de la science empirique doit pouvoir être réfuté par l’expérience
3
». Or cette épreuve de
l’expérience pose problème pour les sciences humaines. Lorsque son objet n’est pas une réalité matérielle,
comme c’est le cas pour l’inconscient freudien, l’hypothèse offre certes un « gain de sens et de cohérence » qui
donne « une raison, pleinement justifiée, d’aller au-delà de l’expérience immédiate
4
», mais elle n’est pas
expérimentable. Qu’est l’expérience pour l’historien ? La recherche des faits, outre qu’elle n’offre pas d’analogie
claire avec un protocole expérimental, fait l’objet de controverses incessantes.
2) La question de la neutralité
Ne peut-on redouter que l’anthropologue en observation au fond de la forêt amazonienne ou du
pacifique occidental ne modifie ce qu’il observe en l’observant ? Ne peut-on craindre une interaction excessive
entre le sujet et l’objet de l’observation ? Dans son Cours de Philosophie positive, Comte fait valoir que
l’individu ne saurait se partager en deux, un qui raisonnerait, et un qui se regarderait raisonner. Est-ce là pour
autant le signe d’une démarcation nette entre sciences humaines et sciences de la nature ? Heisenberg a montré
qu’en sciences naturelles aussi l’observateur transformait ce qu’il observait.
La méthode des sciences de l’homme n’est-elle pas spécifique ? Dilthey considère que « les sciences
de l’esprit ont le droit de déterminer elles-mêmes leur méthode en fonction de leur objet
5
» Or cet objet est
1
Freud, Métapsychologie.
2
Cournot, Considérations sur la marche des idées et des événements dans les temps modernes.
3
Popper, La Logique de la Découverte scientifique.
4
Freud, id.
5
Dilthey, Le Monde de l’Esprit.

2
spécifique : il s’agit de « faits qui se présentent à la conscience comme des phénomènes donnés isolément de
l’extérieur, tandis qu’ils se présentent à nous-mêmes de l’intérieur comme une réalité » Pour être intérieur, cet
objet n’en est pas moins cohérent même plus immédiatement que la nature des sciences physiques reconstituée et
interrogée par des hypothèses.
La gradation traditionnelle entre sciences naturelles et sciences humaines n’est alors pas loin de
s’inverser en faveur de ces dernières : c’est ce que fait valoir Lévi-Strauss dans son hommage à Boas, le père
américain de l’anthropologie. En effet, ce dernier a le premier défini « la nature inconsciente des phénomènes
culturels », caractéristique qui les prémunit des interprétations parasites, de sorte que « le passage du conscient à
l’inconscient s’accompagne d’un progrès du spécial vers le général
6
» Ainsi c’est la généralisation qui fonde la
comparaison, au sens où « il suffit d’atteindre la structure inconsciente, sous-jacente à chaque institution et à
chaque coutume, pour obtenir un principe d’interprétation valide pour d’autres institutions et d’autres
coutumes ».
3) L’unité du savoir, une obsession vaine ?
La mise sur le même plan des sciences humaines, des sciences de la nature et des sciences formelles
repose sur le présupposé galiléen : unifier mathématiquement le monde afin de le rendre continu et cohérent.
Cette ambition culmine avec le scientisme qui entend mathématiser et quantifier les phénomènes culturels.
Il y a certes des régions du savoir qui communiquent entre elles : déplacements, échanges de concepts
par exemple. Mais il s’agit d’une unité sans point fixe, sans norme organisatrice. Le savoir n’est pas continental
mais régional : s’il y a unité, c’est une unité de réseau et non unité linéaire. Le savoir contemporain est en
archipel. La totalisation ne se justifie plus : c’est dans les écarts, les ruptures et les franges que se joue cette
perpétuelle tectonique des savoirs.
Cet éclatement centrifuge se retrouve même dans les théorisations savantes de l’unité. On peut
distinguer trois sens de cette unité de la science : « l’unité de la science au sens le plus faible est atteinte à partir
du moment où l’on réduit tous les termes de la science aux termes d’une discipline
7
» Deuxièmement, elle peut
consister « dans l’unité des lois » En fin, au sens supérieur, il s’agira d’unifier et de relier ces lois les unes aux
autres.
II. Concepts scientifiques et champ théorique
1) Champ théorique et diversité des savoirs
Toute science peut être amenée à créer, à construire l’objet, le « fait théorique », le phénomène qui lui
permettra de satisfaire à cette exigence, objet qu’on peut comprendre comme unique et isolé ou au contraire
comme sérié et donc comme une véritable classe d’objets, soit un champ : celui-ci n’est autre que l’espace
théorique nécessaire à l’exercice des relations entre les objets qui s’y trouvent, comme par exemple l’espace
einsteinien mais aussi l’inconscient freudien : toute science se constitue autour d’un certain champ théorique et
construit ses objets. Kant distinguait la connaissance mathématique comme connaissance par construction de
concepts et la physique comme connaissance par concepts, ce qui laisse supposer que les sciences non
mathématiques ont affaire au donné. En réalité, une analyse attentive de l’expérience de physique montre que tel
n’est pas le cas : Duhem l’illustre par la « disparité entre le fait pratique, réellement constaté, et le fait théorique,
c’est-à-dire la formule symbolique et abstraite énoncée par la physicien
8
» : entre les deux « s’intercale une
élaboration intellectuelle très complexe » qui montre que l’interprétation théorique des phénomènes rend seule
possible l’usage des instruments de mesure.
L’expérience de physique n’est donc pas seulement observation, elle est interprétation. Cette thèse est
une thèse rationaliste, qui considère que l’expérience n’est pas réfutante mais seulement vérificatrice : il faut
‘interpréter pour pouvoir déterminer. L’interprétation se retrouve dans les sciences humaines mais en un autre
rôle : les sciences humaines déterminent pour pouvoir interpréter. Ainsi Freud peut-il dire que « le contenu du
rêve est donné sous la forme de hiéroglyphes, dont les signes doivent être successivement traduits dans la langue
des pensées du rêve
9
» : mais le rêve ne peut être ainsi interprété et faire sens que dans la mesure où l’existence
même d’une telle langue est postulée, qui à son tour repose sur l’hypothèse déterminante de l’inconscient.
L’interprétation marque donc bien à la fois ce qui est commun aux sciences et ce qui les distingue.
2) Le vivant entre mécanisme et finalisme
Le problème du vivant donne à l’interprétation toute son ampleur. Comment en effet interpréter et
questionner le vivant pour atteindre la vie ? D’un côté, le vivant se caractérise comme système complexe,
6
Lévi-Strauss, Anthropologie Structurale, t. I.
7
Oppenheim & Putman, « L’unité de la science : une hypothèse de travail », in De Vienne à Cambridge. (1980)
8
Duhem, La Théorie physique, Vrin, 1989.
9
Freud, L’Interprétation des rêves.

3
comme organisation. Le vivant, c’est de la matière organisée de façon telle qu’elle vit. La définition avoue ici sa
propre impuissance : d’abord du fait de la complexité du vivant qui en rend la connaissance difficile. La vie
peut-elle être pensée comme réductible à une certaine organisation d’une matière ? C’est cette difficulté qui a
conduit à utiliser des modèles.
Le modèle le plus caractéristique de cet effort et de cette impuissance est le modèle mécanique du
vivant. Il est caractéristique d’une tendance à vouloir réduire le vivant à ses conditions matérielles de possibilité.
Le vivant peut être pensé comme un mécanisme à partir du modèle de la machine . Ainsi Descartes peut –il
expliquer la différence entre ce qui est vivant et ce qui est mort par l’analogie de l’horloge : il n’y a pas plus de
différence entre un corps vivant et un corps mort qu’entre « une montre, ou un autre automate […]lorsqu’elle est
montée et qu’elle a en soi le principe corporel des mouvements pour lesquels elle est instituée » et « la même
montre ou autre machine, lorsqu’elle est rompue et que le principe de son mouvement cesse d’agir
10
» Il y a
davantage qu’une analogie : la machine se présente comme un véritable modèle d’intelligibilité. C’est la théorie
cartésienne de l’animal-machine : la seule différence « entre les machines que font les artisans et les divers corps
que la nature seule compose
11
» ne réside que dans la différence d’échelle entre les tuyaux et ressorts des uns et
des autres, moins faciles à percevoir dans le corps vivant.
Même le modèle de l’horloge, familier à Descartes, contemporain de l’invention par Huygens de
l’horloge à ressort, peut être pris à son propre piège : toute horloge suppose pour fonctionner un horloger
extérieur. « Un rouage n’est pas la cause efficiente de la production d’un autre rouage […] la cause productrice
de ces parties et de leur forme n’est pas contenue dans la nature, mais en dehors d’elle, dans un être qui d’après
des idées peut réaliser un tout possible par sa causalité
12
» Le vivant est certes organisé mais c’est un être qui a le
pouvoir de s’organiser lui-même. Ce qu’on appelle la vicariance des fonctions, c’est-à-dire le fait que certains
organes puissent en suppléer d’autres défaillants ou disparus, suppose une exigence, celle du maintien de
l’organisme comme système, autrement dit l’idée d’une finalité interne. Un second modèle d’intelligibilité se
substitue au mécanisme, c’est le modèle finaliste. La vie s’entend alors comme ce qui s’explique par un sens de
la vie. Ainsi la physique aristotélicienne établissait-elle que les êtres vivants obéissent à des fins. Le finalisme
repose certes sur une pétition de principe mais se comprend aussi comme refus de ce que le modèle mécanique a
de réducteur.
L’échec commun à ces deux modèles est le signe de la résistance qu’oppose aux sciences de la vie
leur propre objet, c’est-à-dire la vie elle-même. C’est cette résistance qui alimente la diversité des modèles et qui
provoque, d’un modèle à l’autre, mais aussi du champ théorique et des concepts d’une science à ceux d’un autre,
l’échange et la circulation des outils.
3) La circulations des concepts.
L’échange d’un savoir vers un autre, d’outils comme les concepts, le champ théorique, n’est pas
nécessairement le signe de l’impérialisme de telle science qui fournirait le modèle de toutes les autres. En effet,
cet échange se fait dans les deux sens, entre sciences de la nature et sciences de l’homme.
Certes, en un premier sens, l’attraction normative qu’exercent les sciences naturelles sur les sciences
humaines a organisé un flux ascendant de concepts. La notion de structure, issue de la physique, a ainsi été
importée par les sciences humaines dans le cadre du modèle théorique du structuralisme (années soixante) .
Les relations d’échange sont mutuelles. Il est par exemple remarquable qu’une notion aussi décisive
que l’était pour la biologie du XXè siècle celle de code, ait été, en sens inverse, importée d’une science humaine,
en l’occurrence la linguistique. Ce concept, métaphore filée par d’autres concepts devenus biologiques comme
celui de texte génétique en témoigne assez. Ainsi peut-on analyser la maladie comme une perturbation de la
circulation de l’information dans l’organisme. La cybernétique, comme savoir de la communication, devient
alors à la fois le paradigme d’une science humaine, celle de la communication au sens symbolique ou langagier,
à la fois des sciences naturelles, comme analyse du fonctionnement du vivant.
Cette mutualisation des concepts paraît neutraliser la rivalité entre les savoirs. En réalité, elle la
redouble aussi, comme en témoigne la question contemporaine de l’intelligence artificielle. Entre le processeur
micro-informatique et le cerveau humain, lequel des deux doit être le modèle de l’autre ? En revendiquant la
réductibilité de la pensée humaine à ses conditions organiques de fonctionnement, la neurobiologie fait de
l’ordinateur le modèle normatif de l’intelligence. En cherchant à s’approprier ce dernier concept, pour réduire
l’esprit humain à une expression imparfaite de ce modèle, les neurosciences revendiquent en même temps
l’exclusivité de l’analyse de la pensée et de l’intelligence, vidant ainsi potentiellement les sciences humaines et
la philosophie de leur légitimité et de leur objet. La rivalité des modèles et de leur légitimité n’amoindrit donc
pas l’impérialisme des sciences naturelles.
10
Descartes, Les passions de l’âme, Article 6.
11
Descartes, Principes de la philosophie, IV 203.
12
Kant, Critique de la faculté de juger, §65.

4
III. Une réduction de l’homme ?
1) L’importation d’une méthode
L’appellation même de sciences humaines reflète l’attraction normative incontestable qu’ont exercée
sur ces savoirs les sciences naturelles déjà constituées. La naissance de la sociologie illustre aussi bien cette
attraction que la difficulté d’appliquer à des faits culturels une méthode élaborée pour interroger la nature. Ainsi
Durkheim entend-il fonder la sociologie à partir d’une règle méthodologique : « les faits sociaux doivent être
traités comme des choses
13
» Dans sa richesse et sa pluralité de sens, cette formule pose tout le problème de la
méthode des sciences humaines. En effet, en un premier sens, elle peut être compris au sens d’un naturalisme
sociologique : il s’agirait de traiter les faits sociaux comme des choses en les objectivant, ce qui, en sociologie,
pourrait vouloir dire en les quantifiant. C’est ainsi qu’on peut comprendre que la statistique soit un outil de base
des investigations sociologiques. Cela aurait pour conséquence que tout fait social ne soit pas quelque chose de
donné mais quelque chose de construit. Plus largement, on aurait ici affaire à des sciences humaines qui
importent des méthodes normatives issues des sciences naturelles : le glissement du concept de milieu, d’origine
biologique vers la sociologie comme milieu social en constitue un symptôme.
Quelle peut être alors la spécificité de la réalité sociale ? Durkheim se défend aussi d’une assimilation
complète de la réalité sociale à la réalité naturelle : « nous ne disons pas, en effet, que les faits sociaux sont des
choses matérielles, mais sont des choses au même titre que les choses matérielles, quoique d’une autre manière »
Quelle est alors la différence ? Il s’agit, dans l’esprit de Durkheim, de rendre la sociologie objective, c’est-à-dire
de la faire échapper au grief de l’arbitraire subjectif de l’introspection : ainsi Durkheim dresse-t-il une analogie
avec la psychologie, pour remarquer qu’un « psychologie objective dont la règle fondamentale est d’étudier les
faits mentaux du dehors », peut constituer le modèle de la sociologie et expliciter le sens de la formule qui dit
qu’il faut traiter les faits sociaux comme des choses.
2) La scientificité des sciences humaines
Il y aurait donc deux façons pour les sciences humaines d’accéder au statut de science : d’un côté, par
l’adaptation de méthodes importées des sciences naturelles. En anthropologie, c’est le point de vue de
Malinowski, pour qui les sciences humaines ont des motivations non scientifiques (un point de vue moral,
esthétique, théologique). Malinowski considère que ces motivations, pour être légitimes, n’en sont pas pour
autant immédiatement scientifiques. Aussi l’adoption de la méthode scientifique, au sens des règles et de la
rigueur de la déduction et de la construction d’une théorie, est-elle doublement indispensable, comme garantie de
l’objectivité d’une part, et comme moyen ou comme méthode de cette fin qui n’est pas elle-même proprement et
directement scientifique.
Il existe une seconde voie, que le point de vue de Lévi-Strauss, toujours sur l’anthropologie,
explicite : les sciences humaines n’ont pas besoin d’une caution d’objectivité, puisque la structure inconsciente
des phénomènes humain garantit, par elle seule, leur objectivité. Aussi la comparaison entre sciences naturelles
et sciences humaines se situe-t-elle sur un autre plan : autant les premières n’ont pas à rougir devant la rigueur et
la cohérence explicatives des secondes, autant elles ne peuvent se targuer de la même efficacité en matière de
prévisions, pas plus d’ailleurs qu’elles ne doivent en avoir l’ambition et la vocation. Lorsque Schopenhauer
reprochait à l’histoire de ne pouvoir prétendre au titre de science du fait qu’elle est condamnée à ramper sur le
terrain de l’expérience immédiate en étant incapable de prévision, il ne la condamnerait irréversiblement que si
la mission de l’histoire était précisément de prévoir, alors que Lévi-Strauss oppose à cette vocation l’idée de
sagesse, c’est-à-dire un dosage plus fin que celui des sciences naturelles entre la volonté de savoir et la volonté
de prévoir. Au-delà de ces questions de méthode, c’est le sort et la position de l’homme qui se jouent : même s’il
est impossible, et même malsain, d’abstraire absolument l’homme des conditions naturelles de possibilité de sa
vie et de son expression, l’irréductible spécificité culturelle de l’homme ne saurait être pour autant écrasée ou
effacée. La fameuse question kantienne « qu’est-ce que l’homme ? » est donc bien au centre des difficultés de la
constitution des sciences humaines.
3) L’objectivation de l’homme
L’existence des sciences humaines pose pour l’homme le problème que posent à la science la
multiplicité des sciences : celui de son unité. Scheler remarque par exemple qu’au moins trois points de vue
peuvent être adoptés sur l’homme (scientifique, philosophique et théologique), dont il constate la mutuelle
indifférence. Donc, « nous ne possédons pas de l’homme une idée qui ait de l’unité
14
» Ainsi, ce n’est pas
comme fait donné que l’homme devient l’objet des sciences humaines, mais c’est à un certain moment de
13
Durkheim, Les règles de la méthode sociologique.
14
Scheler, La situation de l’Homme dans le Monde.

5
l’histoire de la pensée que l’homme s’est constitué comme ce qu’il y a à connaître. L’homme n’a pas toujours été
un objet théorique : il a fallu établir la pluralité et la différence des cultures pour qu’il le devienne.
Il y a donc deux positions de l’homme, qui est « à la fois au fondement de toutes les positivités et
présent, d’une façon qu’on ne peut même pas dire privilégiée, dans l’élément des choses empiriques
15
».
L’homme est donc soit un objet scientifique (au risque de perdre ce qu’il a de spécifique, la culture), soit un être
à peine remarquable dans l’empirie, perdant ainsi son originalité. Le dilemme des sciences humaines est
concentré ici : soit elles sont scientifiques, au risque de déshumaniser leur objet ; soit elles se marginaliseront à
vouloir promouvoir la spécificité de leur objet.
15
Foucault, Les Mots et les Choses
1
/
5
100%