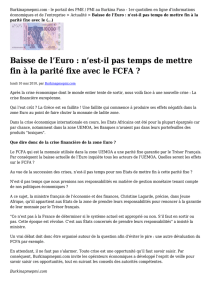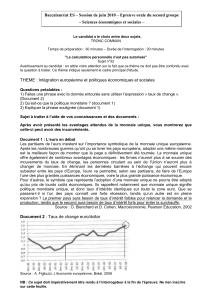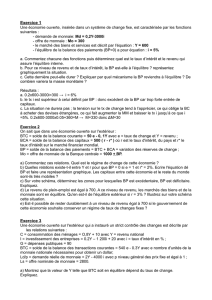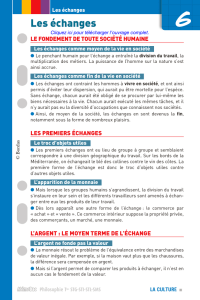MACRO ECO INTERNATIONALE

MACRO ECO INTERNATIONALE
- Echanges de titres fi et de monnaie entre pays = non négligeables
- Macro éco I = étudier fonctionnement global d’une économie ouverte dans une dimension réelle
(B&S) et financière (monétaire)
- Comment les politiques éco aident au bon fonctionnement de l’éco ouverte ?
Ch.1 : LES CONCEPTS DE L’ECONOMIE OUVERTE
2 dimensions de l’ouverture :
- réelle : ouverture des marchés de B&S
- financière : ouverture des marchés fi.
I. Ouverture des marchés :
A. Biens et Services :
- Consommateurs et entreprises choisissent des B&S domestiques ou étrangers : X et M de B&S.
- France : depuis 1929 : part des X et M dans le PIB est passé de 10% à 25-30% en 1999
o Progression continue = surtout depuis 1946 (avant : USA appliquent des tarifs
douaniers)
o ! : sens de ces chiffres :
dépend du niveau de PIB du pays
dépend de la taille du pays et de sa situation géographique : ex : Japon = 10 % vs
Luxembourg = 91 %…
Les petits pays sont plus susceptibles d’être très spécialisés
B. Marchés financiers :
- Choix entre actifs fi domestiques ou étrangers
o Jusqu’à récemment : contrôle des capitaux donc restriction du niveau des actifs étrangers
possédés par les nationaux
o Hoy : +/+ d’échanges fi
- Montant des transactions sur le marché des changes montre l’importance de ces échanges :
o Achat d’actifs fi mène à faire des opérations de change (de même pour les B&S mais =
dans une moindre proportion)
II. Comptabilité nationale en économie ouverte :
A. Identité comptable du revenu national :
- Eco fermée :
o Y = C + I + G
o Revenu national = dépenses des ménages + investissement + dépenses publiques
o Concerne l’achat de biens domestiques
o PIB = somme des VA
- Eco ouverte :
o Y = C + I + G + X – M (ou Q)
o X – Q = balance des transactions courants
o X = consommation étrangères de biens nationaux
o Q = argent revient à l’étranger

B. Balance courante :
- en général on considère : X – Q de B&S
- ! : balance commerciale = différente = X – Q de biens
- Quand la balance courante change, elle fait varier le niveau de production (PIB) donc de l’emploi
= instrument pour l’Etat
- Déséquilibres :
o Déficit de la BTC : quand Q X
Y = C + I + G - BTC
Donc Y C + C + G : revenus domestiques inférieurs aux dépenses domestiques
Hausse de l’endettement extérieur net
Baisse des avoirs extérieurs nets : les dettes des pays étrangers vis à vis de la
nation baissent
o Surplus quand X Q
Y C + I + G
Baisse de l’endettement extérieur net
Hausse des avoirs extérieurs nets : la nation prête aux étrangers
C. Epargne et investissement :
- Epargne = Part de la production (revenu) ne faisant pas l’objet de consommation par le
gouvernement ou les ménages
o Economie fermée :
S = (C + G)
S = I
o Economie ouverte :
S = Y – (C + G)
S = I + BTC
On peut épargner en augmentant le stock de capital (en investissant) ou en
acquérant des avoirs étrangers ie balance des transactions courantes en surplus (X
supérieurs à Q)
III. Balance des paiements :
- enregistre l’ensemble des opérations d’une éco avec le reste du monde
- = établie par BC du pays selon des principes fixés par le FMI (BCE pour la zone euro)
- = constituée de plusieurs comptes
A. Compte des transactions courantes :
- opérations d’exportations et d’importation de B&S
- + revenus des facteurs de production perçus de l’étranger ou versés à l’étranger
- + transferts unilatéraux (argent de travailleurs étrangers envoyés vers leur pays d’origine…)
- Débit = transaction conduisant à un paiement vers l’étranger
- Crédit : transaction conduisant à une recette venant de l’étranger
CREDIT
DEBIT
Exportations de biens et services
Entrées de capitaux
Transferts de l’extérieur
Importations de biens et services
Sorties de revenus
Transferts vers l’extérieur

B. Compte de capital :
- Opérations liées aux achats et ventes d’actifs non financiers, non produits
- Ex : terrains, brevets
CREDIT
DEBIT
Vente d’actifs
= Offre
Achat d’actifs
= Demande
- Solde = O – D : CK
C. Compte financier:
- Opérations liées aux échanges d’actifs financiers et de monnaie
1. Flux financiers hors avoirs de réserve de devises = “mouvements de
capitaux” :
- Achats ventes d’actifs financiers par les secteurs publics ou privés hors BC
- Ex : IDE ou investissements de portefeuille (opération de placement)
CREDIT
DEBIT
Emprunts
Prêts
- CF = emprunts – prêts
- ! : ce n’est pas le compte financier complet
2. Interventions officielles :
- Flux financiers liés aux interventions des autorités monétaires : portent sur les avoirs de réserve : fait
partie des “interventions sur le marché des changes”
CREDIT
DEBIT
Vente de devises
= OD
Achat de devises
= DD
- IO = OD – DD
- Conclusion : BTC + CK + CF + IO = o en principe (sauf erreurs)
- Ex : importations :
CREDIT
DEBIT
Emprunt (compte financier hors avoirs de
réserve) pour régler les importation
Ou vente de devise
Importation (compte de TC)
D. Compte des erreurs et omissions et soldes de la balance des paiements :
- source des données de la balance des paiement = diverses = cause d’erreurs ie la balance ne
s’annulera pas
- Ce compte assure l’équilibre comptable :
- BTC + CK+ + CF + IO + EO = 0 toujours

- En général, quand on parle du solde de la balance des paiements, on fait référence au solde de
la balance globale : BG :
- Différence entre flux financiers monétaires et non monétaires : CF = CF1 + CF2 (CF1 = non
monétaire)
- Solde BG = formé avec tous les soldes intermédiaires non monétaires :
- BG = BTC + CK + CF1 + EO = - IO – CF2
- Ainsi : Elle peut être en déficit ou en excédent
E. Balance des paiements et analyse théorique :
1. Présentation simplifiée de la balance des paiements :
- on néglige CK, EO, CF2 (donc il ne reste que CF1 qu’on appelle CF tout court. La seule banque =
BkC)
- On prend BTC contenant seulement X et Q de B&S voir seulement de biens ie balance commerciale
BC
- IO s’exprime par rapport aux variations de réserve :
- On avait IO = OD – DD des autorités monétaires
- On a –IO = DD – OD = variation des réserves
- donc : BG = BTC (ou BC) + CF = variation des réserves
2. Interprétations :
- comptable :
- BG = forcément équilibrée : BC + CF = variation R traduit le fait que les transactionS réelles
sont forcément composées des transactions financières non monétaires. Si celle-ci ne sont pas
suffisantes on compense avec la variation des réserves
- Economique :
- BG = équilibrée que si variation des réserves nulle ie réserves constantes
- Si variation négative : déficit de la BG
- Vente de devises nationales
- Si variation positive : excédent de la BG
- Demande de devises supérieure à offre de devise : en termes de flux nets, on a des
achats de devises étrangères
- Suppose l’existence de règles de conversion ie de taux de change
IV. Taux de change :
- nominal = correspond aux prix relatifs des devises : permet d’échanger de la monnaie nationale
contre étrangère
- réel = prix relatif des biens issus de pays différents : permet de choisir entre biens nationaux et
étrangers : pas directement observable
A. Taux de change nominal :
- Méthode des termes britanniques ou de cotation au certain :
- Taux de change nominal = prix de la monnaie domestique en monnaie étrangère
- Ex : taux de change de l’euro en $ = 1.2374 $ au 16/01/04
- Méthode des termes européens ou de cotation à l’incertain :
- Taux de change nominal = prix de la monnaie étrangère en monnaie domestique
- Ex : taux de change du $ en euro = 1/1.2374 = 0.81 euros
- On va utiliser celui là = « E »

- Pour les taux fluctuant :
o Appréciation de la monnaie domestique =
hausse de son prix en monnaie étrangère
taux de change baisse car il exprime le prix de la monnaie étrangère en monnaie
domestique : E baisse
o Dépréciation de la monnaie domestique :
Baisse de son prix en monnaie étrangère
Hausse de E
- Pour les taux fixes : décision du gvt
o Réévaluation : E baisse
o Dévaluation : E augmente.
B. Taux de change réel : « e » :
- Taux de change réel bilatéral : entre les biens de deux pays
o Donne le prix des biens étrangers en terme de biens domestique (on peut aussi faire
l’inverse) : nombre de biens domestiques qu’on peut obtenir avec une unité de biens
étrangers
o e = (E . P*) / P
P* = indice des prix des biens étrangers en devise étrangère
E . P = indice des prix des biens étrangers en monnaie domestique
P = indice des prix domestiques en monnaie domestique
Ex : P* = 25, P = 100, E = 2
e = (2 . 25) / 100 = 0.5
avec une unité de bien étranger on peut acheter seulement ½ bien
domestique
1/e = 2 : nombre de bien étranger que je peux avoir avec un bien
domestique.
- = prix relatif : indique la compétitivité d’une économie par rapport à une autre
o plus e = faible, plus les biens sont chers, plus la compétitivité de la nation est faible.
- = indice : pas de niveau optimal : c’est la variation qui a du sens
- variation e = variation E :
o Appréciation réelle :
= hausse du prix des biens domestiques en terme de biens étrangers
or e = prix des biens étrangers en terme de biens domestique
donc e baisse : baisse de compétitivité.
o Dépréciation réelle :
Baisse du prix des biens domestiques en terme de biens étrangers
E augmente : hausse de la compétitivité.
o e = (E . P*) / P :
CT : P* / P = constant : e et E évoluent dans le même sens
Quand P et P* varient au même rythme et dans le même sens : e et E varient aussi
dans le même sens
LT : P varie plus : évolution e et ER = plus divers
o Si P* augmente (inflation) plus rapidement que P : plusieurs cas possibles : ex :
E constant et e augmente
E baisse et e constant : la baisse de E compense la différence de taux d’inflation
entre P et P*
o Théories sur l’évolution des taux de change :
Théorie de la parité des pouvoirs d’achat : évolution à LT des taux de change
réels
Théorie de la parité des taux d’intérêt : évolution à CT des taux de change
nominaux
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%