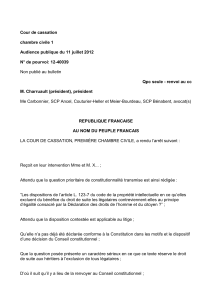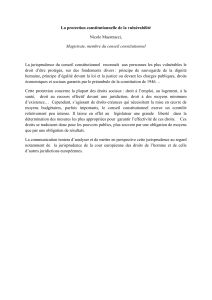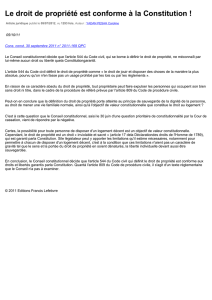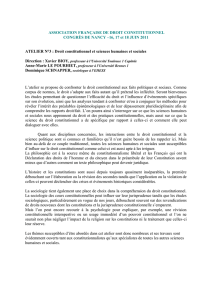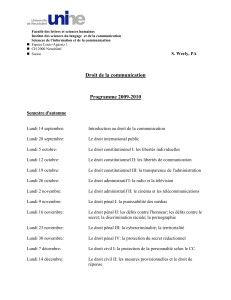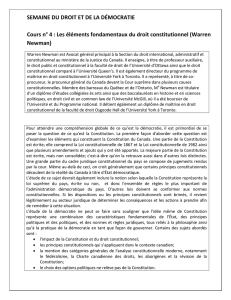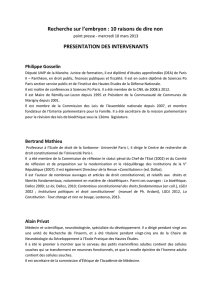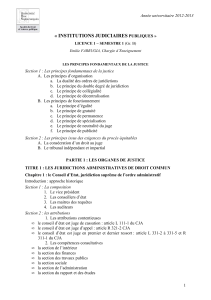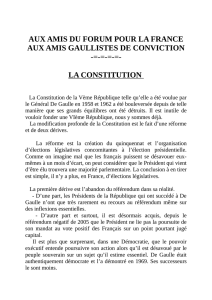Statut_Penal_Chef_Etat - Faculté de Droit de Nantes

1
La portée des décisions du Conseil constitutionnel sur la
jurisprudence de la Cour de cassation : l’exemple des
divergences relatives au statut pénal du Chef de l’Etat
Décision n°98-408 DC du 22 janvier 1999, « Traité portant statut de la
Cour pénale internationale »
Master 2 Droit pénal Faculté de droit - Nantes
Sciences criminelles

2
L’idée d’une irresponsabilité politique du chef de l’Etat est ancienne.
Héritage de la monarchie, certains auteurs estiment qu’elle trouvait sa justification
dans l’adage « le Roi ne peut mal faire ». En réalité elle n’était que la conséquence du
principe selon lequel la personne du Roi est inviolable et sacrée, «elle est la condition de son
hérédité » (J. Barthélemy, P. Duez). Tandis que l’irresponsabilité est le « reflet de la majesté
royale » sous la monarchie, elle devient, avec l’avènement de la République et le
développement du régime parlementaire, la conséquence de l’effacement du Chef de l’Etat.
George Vedel considère que « irresponsabilité et effacement se prêtent un appui mutuel : on
n’a d’autorité que dans la mesure où on assume la responsabilité, on n’est responsable que
dans la mesure où on détient une autorité ». Dans le régime parlementaire, tel qu’institué par
les constituants des IIIème et IVème Républiques, l’irresponsabilité du Chef de l’Etat a pour
corollaire la règle du contreseing ministériel, en vertu de laquelle les membres du
gouvernement sont tenus d’endosser la responsabilité des actes présidentiels. Cette règle est
perçue comme l’un des signes les plus éclatants de la logique parlementaire introduite par ces
deux Constitutions : le Président de la République ne peut agir qu’assisté des ministres, seuls
responsables devant le Parlement. En revanche, sous la Vème République, le Président
dispose d’une autorité accrue et de larges prérogatives. Mais l’irresponsabilité demeure. On
peut toutefois relever l’existence de certains mécanismes de mise en œuvre de la
responsabilité politique du Président de la République comme la procédure de référendum
pour mettre en jeu la responsabilité politique devant le peuple. Cette irresponsabilité
demeurée intacte depuis la Monarchie ne s’entend pas que d’un point de vue politique mais
également d’un point de vue civil et surtout pénal. D’un point de vue civil, le Président de la
République ne peut, pour les actes de sa fonction, être assigné en réparation pécuniaire des
dommages que son activité aurait causés. La notion de responsabilité pénale du chef de l’Etat
est, en revanche, beaucoup plus floue.
Jusqu’à une période très récente, le statut pénal du Président de la République n’a
guère suscité d’intérêt au sein de la doctrine. Examinée souvent en quelques lignes dans les
traités et manuels, la responsabilité présidentielle en matière pénale n’était souvent envisagée
que sous l’angle d’une « hypothèse d’école ». La question a connu un regain d’intérêt depuis
ces vingt dernières années avec la multiplication des affaires politico-financières impliquant
des membres du gouvernement, des élus et même le Président de la République. Quant aux
ministres, les affaires dites du « Carrefour du développement » et du « sang contaminé » ont
suscité de nombreux débats parmi la doctrine, mais l’avortement des procédures a souvent été
ressenti comme une irresponsabilité de fait des ministres à raison d’actes commis dans

3
l’exercice de leur fonction. Ce constat a abouti à la révision constitutionnelle du 27 juillet
1993. L’alinéa 2 de l’article 68 de la Constitution a été modifié et une nouvelle juridiction a
été créée : la Cour de justice de la République, appelée à juger d’anciens ministres.
Pour le Président, la Constitution actuelle définit avec une clarté apparente son statut
pénal qui combine immunité et privilège de juridiction. L’article 68 dispose que « le
Président de la République n’est responsable des actes accomplis dans l’exercice de ses
fonctions qu’en cas de haute trahison. Il ne peut être mis en accusation que par les deux
assemblées statuant par un vote identique au scrutin public et à la majorité absolue des
membres les composant ; il est jugé par la Haute Cour de justice ». La situation ne souffre, a
priori, d’aucune ambiguïté : le Président de la République bénéficie d’une immunité absolue
et perpétuelle pour les actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions hors les cas de haute
trahison où il bénéficie d’un privilège de juridiction (compétence de la Haute Cour de justice).
L’immunité et le privilège de juridiction s’inscrivent dans la tradition républicaine. Déjà sous
la IIIème République on estimait que les actes répréhensibles du chef de l’Etat commis
pendant la durée de ses fonctions faisaient l’objet de procédures d’accusation et de jugement
spéciales définies par les lois constitutionnelles de 1875, lesquelles disposaient que « le
Président de la République n’est responsable que dans les cas de haute trahison » et « le
Président de la République ne peut être mis en accusation que par la Chambres des Députés,
et ne peut être jugé que par le Sénat ».
Toutefois, cette question du statut pénal du Chef de l’Etat jusque là sans équivoque a
été totalement reconsidérée et a fait couler beaucoup d’encre depuis 1999.
Le Conseil Constitutionnel a été saisi le 24 décembre 1998 par le Président de la République
et le Premier Ministre de la question de savoir si une révision de la Constitution était
nécessaire à la ratification du traité de Rome du 18 juillet 1998 portant création de la Cour
pénale internationale.
Dans sa décision n° 98-408 DC du 22 janvier 1999 le Conseil constitutionnel a revu le
régime de la responsabilité du Chef de l’Etat puisqu’il était invité à s’interroger,
conformément à l’article 54 de la Constitution sur la compatibilité de notre Constitution avec
l’article 27 du Statut de la Cour pénale internationale. Cet article intitulé « défaut de
pertinence de la qualité officielle » pose le principe selon lequel le statut « s’applique à tous
de manière égale, sans aucune distinction fondée sur la qualité officielle ». Il ajoute « En
particulier la qualité officielle de chef d’Etat ou de gouvernement…n’exonère en aucun cas
de la responsabilité pénale au regard du présent statut ». Dans son alinéa 2, l’article 27
dispose également que « les immunités ou règles de procédures spéciales qui peuvent

4
s’attacher à la qualité officielle d’une personne, en vertu du droit interne ou du droit
international, n’empêchent pas la Cour d’exercer sa compétence à l’égard de cette
personne ».
Le Statut de la Cour pénale internationale écarte expressément toute protection pénale
dérogatoire accordée par les droits nationaux aux Chefs d’Etat, ministres et parlementaires.
Ces dispositions posent, pourtant, de nombreuses difficultés au regard des immunités et
privilèges de juridiction offerts par notre Constitution à notre personnel politique. Une
analyse précise en était donc nécessaire. Les considérants 15 à 17 de la décision du 22 janvier
1999 sont donc consacrés à l’examen du « respect des dispositions de la Constitution relatives
à la responsabilité pénale des titulaires de certaines qualités officielles ».
Le Conseil a plus particulièrement livré son examen du statut pénal du chef de l’Etat
dans le considérant 16 de sa décision. Il rappelle en une formule assez synthétique le
domaine traditionnel de l’irresponsabilité pénal du chef de l’Etat : il bénéficie d’une immunité
pour les actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions en dehors des cas de haute trahison.
De cette constatation et interprétation de l’article 68, le Conseil déduit que l’article 27 du
Statut de la Cour pénale internationale est contraire au régime dérogatoire ainsi institué. Les
juges ont donc décidé que « l’autorisation de ratifier le traité portant statut de la Cour pénale
internationale exige une révision de la Constitution ».
Un peu moins de trois ans après le juge constitutionnel, la Cour de cassation a eu à se
prononcer sur la question de savoir si le Président de la République peut, en cours de mandat,
être mis en examen ou cité comme témoin à raison d’actes accomplis avant son élection ou en
dehors de ses fonctions officielles ? Au-delà de l’examen du statut pénal du chef de l’Etat, la
Cour de Cassation a clarifié sa doctrine à l’égard de l’autorité dont sont revêtues les décisions
du Conseil Constitutionnel.
L’arrêt de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation fait suite à un pourvoi déposé
le 29 juin 2001 à l’encontre d’un arrêt rendu le même jour par la troisième Chambre de
l’instruction de la Cour d’appel de Paris qui confirmait l’ordonnance des juges d’instruction
dans l’affaire dite de la SEMPAP (Société d’économie mixte paritaire de prestations). Ces
décisions avaient été rendues dans le cadre d’une information contre X concernant plusieurs
irrégularités graves, constatées par le rapport remis par la Chambre régionale des comptes de
l’Ile-de-France au Procureur de la République, et commises dans la passation de certains
marchés publics de la société dont la ville de Paris était actionnaire. A l’époque où s’étaient
produit les faits, M. Chirac était encore maire de Paris. Un contribuable parisien, M.
Breisacher, autorisé par le tribunal administratif à se porter partie civile en lieu et place de la

5
ville avait saisi en novembre 2000 les juges d’instruction d’une requête demandant qu’il soit
procédé à l’audition de M. Chirac. Par une ordonnance du 14 décembre 2000, les deux juges
d’instruction se sont déclarés incompétents pour convoquer le Président de la République en
tant que témoin. Cette incompétence était fondée sur la circonstance que la requête mettait, en
réalité, directement en cause le Chef de l’Etat. En conséquence, conformément à
l’interprétation du Conseil constitutionnel dans sa décision du 22 janvier 1999, l’article 68 de
la Constitution s’opposait à une telle mise en cause.
L’arrêt de la Chambre de l’instruction du 29 juin 2001 confirme l’ordonnance du 14
décembre au motif que, tant l’article 68 que l’interprétation qu’en a fait le Conseil, empêchent
que l’action publique puisse être mise en mouvement à l’encontre du Président de la
République pendant la durée de ses fonctions.
Le requérant a formé un pourvoi en cassation et argué que l’autorité de la chose jugée
par le juge constitutionnel ne peut être opposée dans une affaire qui ne concerne pas le texte
sur lequel s’était prononcé le Conseil mais également que le principe d’égalité devant la loi
impose une interprétation stricte du privilège ou de l’immunité, ce qui devait conduire à
admettre, s’agissant de l’interprétation de l’article 68, une responsabilité pénale du chef de
l’Etat pour les actes accomplis en dehors de l’exercice de ses fonctions.
L’Assemblée plénière de la Cour de Cassation dans son arrêt du 10 octobre 2001 s’est
trouvée confrontée à des difficultés d’interprétation des articles 62 alinéa 2 et 68 de la
Constitution. La Cour estime que « l’autorité des décisions du Conseil Constitutionnel
s’attache non seulement au dispositif, mais aussi aux motifs qui en sont le soutien
nécessaire ». Et conformément aux conclusions du Premier avocat général ajoute que « ces
décisions ne s’imposent aux pouvoirs publics et aux autorités administratives et
juridictionnelles qu’en ce qui concerne le texte soumis à l’examen du Conseil ». Il en déduit
donc que les juridictions de l’ordre judiciaire ne sont pas liées par la décision du 22 janvier
1999 qui a statué sur un texte relatif à la compétence de la Cour pénale internationale.
Sur la question même de la responsabilité pénale du Chef de l’Etat, le Premier avocat
général invitait l’Assemblée plénière a élargir sa réflexion par rapport à l’objet du pourvoi qui
lui était soumis, à savoir la possibilité ou non d’entendre un Chef d’Etat en exercice comme
témoin dans une procédure pénale. Il déclarait que « le problème est celui du degré de
protection qu’il y a lieu d’accorder à la fonction du Chef de l’Etat en général ».
La Cour de cassation rejette le pourvoi dans la mesure où le raisonnement de la
Chambre d’instruction suffit à justifier le refus de demande d’audition du Président Chirac
telle que demandée par le requérant. Pour Régis de Gouttes, « il ne s'agissait donc pas, selon
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
1
/
28
100%