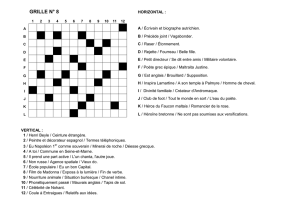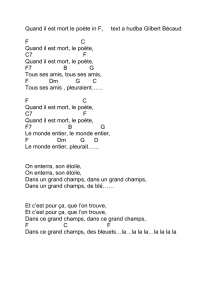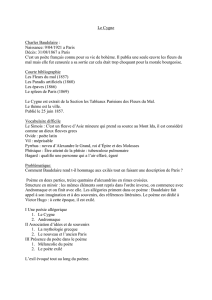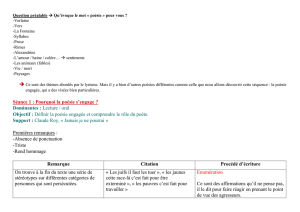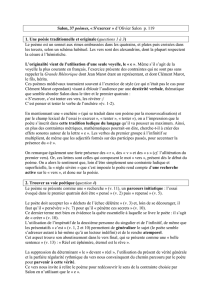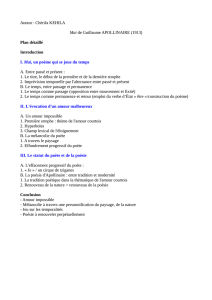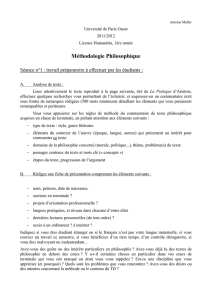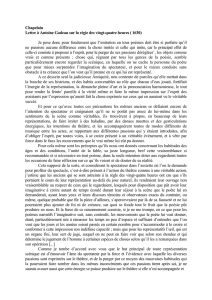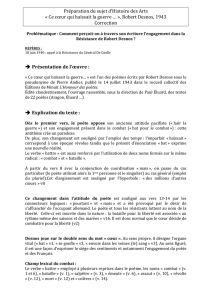Mallarmé « Brise marine

Mallarmé « Brise marine »
Etude de texte
Eléments de biographie : (1842-1898)
Un des poètes maudits
Activité poétique : mode privilégié de création littéraire mais pas différente des autres formes.
« Le monde est fait pour aboutir à un beau livre »
Existence ordinaire, il n’a vécu qu’une aventure intérieure. Professeur d’anglais (Tournon ;
Besançon ; Avignon ; Paris en 1871). Sa destinée littéraire se fait en 22 et 27 ans. Surtout
intellectuelle, il évoque une angoisse physique, un vertige d’inaccessible absolu.
1864 : tragédie Hérodiade
1865 : Le faune, monologue dramatique et 1ère version de l’après midi d’un faune
1873 : Toast funèbre (hommage à T. Gautier). Premier poème « hermétique ». Premier
« tombeau ». Acquiert la notoriété.
Il rédige un magazine féminin La dernière mode à lui seul et adapte des livres d’anglais pour
les classes (activités lucratives)
Il est le chef de file discret du mouvement symboliste.
1880 : les réceptions du mardi, Rue de Rome commencent. Il collabore à des revues, signe des
préfaces, répond à des enquêtes, se livre à des mondanités. Il appartient à une tradition
précieuse.
La jeune génération qui l’entoure se compose de Louÿs, Valéry, Gide, Claudel, Schwab... Il
a l’estime de Zola, Huysmans, l’amitié de Verlaine, Villiers de l’Isle Adam, Mirbeau,
Banville, Manet, Redon, Whistler, Degas.
C’est un wagnérien militant, assidu aux concerts.
Debussy compose le Prélude… en 1891.
Il passe ses derniers étés à Valvins (Fontainebleau)
1887 : Poésies (revu en 1898)
1893 : Vers et prose (florilège)
1897 : Divagation
1897 : Un coup de dé jamais n’abolira le hasard
1920 : Vers de circonstance
1925 : Igitur
Introduction
Personnage d’une grande discrétion, dont la vie n’a rien eu d’aventureux, Mallarmé n’en
est pas moins un écrivain qui a su mener sa recherche esthétique jusqu’au vertige d’un
inaccessible absolu. Chef de file du mouvement symboliste, son travail se distingue par
une grande rigueur où, selon sa volonté, rien n’est laissé au hasard. Souvent qualifiée
d’ « hermétique », son écriture est l’aboutissement d’un travail immense de palimpseste.
Le poème « Brise marine » par son écriture rend compte de la volonté hermétique de son
auteur. Il est aussi un poème qui traite de la difficulté d’écrire et du désir de fuir son
existence. I) Fuir là bas
II) « L’angoisse de la page blanche »
I) Fuir là bas
1) L’ennui du quotidien
Dès le v.1 le poète évoque un ennui profond qui englobe tout ce que l’existence
humaine peut offrir intellectuellement et physiquement : renoncement aux plaisirs du
corps « La chair est triste » c’est à dire qu’il n’y a rien à attendre du plaisir sensuel. La

chair est triste parce qu’elle ne suscite aucun plaisir, parce que c’est déjà une chair en
décomposition.
« et j’ai lu tous les livres » l’esprit s’ennuie lui aussi parce que la littérature n’a plus
rien à lui apporter de nouveau, en tant que lecteur.
On note que la construction de ce vers lui donne une portée considérable, tout d’abord
parce qu’il se termine par un point, c’est à dire qu’il s’agit d’un jugement définitif
(comme un aphorisme).
On note aussi le rythme dans le 1er hémistiche avec l’exclamation « hélas » qui rompt la
régularité du vers et tend à le ralentir.
Noter aussi l’allitération en [ l ].
Dans la suite du poème, nous relevons une énumération de tout ce que le poète renie.
[Pour comprendre ce passage il faut lire les vers 4-6-8 puis le v.5 auquel les trois
précédents se réfèrent comme le montre l’énumération « ni…ni »]
Le v.4 commence par l’adverbe « Rien » qui placé en anaphore accentue le refus qui suit.
Ce que le texte met en valeur, c’est le vide de la négation. Noter ici la rime interne [jo]
vieux/yeux qui associe les deux termes et insiste sur l’idée que l’un est reflété par l’autre +
« rien » [rj ]
Puis les v.4/6/8 détaillent tout ce qui n’est pas capable de retenir l’auteur et qui appartient
à l’univers quotidien et familier. Ce sont tout d’abord les lieux familiers « les vieux
jardins » (à moins que cela n’évoque les idées trop bien connues de l’autre et que l’on voit
se refléter c’est à dire se deviner dans son regard) v.4, puis les autres « les yeux » v.4 puis
la famille « la jeune femme allaitant son enfant » v.8. Noter à ce sujet l’allitération en [f]
(harmonie de l’image).
2) Une fuite en avant
Face à cet environnement trop bien connu qui n’apporte plus aucune joie, aucune émotion,
le poète ne trouve qu’une seule issue : la fuite. C’est ce qui apparaît dès le v.2. dans le
premier hémistiche avec le verbe exclamatif « fuir » répété. Le double emploi de
l’exclamation donne au vers une tonalité incantatoire. Le départ de trouve de nouveau
évoque au v.9 avec le verbe « je partirai » également à la forme exclamative (forte valeur
émotionnelle).
Le poète exprime le désir d’aller vers un ailleurs non déterminé « là-bas ». Cet ailleurs
espéré apparaît au début du poème très vague. Dans le second hémistiche du v.2 le poète
indique que c’est celui vers lequel « des oiseaux » s’en vont. Tandis que le v.3 évoque
« l’écume inconnue » et « les cieux ». Que ce soit le déterminant « des », l’adjectif
« inconnue » ou les « cieux » au pluriel cette description nous apparaît volontairement
imprécise.
On note cependant l’harmonie de la description avec une assonance en [y] v.3,
l’allitération en [m].
On remarque également que la césure intervient au milieu du mot « écume » qui ne fait
que renforcer l’impression d’un mélange entre le haut et le bas ciel et mer.
Au fil du texte cet ailleurs prend une connotation plus exotique et définitivement marine
cf. titre « brise marine ». A cet égard les v.9 et 10 évoquent un départ en mer à bord d’un
« steamer » le terme anglais remplissant ici plus ou moins une fonction « exotique » v.10.
Le rythme du v.9 par l’allitération régulière en [t] et [r] semble imiter le mouvement de
balancement du bateau.
Le v.10 fait appel à un ailleurs stimulant pour l’esprit comme le révèle l’expression
« stimulante nature ». On note dans ce vers l’allitération en [l] puis en [n] qui conforte
cette impression harmonieuse.
3) Le désir de fuite est tentant mais dangereux

Dans les v. 13 14, le poète évoque la dangerosité du voyage, « orages » et « naufrages »
se trouvant tout de même à la rime. A cet instant le poète doute du bien fondé de son
départ. Il évoque ici concrètement l’échec de son entreprise.
Au v.15 le poète imagine les conséquences funestes de ce naufrage. Il évoque ici la perte
de tout point de repère. Les « fertiles îlots » aux connotations doublement positives
renvoient à la terre ferme, le lieu où l’on peut jeter l’ancre, reprendre souffle. Quant à
fertile sa connotation est à la fois positive et rassurante. De même « le mât » apparaît
comme l’ultime point d’appui, celui auquel le naufragé s’accroche en mer. Cependant,
tous ces éléments sont refusés au poète par différents procédés grammaticaux de la
négation. On note l’emploi de la négation « ni » qui termine l’énumération de tout ce qui
est absent ainsi que la répétition de l’expression « sans mât » à la limite du désespoir (le
langage en boucle indice de l’émotion dominante). Enfin les points de suspension à la fin
du vers allongent le temps de diction et intensifient l’aspect aléatoire de l’expédition.
II) « L’angoisse de la page blanche »
1) Déception intellectuelle et illusion suprême :
Nous l’avons déjà vu : ce poème s’ouvre par l’aveu d’une déception intellectuelle dans le
second hémistiche du 1er vers « et j’ai lu tous les livres ». Il s’agit donc ici d’effectuer une
double lecture du poème qui n’évoque pas seulement comme nous l’avons montré le
besoin d’un homme à partir loin des siens pour rencontrer l’aventure mais aussi le désir
d’un écrivain, d’un poète à appréhender de nouvelles contrées littéraires de nouveaux
espaces intellectuels. Or le constat de départ à cet égard est bien celui de la lassitude,
de l’ennui.
Au fil du texte, le poète se fait plus pessimiste. Il en vient à se demander si ce n’est pas
son ennui qui le conduit à se figurer la fuite comme une chance d’être sauvé. C’est ce que
nous relevons aux v.11 12. Ici le poète se demande si le départ, la fuite ne sont pas
qu’illusion : « un Ennui […] croit encore à l’adieu ». On remarque dans ces deux vers que
le mot ennui est en majuscules et en apposition ce qui ne fait que renforcer son impact
dans le texte. L’adjectif « désolé » qui suit convient d’ailleurs aussi bien au poète qu’au
mot ennui lui-même isolé du reste du vers. On remarque également dans ce vers
l’oxymore « cruels espoirs » qui souligne la douleur ressentie par celui qui se sait la
victime de ses illusions. Le poète sent qu’il se confine peut-être dans ses illusions et que
le départ du v.12 « l’adieu suprême des mouchoirs » n’est qu’une croyance vaine
« Croit encore » v.12.
On remarque ici la reprise sonore en [wa] avec « croit » de la rime espoirs/mouchoirs. On
note aussi la position en contre rejet interne de « suprême » mis en valeur.
On note enfin le point d’exclamation qui marque peut-être une distanciation une ironie vis
à vis de lui-même.
2) La lutte de l’écrivain contre la page blanche
Aux v.6 et 7, le poème devient tout à fait explicite. C’est parce qu’il ne parvient pas à la
création littéraire que le poète tente de fuir.
On note ici une opposition entre l’obscurité extérieure « nuit » et la blancheur ou la
lumière à l’intérieur : « clarté », « lampe », papier », blancheur ».
Il est important de remarquer que les connotations ont ici une valeur inverse à celle que
leur prête le sens commun. En effet, c’est le blanc et le clair qui sont synonymes
d’angoisse, qui sont connotés négativement. On le voit par deux expressions : « clarté
déserte » et « vide papier ». La notion de vide ou de désert renvoie bien entendu à la
difficulté de créer, à l’angoisse de la page blanche.

Le texte personnifie cette blancheur au v.7 ce qui donne l’impression avec l’emploi du
verbe « défend » d’une lutte entre le poète et sa feuille. Celle-ci l’empêcherait de la
noircir, c’est à dire de l’emplir de son contraire, de la nuit même noire comme l’encre.
Dans cette optique le v.4 et plus particulièrement l’anaphore « rien » renvoie aussi à l’idée
de vide, de négation. On peut être tenté de penser qu’il s’agit déjà du vide de la feuille.
3) L’appel impérieux
A partir de ce constat, finalement assez simple à faire dans la mesure où le poème fournit
la clé de cette seconde lecture, nous sommes amenés à interpréter d’une nouvelle façon
un certain nombre d’éléments du texte.
A deux reprises encore le texte évoque l’acte d’écriture. Nous le voyons tout d’abord au
v.5 par l’expression « ce cœur qui dans la mer se trempe ». Par une métonymie, le
poète se représente par son cœur. Or ce cœur se trempe dans la mer. Cela symbolise la
plume que l’on trempe dans l’encrier. Le poète a besoin de la mer pour retrouver sa
puissance créatrice. Autrement dit, la mer est l’encrier dans lequel il se trempe pour
parvenir à l’écriture.
Au v.13, le texte évoque « les mâts invitant les orages ». Cette phrase peut se
comprendre ainsi : les mâts sont le symbole des crayons et s’ils font appel aux orages, ce
sont les orages intellectuels, c’est à dire les manifestations violentes de l’écriture (qui
peuvent être propices ou néfastes).
Reste le v.16. Il nous intéresse tout d’abord par sa construction. En effet le verbe
« entends » se trouve en contre rejet interne et donc par là même est mis en valeur. Le
poète entend un chant. Ici la référence poétique est totalement évidente. Le poète juge
que le danger quel qu’il soit (danger de partir concrètement ou danger de se plonger dans
une création littéraire traumatisante parce que difficile) vaut la peine d’être affronté. Il
reste une dernière image surprenante. On est habitué au chant « enchanteur » des sirènes,
or ici il s’agit du chant des matelots. L’image plus virile permet d’exclure toute
connotation de séduction féminine dans le désir de partir. Ce n’est que le goût de
l’Aventure et non d’une aventure.
Conclusion
Nous avons ici un poème qui évoque la fuite, le désir de partir à l’aventure face à la
difficulté de vivre, à la difficulté d’écrire. Le poète rêve de partir, il rêve d’un voyage qui
le libèrerait à jamais des contraintes de l’existence souvent insupportables.
Le poème se signale par une grande unité phonétique et son étude permet de mieux
comprendre le travail sémantique immense de Mallarmé sur son œuvre.
Dans cette mesure, on peut dire que « Brise marine » est une œuvre symboliste car sa
lecture est multiple. La pensée de Mallarmé n’y est jamais expliquée mais toujours
esquissée. Nommer un objet, c’est supprimer les trios quarts de la jouissance du poème
qui est faite de deviner peu à peu : suggérer, voilà le rêve…Il doit toujours y
avoir une énigme en poésie et c’est le but de la littérature.
Mallarmé : Réponse à une enquête de J.Huret
[possibilité de comparaison avec le texte de Nerval : le voyage du poète est tout autant
réel que littéraire. La différence est que chez Nerval l’inspiration est symbolisée par une
figure féminine, ce qui ,n’est pas du tout le cas ici.]
[C. Durand Degranges [email protected]]
1
/
4
100%