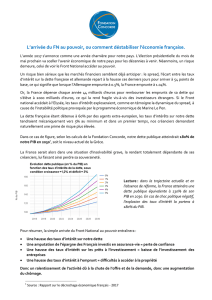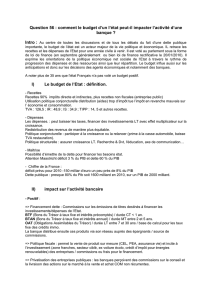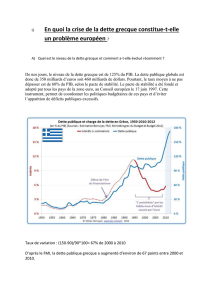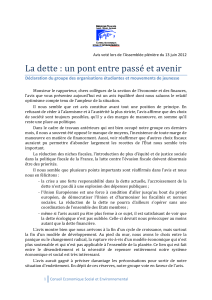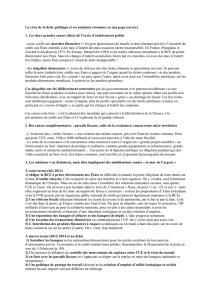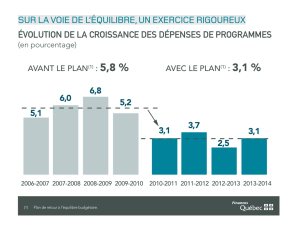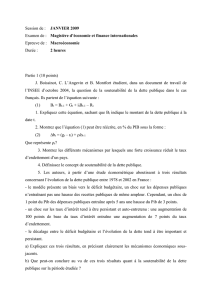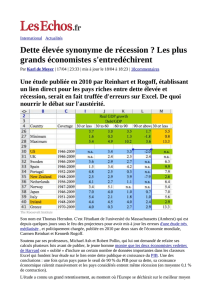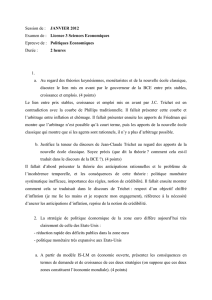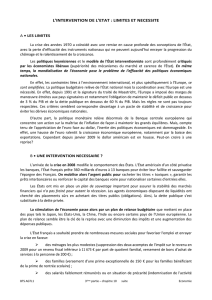État social et théorie post-keynésienne

État social et théorie post-keynésienne
Marc Lavoie, Université d’Ottawa
Résumé
Ce texte aborde le quatrième pilier de l’État social, les politiques de soutien à l’activité et à
l’emploi. Les économistes postkeynésiens contemporains soutiennent les principes de finance
fonctionnelle mis de l’avant par Abba Lerner (1943), dont les fondements sont solidifiés par l’analyse
postkeynésienne du processus de création monétaire et de détermination des taux d’intérêt. Certains
postkeynésiens proposent aussi un programme d’employeur de dernier ressort.
Summary
This paper deals with the fourth feature of the social State – the policies that sustain economic
activity and employment. Contemporary post-Keynesian economists generally support the principles
of functional finance that were proposed by Abba Lerner (1943). These principles now benefit from
better foundations, thanks to the current post-Keynesian analysis of the monetary creation process and
of interest rate determination. Some post-Keynesians also endorse employer of last resort policies.
1. INTRODUCTION
Christophe Ramaux (2006, p. 297) définit l’État social par la présence de quatre piliers « que sont
la protection sociale, le droit du travail, les services publics et les politiques de soutien à l’activité et à
l’emploi ». C’est surtout ce quatrième pilier que je vais aborder dans le cadre de ma présentation des
théories postkeynésiennes justifiant des politiques budgétaires et monétaires expansionnistes.
Le message postkeynésien est simple, voire simpliste. Selon Sheila Dow (1990, p. 354), citant
Geoff Harcourt, la vision des économistes postkeynésiens est « de transformer le monde pour en faire
un meilleur endroit pour les hommes et les femmes ordinaires, de construire une société plus juste et
plus équitable ». C’est un objectif des plus louables, mais certains pourraient objecter que c’est aussi
l’objectif de toutes les écoles de pensée en économie, ou presque. Comment parvenir à cet objectif?
Les économistes postkeynésiens croient que c’est en poursuivant l’objectif du plein emploi, un plein
emploi qui va au-delà du niveau d’emploi compatible avec le prétendu taux de chômage à inflation
stable (TCIS). Ce qui distingue particulièrement les économistes post-keynésiens c’est leur croyance
que le problème du chômage est essentiellement un problème lié à l’insuffisance de la demande
effective, et que cette insuffisance relève autant du long terme que du court terme. L’insuffisance de la
demande globale peut se manifester autant par une insuffisance chronique (liée à des esprits animaux
insuffisants, une politique budgétaire trop restrictive, un solde commercial systématiquement
déficitaire) que par une insuffisance structurelle, associée notamment aux changements et au progrès
techniques.
C’est en créant les conditions compatibles avec le plein emploi que le gouvernement va le plus
contribuer à transformer le monde pour en faire un meilleur endroit pour les gens ordinaires. Le plein
emploi va assurer davantage d’équité dans la répartition des revenus; il va réduire la pauvreté, car le
chômage frappe surtout les citoyens dont les revenus sont les plus faibles; il va favoriser le progrès
technique et donc la hausse du pouvoir d’achat des gens ordinaires; il va engendrer un rapport de force
qui va être favorable aux trois autres piliers de l’État social.

État social et théorie post-keynésienne
2
2. QUELQUES GÉNÉRALITÉS
Sous de nombreux aspects, les postkeynésiens ne sont pas très éloignés des positions défendues
naguère par les premiers keynésiens. Les postkeynésiens sont favorables à des politiques monétaires
de taux d’intérêt bas; certains auteurs pensent même que ces taux devraient être totalement
déconnectés des politiques anti-inflationnistes, et qu’en termes réels ou même en taux nominaux, ils
devraient rester approximativement constants, déterminés par des considérations de répartition du
revenu, les taux directeurs fixés par les banques centrales ne devant refléter que des taux justes, c’est-
à-dire des taux qui procurent un gain raisonnable aux rentiers ou aux prêteurs, en proportion avec le
taux de croissance de la productivité du travail.
Les postkeynésiens sont également favorables à des politiques budgétaires expansionnistes,
n’hésitant pas à promouvoir des déficits budgétaires si ceux-ci sont nécessaires pour lutter contre le
chômage, ou à promouvoir des dépenses d’infrastructures – les investissements publics – afin
d’améliorer les services publics et accroître la productivité du secteur privé (autoroutes, TGV, internet,
etc.). Autrement dit, les postkeynésiens voient l’investissement public comme un moteur de la
croissance (Seccareccia 1995). Les postkeynésiens sont aussi favorables à la présence de grandes
entreprises publiques faisant concurrence à des entreprises privées. De fait les gouvernements
devraient toujours avoir une liste de projets d’infrastructures, prêts à être mis en route, dès qu’il y a
ralentissement de l’économie nationale (et non lorsque les recettes de l’État augmentent, en situation
de boom, et semblent permettre le financement du projet).
Même si les organisateurs du colloque veulent éviter un « positionnement en négatif par rapport à
la théorie néoclassique dominante», il pourrait être utile de rappeler ce qui constitue la « pensée
unique » des politiques budgétaires. Chacune des propositions énoncées ici est rejetée par les
économistes postkeynésiens. Ces assertions de la théorie économique dominante, qui est aussi celle
qui semble s’être imposée dans le monde politique, sont les suivantes, telles que définies par Nell
(1988, p. 212-3) :
Tableau 1 : Les vérités de la pensée unique
Les déficits budgétaires …
Entraînent l’élévation des taux d’intérêt
Causent l’inflation
Évincent l’investissement privé
La dette nationale …
Alourdit injustement le fardeau des générations
futures
Pourrait mener à la faillite de l’économie
nationale
Devra être remboursée un jour
Les dépenses gouvernementales …
Sont improductives
Sont trop élevées
Encouragent la paresse des gueux
Les impôts …
Sont trop élevés
Découragent l’ardeur au travail et
l’entrepreneurship

3
Réduisent l’épargne, et donc la croissance
Source : Nell (1988, p. 212-3)
Je ne dirai rien ou presque rien des mythes concernant les dépenses gouvernementales et les
impôts. De toute évidence, dans un monde keynésien où c’est l’investissement qui détermine
l’épargne, et non l’inverse, l’affirmation que des taux d’imposition élevés réduiraient les taux
d’épargne et donc la croissance n’a aucun sens.
Venons en donc rapidement aux mythes relatifs au déficit budgétaire et à la dette publique. Les
postkeynésiens récusent la relation positive entre taux d’intérêt et déficit budgétaire. Selon les
postkeynésiens, les taux d’intérêt sont entièrement déterminés par les décisions de la banque centrale.
Les relations de Kalecki montrent aussi que les déficits budgétaires mènent à la hausse des profits des
entreprises : il ne saurait donc être question d’un effet d’éviction. Pour ce qui est de la relation entre
déficit budgétaire et inflation, habituellement justifiée par la monétisation du déficit, cette relation ne
peut être qu’indirecte selon les postkeynésiens puisque, selon ceux-ci, il ne peut jamais y avoir de
monnaie excédentaire; par contre, si le déficit budgétaire aide à relancer l’activité économique, il
pourrait activer des forces inflationnistes, comme l’indiquerait la relation de la courbe de Phillips.
Les post-keynésiens ne voient pas nécessairement la dette publique d’un mauvais œil. La dette
nationale a pour contrepartie les actifs (bons du Trésor, obligations gouvernementales) détenus
directement par les ménages ou indirectement à travers les institutions financières. Sans dette
nationale, les institutions financières ne disposeraient d’aucun actif dont le risque de défaut est
virtuellement nul. La dette publique ne constitue pas nécessairement un fardeau pour les générations
futures, puisque ces générations vont aussi hériter des revenus en intérêt associés à cette dette. Enfin,
comme c’est le cas de la dette des entreprises privées, il n’est aucunement nécessaire que la dette
publique soit un jour remboursée.
Sur toutes ces questions, les économistes postkeynésiens ont un point de vue très voisin de celui
développé par Abba Lerner (1943, 1944), dans le cadre de ce qu’il a appelé la finance fonctionnelle,
par opposition à la finance saine (voir Nell et Forstater 2003). C’était aussi le point de vue d’un certain
nombre d’économistes keynésiens, comme Paul Samuelson, jusque dans les années 1960. Pour Lerner,
comme pour les postkeynésiens, le niveau exact de la dette publique, des dépenses publiques ou des
impôts est déterminé par l’objectif que la société veut bien se donner. Si l’objectif est le plein emploi,
il est possible que les décisions des agents du secteur privé, entreprises ou ménages, soit telles qu’un
ratio dette/PIB élevé soit requis pour réaliser cet objectif. Le ratio dette/PIB, ainsi que le niveau du
solde budgétaire, ne peuvent être en soi des objectifs; ils ne peuvent être que des instruments.
3. QUELQUES PRÉCISIONS
3.1 Dette publique et demande effective
Selon certains auteurs hétérodoxes, y compris certains postkeynésiens comme Palley (1998) ou des
auteurs classico-marxistes comme Moudud (2002), les déficits publics auraient des effets favorables
sur la demande effective dans le court terme, comme l’affirment traditionnellement les keynésiens,
mais par contre leurs effets seraient négatifs dans le long terme. Deux types d’arguments sont avancés
par ces auteurs. Selon Moudud, puisque les déficits publics réduisent le taux d’épargne national, ils
réduisent le taux de croissance garanti de Harrod; ainsi le taux de croissance réalisé à long terme devra
s’ajuster à ce taux de croissance garanti réduit, et donc malgré les effets positifs de court terme, les
effets négatifs du déficit budgétaire finiront par surpasser les effets positifs transitoires. Encore
faudrait-il démontrer que le taux de croissance réalisé va s’ajuster au taux de croissance garanti, plutôt
que l’inverse, ce qui était précisément la réponse des premiers postkeynésiens, Joan Robinson et
Nicholas Kaldor, aux conséquences en termes de taux de croissance garanti de Harrod.

État social et théorie post-keynésienne
4
Quant à lui, Palley argumente, dans le cadre d’un modèle reposant essentiellement sur les identités
de la comptabilité nationale de Kalecki, que suite à l’augmentation de la dette publique, le
gouvernement sera éventuellement dans l’obligation d’engendrer des soldes budgétaires primaires ou
opérationnels positifs (le solde avant paiement des intérêts sur la dette). Ainsi, toujours selon Palley,
dans le long terme, les effets positifs sur les profits des entreprises des flux de déficits budgétaires
seront complètement annihilés par les effets négatifs dus au stock de dette existant. La façon la plus
simple de modéliser cet effet est de postuler que le gouvernement décrète que le niveau de dette
publique va rester à tout jamais constant, autrement dit que le gouvernement s’impose une contrainte
budgétaire forte, en s’imposant dorénavant un déficit zéro. Dans ce cadre, le solde primaire doit
exactement compenser les paiements en intérêts sur la dette, et il est alors exact de prétendre que les
déficits passés auront un effet négatif sur les profits des entreprises d’aujourd’hui, avec tous les effets
négatifs que ces profits réduits pourraient engendrer pour l’investissement et éventuellement la
croissance.
Mais ces résultats peuvent être complètement inversés si l’on suppose que le gouvernement accepte
de laisser croître le déficit au même taux que l’économie (autrement dit le gouvernement accepte de
conserver un ratio déficit/PIB constant). Dans ce cadre, développé par Lavoie (2003), les déficits
accumulés dans le passé, autrement dit la dette publique, auront des effets favorables sur les profits des
entreprises, même à long terme, pourvu que le taux de croissance de l’économie soit supérieur au
produit du taux d’intérêt net d’impôt et du taux d’épargne des rentiers. Donc, même pour une vaste
plage de taux de croissance inférieurs au taux d’intérêt brut, les effets à long terme des déficits
budgétaires resteront positifs.
Un modèle kaleckien plus sophistiqué et complet, celui de You et Dutt (1996), confirme ces
résultats. You et Dutt construisent une extension du modèle de croissance kaleckien canonique de
Bhaduri et Marglin (1990), en y introduisant un taux de taxation différencié sur les salaires et sur les
profits et intérêts. Les dépenses gouvernementales d’opération (excluant le service de la dette) sont
fixées comme une certaine proportion du stock de capital ou de l’output. Leur modèle a plusieurs
caractéristiques intéressantes.
Tout d’abord, dans un monde où le taux de croissance du capital dépend du taux d’utilisation de la
capacité, le rapport dette publique/capital, ou autrement dit le ratio dette publique/PIB, s’il peut
s’accroître, ne peut exploser indéfiniment. Autrement dit, ou bien le ratio dette/PIB diminue
inexorablement, ou alors il converge vers une valeur positive. Si le modèle kaleckien est une
représentation adéquate du monde réel, il n’y a donc pas lieu de s’inquiéter que le ratio dette/PIB
explose par suite de politiques budgétaires qui seraient démesurément expansionnistes.
De fait, l’augmentation de la part des dépenses publiques opérationnelles par rapport au PIB
n’entraînent pas nécessairement une augmentation du ratio dette/PIB de long terme. Il est possible, en
particulier lorsque ce ratio est déjà élevé, que l’augmentation des dépenses publiques mène à une
baisse du ratio dette/PIB de long terme, en raison notamment des effets accélérateurs qui pourraient
générer une réduction du ratio déficit/PIB. Quoi qu’il en soit, même si l’augmentation de la proportion
de dépenses publiques devait mener à une hausse du ratio dette/PIB de long terme, ce qui selon You et
Dutt (1996 , p. 343) est le cas le plus probable, cette hausse serait limitée, comme on l’a déjà dit.
Quand aux effets sur le taux d’accumulation de l’économie, ils seraient normalement positifs, mais on
ne peut exclure le cas où, en raison de la réduction paradoxale des paiements sur la dette, les effets sur
le taux d’accumulation d’une augmentation des dépenses publiques pourraient être négatifs à long
terme.
3.2 Dette publique et effets de répartition
You et Dutt (1996) démontrent aussi que la hausse des dépenses publiques, ou la baisse des taux de
taxation, ne mène pas nécessairement à un accroissement de la part du revenu personnel net allant aux
mains des rentiers (les récipiendaires de profits et de versements en intérêt). Il est tout à fait possible
que la part des revenus personnels nets versés aux salariés augmente, à court terme bien sûr en raison

5
de l’effet multiplicateur, mais aussi à long terme, malgré la hausse du ratio dette/PIB. Ainsi il n’est pas
exact de prétendre que la hausse du déficit gouvernemental, et donc la hausse subséquente des
paiements en intérêt sur la dette dont vont bénéficier les rentiers, va être financée par les impôts
prélevés sur les salaires.
Cette question, qui relève de la distribution intergénérationnelle du fardeau de la dette, est aussi
abordée de façon astucieuse par Pasinetti (1996). Celui-ci définit ce qu’il appelle le « fardeau social »
de la dette publique. Ce fardeau, à supposer que le gouvernement tienne à conserver le ratio dette/PIB
(D/Y) à son niveau actuel, dans une économie qui croît au taux réel g, tandis que le taux d’intérêt réel
est i, est défini comme étant : f = (i-g)D/Y. C’est que, pour conserver le ratio dette/PIB constant, l’État
peut se permettre un déficit de gD par année, tandis que les paiements en intérêt sont de iD. Le solde
primaire nécessaire est donc (i-g)D. Ceci implique que, en sus des dépenses d’opération financées par
taxation, le solde primaire (i-g)D doit lui aussi être financé par imposition, ce qui signifie un taux de
taxation supplémentaire f = (i-g)D/Y, qui constitue le fardeau social de la dette publique. S’il n’y avait
pas de dette, ce montant n’aurait pas à être financé par la taxation.
Il est dès lors évident que le fardeau social de la dette publique dépend de la relation entre le taux
de croissance et le taux d’intérêt de l’économie. Quand i = g, le fardeau social est nul. Quand i > g, le
fardeau social est d’autant plus élevé que le ratio dette/PIB est élevé, ce qui est le cas généralement
considéré comme pertinent. Pour maintenir le ratio dette/PIB à un niveau constant, le gouvernement
doit alors opérer avec un solde primaire positif, précisément égal à (i-g)D. Dans ce cas, on peut dire
que les déficits des années antérieures constituent un fardeau social pour les générations présentes,
puisque le taux de taxation moyen, pour éviter que le ratio dette/PIB ne s’accroisse, doit être accru de
f. Par contre, quand i < g, ce qui est un cas tout à fait réaliste, le fardeau social de la dette publique est
négatif. Comme le dit Pasinetti (1996, p. 163), « La communauté bénéficie d’un subside, ou si vous
préférez, d’une taxe négative. Ceci peut sembler paradoxal, mais nous devons réaliser que plus élevé
est le niveau de la dette publique plus élevé est le déficit … que le gouvernement peut se permettre
sans empirer le ratio D/Y. Autrement dit, le taux d’imposition négatif – c’est-à-dire le taux de subside
– pour la communauté dans son ensemble est d’autant plus élevé que le ratio (stabilisé) D/Y est
élevé. »
Vu sous cet angle, les politiques monétaires anti-inflationnistes qui ont engendré des taux d’intérêt
réels de 5 à 10% dans les années 1980 et 1990 paraissent totalement aberrantes. Non seulement ces
politiques ont-elles freiné l’activité économique et créé du chômage, mais en plus elles ont imposé un
fardeau social excédentaire parfaitement inutile à la collectivité. Ceci s’est traduit soit par
l’augmentation des taux effectifs d’imposition soit par une diminution des services publics. Tandis que
ce fardeau social était, inexistant, puisque négatif en moyenne, sur la période entre 1945 et 1979 pour
la plupart des pays de l’OCDE ou en tout cas pour les États-Unis et le Canada (Fullwiller 2006;
Stanford 1999, p. 189), il a subi une hausse vertigineuse en raison des politiques discrétionnaires des
banques centrales.
Selon les économistes néoclassiques, les taux d’intérêt dépendent uniquement des relations entre
offre et demande de fonds prêtables, et donc le fardeau social dépend en grande partie de facteurs qui
sont hors de contrôle des gouvernements. Au mieux, les États peuvent aider à garder les taux d’intérêt
à de bas niveaux en pratiquant l’austérité budgétaire, en réduisant leurs déficits budgétaires et leur
dette publique. Dans les faits, nous savons qu’il n’en est rien. Suite au krach boursier de l’après 2000,
les États-Unis ont opéré avec de gigantesques déficits budgétaires, tout en gardant les taux d’intérêt à
des niveaux relativement bas. Et que dire de la situation du Japon, où le rapport dette/PIB a grimpé de
façon vertigineuse au cours des derniers 15 ans, dépassant largement les 100%, pendant que la Banque
du Japon conservait les taux d’intérêt à court terme à zéro, tandis que les taux d’intérêt à long terme
avoisinaient à peine les 2%.
Ces observations du monde réel sont en revanche tout à fait compatibles avec la théorie
postkeynésienne des taux de l’intérêt, selon laquelle les taux d’intérêt à court terme sont sous le
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
1
/
14
100%