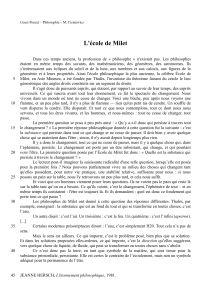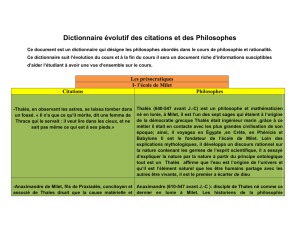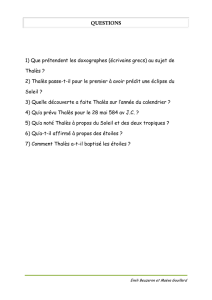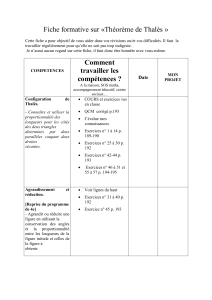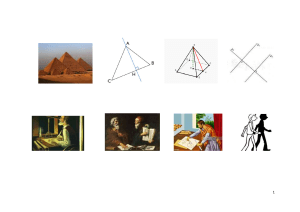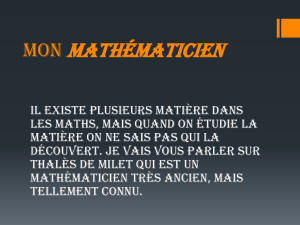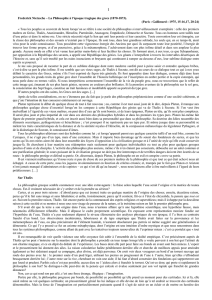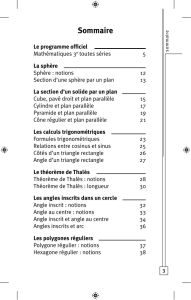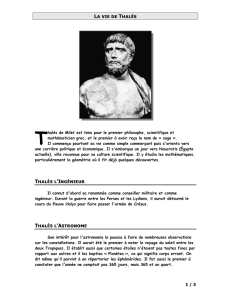File

Les Présocratiques
« Dans les temps anciens, la profession de « philosophe » n’existait pas. Les philosophes
étaient en même temps des savants, des mathématiciens, des géomètres, des astronomes. Ils
s’intéressaient aux éclipses du soleil et de la lune, aux nombres et aux calculs, aux figures de
la géométrie et à leurs propriétés. Ainsi l’école philosophique la plus ancienne, la célèbre
Ecole de Milet, en Asie Mineure, a été fondée par Thalès, l’inventeur du théorème faisant du
cercle le lieu géométrique des angles droits construits sur un segment de droite. Il s’agit donc
de puissants esprits, qui étaient, par rapport au savoir de leur temps, des esprits universels. »
1
1
Jeanne Hersch, L’étonnement philosophique, Gallimard, Folio, Paris, 1993, p. 11

I. Les Ioniens ou les Milésiens
I.1 Thalès de Milet
I. 1. 1 Biographie
I. 1. 2 La marque du génie
« D’après les récits en cours chez les Grecs, c’est Thalès le Milésien qui rendit possible le
passage de l’armée de Crésus. D’après les rumeurs, Crésus aurait été emprunté pour faire
passer la rivière à son armée, car ces ponts n’existaient pas encore à l’époque ; Thalès qui se
trouvait au sein de l’armée, aurait dévié le cours de la rivière qui coulait à gauche de l’armée
et fait en sorte qu’elle coule aussi à droite. Il s’y prit de cette manière : en amont de l’armée, il
fit creuser un profond canal auquel il donna la forme d’un croissant, de sorte que l’eau coule
autour du site où l’armée campait ; de cette façon, la rivière se trouvait détournée de son lit
par le canal et après avoir contourné le camp, retrouvait son ancien lit. Le résultat fut qu’une
fois la rivière divisée en deux, chacun des bras pouvait être passé à gué. »
2
« On rapporte qu’une espiègle et mignonne servante thrace se serait moquée de Thalès pour
être tombée dans un puits alors qu’il observait les étoiles et regardait en l’air ; elle lui fit
remarquer qu’il désirait connaître ce qui se passait dans le ciel, mais que ce qui se trouvait
juste derrière lui ou à ses pieds, échappait à son attention. »
3
« Comme on lui reprochait sa pauvreté, preuve de l’inutilité de la philosophie, on raconte,
que, par l’observation des corps célestes qu’il étudiait, il réussit à savoir que la prochaine
récolte d’olives serait abondante ; encore pendant l’hiver, il réunit un modeste capital et paya
des arrhes sur la location de tous les pressoirs à huile de Milet et de Chios ; il les obtint à un
prix avantageux, car personne ne faisait monter les enchères contre lui. Quand arriva le
moment de la récolte, il y eut soudain une forte demande pour les pressoirs ; alors il les sous-
loua aux conditions qu’il imposa et en retira de vastes bénéfices. Ainsi fit-il la preuve qu’il est
aisé pour des philosophes de s’enrichir pour peu qu’ils le désirent, mais que ce n’était pas en
cela que résidait leur intérêt primordial. »
4
I. 1. 3 Cosmologie
« D’autres disent que la terre repose sur l’eau. Car c’est l’explication la plus ancienne que
nous ayons reçue, celle qui, d’après ce qu’on rapporte, a été donnée par Thalès de Milet pour
qui la terre restait sur place parce qu’elle flottait comme une bûche ou quelque autre chose
semblable (car il est évident qu’aucun de ces objets ne reposent naturellement dans l’air, mais
au contraire sur l’eau). »
5
« Ce qui suscita avant tout leur étonnement, ce fut le spectacle du changement. Nous vivons
dans un monde où tout cesse de changer. Voici une bûche, peu après nous voyons une
flamme, et un peu plus tard, il n’y a plus de flamme – rien qu’un petit tas de cendre. Un
souffle de vent disperse la cendre. Elle disparaît. Et tout ce que nous contemplons, tout ce
2
Hérodote, Histoires, I, 75
3
Platon, Théétète, 174 a
4
Aristote, Politiques, A, 11, 1259 a 9
5
Aristote, De Caelo, B, 13, 294 a 28

dont nous nous servons, et tous les êtres vivants, et les hommes, et nous-mêmes : tout ne cesse
de changer, tout passe.
La première question se posa à peu près ainsi : « Qu’y a-t-il donc qui persiste à travers
tout le changement ? » La première réponse philosophique donnée à cette question fut la
suivante : c’est la substance qui persiste dans tout ce qui change et ne cesse de passer. Il doit
bien y avoir quelque chose qui se maintient dans l’être ; sinon il n’y aurait depuis longtemps
plus rien.
Il y a donc le changement, tout ce qui ne cesse de passer, mais il y a quelque chose qui,
dans l’éphémère, persiste. Le changement est porté par un être subsistant, qui change, et qui
pourtant reste l’être. La première question philosophique posée par l’Ecole de Milet fut donc :
« Quelle est donc la substance qui persiste à travers le changement ? »
Le lecteur peut-il imaginer la saisissante radicalité d’une telle question, lorsqu’elle est
posée pour la première fois ? Nous pouvons parfaitement vivre au milieu des choses qui
changent tant qu’elles possèdent, pour notre vie pratique, une stabilité relative, suffisante pour
nous : si nous posons un pain sur la table, nous l’y retrouvons un peu plus tard, et cela nous
suffit.
Et voici que ces hommes viennent à poser leurs questions. Ils ne voient pas le pain qui
reste là sur la table tant qu’on en a besoin. Ce qu’ils voient, c’est le changement, l’éphémère
de tout – et en même temps ils constatent : l’être est toujours là. Et ils demandent quel est
donc ce fondement qui porte tout ce qui passe ? Les philosophes de Milet ont donné à cette
question des réponses différentes. »
6
« La plupart des premiers philosophes pensaient que les principes sous forme de matière
étaient les seuls principes de toutes choses ; car la source première de toutes choses existantes,
celle dans laquelle une chose prend naissance et dans laquelle elle finit par s’anéantir, étant
donné que la substance perdure, mais change de qualité – cela donc, déclarent-ils, est
l’élément et le principe premier des choses existantes, et pour cette raison, ils estiment qu’il
n’y a ni génération, ni anéantissement absolus, puisque cette nature est à jamais préservée…
car il doit y avoir une certaine substance naturelle, unique ou multiple, à partir de laquelle les
autres choses sont engendrées, tandis qu’elle-même demeure. Ils ne sont pas tous d’accord
cependant sur le nombre et la forme de ce principe ; mais Thalès, l’initiateur de ce genre de
philosophie, dit qu’il s’agit de l’eau (et donc déclara que la terre flotte sur l’eau) ; peut-être
fit-il cette supposition en constatant que la nourriture de toutes choses est humide et que le
chaud lui-même en tire sa provenance et en vit – appuyant sa déduction sur cette dernière
information et sur le fait que la semence de toutes choses a une nature humide, l’eau
représentant pour les choses humides le principe même de leur nature. »
7
« Car la substance de nature humide, du fait qu’elle revêt facilement la forme de toutes
choses, est habituée à subir de nombreux changements : la part de l’humidité qui s’exhale, se
transforme en air, et la partie la plus subtile s’embrase pour transformer l’air en éther, alors
que l’eau, lorsqu’elle est comprimée se change en limon et devient de la terre. C’est pourquoi
Thalès décrète que, parme les quatre éléments, l’eau était le plus propre à agir en tant que
cause. »
8
6
Jeanne Hersch, L’étonnement philosophique, Gallimard, Folio, Paris, 1993, pp. 11-12.
7
Aristote, Met A, 3, 983 b 6
8
Héraclitus Homericus, Quaest. Hom. 22

I. 1. 4. Psychologie
« D’après ce qui a été rapporté, il semble que Thalès aussi pensait que l’âme est un principe
moteur, puisqu’il aurait affirmé que la pierre [magnétique] possède une âme, car elle fait se
mouvoir le fer. »
9
« Et certains prétendent qu’elle [l’âme] est entremêlée au tout de l’univers ; peut-être est-ce la
raison pour laquelle Thalès pensait aussi que toutes les choses sont remplies de dieux. »
10
I. 1. 5 Conclusion
I. 2 Anaximandre
I. 2. 1 Biographie
I. 2. 2 Les œuvres
« Anaximandre le Milésien, élève de Thalès, fut le
premier à avoir eu l’audace de dessiner sur une tablette le
monde habité ; après lui, le grand voyageur Hécatée de
Milet y apporta des précisions, et cette carte devint
source d’émerveillement. »
11
I. 2. 3 L’apeiron
9
Aristote, De Anima, A 2, 405 a 19
10
Aristote, De Anima, A, 5, 411 a 7
11
Agathémère, I, 1
1
/
4
100%