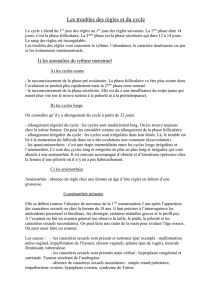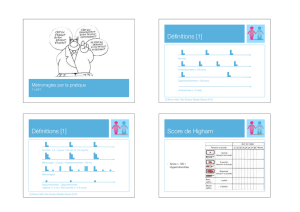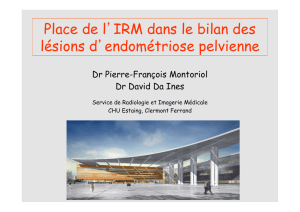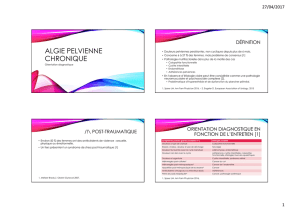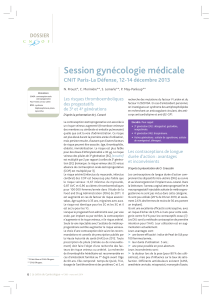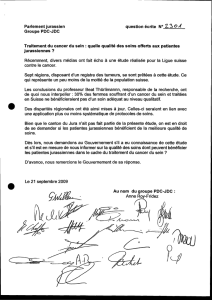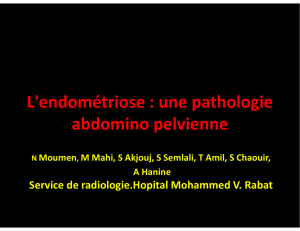Womens Health (Lond Engl)

ADENOMYOSE UTERINE
Une maladie très ancienne qui prend un nouveau visage
INTRODUCTION
L'adénomyose est un exemple des plus démonstratifs de ces maladies gynécologiques qui ont
subi de profondes modifications tant avec les progrès des explorations qu'en raison des
transformations sociologiques - désir de plus en plus tardif de grossesses d'un grand nombre
de femmes- survenues à la fin du dernier siècle.
C'est une maladie, considérée naguère comme affectant les femmes multipares proches de la
ménopause, aux limites floues même sur le plan de l'histologie et qui se présente sous deux
aspects : adénomyose diffuse et adénomyose localisée ou adénomyome. Ses symptômes
s'entremêlent souvent avec ceux de l'endométriose qui lui est associée dans environ un quart
des cas ( c'est à dire plus souvent qu'on ne le pensait avant la mise en œuvre systématique de
l'échographie et fréquente de l'IRM).
Son traitement est désormais conditionné en grande partie par la question de la fertilité
espérée ou non par la patiente. De multiples travaux récents ont montré que ces lésions étaient
plus sensibles aux traitements hormonaux qu'on ne l'écrivait dans les traités. Les techniques
chirurgicales conservatrices imaginées au cours des dernièrs années ont fait l'objet de travaux
de plus en plus nombreux et étoffés.
Il est apparu que la méconnaissance des lésions adénomyosiques peut conduire à des échecs
thérapeutiques très dommageables pour les patientes endométriosiques opérées. Cependant
son diagnostic, très utile pour la prise des décisions thérapeutiques, est suivi de bénéfices qui
ne sont manifestes que dans une certaine proportion de cas car son traitement n'est pas encore
parfaitement codifié.
De nouvelles questions se posent donc aux gynécologues : quelle est la prévalence de cette
affection, isolée ou associée à d'autres causes d'infertilité, quelle est la meilleure méthode
chirurgicale, quels traitements médicaux sont à appliquer et quelles sont les conséquences de
ces lésions et de leurs traitements sur l'issue des grossesses quand elles sont obtenues ? La
littérature apporte des réponses souvent pertinentes à ces interrogations.
PLAN de l'ARTICLE
DEFINITIONS
PREVALENCE DE L'ADENOMYOSE
LES 2 OU LES 4 ADÉNOMYOSES
SYMPTOMATOLOGIE
LES EXPLORATIONS
LES TRAITEMENTS CHIRURGICAUX–– ET L'EMBOLISATION
LE TRAITEMENT HORMONAL
LES MOYENS
LES INDICATIONS
TEXTE
La définition de l'adénomyose et sa physiopathologie étant incertaines, ce ne sont pas les
lésions et leur extension mais les troubles dont se plaignent les patientes qui doivent orienter

la conduite à tenir et cela encore plus que pour l'endométriose externe.
Jusqu'ici on a considéré le traitement médical de l'adénomyose comme peu efficace. En
pratique lorsque le diagnostic était évoqué, la sanction était l'hystérectomie et le diagnostic
final n'était pratiquement porté que par l'histologie des pièces opératoires. Aujourd'hui
l'attitude est plus conservatrice, autant du fait du désir de préserver la fertilité qu'en raison
d'une meilleure connaissance des lésions de l'utérus -grâce en particulier à l'imagerie
pelvienne- et de leurs conséquences. Cette attitude résulte également de l'observation des
effets bénéfiques fréquents du freinage hormonal, effets qui ne sont cependant pas encore
prouvés de façon indéniable.
DEFINITIONS
Les définitions grossières de l’adénomyose sont acceptées de tous : il s’agit de l’invasion
bénigne dans le muscle utérin, de glandes analogues à celles de l'endométre (tissu qui tapisse
lacavité de l'utérus et dans lequel l'embryon fait son nid) , invasion associée habituellement à une
couronne de faisceaux musculaires lisses formant plusieur ilots. Etant donné que la frontière entre
le muscle utérin (myomètre) et l’endomètre n’est pas rectiligne, c’est la profondeur de ces ilots
dans le myomètre qui permettra de parler d’adénomyose. Or la valeur de la distance entre les îlots
d’endomètre à l'intérieur du tissu musculaire normal et la ligne de jonction endomètre-myomètre
n'étant pas consensuelle, on a décidé qu'il était nécessaire que les ilots soient enfoncés de au moins
2 mm dans la paroi de l'utérus pour pouvoir parler d'adénomyose (Ch BERGERON) (1). Les
lésions proches de la cavité sont évidemment les plus accessibles à certaines explorations telles que
l'hystérographie et l'hystéroscopie.
Aujourd'hui on accorde une grande signification aux altération d'une zone de jonction formée à la
fois par l'endomètre le plus externe et par le muscle normal. L'épaississement de cette zone en
echographie et surtout en IRM représente un signe essentiel, causes de perturbations notables des
mécanismes de la reproduction, comme on le verra plus loin.
FREQUENCE DE L'ADENOMYOSE
Selon la définition adoptée la prévalence sera plus ou moins élevée. Elle était située
classiquement entre 25 et 40 % des utérus retirés. Elle dépend aussi de la finesse des coupes
soumises à un examen microscopique puisqu’elle passe de 38 à 61,5 % quand celles-ci sont très
rapprochées (BIRD)(2). EMGE la retrouvée chez 53,7% chez des femmes autopsiées (qui avaient
de ce fait échappé à l’hystérectomie, c’est à dire qu’elles n’avaient pas souffert d’une
symptomatologie très gênante (3).
L’analyse histopathologique des pièces d’hystérectomie met en évidence la diversité des
conceptions des observateurs. Selon les publications, des fibromes s’associent à l’adénomyose
chez 5,6 à 32 % des femmes et l’hyperplasie de l’endomètre aurait été observée dans 1O,5 à
96 % des utérus ! (1O,5 et 23,7 % pour la plupart des auteurs ). Cependant le point d’intérêt
théorique et pratique concerne l’association adénomyose et endométriose : elle est de 4O %
pour NOVAK et WOODRUFF ( 4), 69 % pour EMGE et 14 % pour B. BLANC (enquête du
Groupe français d'Etude de l'endométriose) (5). Il est logique que l'on retrouve plusieurs
maladies oestrogéno-dépendantes chez la même femme mais non un tel éventail des
fréquences qui démontre l’extrême diversité des concepts. On comprend également qu'il soit
particulièrement malaisé de juger des effets des traitements appliqués. Et ce d'autant plus qu'il
n'est pas exclu, comme pour l'endométriose, que l'adénomyose soit dans certains cas le fait
d’un état physiologique résultant par exemple de la persistance de résidus embryonnaires, et
ailleurs de nature pathologique provoquant des troubles exigeant un traitement. J Naftalin et
al. ont choisi un angle pratique d'attaque de cette question, ils ont trouvé que la prevalence de

l'adénomyose dans une population de femmes consultant dans un service de gynécologie
générale était 20.9% (6).
Ajoutons cependant avec Christine Bergeron que les foyers d’adénomyose répondent souvent
mal à la progestérone et aux progestatifs. Cette observation a des conséquences en matière
d’interprétation des images échographiques. Enfin on doit rappeler que l'association de
lésions malignes de l'utérus et d'adénomyose quoique vraiment très rare n'est pas
exceptionnelle et que ce risque doit toujours être présent à l'esprit.
Il faut désormais tenir compte de la distinction qu'ont faite à travers le monde les grandes
équipes de gynécologie entre les adénomyoses à l'origine des troubles gynécologiques
habituels de la cinquième décennie et de la préménopause et les adénomyoses à
symptomatologie modérée ou inexistante découvertes au cours de l'exploration de la femme
infertile. Lorsque celle-ci souffre en outre d'hémorragies et de douleurs vives pendant les
règles, de Souza et al ont trouvé une adénomyose chez plus de 50 % de leurs 26 patientes
(1995) (7)
DESCRIPTION DES TROUBLES
1) Les symptômes classiques dans la cinquième décennie
Ménorragies, dysménorrhée secondaire de type spasmodique et douleurs pelviennes souvent à
irradiations postérieures sont les trois symptômes attribués à l’adénomyose qu'ils soient isolés ou
associés. Devant ces troubles chez une femme à la quarantaine on doit l'évoquer lorsque l'utérus
n'est pas déformé par un fibrome a fortiori s'il est augmenté de volume de façon régulière.
Jusqu’ici c’était la récapitulation rétrospective de la symptomatologie chez les femmes ayant subi
une hystérectomie et dans l’utérus desquelles on avait observé des foyers d’adénomyose qui avait
permis d'en reconnaître les symptômes. Comme le diagnostic histologique varie avec le niveau
d’intérêt du pathologiste pour la maladie, on voit immédiatement que le groupe contrôle, présumé
sans adénomyose, sera excessivement variable. Un exemple classique en est donné par la
publication de Kilkku (8) qui après 212 hystérectomies ne trouve de foyers d’adénomyose que
chez 28 patientes (soit 13%) ! Il y avait donc très vraisemblablement bon nombre d’adénomyoses
méconnues dans les groupes pathologique et même témoin. Autre méthode, ne prendre en compte
que les cas diagnostiqués histologiquement ce qui signifie qu'ils étaient parvenus sous le bistouri :
ainsi Ch. Quereux et son équipe ont observé que la dysménorrhée (douleurs de règles) était le
trouble le plus rare dont se plaignaient leurs 91 patientes et les hémorragies le plus fréquent (9) .
Dans notre expérience, les douleurs pelviennes continues ou prédominant en période
prémenstruelle et résistantes aux traitements antalgiques avec ou sans métrorragies
(hémorragies en dehors des règles) étaient la source principale du handicap des patientes. Il a
été conseillé, en particulier en cas de méno-métrorragies, d'entreprendre rapidement une
exploration complète dans le but de découvrir une adénomyose lorsque les traitements
habituels sont sans effet.
2 la femme infertile de plus de 35 ans
Si elle se plaint de lourdeurs pelviennes ou de ménorragies on pensera évidemment à
l'existence possible d'une adénomyose. Mais parfois, sinon souvent, ce sont les explorations
réalisées à la recherche des causes d'une infertilité qui mettront en évidence des signes plus ou
moins francs de cette affection (10 Devlieger). Cette éventualité est d’autant plus fréquente
que les femmes consultent plus tardivement et que les explorations gynécologiques ont été
nombreuses et attentives.
L'impact de l'adénomyose, diagnostiquée par échographie, sur la fertilité est démontré par des
travaux très récents chez des femmes ayant eu recours à la Fécondation In Vitro.

Ainsi Salim & al. dans une étude prospective portant sur 275 femmes ayant une réserve
ovarienne en ovocytes satisfaisante, 19 d'entre elles étant adénomyosiques, a observé que
chez celles-ci 22.2% avaient eu une grossesse clinique contre 47.2% dans le groupe témoin.
(et 11.1% de grossesses évolutives contre 45.9%) avec un taux d'avortement de 2.8% contre
50.0% (11).
Thalluri et Tremellen KP en Australie ont observé chez les patientes soumises à un traitement
par antagonistes de la GnRH une réduction du taux d'implantation des embryons de bonne
qualité avec 23.6% de grossesses viables contre 44.6% chez les femmes indemnes (12).
On a également rapporté que le travail préterme et la rupture prématurée des membranes
étaient plus fréquents chez les femmes atteintes d' adénomyose, cependant, Maheshwari
demeure dubitatif sur l'importance à accorder à l'adénomyose à l'origine de ces complications.
Et il conclut même : actuellement il n'existe pas de preuves que l'on doive rechercher et traiter
l'adénomyose chez les femmes qui désirent concevoir (13). A
En fait de solides arguments donnent une grande plausibilité aux effets négatifs de
l'adénomyose sur la fertilité. Ils sont de nature biologique et mécanique.
Ota en 1998 (14)) à découvert, même dans le sang périphérique, des signes d'une
inflammation et ces anomalies, ainsi qu'une activation immunologique contribueraient à
expliquerl'infertilité. Selon d'autres hypothèses, ce sont les perturbations mécaniques
provoquées par la présence des îlots d'endomètre truffant le muscle et les anomalies de la
zone jonctionnelle qui affecteraient l'ascension des spermatozoïdes et la nidation.
La recherche attentive d'une adénomyose est donc devenue aujourd'hui une obligation et
probablement aussi l'administration d'un traitement hormonal de durée brève mais efficace.
EXPLORATIONS
Ultrasons et Imagerie par Résonance Magnétique
Elles ont fait l'objet de travaux de plus en plus précis et sont désormais indispensables puisque
l'hystérectomie n'est plus la méthode mise en œuvre de façon systématique. Elles seront
décrites ailleurs, mais il faut préciser qu'il n'y a pas encore un véritable consensus dans
l'interprétation des images tant en échographie qu'en IRM (B MARTIN) (15)
Cependant lorsque la lecture est le fait d'un praticien expérimenté la marge d'erreurs s'est
notablement réduite au cours des dernières années. En ce qui concerne la fertilité, la
possibilité donnée par les méthodes de FIV de connaître immédiatement les résultats en ce qui
concerne l'obtention ou non de grossesse permet maintenant, comme on l'a vu, de juger des
effets néfastes de l'adénomyose. Un des travaux les plus démonstratifs est par exemple, celui
de Maubon, Piver et al. (16) qui ont observé que lorsqu'en IRM la zone jonctionnelle est en
moyenne plus épaisse que 7 mms (et que 10 mms pour l'épaisseur maximale) un échec
d'implantation était observé dans 95,8 % des cas contre 37,5% pour les autres patientes.
Hystérosalpingographie
Bien que l'école française ait apporté à la lecture de ses images des données d'une grande
valeur, elle n'est plus considérée comme suffisamment fiable. Elle sera étudiée dans le
chapitre consacré à l'imagerie.
CA 125
Etrangement, l'élévation du marqueur CA 125 est mal connu des gynécologues alors qu'il est
souvent bien au dessus de la limite supérieure de la normale (Mitchel (17). Le suivi des
dosages est également un moyen simple de vérifier l'efficacité du freinage hormonal. C'est un
critère de plus en plus souvent utilisé ( Akira (18), Sheng (19), Wang (20), Duan (21). Et
Wang a même observé que la valeur du CA125 en période postoperatoire pourrait predire le
taux des grossesses à venir.

TRAITEMENTS
Avant d'aborder ce vaste sujet, il est indispensable de prendre en compte un ensemble de
données : les explorations qui ont permis le diagnostic de l'adénomyose chez les patientes
sont relativement récentes au point que lors du congrès mondial de Montpellier tenu en
septembre 2011, deux des grands spécialistes nord-américains de l'endométriose, chargés de
proposer des améliorations de la classification actuelle de cette affection, n'ont pas prononcé
durant l'heure qui leur était dévolue , les termes d'ultra-sons ni d'Imagerie par Résonance
Magnétique !
Les méthodes chirurgicales conservatrices proposées sont également récentes et ne permettent
donc pas d'avoir un recul valable, mais leur nombre s'est notablement accru et déjà au moins
douze sont mises en œuvre (Maheshwari A) (13). On ne peut donc encore disposer de vastes
séries avec un recul satisfaisant et c'est vraisemblablement pour cette raison que dans leur
article majeur sur la question endométriose et infertilité paru en 2010 dans le Lancet de
Ziegler et Chapron ne mentionnent pas l'adénomyose dans le résumé (22). De plus selon
Levgur (23) le traitement doit être conditionné par l'âge, les symptomes, le désir d'enfant,
l'extension des lésions et l'expertise du chirurgien. C'est dire que les comparaisons des
résultats dans des séries homogènes seront bien difficiles à réaliser. Mais le nombre de cas
d'adénomyoses diagnostiquées ne cesse de croître. C'est donc une période de transition que
traverse l'adénomyose. Le sens clinique du gynécologue ainsi que son habileté chirurgicale
sont donc indispensables pour poser les meilleures indications et les mettre en œuvre de la
façon la plus adéquate.
H Fernandez et AC Donnadieu (24) ont fait en 2007 une synthèse exhaustive des méthodes
de diagnostic et des moyens thérapeutiques ainsi que de la confiance que l'on peut leur
accorder.
LE TRAITEMENT HORMONAL
Agonistes de la GnRH, progestatifs, pilules Oestro-Progestatives, Système Intra-Utérin au
lévonorgestrel (Mirena) et plus récemment antioestrogènes peuvent être utilisés. Les
antiangiogenèses n'en sont encore qu'au stade expérimental.
Aujourd'hui la démonstration de leur efficacité dans l'adénomyose est l'objet de controverses.
En attendant les preuves irréfutables, patientes et médecins devront encore faire des choix
personnels fondés sur leur propre expérience (Vercellini et al. )(24). Les travaux les plus
récents seront ici présentés.
Les Moyens
- Les analogues de la LHRH
Grâce à la profonde hypoestrogénie et l'arrêt des règles qu’ils induisent, ils suppriment les
douleurs menstruelles; les douleurs permanentes sont également réduites ou peuvent même
disparaître. Cet te amélioration est aussi objective : le volume utérin se réduit . Mais la récidive est
à peu près constante lors de leur interruption. D’où la nécessité d’une administration prolongée ou
d’une reprise à répétition qui ne serait admissible qu’en recourant à une add-back thérapie c'est à
dire à l'addition d'une très faible dose d'oestrogènes et ou de progestatifs. D'autres suggestions sont
testées.
Toutes les molécules existantes sont disponibles. La buserelin, la nafareline par voie nasale,
la goserelin, l'acétate de leuprolide ont été souvent administrés et suivis de grossesse, les
traitements durant 3 mois et parfois des années (voir Devlieger)(10). Quoique les effets en soient
excellents, le coût en est nécessairement élevé. Pour le réduire, diverses modalités non
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
1
/
13
100%