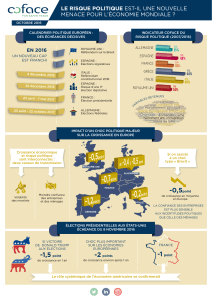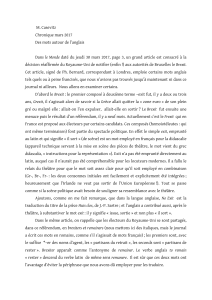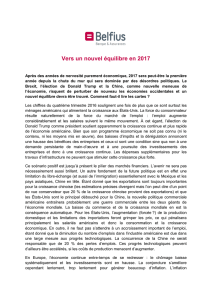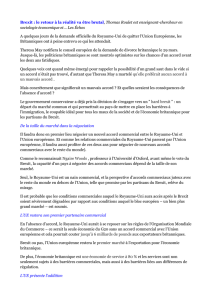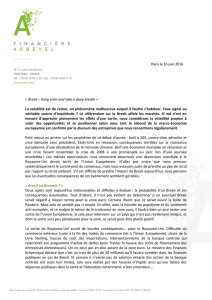du 25 AU 30 JUIN 2016

Gerard CLEMENT Page 1 du 25 AU 30 JUIN 2016 76978550217/04/2017
1
CENTRE RHONE –ALPES D’INGENERIE SOCIALE SOLIDAIRE & TERRITORIALE
REVUE DE PRESSE
Du 25 AU 30 JUIN 2016
Les représentants du personnel : (1) La cartographie des RP
Congrès CGC : un nouveau Président, un nouveau positionnement
Brexit : « un jour sombre pour l’Europe et pour la Grande-Bretagne », selon la CES
On peut vivre sans dialogue social territorial en France - mais tellement moins bien
L'intermédiation : point aveugle de la réforme du marché du travail
travailler plus pour gagner autant
Après le Brexit, le temps de la réflexion
Et si les Britanniques ne sortaient pas de l’UE?
Débat entre Bernard Thibault et Pierre Moscovici : "L'Europe sera sociale ou ne sera
plus"
Billet invité : “Le Royaume-Désuni, ou plutôt déchiré”, par Perfide Albion
MERCI A DAVID CAMERON
AH, le bon air Suisse...
Le bureau de poste éloigne le Front national
Les représentants du personnel : (2) Les interactions entre employeurs et
représentants du personnel
Formations professionnelles d’entreprises et itinéraires des salariés
Une Europe à refaire
Pour démanteler l’Etat-providence Les faussaires de l’Europe sociale
Information sous contrôle Tous ensemble, tous ensemble…
Épistémologie du capitalisme
Brexit : l'heure n'est plus au débat mais à l'action
(Br) exit la démocratie participative ? Coup de gueule d'un accro du référendum

Gerard CLEMENT Page 2 du 25 AU 30 JUIN 2016 76978550217/04/2017
2
Les représentants du personnel : (1) La cartographie des RP
samedi 25 juin 2016
Cette étude de Thomas Breda dresse la cartographie des représentants du personnel (RP), leurs motivations, leur situation professionnelle,
leurs évolutions de carrière, la façon dont ils sont perçus par leurs collègues et leurs employeurs, les relations qu’ils entretiennent entre eux,
leur poids réel dans l’entreprise. Un syndiqué sur trois est représentant du personnel. Une myriade de RP, pas nécessairement syndiqués,
coexistent au sein des différentes instances représentatives du personnel. Cet ensemble représente plus de 6 % des salariés dans le secteur
marchand non agricole, soit plus de 500 000 salariés. L’étude s’appuie sur l’enquête de la DARES, réalisée d’après une enquête employeurs et
une enquête salariés en 2004 et en 2010 [1].
Leurs droits et leurs devoirs : ils sont protégés contre le licenciement, ils disposent de droits et de moyens, ils disposent d’un crédit d’heures
pris sur leur temps de travail pour l’exercice de leur mandat. Ils ont des devoirs, défendre leurs collègues, les représenter dans des instances
telles que le comité d’entreprise, négocier avec les employeurs lors des négociations annuelles obligatoires… Les représentants du personnel
en entreprise sont des salariés, soumis à l’autorité hiérarchique de leur employeur auprès duquel ils représentent leurs collègues. Ils sont sous
le contrôle de l’employeur en tant que salariés mais leur égal lors des négociations d’entreprise.
Au-delà de 250 salariés, presque tous les établissements d’entreprise disposent d’IRP. Si les seuils légaux ne semblent pas avoir d’impact très
fort sur la prévalence des IRP, il n’en est pas de même de la taille de l’entreprise. La délégation unique du personnel (DUP) est une solution
choisie dans les entreprises autour de la centaine de salariés, où elle remplace les CE, presque une fois sur deux. Le taux de présence des
délégués syndicaux (DS) augmente un peu moins vite que celle des DP et DU (délégation unique du personnel) ou CE et DU réunies. Les grands
établissements possèdent presque toujours des DS.
Quatre catégories de salariés sont identifiées à partir de l’enquête salariés (9 187 558 salariés de plus d’un an d’ancienneté travaillant dans un
établissement de 11 salariés ou plus du secteur marchand non agricole en 2010) : 1°-Les RP syndiqués, 2°-les RP non-syndiqués, 3°-les
syndiqués non RP et 4°-les non syndiqués non RP.
86 % des salariés ne sont ni RP, ni syndiqués.
6,4% des salariés sont RP et 7,4 % des salariés sont syndiqués.
3,6 % des salariés sont RP et syndiqués et 2,8 % sont des RP non syndiqués. Un tiers des RP syndiqués sont délégués syndicaux. Les
autres RP syndiqués (220 000) ne participent pas aux négociations annuelles obligatoires. Ils siègent au sein des autres instances de
représentation (DP, CE, CHSCT), au côté d’environ 360 000 représentants non syndiqués. Les RP syndiqués sont donc minoritaires au
sein de ces instances.
D’après l’enquête employeur, il y aurait plus de 590 000 RP (ou de salariés protégés) en France. Les relations que les DP entretiennent avec
leurs employeurs sont différentes entre RP syndiqués et non syndiqués.
Peu de syndiqués mais beaucoup de représentants syndicaux, ce sont les caractéristiques essentielles du syndicalisme de « représentativité à
la française ».
Qui sont les RP ? Les RP sont en moyenne deux ans plus âgés que l’ensemble des salariés, 4 ans et demi plus âgés pour les RP syndiqués et 8
ans plus âgés pour les délégués syndicaux des syndicats majoritaires. Les syndiqués, représentants ou non, sont en moyenne 3 ans plus âgés
que l’ensemble des salariés.
La proportion des femmes parmi les représentants du personnel (36,6 %) est inférieure de 5 points à la proportion de femmes parmi
l’ensemble des salariés. C’est un écart assez faible par rapport à l’image « masculine » associée aux syndicats français.
Les RP ne sont pas moins diplômés que les autres salariés. Ils sont même beaucoup moins souvent sans diplôme (8 % des RP et
seulement 4 % des délégués syndicaux majoritaires le sont contre 10 % des salariés). Les RP les plus diplômés sont ceux qui jouent un
rôle prépondérant. Les salariés sans diplôme comme les salariés les plus diplômés (bac+3 et plus) sont sous représentés parmi les RP.
Les cadres sont sous-représentés dans les RP (13,6 % des RP contre 17,8 % de l’ensemble des salariés), contrairement aux
professions intermédiaires qui sont légèrement surreprésentées.
Où sont les RP ? Il existe de forts écarts de taux de syndicalisation par secteur d’activité dans les établissements de 10 salariés et plus. Le
secteur de la construction est celui qui connaît le plus fort taux de syndicalisation (15,6 % parmi les établissements de plus de 20 salariés), suivi
des services (10,8 %), de l’industrie (10,4 %), puis du commerce (8,9 %).
Le taux de participation aux IRP varie peu par secteur (7 % environ). C’est la répartition entre RP syndiqués et RP non syndiqués qui
varie : les RP syndiqués dans la construction sont surreprésentés (4,3 % des salariés du secteur mais seulement 3,5 à 3,9 % des
salariés dans les autres secteurs). Le secteur du commerce se distingue par une proportion de salariés RP forte et une proportion de
salariés syndiqués faible (soit autant de RP que de syndiqués).
La syndicalisation est plus forte dans les grands établissements (les RP sont presque tous syndiqués, au contraire des petits
établissements qui ont une majorité de DP non syndiqués). La bascule s’effectue autour de 200 salariés.
Référence :
http://www.parisschoolofeconomics.com/breda-thomas/papers/Les_representants_du_personnel_en_France_Breda_online.pdf
Notes :
[1] La Direction de l’Animation de la Recherche et des Etudes Statistiques (DARES) du Ministère du travail réalise tous les 6 ans une enquête
auprès d’un échantillon de 4 000 établissements d’entreprise du secteur marchand non agricole.
Congrès CGC : un nouveau Président, un nouveau positionnement
samedi 25 juin 2016
Étonnante CFE-CGC qui, à son congrès de Lyon, les 1er et 2 juin 2016, se sépare sans douleur apparente d’une
Présidente qui présente un bon bilan et élit un président qui prend ses distances avec le réformisme en rentrant en
opposition à la loi travail sans toutefois se rallier au mouvement social ! Une organisation manifestement à la recherche
d’un positionnement original alors que la dernière mesure de représentativité dans l’encadrement la situait loin derrière la
CFDT réformiste et derrière la CGT contestataire [1].
Le départ de Carole Couvert…
La surprise est venue en décembre dernier du refus de la fédération d’origine de Carole Couvert, l’Énergie, de la représenter au
Congrès. Rivalités internes, distances prises par la fédération vis-à-vis du bilan de l’équipe confédérale, désaccords personnels
sont probablement à l’origine de ce refus. Malgré une motion de soutien de 14 fédérations sur 19, une tentative de pétition, les
statuts ont primé. Carole Couvert a annoncé en avril son retrait pour éviter une crise dans l’organisation et a soutenu sans réserve

Gerard CLEMENT Page 3 du 25 AU 30 JUIN 2016 76978550217/04/2017
3
son adversaire malheureux du congrès de 2013, François Hommeril. Elle devient Présidente d’honneur de la CFE-CGC et garde
son poste de Présidente du groupe au CESE.
…malgré une certaine autosatisfaction sur le bilan de l’équipe sortante !
Le rapport d’activité et les déclarations de la Présidente et de sa Secrétaire générale Marie-Françoise Leflon font état d’un bilan
largement positif où on montre une CFE-CGC à l’offensive sur de nombreux sujets, influente sur les négociations ou les projets de
loi et nettement plus visible que dans les périodes précédentes.
Ainsi, la CFE-CGC déclare être en première ligne lors des conférences sociales pour demander d’alléger la charge fiscale pour les
entreprises et les classes moyennes, développer la formation tout au long de la vie ou encore sécuriser les parcours professionnels
autour du Compte Personnel d’Activité.
De même, dans la négociation sur les retraites complémentaires, où elle estime avoir sauvé l’essentiel : la pérennité des régimes
et des garanties pour sécuriser l’avenir du statut cadre notamment par l’ouverture d’une négociation sur l’encadrement, tout en
occultant son acceptation de la fusion de l’ARRCO et l’AGIRC qu’elle avait toujours combattue jusqu’alors.
Le rapport valorise l’élaboration des textes de lois comme la loi Rebsamen, les réflexions sur la préservation du statut cadre, la
restructuration des branches, les négociations et les actions sur la santé au travail et le handicap. Elle se prétend, par ailleurs,
leader sur les thématiques du développement durable, défi climatique, COP21, transition énergétique et responsabilité sociale des
entreprises.
Toutefois, elle rappelle son opposition à l’accord de 2014 sur l’UNEDIC, faute d’une augmentation des cotisations de la part des
employeurs et du prolongement du délai de carence. Elle a aussi refusé de signer le texte sur le Pacte de responsabilité ou encore
affiche ses critiques sur la Loi El Khomry. Bref un parcours assez chaotique dont on cherche un peu la cohérence.
Globalement, on retrouve bien sûr la CFE-CGC sur des thématiques traditionnelles pour elle, la défense du pouvoir d’achat des
« classes moyennes », notamment par son opposition à la modulation des allocations familiales, la baisse du plafond du quotient
familial et la fiscalité en général.
Au final, la CFE-CGC, se veut être un partenaire exigeant, pas prêt à tout accepter d’un patronat en qui elle n’a plus confiance
notamment à la suite de la négociation sur l’Assurance chômage.
Bilan qu’elle considère comme positif, aussi, sur le travail de mobilisation de l’organisation sur les questions d’information,
communication, de développement et la représentativité. Elle se considère aujourd’hui plus visible avec pas moins de 11
retombées de presse par jour. Son nombre d’adhérents serait passé de 143 000 (chiffre annoncé lors du congrès de 2013) à
155 771 en trois ans. Elle fait état de ses nombreuses progressions électorales dans les entreprises en saluant tout
particulièrement sa première place dans les groupes Renault et Air France. Le rapport d’activité fait état de nombreux guides,
supports divers ou vidéos pour éclairer de nombreux sujets et aider les militants.
Bilan globalement positif donc pour sa Secrétaire générale sortante, qui dans son édito présentant le rapport d’activité déclare que
la CFE-CGC a gagné « ses galons de partenaire social incontournable et nous en sommes collectivement fiers ». Une
autosatisfaction quelque peu excessive au regard du poids et de l’influence réelle de la CFE-CGC.
Un programme qui se résume en trois mots : visibilité, représentativité, Inventivité !
Traditionnellement à la CFE-CGC, le programme du Président se résume à quelques orientations d’une portée limitée qui laissent
assez largement les mains libres à l’équipe dirigeante pour mener au quotidien aux destinées de l’organisation. Ce congrès n’a pas
dérogé à la règle et ce sont les déclarations du nouveau Président qui permettent de mieux entrevoir les évolutions de
l’organisation.
La CFE-CGC réaffirme clairement son rôle d’organisation de l’encadrement. Elle se bat pour une juste rémunération des efforts et
des responsabilités, défend la qualité de vie au travail et s’engage en faveur du développement durable et de l’Europe.
Elle se veut donc plus visible en valorisant mieux ses actions, mutualisant ses moyens et modernisant ses outils de
communication ; plus représentative en renforçant l’opérationnalité de ses structures territoriales, en favorisant le développement et
en étant plus à l’image de ceux et celles qu’elle représente ; enfin, plus inventive en prenant en compte les enjeux d’une société
confrontée à l’impact du numérique, en réfléchissant à la « société de demain » notamment au travers d’un think-tank pour acquérir
« une autorité politique et intellectuelle » et en créant de nouveaux services aux adhérents tel qu’un conseil en parcours
professionnel.
Ce sont, toutefois, les déclarations de son président dans le discours final et dans la presse qui marqueront ce congrès. Le
nouveau Président a pris ses distances avec la qualification de réformiste de la CFE-CGC qui ne serait qu’une
« instrumentalisation du gouvernement ». Les gouvernements successifs n’auraient choisi pour faire face à la crise que le
« nivellement par le bas ». Qualifiant la loi El Khomri de « magasin des antiquités du néo-libéralisme », il s’est déclaré en
opposition à ce texte notamment sur la prédominance du dialogue social dans l’entreprise « au plus près de la fragilité des acteurs
dans le rapport de force ». Toutefois, il refuse de rentrer dans le mouvement social actuel « parce qu’il existe encore une possibilité
pour le gouvernement d’accéder à un peu de sagesse et de raison » en remettant l’affaire à la négociation des partenaires sociaux.
Ce positionnement de l’organisation, outre le fait qu’il n’a pas vraiment donné lieu à débat ni avant ni pendant le congrès, a été
diversement apprécié parmi les participants.
En confirmant sa posture traditionnelle de défense catégorielle de l’encadrement et en tentant de se démarquer encore un peu plus
de la CFDT réformiste, la CFE-CGC semble faire un pari risqué pour tenter de reconquérir une audience prédominante chez les
cadres. Y parviendra-t-elle ? Ne risque-t-elle pas d’affaiblir le camp réformiste sans en tirer pour elle-même les bénéfices
escomptés du fait de son probable isolement ?
Sources
Rapports d’activité et programme de la CFE-CGC au Congrès de Lyon, Articles du Monde et de l’Humanité.
http://www.clesdusocial.com/congres-de-la-cfe-cgc-carole-couvert-secretaire
Notes :
[1] Note sur la représentativité En 2013, dans l’encadrement, la CFDT avait obtenu 26.84 % des voix, la CGT 20,98 % et la CFE-
CGC 18,14f.
Brexit : « un jour sombre pour l’Europe et pour la Grande-Bretagne », selon la CES
samedi 25 juin 2016
Les Britanniques ont tranché en faveur du « Leave », c’est-à-dire, quitter l’Union européenne lors du référendum du 23 juin. Cette disposition
de sortie d’un État membre est possible depuis l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, dans son article 50. C’est à réception d’une lettre du
Premier ministre britannique que le Conseil statuera sur le départ du Royaume-Uni en proposant une négociation qui peut s’étaler sur deux
ans.
Comme le souligne la Confédération européenne des syndicats, « c’est un jour sombre pour l’Europe et la Grande-Bretagne ».

Gerard CLEMENT Page 4 du 25 AU 30 JUIN 2016 76978550217/04/2017
4
Le départ du Royaume-Uni est une première car aucun pays n’est parti de l’UE jusqu’à maintenant, même si des projets d’adhésion ont échoué
(Norvège) ou des régions ont quitté l’UE lors de leur indépendance (Groenland, par exemple). En effet, l’article 50 permet à un pays de faire
cette demande mais aucune procédure explicite n’est établie.
Les conséquences seront importantes au-delà des répercussions immédiates sur les marchés financiers.
Au Royaume-Uni, le droit découlant de l’Union européenne pourra être remis en question. Celui-ci concerne :
l’ensemble des réglementations techniques de normalisation des produits (l’étiquette CE sur nos produits), qui nous permettent
d’avoir confiance dans les produits disponibles sur le marché commun (réglementation technique, de sécurité, d’utilisation, de
garantie, appellations européennes d’origine…) ;
un certain nombre de droits sociaux apportés par le droit social européen notamment le plafond de 48h hebdomadaire de travail, le
droit aux congés payés, ou encore l’égalité de traitement entre salariés à temps partiel et à temps plein, le congé maternité décidé
par accord entre partenaires sociaux européens, dans un pays qui peine en général à mettre en œuvre des innovations sociales
positives ;
les aides européennes notamment au développement économique et social dans les régions en difficulté, qui ne seront plus
possibles ;
les accords commerciaux internationaux et notamment la protection européenne contre l’importation de produits faisant preuve de
dumping social ou environnemental ;
la citoyenneté européenne permettant de se faire aider par n’importe quelle représentation d’un État membre de l’UE dans un pays
hors UE (le passeport britannique ne comportera plus la mention Union européenne).
Comme le soulignent les syndicats britanniques du TUC, « les salariés ne doivent pas payer le prix du départ de l’UE ». L’enjeu du respect du
droit social apporté par l’UE aux salariés britanniques devra être posé dès la sortie de l’UE.
Pour les pays de l’UE à 27, une période nouvelle s’ouvre également, car le départ d’un grand pays comme le Royaume-Uni modifiera l’équilibre
entre grands pays et interrogera sur l’avenir de la construction européenne, alors que les peuples hésitent entre un saut fédéraliste ou un repli
nationaliste.
Sources :
https://www.tuc.org.uk/.../workers%E2%80%99-rights-are-line
https://www.etuc.org/.../le-vote-brexit-%E2%80%93-lue-doit-agir-pour-am%C3%A9liorer-le-sort-des-travailleurs#.V20LaI9OLIV
On peut vivre sans dialogue social territorial en France - mais tellement moins bien
par Frédéric Bruggeman, Bernard Gazier - 24 Juin 2016
Dans un récent travail d'étude historique et comparative du dialogue social territorial (DST) en France et dans les pays développés
(Gazier et Bruggeman, 2016) nous avons entrepris de mettre en évidence et de questionner sa dynamique. Cet article en reprend
les principales conclusions centrées sur le cas français. Après avoir évoqué les grandes étapes de son devenir dans notre pays,
nous proposons d'en discuter les apports et limites. Nous présentons enfin quelques remarques sur les potentialités actuelles du
DST en France. Metis a publié en décembre 2010 un dossier sur le dialogue social territorial.
LE (RE)DEVELOPPEMENT DU DIALOGUE SOCIAL TERRITORIAL EN France
Un DST actif et innovant existe en France depuis une quarantaine d'années. On peut parler de renouveau dans la mesure où -
après une longue période de développement à l'échelle territoriale entre la fin du XIXème siècle et le milieu du XXème - le cadre
national était devenu la norme, et ce dans la foulée de la mise en œuvre du programme du Conseil National de la Résistance et
durant la période des « trente glorieuses ». La conclusion de conventions collectives infranationales ne s'est poursuivie jusqu'à nos
jours, que dans les quelques branches (Métallurgie, Bâtiment, Industrie des Mines et Carrières, Agriculture, Entreprises
d'Architecture) qui ont maintenu des niveaux territoriaux de discussion, ou dans des situations spécifiques comme celles de la
manutention et du nettoyage des aéroports de la région parisienne ou de l'industrie du Roquefort.
Le dialogue social territorial (DST) s'est développé en France durant les 40 dernières années autour de trois fonctions
successivement affirmées, et désormais présentes simultanément toutes les trois : la facilitation du redéveloppement (dès le début
des années 1970), l'intégration - organisation des isolés (à partir de la fin des années 1990) et la gouvernance territoriale
décentralisée, principalement à l'échelle régionale et sur les champs de l'emploi et de la formation professionnelle (depuis la
seconde moitié des années 2000).
Des Comités Locaux pour l'Emploi...
Nés dès le début des années 1970, les Comités Locaux pour l'Emploi, devenus Comités de Bassin d'Emploi (CBE) en 1983, ont
été la première forme sous laquelle le DST a ré-émergé en France. L'expérience accumulée par ces comités, qui étaient au
nombre de 313 en 1983 et encore 60 en 2011, s'étale sur plus de 40 ans. Elle est considérable bien qu'elle reste faiblement
étudiée. Les CBE se constituèrent pour apporter des solutions à des problèmes d'emploi ; de mobilité spatiale et professionnelle,
de formation, de chômage des jeunes, d'adaptation à la division internationale du travail, de réduction des tensions sociales, etc.
... aux Commissions Paritaires Régionales Interprofessionnelles...
Les commissions paritaires territoriales sont nées à la fin des années 1990 dans quelques expériences pionnières telle celle du
Tarn ou des Deux-Sèvres, et le développement des accords territoriaux dans cette période marque un second temps de la
renaissance du dialogue social territorial en France. Il s'est poursuivi par la signature, en 2001, d'un accord interprofessionnel entre
l'UPA et les cinq Organisations syndicales représentatives des salariés. Ayant provoqué une vive opposition des autres
Organisations représentatives des Employeurs qui s'est traduite par un long contentieux, il n'est pas entré en vigueur avant 2009.
Mais, depuis cette date, des Commissions Paritaires Régionales Interprofessionnelles de l'Artisanat (CPRIA) se sont mises en
place dans les 22 régions françaises. La loi dite « Rebsamen» de juillet 2015 prévoit la mise en place de Commissions Paritaires
Régionales Interprofessionnelles (CPRI) dans les entreprises de moins de 11 salariés, pour le premier janvier 2017 au plus tard.
En moins de deux décennies, une forme de dialogue social visant à organiser les isolés s'est donc institutionnalisée et devrait
prochainement couvrir 4,6 millions de salariés.
Les CPRIA ont vocation à favoriser le dialogue social, l'accès à l'emploi, la connaissance et l'attractivité des métiers, les besoins de
recrutement, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, les conditions de travail, la santé, l'hygiène et la sécurité
au travail ou encore les œuvres sociales et culturelles. Les négociations salariales, les classifications, etc. sont et demeurent du
ressort exclusif des branches. L'organisation des isolés est explicitement développée dans certaines régions françaises dans le
champ de l'aide à domicile auprès des publics dits fragiles pour améliorer la qualité de l'emploi (la fonction d'intégration).
... et au quadripartisme régional

Gerard CLEMENT Page 5 du 25 AU 30 JUIN 2016 76978550217/04/2017
5
Initié au milieu des années 1960 par la mise en place des CESR, le développement du dialogue social régional s'est accéléré à
partir du début des années 2000 et c'est à cet échelon que le renouveau du dialogue social territorial s'est alors poursuivi en
France. Dans le contexte d'une montée en puissance des régions (relative comparativement à leur rôle dans d'autres pays
d'Europe- Allemagne ou Italie par exemple -, mais forte à l'échelle française) ce développement a suivi trois lignes de force :
institutionnelle, quadripartite et, de façon plus minoritaire, bipartite.
Les CREFOP (Comités régionaux de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle), instaurés par la loi Sapin du 5
mars 2014, constituent une institutionnalisation d'un dialogue social quadripartite plaçant l'État en Région (Préfet de Région,
Éducation Nationale, Pôle Emploi Régional), la Région (Conseil Régional), et les Partenaires Sociaux (trois Organisations
Représentatives des Employeurs et cinq Organisations Représentatives des Salariés) au cœur de la gouvernance territoriale des
politiques publiques d'emploi, d'orientation et de formation. Leur mise en place est encore en cours à la fin du printemps 2016.
ENTRE INNOVATION ET CRAINTE D'UN CONTOURNEMENT DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE, UNE OPERATIONNALITE
QUI RESTE PROBLEMATIQUE
Ainsi pratiqué en France, ce DST occupe cependant une place restreinte et pas tout à fait stabilisée ; le renouveau observé est
d'abord qualitatif. Le DST explore d'autres champs que ceux qui étaient l'objet des premières conventions collectives et joue un
autre rôle : il s'est déployé comme accompagnateur du développement local ou plus exactement du redéveloppement comme
vecteur d'organisation et de développement du dialogue social et du syndicalisme dans les TPE, et comme facilitateur du
décloisonnement des politiques publiques dans le contexte de la décentralisation française.
L'innovation est véritablement la marque de fabrique de ce DST. On doit par exemple au dialogue social régional d'avoir « rodé » le
quadripartisme institutionnalisé par les CREFOP, d'avoir expérimenté ce qui deviendra le contrat de génération, ou encore d'avoir,
dans la foulée de la crise de 2008, testé différents dispositifs de sécurisation des parcours des travailleurs précaires et expérimenté
des dispositifs visant à « former plutôt que licencier », par exemple en Franche-Comté. Le DST assure donc, en France, un rôle de
laboratoire, ce qui confirme - en l'étendant à d'autres champs que celui des restructurations à propos duquel elle a été initialement
formulée - l'idée selon laquelle le territoire est un laboratoire d'innovations en matière de pilotage multi-acteurs.
Il est cependant peu producteur de résultats visibles. En écho à « la faiblesse des résultats concrets obtenus » (Micheau, 1982)
des premiers CBE, force est de constater les résultats décevants des CPRIA, « si l'on veut considérer la diffusion des droits
sociaux d'un point de vue quantitatif » (Rey, 2016). Il faut bien sûr se garder de juger trop vite un dispositif qui s'expérimente
encore, mais le constat est le même dans d'autres domaines. Ainsi, le territoire s'avère un « candidat décevant » (Fayolle, Guyot,
2014) à la sécurisation des parcours professionnels ; chaque fois qu'il a été tenté de mesurer l'effet sur l'emploi, aucun résultat
significatif n'a pu être trouvé (Quynh, 2015, par exemple). Enfin, les très rares évaluations accessibles (généralement non chiffrées)
d'instances de DST concluent seulement à des impacts positifs en termes de communication et d'échange d'information, les
Groupements d'employeurs constituant l'exception qui confirme la règle.
On peut remarquer qu'il ne s'agit pas d'une faiblesse, mais d'un trait caractéristique. Ainsi, a-t-il été dit des CBE qu'ils se situaient
en amont des actions pour l'emploi, animaient une « concertation dont le fruit leur échappe » (Palmowski, Morin, 2005) et étaient
donc dans, l'inconfortable position d'être des initiateurs d'actions portées par d'autres. Dans cette perspective, l'effet du DST sur
l'emploi ne peut être qu'indirect. Les effets sur l'emploi à court terme ne constituent sans doute pas un bon indicateur de l'activité
du dialogue social territorial et il vaudrait mieux trouver des indicateurs d'innovation, de créativité ou de mise en relation d'acteurs.
Ce positionnement du DST semble contraindre les participants à remettre incessamment de nouveaux projets à l'ouvrage, sans
jamais pouvoir espérer les concrétiser. Cette situation interdit l'apprentissage qui découle de la mise en œuvre, favorise
l'instrumentation (ceux qui mettent en œuvre poursuivent leurs propres objectifs) et son caractère chronophage. C'est en effet un
dialogue que son caractère multi partenarial rend complexe, qui requiert des apprentissages ne s'opérant que sur le tas et
demandant des moyens dont les acteurs qui l'investissent ne disposent pas en termes opérationnels et financiers (sauf pour ce qui
concerne, depuis quelques années seulement, les CPRIA). Cette situation explique qu'il n'est pas rare que ceux qui s'y investissent
s'effarent des «temps de travaux et débats nécessaires » (CNFPTLV 2012) comme si chacun « cherchait son rôle dans un
scénario lui-même à écrire » (Charlot, Bergère, 2011).
L'hypothèse qu'il est possible de faire face à ces constats est que les voies et moyens du fonctionnement du DST n'ont pas encore
été mis au point. La crainte qu'il ne serve à contourner les résultats de la négociation collective nationale a conduit les partenaires
sociaux français à affirmer en 2008 que :
« la volonté des interlocuteurs sociaux d'élargir le dialogue social doit également trouver une traduction concrète au niveau
territorial interprofessionnel. Ce dialogue social interprofessionnel territorial, qui ne saurait avoir de capacité normative, doit être
l'occasion, à l'initiative des interlocuteurs concernés, d'échanges et de débats réguliers sur le développement local dans sa
dimension sociale et économique. »
(Partenaires sociaux 2008, article 14, nous soulignons)
Cette position est à visée préventive contre l'utilisation, toujours possible, du dialogue social territorial (comme d'ailleurs du
dialogue social d'entreprise !) à des fins de remise en cause d'accords collectifs conclus à d'autres niveaux, risquant ainsi d'ouvrir
la voie à une concurrence interentreprises déloyale. Faut-il considérer pour autant qu'elle est gravée dans le marbre ?
QUELLES PERSPECTIVES POUR LE DST EN FRANCE ?
Il est maintenant de plus en plus clairement perçu que le DST crée « des dispositifs innovants » (Combrexelle, 2015). Alors,
comment envisager un développement plus affermi ?
Plusieurs propositions existent dans ce domaine. La première et la plus simple consiste à faire évoluer le droit pour que des
représentants d'employeurs et de salariés en activité puissent bénéficier des droits leur permettant de participer de plain-pied à ce
dialogue social et aux projets qui lui sont associés. L'article 50 proposé par Robert Badinter et Antoine Lyon-Caen (Badinter, Lyon-
Caen, 2015) va dans ce sens pour ce qui concerne les TPE, et il pourrait être étendu à la participation de représentants aux
Espaces d'Initiatives Territoriales préconisés par le rapport Aubert (Aubert 2014, op. cit.). La proposition 39 faite par le rapport
Combrexelle de reconnaissance par la loi des « négociations territoriales et de sites créant des dispositifs innovants », dont les «
les dispositions de nature normative que, le cas échéant, [ils] contiendraient n'auraient d'effet juridique que dans la mesure où elles
seraient explicitement reprises dans les accords d'entreprise » (Combrexelle op. cit.) ouvriraient la porte à l'expérimentation. Ces
propositions sont importantes, car elles permettraient de sortir le DST en France de sa dépendance des financements et décisions
centralisées, notamment de l'État ou de la Région. De ce point de vue, il faudra suivre de près les conséquences qu'auront - dans
les régions dans lesquelles existait un dialogue social régional et/ou infra régional (Rhône-Alpes ou Ile-de-France, par exemple) -
les changements de majorité intervenus lors des élections de décembre 2015.
Il s'agit cependant de propositions d'organisation, dépendantes de projets dont il faut préciser le sens et les champs. De ce point
de vue, on peut formuler l'hypothèse que deux champs au moins pourraient bénéficier d'un développement du DST : celui des
transitions professionnelles et, plus largement, celui couvert par les droits de tirages sociaux proposés par le « rapport Supiot »
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
1
/
23
100%