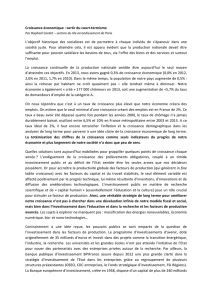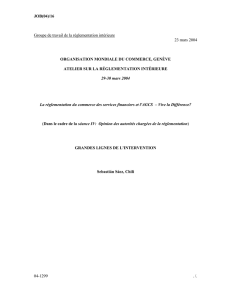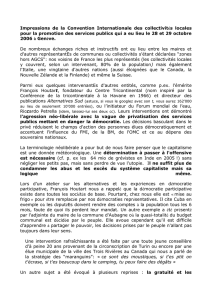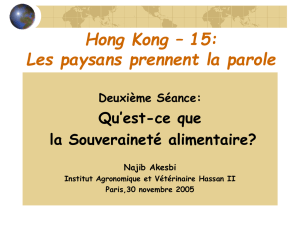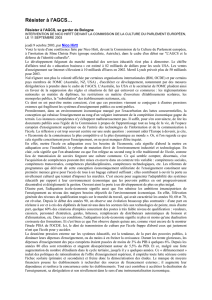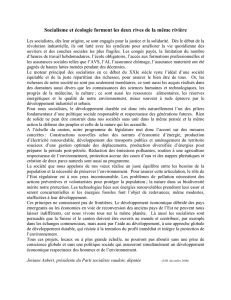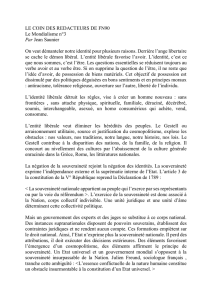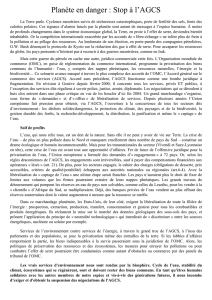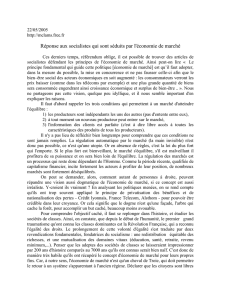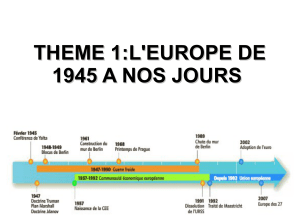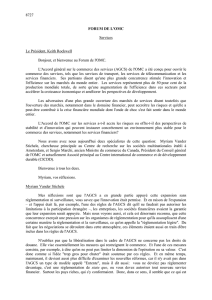Amélioration de l`état social - États généraux du Parti Socialiste

Contribution Section de Rethel, le 06 octobre 2014
1
ETAT SOCIAL ET SERVICE PUBLIC
Comment moderniser et améliorer l’Etat social ? Pour l’éducation nationale, le système de
santé, la politique du logement, la formation professionnelle, le droit à la sécurité, la prise en
compte du vieillissement ou la dépendance. Quelle solidarité intergénérationnelle ?
Nous commémorons cette année l’assassinat du plus illustre des socialistes français, Jean
Jaurès. Ce qui compte surtout ce n’est pas la figure de ce personnage mythifié, repris par même par N.
Sarkozy, dans l’amalgame du roman national, c’est d’abord sa pensée. Voici le début de son célèbre
discours à l’Assemblée Nationale le 21 novembre 1893 :
« Oui, par le suffrage universel, par la souveraineté nationale qui trouve son
expression définitive et logique dans la République, vous avez fait de tous les citoyens, y
compris les salariés, une assemblée de rois. C'est d'eux, c'est de leur volonté souveraine
qu'émanent les lois et le gouvernement ; ils révoquent, ils changent leurs mandataires, les
législateurs et les ministres, mais, au moment même où le salarié est souverain dans l'ordre
politique, il est dans l'ordre économique réduit à une sorte de servage. (…)
Et c'est parce que le socialisme apparaît comme seul capable de résoudre cette
contradiction fondamentale de la société présente, c'est parce que le socialisme proclame que
la République politique doit aboutir à la République sociale, c'est parce qu'il veut que la
République soit affirmée dans l'atelier comme elle est affirmée ici, c'est parce qu'il veut que la
Nation soit souveraine dans l'ordre économique pour briser les privilèges du capitalisme
oisif, comme elle est souveraine dans l'ordre politique, c'est pour cela que le socialisme sort
du mouvement républicain. C'est la République qui est le grand meneur : traduisez-la donc
devant vos gendarmes ! »
Jean Jaurès lie la question de la souveraineté nationale d’ordre politique à la
souveraineté nationale d’ordre économique. C’est ce en quoi nous sommes socialistes. Cette
identité ne peut pas être balayée au nom de l’adaptation à la crise actuelle, au nom de la
mondialisation, au nom de cette conjoncture libérale qui réduit le salarié « à une sorte de
servage ».
Depuis le XIXème siècle, la France a su créer un Etat où les valeurs socialistes ont pu
être réalisées, surtout après la 2ème guerre mondiale avec le Programme du Conseil National
de la Résistance. L’Etat-Providence a permit en effet une certaine souveraineté nationale
d’ordre économique comme l’espérait Jean-Jaurès.
C’est donc aujourd’hui, et d’abord aux socialistes de le défendre. Et cette défense
c’est d’abord celle d’un monde où il existe encore un service public. Un monde où les
cantines scolaires restent gérées par les collectivités territoriales et non par des firmes comme
Coca-Cola ou McDonald’s. Un monde où les salaires sont discutés à travers des négociations
tripartites (Etat-syndicats-patrons) et non selon le bon vouloir d’entreprises transnationales
mettant en concurrence des salariés vivants dans territoires éloignés. La libéralisation
progressive du monde ne cesse de s’amplifier et menace les spécificités locales. L’Accord
général sur le commerce des services (AGCS) veut détruire les souverainetés populaires pour

Contribution Section de Rethel, le 06 octobre 2014
2
mieux proclamer le « droit supérieur » des investisseurs. Il vise à la « libéralisation
progressive » de toutes les activités de service à travers des « négociations successives qui
auront lieu périodiquement en vue d’élever progressivement le niveau de libéralisation »
(article 19-1) et ne reconnaît que des « fournisseurs de services », indépendamment de leur
statut public ou privé. Cet accord est mis en œuvre par les gouvernements, qui amputent ainsi
eux-mêmes le champ de leurs compétences, et par des institutions supranationales (Union
européenne, OMC, Fonds monétaire international) qui échappent à tout contrôle démocratique
digne de ce nom.
Douze secteurs sont concernés par l’AGCS : services fournis aux entreprises,
communication (dont la poste et l’audiovisuel), construction et ingénierie, distribution,
éducation, environnement, services financiers et assurances, santé et services sociaux,
tourisme, services récréatifs, culturels et sportifs, transports et « autres services non compris
ailleurs ». S’ensuit une division en cent soixante sous-secteurs : rien ne lui échappe.
L’application de l’AGCS signifierait la fin des services publics (éducation, santé, transport,
énergie, etc.) tels qu’on les connaît dans la plupart des pays d’Europe. La libéralisation doit se
comprendre comme la soumission aux règles d’une concurrence que ne saurait contrarier
aucune norme sociale, sanitaire ou environnementale : un code du travail nuisant à la
rentabilité d’un investissement, un principe de précaution jugé trop contraignant, la fixation
de limites à la pollution engendrée par une industrie...
Chaque Etat propose la liste des services qu’il s’engage à libéraliser — les « offres »
— ainsi que les limites prévues à cette ouverture au marché. Le degré de libéralisation
concédé est irréversible. Les négociations ultérieures ne pourront porter que sur la réduction
des limites réclamées initialement. Le but est d’empêcher toute forme de réappropriation
publique d’une activité commercialisée ou privatisée. Les textes doivent demeurer secrets.
L’article 17-1 de l’AGCS impose le principe du « traitement national » : « Chaque
membre accordera aux services et fournisseurs de services de tout autre membre, en ce qui
concerne toutes les mesures affectant la fourniture de services, un traitement non moins
favorable que celui qu’il accorde à ses propres services similaires et à ses propres
fournisseurs de services similaires. » Cela signifie que la France devrait financer une
université privée étrangère — ou un lycée privé étranger — s’installant sur son territoire à la
même hauteur que ses propres établissements publics d’enseignement. La chose étant
impossible budgétairement, elle n’aurait d’autre choix que de renoncer au financement des
universités et des lycées français. Les monopoles publics (telle l’éducation nationale) et les
fournisseurs exclusifs de services, même au niveau régional ou local (les régies municipales
de l’eau) sont menacés. Les obligations de service universel, c’est-à-dire tout ce dont un Etat
estime devoir faire bénéficier l’ensemble de sa population : santé, éducation, poste, etc.
L’AGCS repose sur des règles juridiquement contraignantes où les droits des
investisseurs valent plus que les droits des Etats. Il ne faut pas que les Etats abdiquent face
aux multinationales.
Il faut que les socialistes s’informent et informent l’ensemble de la population des
accords qui se trament en haut lieu. Pour qu’une démocratie existe véritablement, il faut aussi
que le peuple soit au courant des enjeux et qu’il puisse utiliser pleinement sa souveraineté.
Pourquoi les négociations liées à l’AGCS sont-elles secrètes ? Les gouvernements ont-ils peur
l’opinion des citoyens ? N’est-ce pas une confiscation de leur pouvoir ? C’est à se demander
si la souveraineté dans l’ordre politique existe encore. C’est à se demander si la souveraineté

Contribution Section de Rethel, le 06 octobre 2014
3
dans l’ordre économique, si chère à Jean Jaurès, n’a été qu’effleurée de manière éphémère
pendant quelques décennies révolues, n’est qu’une utopie. Le temps du servage revient au
galop …
Cependant, voici ce qu’aurait pu être la réponse de Jaurès, celle par laquelle il
concluait son discours le 21 novembre 1893 à l’Assemblée Nationale face à la réaction :
« et pendant que vous userez ce qui peut vous rester de force et de prestige à lutter
contre le peuple en marche, dans les intervalles que nous laisseront vos persécutions
impuissantes, nous apporterons les projets de réforme que vous n'avez pas apportés ; et,
puisque vous désertez la politique républicaine, c'est nous, socialistes, qui la ferons ici. »
C’est aux socialistes de porter la politique républicaine, il ne faut pas que le Parti
l’oublie. Le Parti doit donc s’opposer de toutes ses forces à l’AGCS et autres accords du
même type atteignant la souveraineté du peuple.
C’est par là que passe la modernisation et l’amélioration de l’Etat social.
1
/
3
100%