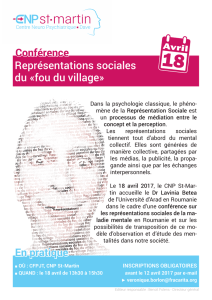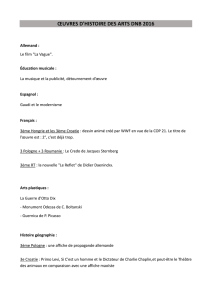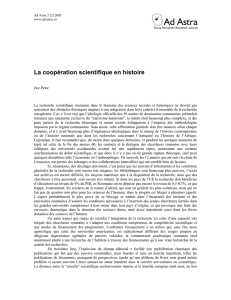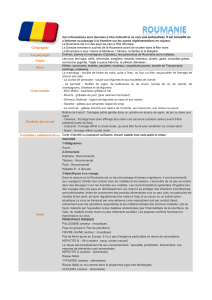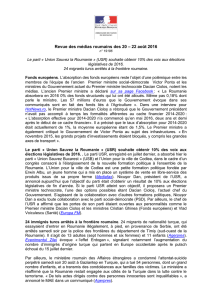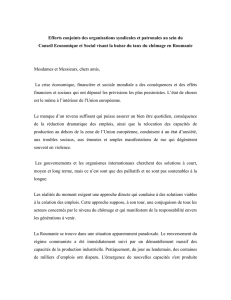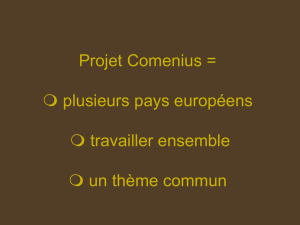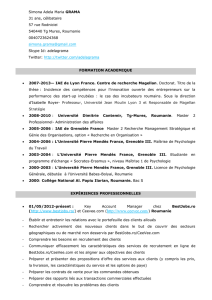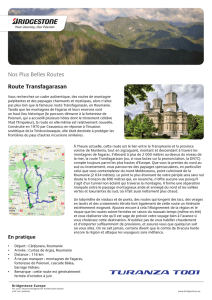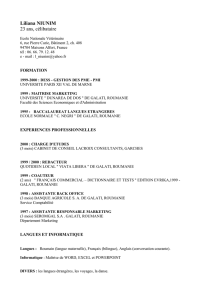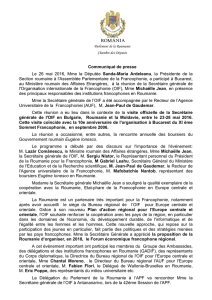Le croisement de l`intensité énergétique avec l`indépendance

1
Les instruments économiques de la politique environnementale :
politique énergétique et analyse préliminaire pour la construction
d’un MEGC
1
appliqué à la Roumanie
Rodica SANDU-LOISEL
CARE (Centre d’Analyse et de Recherche en Economie)
Université de Rouen
Résumé
Avec l’élargissement de l’UE, la question du rapprochement législatif est posée pour les
PECO et les Etats membres afin de trouver une position commune de négociation pour
chacun des 31 chapitres de l’acquis. L’analyse de l’opinion publique montre une
préoccupation croissante de la population pour la qualité de l’environnement, mais celle-ci
perçoit souvent son amélioration comme étant une responsabilité de l’Etat.
Dans ce contexte, compte tenu des conditions économiques et sociales actuelles en Roumanie,
ce papier étudie l’intervention de l’Etat dans la politique environnementale par les instruments
économiques. Ainsi, la mise en oeuvre de ces instruments est conditionnée par la capacité des
secteurs public et privé et des ménages à payer pour la protection environnementale.
Afin d’analyser la façon dont la Roumanie peut s’aligner aux exigences communautaires sans
graves distorsions budgétaires, économiques et sociales, nous nous intéressons aux impacts
que la réforme énergétique aura sur les ménages et sur la compétitivité industrielle. A cet effet,
nous élaborons un modèle d’équilibre général calculable dynamique à long terme. Le projet se
propose d’analyser les hypothèses de construction du modèle dans la perspective de simuler
l’application d’un dosage de politiques énergétiques qui cadrerait au mieux avec le contexte
juridique, économique et social roumain.
Introduction
1
MEGC = Modèle d’Equilibre Général Calculable

2
L’adhésion des PECO à l’Union Européenne (UE) représente la préoccupation principale de
ces pays, orientée dans un premier temps vers l’adoption de « l’acquis communautaire »,
organisées autour de 29 chapitres. Le processus d’intégration suppose l’adoption et
l’application de la législation de l’UE dans tous les secteurs, l’environnement y compris. Les
enjeux environnementaux qui en découlent diffèrent d’un pays à un autre en fonction des
conditions macro-économiques et sectorielles, de la taille, de la localisation géographique et
des structures productives, ainsi que des caractéristiques des milieux naturels. Dans le
calendrier du futur élargissement de l’UE, le chapitre « Environnement », numéro 22, a été
fermé
2
avec Chypre, la République tchèque, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie,
Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie. Les négociations continuent avec la Bulgarie
et la Roumanie.
Le processus d'élargissement, par la pression exercée sur les pays en vue de modifier leur
politique environnementale, représente un instrument efficace du respect des normes
écologiques de l'UE. Mais la transposition de l'ensemble de l'acquis communautaire
s’accompagne, pour les Etats adhérents, d’un coût très élevé par rapport à leur produit
intérieur brut. En ce qui concerne l'environnement, les PECO doivent non seulement adopter
et mettre en œuvre la législation, mais également contribuer aux dépenses à hauteur de 2% à 3
% de leur PIB.
Pour la Roumanie, les directives-clés, lourdes en termes d’investissements (17,8 mld euros,
MAPM 2003), concernent l’approvisionnement et l’assainissement de l’eau, la gestion des
déchets (décharges, incinérations et emballages) et la pollution atmosphérique (directives
relatives aux grandes installations de combustion et à la qualité de l’air). Les coûts élevés de
l’adoption de l’acquis et le développement économique expliquent l’allongement de la
période d’adaptation
3
. La pression que constituent ces besoins de financement est repartie
entre le budget central, les budgets locaux et les prêts à long terme. A part les aides
internationales (Phare, ISPA, SAPARD, la Banque Mondiale, la BERD, le Centre Régional de
l’Environnement etc.), le financement est supporté dans tous les cas de figure par les ménages
roumains. La capacité contributive des ménages est la clé de voûte de la politique de
financement à mettre en place, mais à court terme elle semble limitée.
La question que nous posons est de savoir comment financer le coût du rattrapage de l’acquis
environnemental en intégrant les coûts des dommages environnementaux dans le prix du
service directement payé par les consommateurs. Nous nous interrogeons sur la fiscalité à
adopter pour alléger les charges des contribuables.
Afin de décrire la manière dont la Roumanie a développé sa politique environnementale dans
le souci de se rapprocher des normes internationales, nous illustrons dans la première section
les modalités d’intervention publique à travers les instruments économiques. Dans une
deuxième section, nous abordons une approche sectorielle pour mieux analyser les modalités
d’application des instruments, en particulier les permis négociables d’émissions de CO2 dans
le secteur énergétique, via un MEGC.
2
En décembre 2002, dans le contexte de leur intégration prévue pour le 1er mai 2004.
3
Jusqu’en 2020 pour le secteur des déchets et jusqu’en 2022 pour le secteur de l’eau (Salles, 2003).

3
1. Les instruments économiques de la politique environnementale : le cas de la
Roumanie
La complexité inhérente au processus de développement des PECO réside dans le difficile
arbitrage entre croissance et qualité de vie d’une part, développement et environnement
d’autre part. Une manière de réconcilier ces intérêts divergents est l’utilisation des
instruments fiscaux et financiers dont la logique relève du concept de développement durable.
La politique environnementale en Roumanie a été traditionnellement dominée par la
régulation normative ; l’introduction des instruments économiques s’en heurte. Cela entraîne
une transformation institutionnelle, mais le rôle prioritaire parmi l’ensemble des agents
économiques appartient à l’Etat, puisque les forces de marché ne sont pas suffisantes pour
assurer un développement durable.
Dans cette section, nous présentons certains aspects de la transition roumaine vers l’économie
de marché, les éléments qui justifient l’intervention de l’Etat dans la protection de
l’environnement et les limites de cette dernière.
1.1 La transition en Roumanie
Le point de départ du processus de transition a été plus difficile en Roumanie que dans les
autres PECO. Les politiques autarciques ont conduit à une focalisation excessive sur les
industries lourdes et les projets de grandes infrastructures. Durant les années 1980, le
remboursement rapide d’une dette extérieure de 11 mld USD (20-30% du PIB) a imposé des
sévères contraintes sur la population, avec une limitation des importations et une aggravation
du retard technologique (Salles, 2003).
A partir de 1991, les nouveaux gouvernements ont commencé une refonte institutionnelle et
organisationnelle générale dans tous les secteurs et à tous les niveaux de l’économie, par une
approche graduée souhaitant protéger les intérêts constitués et minimiser les coûts sociaux. La
spécificité de la Roumanie, dix ans après sa transition, apparaît dans la structure économique -
poids des actifs dans le secteur secondaire, importance de la consommation d’énergie, poids
de l’investissement public - et ensuite dans la qualité - relativement médiocre - des institutions
qui assurent la représentation démocratique et qui régulent l'activité de marché (Labaronne,
2003). L’originalité de la transition à l’Est est que le volet démocratique a précédé le volet
économique ; ainsi la Roumanie remplit les critères politiques de Copenhague. Mais elle n’est
pas encore une économie de marché fonctionnelle puisque les structures politiques ont étaient
mises en place avant le lancement des premières réformes économiques et institutionnelles.
Cette stratégie n’a pas permis de produire des gains économiques et sociaux durables. La
pauvreté a fortement augmenté et la part de la population pauvre était de 20% à 40% en 1999
(la Banque Mondiale, 2002).
A partir de 2000, le pays a enregistré des progrès dans la réforme et la restructuration
économique, favorisés en partie par le début des discussions sur l’accession à l’UE à Helsinki
fin 1999. En effet, l'adhésion à l'Union européenne joue un rôle d'ancrage extérieur favorable
aux réformes institutionnelles de nature politique ou économique dans les pays candidats. Les
indicateurs récents montrent un certain nombre de développements positifs : croissance du
PIB de 5.3% en 2001 (la plus forte d’Europe), 5% en 2002 et 4.5% en 2003 ; l’inflation qui
était supérieure à 50% en 1999, a chuté à 18% en 2002 ; les réserves de devises de la banque
centrale étaient de 7 mld USD fin 2002 (soit l’équivalent de cinq mois d’importations) ; le
déficit budgétaire a été maintenu à 3.1% du PIB en 2001 et 2002 ; le volume d’exportations a

4
été le plus élevé de l’histoire du pays en 2002 ; le taux de chômage fluctue autour de 8% et les
investissements directs étrangers augmentent (Salles, 2003). Même si la Roumanie reste le
pays le plus pauvre accédant à l’UE (2000 USD/ hab., 5000 en PPA), l’ensemble des
indicateurs conjoncturels apparaît favorable pour l’évolution économique du pays.
1.2 Les instruments économiques de la politique environnementale
La théorie avance toute une série de raisons pour expliquer les défaillances du marché
(externalités négatives, inexistence des droits de propriété sur l’environnement). En l’absence
d’intervention de l’Etat par des mesures correctives, ces défaillances persisteront avec les
résultats sous-optimaux qui en découlent.
1.2.1 Nécessité de l’intervention de l’Etat
Le fondement de l’analyse économique de la pollution met l’accent sur les notions
d’externalités, de biens publics et de droits de propriété. Le concept d’externalité est défini
(Pigou, 1920) comme la situation où les décisions d'un agent affectent directement d'autres
agents ; faute d'une définition incorrecte des droits de propriété, le marché ne fera pas payer
l'agent pour l’effet négatif de son activité. Dans ce cas, la pollution apparaît comme une
externalité dite négative, dont l’existence est liée à l’utilisation d’un bien environnemental
public pour lequel se pose le problème d’existence de droits de propriété. On définit le bien
public comme étant le bien ou le service dont la consommation est collective et non exclusive
et pour lequel les droits de propriétés ne sont pas définis. En l’absence d’intervention des
pouvoirs publics, les biens environnementaux sont généralement considérés comme des biens
publics.
Si des externalités existent, c’est parce qu’il est plus coûteux en terme de transactions de les
faire disparaître que de les supporter. Le concept de coûts de transaction (Coase, 1960) traduit
l’existence de coûts spécifiques dus à la coordination d’un grand nombre d’agents qui suppose
des coûts de recherche de partenaires, des coûts de contrats, des coûts de collecte de données
et du contrôle du niveau de pollution. Les coûts supportés par les agents sont, dans ce cas,
supérieurs aux bénéfices attendus (Beaumais, Chirouleu-Assouline, 2001).
Internaliser les externalités rend nécessaire l’intervention de l’Etat par des instruments tels
que les normes, les taxes, les subventions et les marchés de droits, qui permettent de réaliser
l’optimum, mais avec des effets redistributifs différents. L’expérience des pays industrialisés
dans le domaine de la promotion de la politique environnementale sert de base pour étudier la
possibilité de son adaptation au cadre juridique, économique et social spécifique à la
Roumanie. Le souci de la politique roumaine pour la protection de l’environnement se
retrouve dans l’introduction des concepts de développement durable et du principe pollueur-
payeur dans le nouveau cadre de la loi environnementale adoptée en 1995
4
.
Malgré la préoccupation croissante de la population pour la qualité de l’environnement,
l’analyse de l’opinion publique montre que celle-ci perçoit souvent son amélioration comme
étant une responsabilité de l’Etat. Les consommateurs et les producteurs ne suivent pas
souvent la rationalité économique dans leur choix et sont gouvernés par l’inertie de
l’habitude, l’indifférence à la protection de l’environnement, le bas revenu et le taux élevé
d’actualisation (Mima, 1996) qui caractérisent la population roumaine après 40 ans de
4
La Loi n° 137/1995, du 31 décembre 1995

5
communisme. Dans ce contexte, il appartient à l’Etat d’intervenir pour élargir cette rationalité
par l’utilisation d’un ensemble de politiques qui contient à la fois des instruments
réglementaires, économiques et persuasifs (la responsabilité en matière d’environnement, les
accords volontaires et l’éducation écologique).
1.2.2 Les instruments de la politique environnementale en Roumanie
Les instruments réglementaires fixent les concentrations maximales d’un polluant donné
dans les différents milieux tels que l’air et le sol, en recourant soit à la contrainte soit à la mise
en place de mécanismes incitatifs, laissant un fort degré de liberté aux agents. Les instruments
les plus répandus sont les normes de qualité de l’environnement et les permis d’activité
accordés à la base des normes fixées et des caractéristiques techniques de l’activité. La
Roumanie était déjà dotée de systèmes de normes de qualité de l’environnement (la loi n°
9/1973, complétée par la lois n° 127/1994), souvent bien plus sévères que celles des pays de
l’OCDE et pour autant complexes et difficiles à administrer. Les permis d’activité sont
obligatoires pour la pollution atmosphérique et pour l’utilisation des ressources en eau.
Les instruments économiques reposent sur l’hypothèse que les marchés sont les plus
efficaces pour traiter une multitude d’informations qui orientent les décisions des agents de
telle sorte que la répartition des ressources soit réalisée. Le rôle du signal prix est donc
déterminant (Vallée, 2002). Nous allons présenter brièvement les taxes et les redevances,
les subventions, le Fonds pour l’environnement et les permis négociables.
Les taxes environnementales permettent d’amener le producteur pollueur à internaliser les
effets externes engendrés par son activité. Elles participent au financement public général et
sont destinées à lancer un signal-prix, au sens où leur revenu n’est pas directement affecté au
financement de la politique environnementale. La Roumanie n’applique aucune taxe sur les
émissions atmosphériques, bien que des propositions aient été faites (la taxe sur le contenu en
souffre des combustibles, la taxe sur les émissions atmosphériques) (REC, 2002). Toutefois, il
existe des pénalités sur les émissions atmosphériques lorsque les niveaux autorisés sont
dépassés, mais celles-ci sont mises en application au cas par cas et ne sont pas liées
corrélativement à la quantité de pollution émise. Le bas niveau des pénalités (100- 400 EUR ;
Bluffstone, 1997) ne fournit aucune incitation pour les entreprises à réduire leur pollution et
leur but est, pour l’instant, éducatif.
Les redevances sont en revanche des paiements en contrepartie de services rendus, dans des
domaines tels que l’eau, l’air, le bruit et les déchets. Une redevance environnementale peut
être prélevée purement dans le but de changer les comportements préjudiciables à
l'environnement et sans aucune intention d'engendrer des recettes, même si ces dernières sont
probables. Les redevances que le système roumain prévoit sont prélevées pour la
consommation directe et pour l’assainissement de l'eau de 56 euros/ménage/an, et pour la
collecte des ordures et les décharges des déchets de 22 euros/ménage/ 2003 (Salles, 2003).
Les subventions représentent un transfert monétaire versé aux pollueurs pour qu’ils polluent
moins. Leur utilisation soulève la question de leur compatibilité avec le principe pollueur-
payeur puisque le financement de la politique environnementale s’appuie sur les
contribuables. Les subventions ont diminué dans tous les pays en transition presque dans tous
les secteurs depuis 1990, résultat direct du déficit budgétaire de l’Etat. Comme dans l’Europe
de l’Ouest d’ailleurs, elles jouent toujours un grand rôle dans les secteurs de l’énergie (5% du
PIB en Roumanie ; Cossé, 2003), de l’agriculture et des transports.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
1
/
27
100%