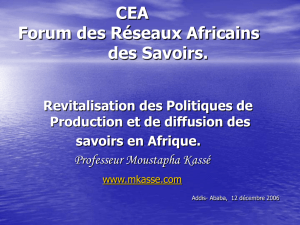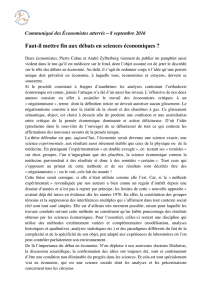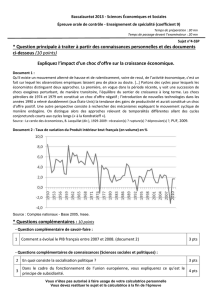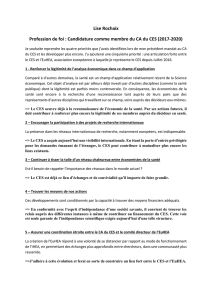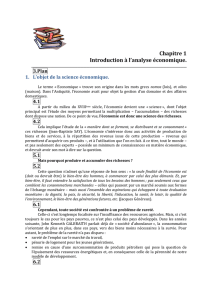LE ZOMBIE, LE LAMPADAIRE ET LE CYGNE. CRITIQUES DE L

1
LE ZOMBIE, LE LAMPADAIRE ET LE CYGNE.
CRITIQUES DE L’ECONOMIE ORTHODOXE EN DEBUT DE MILLENAIRE
Depuis la crise financière de 2008, la demande sociale d’explications économiques est plus forte que
jamais ce qui explique en partie le flot quasi ininterrompu de parutions d’ouvrages économiques. Dans
un premier temps, ces livres se sont surtout polarisés sur l’analyse de la crise financière, l’explication
détaillée des subprimes, de la titrisation et des CDS, quelques uns se risquant proposer des solutions
alternatives. Puis, très vite, s’est imposée l’idée que derrière cette crise financière il y aurait aussi une
crise de la « pensée économique », pensée généralement perçue comme un bloc monolithique
correspondant grossièrement à ce qu’on appelle parfois le « mainstream », cette idée s’appuyant sur le
fait (très contestable) qu’aucun économiste n’aurait vu venir la crise. A ce titre on a répété à l’envi la
déclaration de la reine Elizabeth II d’Angleterre à la London School of Economics en Novembre
2008 : « Pourquoi personne n'a-t-il vu venir la crise financière ? »
La production éditoriale s’adapta donc et nous eûmes énormément de livres remettant en question « la
théorie économique », de manière plus ou moins abrupte, plus ou moins habile, critiques provenant
d’auteurs appartenant au cœur du champ de la science économique, pour certains, à sa périphérie pour
d’autres, voire totalement extérieurs (sociologues, anthropologues, psychologues,...). Nous proposons
ici un passage en revue de quelques uns de ces ouvrages, tous postérieurs à 2008 ou 2009
1
.
AVEUGLEMENT SOUS UN LAMPADAIRE
Est-il vrai qu’aucun économiste n’aurait vu venir cette crise ? Dans l’ouvrage collectif « A
quoi servent les économistes ?», Christian de Boissieu et Bertrand Jacquillat rappellent que, bien au
contraire, les alertes ont été lancées en 2005 et 2006 par Roubini, Shiller, Aglietta,...et bien d’autres
2
.
Cela permet donc à André Cartapanis, dans ce même ouvrage, de tracer une frontière relativement
nette entre les économistes mainstream et les autres. C’est le travail des premiers, et surtout leurs
modèles, qu’il faut critiquer. Certains économistes (Krugman par exemple
3
) reprochent à ces
économistes d’avoir été plus sensibles à la mathématisation des modèles qu’à leur pertinence. Pour De
Boissieu et Jacquillat, ce n’est pas l’essentiel et ils se demandent surtout si ce sont les bons problèmes
qui ont été modélisés. Ainsi, ils critiquent les modèles macroéconomiques dans lesquelles la sphère
financière est ignorée ou perçue comme parfaite (ce qui est deux manières de dire la même chose) ;
ces modèles, disent-ils, n’ont pas la mémoire des crises financières et laissent peu de place à la
réflexivité et aux externalités. En clair, si les économistes n’ont pas vu venir la crise c’est que leurs
modèles ne le leur permettaient pas. Selon Stoffaes (dans le même ouvrage
4
), en abandonnant les
modèles keynésiens au profit des modèles de finance de marché, les économistes des années 2000 ont
accordé une caution scientifique aux excès de la finance de cette période.
1
Cette liste n’est, bien entendu, pas exhaustive et le choix des livres répond à un principe très simple qui est
celui de mes lectures, de mes engouements et du hasard des rencontres. Il manque donc énormément d’ouvrages
et sûrement des ouvrages essentiels.
2
On peut rappeler que les avertissements avaient été faits dans des ouvrages grand public dès 1999 par Georges
Soros dans « la crise du capitalisme mondial » et André Orléan dans « Le pouvoir de la finance ». On peut
signaler également l’article de James Galbraith « Mais qui sont donc ces économistes ? » accessible sur le site de
« la vie des idées » - http://www.laviedesidees.fr/Mais-qui-sont-donc-ces-economistes.html
3
Paul Krugman : « nous nous sommes tant trompés » - 2 septembre 2009 -
http://contreinfo.info/article.php3?id_article=2778
4
Christian Stoffaës : « La financiarisation des économistes » in Christian de Boissieu et Bertrand Jacquillat
(dir.) : « A quoi servent les économistes ? » - P.U.F. – 2010.

2
Si les économistes mainstream n’ont pas abordé les bons problèmes, c’est peut-être parcequ’ils
ne se sont attaqués qu’aux problèmes que leurs outils leur permettaient d’aborder. C’est la vieille
histoire de l’ivrogne qui cherche ses clés sous un lampadaire alors qu’il les a perdues ailleurs, parce
que le lampadaire lui offre la lumière nécessaire ; mais c’est aussi le titre du dernier livre de Jean Paul
Fitoussi, « le théorème du lampadaire »
5
. Son ouvrage déborde largement la question que nous nous
posons ici mais il lui consacre le premier chapitre intitulé « La théorie à la renverse » et il n’y va pas
avec le dos de la cuiller, qualifiant les théories mainstream de « conte pour enfants », titre de la partie
dans laquelle il écrit : « Si je pars des hypothèses que, d'une part, la rationalité permet de résoudre tous les
problèmes du monde et que, d'autre part, dans le champ de l'économie, l'homme est un individu rationnel, je
définis une science où la recherche ne permet pas de progresser, puisqu'elle n'a aucun problème à résoudre. ».
Mais il a aussi ce propos : « Je m'interroge depuis longtemps sur les raisons qui poussent une majorité
d'économistes, dont certains parmi les meilleurs, à investir leur intelligence dans la construction de théories dont la
complexité le dispute à l'inutilité » (p.22)
Il y aurait donc eu un « aveuglement » de la part de la majorité des économistes
« mainstream ». Mais comment expliquer cet état de fait ? Les économistes mainstream ayant
le vent en poupe, isl se seraient laissés prendre par une ambiance générale une « zeitgeist »
qui était, selon Cartapanis
6
, plus une idéologie qu’une science et étouffa toutes les approches
ne relevant pas de leur démarche. On retrouve la même idée sous la plume de Fitoussi :
« Mais, plutôt que de tenter d'analyser les nouvelles réalités, la plupart des économistes
entreprirent une course à la théorie pure, rejetant avec mépris toute proposition dont les
fondements micro-économiques (l'optimisation du comportement des agents) n'étaient pas
impeccablement assurés » (Fitoussi p.22-23).
LE SAVANT ET LE FOU
Comme nous le savons, l’homo oeconomicus est au cœur de ces démarches « mainstream ».
Bien sûr, tout apprenti économiste sait que ce personnage ne correspond pas à la réalité mais
est un ideal-type au sens de Weber, une simplification utile pour analyse r des problèmes
complexes, ce qui n’interdit pas ensuite de « relâcher » les hypothèses pour rendre le concept
plus « réaliste » (asymétries d’information, par exemple). Pourtant, « Le triomphe de la
cupidité »
7
de Stiglitz ne laisse pas de surprendre : théoricien des asymétries d’information,
on pourrait s’attendre à ce qu’il mette cette démarche en avant. On a un tout autre discours :
« J’ai vite compris que l’attachement de mes collègues au postulat de la rationalité était
irrationnel, et qu’ébranler leur foi ne serait pas simple. J’ai donc choisi l’angle d’attaque le
plus facile ; j’ai accepté le postulat de la rationalité, mais j’ai montré que même d’infimes
changements dans les hypothèses sur l’information modifiaient entièrement tous les
résultats ». (p. 396-397). Loin de l’épistémologie ou de la méthodologie, l’acceptation de
l’individu rationnel relève alors de la stratégie et Stiglitz, à propos des modèles à agent
représentatif, n’hésite pas à écrire que « Nombre des conclusions (manifestement absurdes)
auxquelles parvient cette école sont dues à ces simplifications extrêmes (...) » (Stiglitz p. 411). Loin
de soutenir cette modélisation, il n’hésite pas à évoquer les travaux de Dan Ariely, psychologue
versé dans la science économique et titulaire de la chaire d'économie comportementale (Behavioral
Economics) au MIT, lequel développe surtout des expérimentations psychologiques et, qui plus est,
5
Jean Paul Fitoussi : « Le théorème du lampadaire » - « Les liens qui libèrent » - 2013
6
Dans Christian de Boissieu et Bertrand Jacquillat (dir.) : « A quoi servent les économistes ? » - P.U.F. – 2010
7
Joseph Stiglitz : « Le triomphe de la cupidité » - « Les liens qui libèrent » - 2010.

3
aussi souvent sur le terrain et « sauvages » qu’en laboratoire et contrôlées. A travers des
expérimentations souvent très surprenantes, il s’attache à montrer que l’individu, et notamment le
consommateur, est plus souvent irrationnel que rationnel mais que les entorses à la rationalité qu’il
commet sont suffisamment stables pour être prévisibles
8
.
L’irrationalité (ou la non rationalité) est également au centre de l’ouvrage d’Akerlof et Shiller, « Les
esprits animaux – Comment les forces psychologiques mènent la finance et l’économie ». Le premier
est professeur d’économie à Berkeley - bien connu pour ses lemons et asymétries d’information - et
prix Nobel ; le second est professeur d’économie et de finance à Yale. Difficile de les classer « en
dehors » du champ reconnu de l’analyse économique. Dans ce livre grand public (donc aisément
accessible), les auteurs cherchent à retrouver la radicalité de l’approche keynesienne (par opposition
au Keynes de la synthèse) et à s’appuyer sur les résultats de « l’économie comportementaliste » et sur
« soixante dix ans de recherches en sciences sociales » (p.7). Ils pensent que le modèle standard actuel
ne s’intéresse qu’à une question : « comment l’économie réagit-elle quand les hommes n’obéissent
qu’à des motivations d’ordre strictement économique et y répondent de façon rationnelle ? » oubliant
tous les cas où les motivations sont d’ordre autres qu’économiques et les réponses irrationnelles.
S’intéresser à ces autres questions suppose de tenir compte des « esprits animaux » à savoir la
confiance, la recherche d’équité (ou du moins l’idée qu’on s’en fait), la mauvaise foi, l’illusion
monétaire et le gout des histoires (les auteurs reprennent le concept de storytelling). Comprendre, par
exemple, l’ampleur de la bulle immobilière implique que l’on prenne en compte ces « esprits
animaux ». Que les emprunteurs fortement endettés et victimes des subprimes, ceux là dont Stiglitz dit
qu’ils sont des analphabètes financiers, aient pu être irrationnels, on peut l’admettre. Mais les
financiers eux mêmes ? Voila ce qu’en dit un homme de terrain, Bertrand Collomb, président
d’honneur du groupe Lafarge, dans la préface de l’ouvrage collectif « L’Economie, une science qui
nous gouverne ? » : « J’ai aussi appris à connaitre les financiers. J’ai observé le caractère inévitable
des comportements financiers irrationnels. D’aucuns voudraient les discipliner. Je doute que cela soit
possible. On peut certes le tenter en leur imposant des règles. Mais modifier leur comportement en
profondeur, je n’y crois pas un instant, et j’ai quelques expériences pour appuyer mon jugement ».
(p.20).
UN MODELE A NE PAS SUIVRE ?
Mais l’irrationalité des individus n’est pas la principale cause de la crise financière que nous
avons connue. Paul Jorion, qui s’est trouvé au centre du séisme pour avoir travaillé au sein de Country
wide, en a fait l’expérience de terrain et nous dit dans « Misère de la pensée économique » que si la
cupidité a eu son rôle dans cette crise, la responsabilité principale est à chercher dans le choix des
modèles financiers. Il est maintenant bien connu que les modèles utilisés pour des opérations
financières et largement utilisés depuis les années 70, sont totalement inadaptés à la réalité de ces
marchés. Parmi tous les livres qui ont abordé ce problème « Le virus B – Crise financière et
mathématiques » de Christian Walter et Michel De Pracontal présente l’avantage d’être très
pédagogique et accessible à un grand public
9
. Les auteurs montrent que les modèles majoritairement
utilisés en finances reposaient sur l’hypothèse du « mouvement brownien » (ou de la courbe de gauss
ou la loi normale,…) c'est-à-dire que l’on suppose que les cours des titres devraient s’établir autour
d’une moyenne (fixée par la « valeur fondamentale » du titre) et que les phénomènes extrêmes (sous
évaluation ou sur évaluation) sont rares.
8
Dan Ariely : C'est (vraiment ?) moi qui décide 2008- Flammarion
9
Christian Walter et Michel De Pracontal : « Le virus B – Crise financière et mathématiques » – Seuil – 2009

4
Mais cette hypothèse suppose que les évènements sont indépendants, ce qui ne correspond pas
à la réalité des marchés. De ce fait, les évènements explosifs sont sous évalués. La crise économique
serait donc du non seulement à une crise de la théorie économique mais plus précisément à une crise
des modèles, liée à un mauvais choix des hypothèses sous jacentes.
Les critiques provenant d’auteurs reconnus sont donc sévères. « Pour que l’économie retrouve la
raison »
10
, livre collectif coordonné par Claude Mouchot est plus radical encore. Reprenant les
critiques habituelles sur l’hypothèse de l’individu rationnel, Mouchot invite à distinguer « rationnel »
et « raisonnable », insiste sur l’incertitude et le caractère performatif de l’économie et n’hésite pas à
titrer un chapitre « Impostures de la théorie orthodoxe ». Il s’agit là d’un ouvrage que j’ai trouvé
extrêmement stimulant (même si je ne lui consacre que quelques lignes).
DECEPTION DU COTE DE L’ANTHROPOLOGIE
Mais la critique vient aussi de l’extérieur du champ des économistes, le plus connu de ces
critiques étant Paul Jorion. Paul Jorion est apparu comme un trublion dans le monde de la science
économique en publiant « Vers la crise du capitalisme américain ? » en 2007, peu de temps avant le
déclenchement effectif de la crise des subprimes, annonçant donc non seulement l’imminence d’une
crise mais également le fait qu’elle démarrerait dans le secteur des prêts à risque de l’immobilier
américain. Jorion n’est pas économiste mais anthropologue (sa thèse a porté sur la fixation des prix sur
le marché au poisson de l’ile d’Houat
11
), il est également spécialiste sciences cognitives et enfin il
travaillait en 2006 chez Country Wide, c'est-à-dire au cœur même des activités où démarrera la future
crise des subprimes. Doit-on attribuer la qualité de ses prévisions à sa formation particulière ou au fait
qu’il s’est trouvé au bon endroit au bon moment ? Toujours est il qu’il jouit d’une très grande notoriété
(son blog connait entre 10 000 et 20 000 visites par jour) et a une production éditoriale assez
impressionnante (une dizaine de livres entre 2007 et 2012) parmi lesquels on peut retenir (pour le
propos qui nous concerne ici) « l’argent, mode d’emploi » (2009), « Le prix » (2010) et « Misère de la
pensée économique » (2012). Dans « L’argent, mode d’emploi », il entreprend de revoir l’analyse de la
monnaie en critiquant notamment les bases mises en place, d’après lui, par Schumpeter
12
, et envisage
une « véritable révolution » de l’analyse économique semblable à ce que Freud a fait pour la
psychologie. « Le prix » est consacré à une critique de la « loi de l’offre et de la demande » fondée sur
un retour à l’analyse d’Aristote. Dans « Misère de la pensée économique » il entreprend de redresser
une discipline qui, d’après lui, est partie dans une mauvaise direction depuis, et à cause de, Karl Marx.
S’il y a des éléments à retenir (notamment sur sa critique de la création monétaire) force est d’avouer
(je dis « avouer » car j’avais mis beaucoup d’espoir chez cet auteur) que le résultat est plutôt décevant.
L’explication en est simple : si les réflexions de Jorion sont passionnantes lorsqu’il s’appuie sur ses
travaux et sa pratique personnelle (notamment les apports ethnologiques dans « le prix » et son
expérience de trader relatée dans « Misère de la pensée économique »), sa critique est limitée par
l’insuffisance de ses références théoriques (pour exemple, dans son livre sur l’argent il n’y a aucune
mention de Simmel, Simiand, Aglietta, Orlean, Zelizer, …).
En 2011 parait un petit livre d’une centaine de pages titré « L’économie n’existe pas » et écrit
par Bernard Traimond, professeur d’anthropologie à Bordeaux. Critique sans appel reposant sur le
fait (avéré) que les termes économiques, et le terme « économie » lui même, sont imprécis et
10
Claude Mouchot (dir.) « Pour que l’économie retrouve la raison » (Economica – 2010)
11
Paul Jorion : Les pêcheurs d’Houat : anthropologie économique, coll. « Savoir », Hermann, Paris, 1983
12
Paul Jorion : « L’argent, mode d’emploi » - Fayard - 2009

5
polysémiques, que les modèles utilisés sont souvent bien loin du réel et que l’idéologie y a sa part.
L’auteur met le doigt sur le contraste entre un discours devenu dominant et son extrême fragilité. Si
l’intention est plaisante, la démolition est un peu sommaire et , minorant la complexité et la diversité
des recherches économiques, rate sa cible.
« Un Fermier attrapa le plus beau des cygnes, croyant tenir une belle oie grasse» (fable)
Mais il existe aussi des économistes qu’on peut situer à la périphérie du champ économique
par leur positionnement et leur trajectoire, par exemple un ancien économiste maintenant présenté
comme philosophe (Jean Pierre Dupuy) ou un philosophe devenu financier qui s’intéresse à la théorie
économique (Georges Soros).
Jean-Pierre Dupuy fut probablement un des premiers à importer les travaux de René Girard
dans l’analyse sociologique et économique
13
. En 2012, il publie « l’avenir de l’économie »
14
, ouvrage
dans lequel il s’inquiète de la manière dont l’économie a pu s’autonomiser, perdant tout référent
extérieur, pour prendre la place de la politique tout en étant incapable de proposer quelque perspective
à la collectivité (« économystification »). L’ouvrage est cependant plus consacré à une approche
originale du problème économique qu’à une critique des modèles traditionnels.
Pour Dupuy, la logique « rationnelle » attribuée aux individus par les économistes les rend incapables
de s’associer du fait que toute association repose sur la confiance. Toutefois, il est possible de
concilier raison économique et raison politique si les hommes perçoivent le même avenir et le
perçoivent comme indépendants de leurs actions (« La description de l’avenir est un déterminant de
l’avenir » - p 111). Cette « coordination par l’avenir » peut être assimilée à une forme de
« prédestination » ce qui permet de distinguer la rationalité classique des économistes et la rationalité
qui ressort de l’idée de la prédestination calviniste chez weber. La critique des approches économiques
dominantes n’est donc pas au cœur de son ouvrage mais Jean-Pierre Dupuy est bien obligé d’aborder
la question à divers moments et il n’est pas toujours tendre.
« Peut-on penser l’économie sans être économiste ? Non seulement on le peut mais la pensée de
l’économie serait débile si elle restait l’apanage des économistes » (p 21)
« Les explications de Becker et de ses nombreux épigones sont souvent baroques et parfois grotesques,
ce qui n’a pas empêché la communauté mondiale des économistes de lui faire décerner le prix Nobel
en 1992 (...) » (p 165)
« Je prétends qu’il faut sortir résolument de la discipline pour comprendre la nature du mal » (p. 22)
Au cœur de sa démarche, on trouve les concepts de performation, de prédiction créatrice et d’auto
transcendance. Parallèlement, Dupuy reproche aux approches traditionnelles en économie d’avoir
instauré une distinction entre subjectif et objectif (ou entre objet et sujet) qui ne tient pas dans les
sciences du social, et qui ne permet pas de saisir les processus d’imitation. En conséquence, ces
approches tendent à privilégier les distributions gaussiennes (courbe en cloche) et les dynamiques
empruntées à la mécanique rationnelle ou à la thermodynamique, souvent inadaptées à la
compréhension des phénomènes humains qui relèvent de dynamiques mimétiques. Pourtant, il aurait
pu en être autrement : « L’économie c’est le champ libre offert au déploiement de ce que René Girard
appelle le désir mimétique » (p 120) et les « grands », Smith, Hayek ou Keynes, avaient su théoriser
cette imitation mais pas ceux qui les ont suivi.
13
Jean-Pierre Dupuy et Paul Dumouchel, L'enfer des choses, Seuil, 1979
14
Jean Pierre Dupuy : « L’avenir de l’économie » - Flammarion - 2012
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
1
/
9
100%