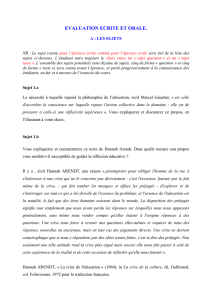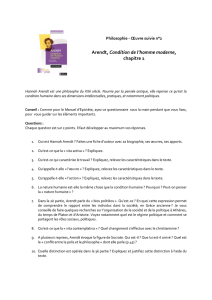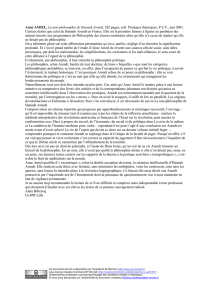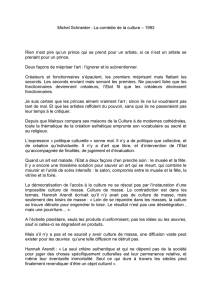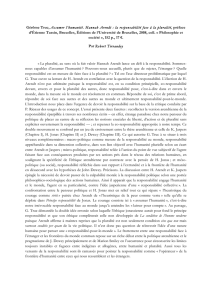La crise de la culture Hannah Arendt

La crise de la culture,
Hannah Arendt
Introduction
Le parcours d'Hannah Arendt est unique. Celle qui fit, tout au long de sa vie, preuve
d'un œcuménisme rare chez les intellectuels de son temps, était d'origine juive, bien
que non pratiquante. Elle s'intéressa d'abord au christianisme et soutint en 1928 une
thèse sur le concept d'amour chez Saint Augustin, sous la direction de Karl Jaspers.
Ayant fui son Allemagne natale à cause des persécutions nazies elle acheva d'écrire
un ouvrage magistral sur les origines du totalitarisme et a nourri de riches réflexions
sur la liberté humaine.
L'ouvrage étudié, dont le titre original, Between Past and Future, a été remplacé en
français par le titre - peut-être contestable - de La Crise de la Culture est un recueil
d'essais - ou d'exercices de pensée politique - rédigés entre 1954 et 1968. Ces huit
exercices ne constituent pas à proprement parler une unité logique puisque se
succèdent des thèmes aussi variés que "la crise de la culture", "la conquête de
l'espace et la définition de l'homme", ou "qu'est ce que la liberté?", mais Hannah
Arendt réaffirme tout au long de son œuvre sa conviction que les aspects les plus
authentiques et notables de la vie politique n'ont jamais été correctement traités par
la philosophie.
Nous allons organiser notre présentation autour des deux thèmes résonnants que
sont l'autorité et l'éducation. Si ces deux notions font l'objet d'un essai chacune, nous
veillerons à emprunter aux autres essais des éléments permettant de donner plus de
profondeur à la réflexion et d'envisager ces concepts sous l'angle plus global de la
pensée d'Hannah Arendt.
La crise de l'éducation est un thème récurrent des sociétés occidentales dites
"avancées", qui à force d'être périodique est devenue un enjeu politique déterminant
de nos sociétés. Cette crise est en partie liée à une autre crise évoquée par Hannah
Arendt dans un long processus de définition, celle de l'autorité, que nous évoquerons
à dans un premier temps.
Déclin d'autorité
Que dire en effet aujourd'hui du concept d'autorité sinon qu'il a généralement disparu
et qu'il n'est plus qu'un reliquat poussiéreux dans l'histoire séculaire des sciences
politiques. De quelle autorité s'agit-il? Ce concept, comme bien d'autres, multiforme
et largement polysémique, Hannah Arendt refuse d'en donner une définition
essentielle et naturelle et ne base son analyse que sur une évolution historique de
l'autorité.
La perte de l'autorité, ou plutôt des autorités traditionnelles, a été généralement
provoquée par la montée de mouvements politiques profitant souvent d'une
atmosphère sociale et politique dans laquelle le système des partis avait perdu son
prestige et l'autorité du gouvernement n'était plus reconnue. Un symptôme aggravant
de la crise qui frappe le concept d'autorité réside dans le fait que ce phénomène s'est
étendu aux sphères prépolitiques que sont l'éducation et la famille, domaines dans
lesquels l'autorité avait toujours été acceptée comme une nécessité naturelle,

requise autant par des besoins naturels, que par une nécessité politique: la continuité
d'une civilisation…
Mais il s'agit là surtout de la disparition d'un concept qui avait servi de modèle à un
grande variété de formes autoritaires de gouvernement. La déchéance de l'un amène
la perte de la plausibilité des autres, et l'on ne peut plus aujourd'hui savoir ce qu'est
l'autorité, sinon ce qu'elle fut.
Notre auteur oppose d'abord l'autorité à la force, mode antique de règlement des
affaires étrangères, puis à la persuasion, qui présuppose l'égalité et opère par un
processus d'argumentation. Une définition de l'autorité reposerait donc sur cette
double opposition à la contrainte par la force et à la persuasion.
Rappelons qu'historiquement, la disparition de l'autorité est analysée comme la
phase finale d'une évolution qui a sapé la religion et la tradition, dans sa rupture avec
l'âge moderne. Cependant, si en perdant la tradition - qu'on ne confondra pas avec le
passé -, nous avons perdu un fil conducteur dans les domaines du passé, ce fil liait
aussi des générations successives à un aspect prédéterminé du passé. Cela ne
manque certes pas d'intérêt mais met en péril la profondeur de l'existence humaine
qui est la mémoire de l'humanité. Hannah Arendt, au long de son ouvrage rappelle
régulièrement ce double enjeu : il faut tout à la fois éviter de raisonner en termes
prédéterminés, en idées toutes faites ou par des préjugés, et profiter alors de
l'occasion qui nous est donnée pour ré-entrevoir les choses sous un regard nouveau,
mais également ne pas perdre l'aspect fondateur et profond de la tradition, sorte de
permanence de l'humain et de l'histoire dans le passé, dont l'homme a besoin. En
termes d'autorité, notre auteur rappelle dans la même ambivalence que si la perte
d'autorité est associée à un monde de plus en plus fugace et protéen, cela n'entraîne
pas nécessairement la perte de la capacité humaine à construire un monde qui
puisse survivre et demeurer viable.
L'évolution des modèles d'autorité en tant que "pédagogiques" - puisque nous
parlons d'éducation - ne peut se réaliser que si l'on présume avec les romains qu'en
toutes circonstances les ancêtres représentent l'exemple de la grandeur pour chaque
génération successive. Partout où le modèle de l'éducation par l'autorité, sans cette
conviction première, a été plaqué sur le domaine politique, il a essentiellement servi
à couvrir une prétention de domination et a prétendu éduquer alors qu'il voulait
dominer.
La crise de l'autorité, évidente dans des domaines que la famille et l'école rejoint
d'une certaine manière, celle de l'éducation puisque toutes deux sont les révélateurs
agissants de ce passage entre la tradition et la modernité, "between past and future".
Crise de l'éducation
D'une manière générale, pour les philosophes, la réflexion sur l'éducation est
inséparable d'autres réflexions, notamment sur la nature humaine et sur la place de
la culture. Une question, en effet est de savoir si l'homme est "naturellement" bon, et
s'il faut alors soustraire d'une manière ou d'une autre les enfants aux influences
jugées "perverses" de la société. Ou bien s'il est à l'inverse "naturellement" soumis à
des pulsions dont il s'agirait de l'arracher par une éducation morale, donc normative.
Ou enfin s'il n'y a d'autre "nature" pour l'homme que d'être tout entier un être de
culture dont les comportements sociaux sont - contrairement aux autres créatures -
entièrement acquis. Pour Jacques Ulmann qui a consacré une bonne part de sa
réflexion à cette question, il est établi par les sciences sociales et humaines que
toute civilisation tend à ancrer l'homme dans une culture et à l'éloigner de la nature.

Toute doctrine, toute méthode éducative, se trouve donc contrainte - même à son
corps défendant - de se situer dans ce champ de tension fondamental. Soit elle
opère un choix résolu pour l'un ou l'autre pôle - comme les pédagogies inspirées de
l'anarchisme pour la nature, ou celle influencées par le marxisme pour la culture -,
soit elle cherche à les concilier - comme celles qui se réfèrent à Piaget ou Freud - ou
tend à dépasser leur opposition. Mais cette réflexion fondamentale ne peut suffire à
éclairer notre propos. Pour penser les rapports de l'éducation et des valeurs
aujourd'hui, il est nécessaire d'introduire la question de la démocratie. Pour Hannah
Arendt la double polarité qui structure l'éducation, et qu'on ne peut vraiment réduire à
la nature et la culture, est celle de l'enfant et du monde. Éduquer est toujours et à la
fois, selon elle, socialiser, assurer la vie, le développement et l'intégration des
enfants dans une société, et conserver, assurer la continuité du monde, transmettre
la tradition, le patrimoine culturel, dans le mouvement de succession des générations.
Éduquer en effet c'est en premier lieu transmettre les règles qui fondent toute vie en
commun dans la classe, dans l'établissement, dans la société, c'est une relation
inégalitaire, autoritaire, entre un adulte qui possède les savoirs et les règles et un
enfant qui ne les possède pas, ou pas tous, ou pas complètement. Mais en second
lieu, et dans le même temps, éduquer c'est aussi apprendre à juger par soi-même, à
rechercher la vérité, à critiquer, à faire évoluer et changer les règles, à modifier les
traditions.
Hannah Arendt refuse d'emblée l'idée selon laquelle la crise de l'éducation est un
phénomène local, contingenté par des ressorts culturels ou étatiques, et rejette cette
tentation spécificisante en dénonçant principalement cette attitude. "On peut
aujourd'hui poser comme règle générale que ce qui peut arriver dans un pays peut
aussi arriver dans presque tous les pays" disait-elle, il y a quarante ans, et le futur là
encore lui a donné raison.
L'enjeu de l'éducation, dans un tel contexte de crise est aussi l'occasion de repenser
le sujet en évitant les réponses toutes faites et les préjugés qui ne feraient que
rendre la crise plus aiguë.
Hannah Arendt resitue d'abord cette crise dans le contexte américain des années
1950 et associe la gravité de la crise à l'enjeu politique que représente l'éducation.
Celui-ci étant fortement présent aux États-Unis, pays d'immigration dans lequel seule
la scolarisation peut tenir la gageure de fondre en un seul peuple les groupes
ethniques les plus divers. La particularité américaine réside aussi dans sa volonté de
rupture et de refondation d'un nouvel ordre "Novus ordo Saeclorum", opposé à
l'ancien en termes économiques et politiques : ce nouvel ordre se doit de supprimer
la pauvreté et l'oppression. On retrouve alors un idéal d'éducation directement
influencé par Rousseau pour qui l'éducation devient un moyen politique et la politique
une forme d'éducation. L'article de Hannah Arendt sur La crise de l'éducation, publié
en 1958, était alors sans doute visionnaire. Les champs de bataille de la culture
s'étaient déplacés dans les écoles, où trois idées ravageaient les bases mêmes de
l'éducation : les enfants forment un monde à part, où l'adulte doit s'immiscer le moins
possible, le conformisme et la délinquance devraient-ils s'ensuivre ; l'enseignement
n'appartient plus aux maîtres, qui possèdent à fond une discipline, mais aux
pédagogues, généralistes de la science de l'enseignement ; il importe, autant que
possible, de substituer le faire à l'apprendre, le jeu au travail, l'expression de soi aux
connaissances pures. Avant de développer ces trois idées revenons à cette volonté,
alors américaine, de refondation d'un nouveau monde, plus juste et plus libre.
L'histoire a montré, depuis l'antiquité que les utopies politiques ont voulu fonder un
monde nouveau avec ceux qui sont nouveaux par naissance et par nature. Arendt
dénonce ici une erreur politique grave, dans la conception même de la politique : en

effet, au lieu de réunir ses semblables par la voie de la persuasion, on intervient de
façon dictatoriale qui se fonde sur la supériorité absolue de l'adulte et on essaie de
"mettre en place le nouveau comme un fait accompli" (p. 227), comme s'il était
préexistant à la nouveauté de l'être naissant. Viennent immédiatement à l'esprit les
mouvements révolutionnaires et fascistes qui estiment que, pour mettre en place de
nouvelles conditions, il faut commencer par les enfants et par un endoctrinement de
masse. Cette attitude se prolonge dans le fait que celui qui veut véritablement créer
un nouvel ordre politique par le seul moyen de l'éducation, c'est à dire en ne faisant
appel ni à la force, ni à la contrainte, ni à la persuasion, doit se rallier à une
conclusion immédiate : bannir tous les vieux du nouvel ordre! Or le propre de la
condition humaine, nous dit Arendt, est que chaque génération nouvelle grandisse à
l'intérieur d'un monde déjà ancien, et par suite, former une génération nouvelle pour
un monde nouveau traduit le désir de refuser aux nouveaux arrivants leurs chances
d'innover. L'exemple américain refuse cette acception, mais le fait que les écoles n'y
servent pas seulement à américaniser les enfants mais affectent aussi leurs parents
et contribuent à se défaire de l'ancien pour entrer dans le nouveau entretient l'illusion
fallacieuse que grâce à l'éducation des enfants, un monde nouveau est en train de
s'édifier…
Pour Hannah Arendt, l'acuité des problèmes d'éducation aux États-Unis n'est pas dû
à ce que ce pays jeune n'a pas encore rattrapé le monde ancien, mais au contraire à
ce qu'il est en ce domaine le plus avancé. Encore une fois visionnaire, la philosophe
écrit-elle que "la crise de l'éducation en Amérique annonce la faillite des méthodes
modernes d'éducation." Ces mêmes méthodes seront utilisées en Europe une
quinzaine d'années plus tard avec l'effet néfaste que l'on sait.
Revenons à présent aux trois idées de bases qui permettent d'expliquer la genèse
de cette crise. La première de ces idées, nous l'avons dit, est qu'il existe un monde
de l'enfant, une sorte de présociété dans laquelle les adultes n'ont aucun rôle à jouer
sinon d'être des spectateurs d'un groupe qui détient lui-même l'autorité. Cette réalité
a un double impact : il isole l'adulte face à l'enfant pris individuellement et privé de
contact avec lui, et il isole l'enfant dans un groupe tyrannique, car "l'autorité d'un
groupe, fût-ce un groupe d'enfants, est toujours beaucoup plus tyrannique que celle
d'un individu, si sévère soit-il." (p. 233) L'enfant est alors affranchi de l'autorité des
adultes à laquelle se substitue la tyrannie de la majorité. Cette solitude de l'enfant vis
à vis des adultes et des autres enfants le pousse alors au conformisme béat, à la
délinquance juvénile, et souvent à un mélange des deux.
La deuxième idée a trait à l'enseignement. Le professeur est alors de plus en plus
souvent désigné comme celui qui est capable d'enseigner… quoi que ce soit. La
perte de légitimité qui y est associée pousse la professeur non autoritaire - qui ne
veut pas user de moyens coercitifs -, comptant sur l'autorité que lui confère sa
compétence, à ne plus exister.
Enfin la troisième idée de base est que l'on ne peut savoir et comprendre que ce que
l'on a fait soi-même. On substitue dès lors le faire à l'apprendre. Cette attitude
pousse délibérément l'enfant à conserver un niveau infantile. L'habitude du travail,
devant préparer l'enfant au monde des adultes, à laquelle s'est substituée celle de
jouer, est supprimée au profit de l'autonomie du monde de l'enfance.
Ces idées trompeuses selon Arendt, détournent l'éducation de sa vraie fin, qui n'est
ni de célébrer, ni d'amuser l'enfant, mais de l'extraire de l'agitation de la société pour
le mettre en présence d'un héritage et de lui assurer les conditions de l'accueil de cet

héritage. Ainsi, c'est pour préserver ce qui est neuf et révolutionnaire dans l'enfant
que l'éducation doit être conservatrice.
Mais de quel conservatisme parlons-nous? Remettons dans le contexte la position
des philosophes face à ce que l'on conçoit désormais comme une véritable
pathologie et resituons-le dans le cheminement d'Hannah Arendt. Le rejet du
conservatisme, comme l'a rappelé Finkielkraut est assez récent, même si le débat
entre les "conservateurs" et les "progressistes" remonte à la fin du 18ème siècle. En
1790, l'idée propagée par les révolutionnaires français qu'il existât un être abstrait,
titulaire de droits universels, choquait Burke, qui craignait que l'engouement pour les
idées abstraites et le changement radical ne mette la société en danger. À
l'universalisme des droits de l'homme, il opposait l'héritage du temps et de la tradition,
qui confère aux hommes consistance et sagesse. Thomas Paine donna la réplique à
Burke en 1791, avec son essai Les droits de l'homme. Pas question, protesta Paine,
que la démocratie appartienne aux morts. Chaque nouvelle génération possède le
droit inaliénable de refaire la société qui l'a vu naître, aucun héritage intangible ne
saurait prévaloir sur sa volonté.
Les dangers d'un humanisme abstrait alarmèrent d'autres que Burke. Joseph de
Maistre avoua n'avoir jamais rencontré d'Homme de sa vie - s'il existe, c'est bien à
mon insu, dit-il - bien qu'il ait connu des Français, des Allemands, des Anglais, des
Russes et des Persans. Des conservateurs comme Burke et de Maistre tentèrent
d'établir que les hommes ne pouvaient être arrachés à leur monde - fait de coutumes,
de traditions et d'appartenances - pour être réduits à une chimère vide de sens -
l'individu, pur être social.
Si le conservatisme naquit en réaction à la Révolution française, c'est au XXe siècle
que les inquiétudes des conservateurs se réalisèrent comme de malheureuses
prophéties. Selon Finkielkraut, Hannah Arendt, poussée à l'exil par le régime nazi,
approfondit la condition de l'homme moderne à travers sa propre expérience
d'apatride, dont elle sortit par son immigration aux États-Unis. Dans cette querelle,
Arendt prit parti pour les conservateurs. Or, chez Arendt, le conservatisme n'a rien à
voir avec la méfiance viscérale des traditionalistes à l'égard du changement. En
politique, rappelle-t-elle, "cette attitude conservatrice […] ne peut mener qu'à la
destruction" (p. 246). C'est une inquiétude pour ce qui existe, un sentiment aigu pour
la stabilité du monde, un monde qui devrait se soucier de son héritage.
L'impérialisme européen du 19ème siècle et le totalitarisme de l'Allemagne nazie et
du communisme stalinien révélèrent sans doute à Hannah Arendt toute l'ampleur de
la réduction infligée aux hommes pris dans l'engrenage de la guerre et des luttes
idéologiques : ramené à sa plus simple expression, l'homme n'est rien. Là réside
probablement la triste originalité du XXe siècle. Il a créé l'Homme, pur échantillon
d'une espèce, élément interchangeable privé de toute attache, qui peut être sacrifié
sans limite à une grande cause. Une formule du credo totalitaire fut prononcée par
les Khmers rouges du Cambodge: "perdre n'est pas une perte, conserver n'est
d'aucune utilité". Le grand sacrifice des hommes à l'Homme, les morts et même les
survivants des camps de concentration en furent les victimes immolées, de même
que les réfugiés, les apatrides et les déportés que les guerres ont produits en
millions d'exemplaires considérés comme une quantité négligeable. Quelle leçon tirer
de ces sacrifices perpétrés par des régimes vouant tant d'hommes à l'inutilité? Pour
Arendt, la liberté échappe au déraciné, le déshérité ne peut accéder à la vie
humaine; il lui faut pour cela un point d'ancrage, une citoyenneté, une appartenance,
bref un monde nourricier qui dans l'esprit d'Arendt commence par être une patrie.
 6
6
 7
7
1
/
7
100%